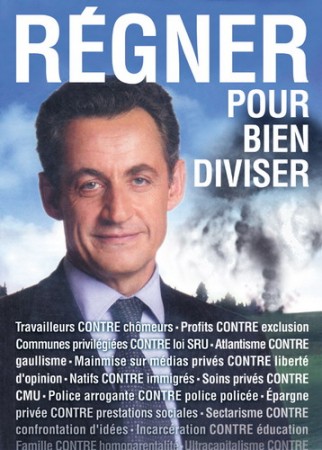
Élection présidentielle
Les batailles de demain
Avec Royal ou Sarkozy au pouvoir, bien que dans des contextes
différents, il faudra se battre demain pour défendre les intérêts des
classes populaires contre la politique libérale du gouvernement. Quelles
sont les brèches ? Quels sont les points d’appui ?
À quoi peut-on s’attendre ? À quelles attaques seront soumises les
classes populaires après le 6 mai ? À l’heure où nous écrivons ces
lignes, le résultat du second tour de la présidentielle n’est pas encore
connu. Mais déjà on connaît le programme des deux adversaires en lice
pour l’Élysée.
Ce sont des programmes établis depuis longtemps, moins dans les paroles
que dans les faits. Que l’on se souvienne de la campagne sécuritaire de
Jospin-Chirac en 2002, du “programme commun” PS-UMP arrêté au Conseil
européen de Barcelone en mars 2002 pour la casse des retraites, puis en
faveur de l’ultralibéral Traité constitutionnel européen en 2005. Que
l’on se souvienne de ces programmes “en actes” qui ont montré tant de
similitudes sur des sujets brûlants pour les travailleuses et les
travailleurs.
C’est à l’aune de ce programme réel, et non à celui des effets d’annonce
accumulés en quelques semaines de battage électoral, qu’on peut fonder
des pronostics sur le comportement du futur gouvernement, et sur la
stratégie à lui opposer.
L’hypothèse Sarkozy, ou le berlusconisme à la française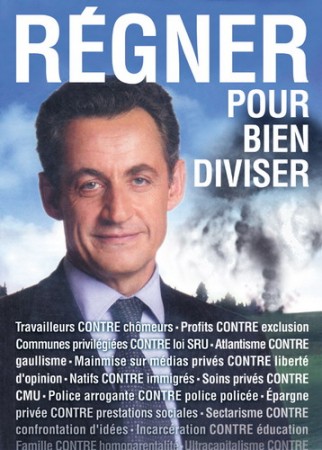
Si Sarkozy l’emporte, ce sera un véritable défi pour les travailleurs et
les travailleuses, les classes populaires, les mouvements sociaux et
syndicaux. Sa politique reposera sur deux chantiers, déjà lancés mais
qui connaîtront là un second souffle : – d’une part la poursuite de la
démolition sociale : dépassement de la notion de CDI/CDD pour établir un
“contrat unique” inspiré du Contrat nouvelles embauches/CNE, poursuite
du démantèlement des retraites et de l’assurance-maladie, droitisation
de la loi Aubry sur l’ARTT (Aménagement et réduction du temps de
travail) ; – d’autre part le renforcement autoritaire de la république
(durcissement sécuritaire, présidentialisation accrue du régime) et le
contrôle renforcé des pôles de contestation potentiels (restrictions du
droit de grève et la domestication des syndicats).
Fait non négligeable, cette politique sera menée avec l’appui d’une
véritable machine de guerre médiatique. Certes, les grands médias ont
toujours encouragé les contre-réformes libérales. Mais le degré atteint
par Nicolas Sarkozy dans la domestication de la presse, faite
d’intelligence avec ses dirigeants et d’intimidation envers les
journalistes, lui confèrera une force de frappe idéologique digne d’un
Berlusconi. Sarkozy, ce sera aussi l’ambition thatchérienne de briser
les reins du syndicalisme contestataire qui, seul, est en mesure de
s’opposer à lui – le PS, quand il ne partage pas les projets de l’UMP,
étant cantonné à une inoffensive opposition parlementaire. Ces deux
chantiers – démolition sociale et domestication du mouvement syndical –
pourront être menés alternativement ou de front, l’un nourrissant
l’autre.
Sur le chantier de la domestication des syndicats, et notamment la
limitation du droit de grève, il sera ardu de s’affronter au
gouvernement. La majorité du salariat risque de se sentir étrangère à ce
combat. Pour réussir, Sarkozy pourrait s’inspirer du modèle italien et
concéder certains avantages matériels aux bureaucraties syndicales pour
obtenir leur assentiment. Un tel scénario pourrait recueillir, comme en
Italie ou en Grande-Bretagne, l’approbation du PS bien sûr, mais aussi
et surtout des directions CFDT, CFTC, Unsa et CGC. Reste à savoir quelle
serait l’attitude des directions FO et CGT, généralement attentistes, et
la marge de manœuvre de Solidaires dans ce contexte.
Les directions CGT et FO peuvent résister à la tentation de “trouver un
compromis” sur le droit de grève, si une montée de la conflictualité
sociale le leur interdit, et que la perspective d’une réduction du
“droit de contester” apparait inadmissible aux syndiqué-e-s et aux
salarié-e-s conscientisé-e-s.
Reste à trouver le terrain social sur lequel affronter le gouvernement.
Il est possible que le centre de gravité des conflits sociaux se déplace
quelque peu. Dans la mesure où il ne reste plus grand-chose à
privatiser, et où la casse de la Sécurité sociale a été bien avancée
sous Raffarin, ce n’est peut-être pas sur ce terrain que se joueront les
grandes déflagrations sociales de demain.
Le “contrat unique” sera sans doute LA grande bataille du quinquennat,
dans la continuité du CPE. Sarkozy sait qu’il doit éviter à tout prix un
tel scénario. Il faut voir comment.
Des conflits peuvent également éclater de façon éparse, dans les
entreprises, sur des problématiques plus traditionnelles (salaires,
précarité). La question du pouvoir d’achat est en train de revenir avec
force sur le devant de la scène, tant la paupérisation relative des
classes salariées devient sensible.
À tout cela il faut ajouter la montée d’un climat de “haine de
l’autorité et de la police”, avec des affrontements sporadiques, dont on
a pu voir les prémices durant la campagne électorale, à la gare du Nord
à paris, par exemple.
Les motifs d’explosion ne manqueront donc pas. Restera à faire le lien
entre les mécontentements. Notre atout principal sera la haine
anti-Sarkozy qui est en passe de supplanter, dans une partie de la
population, la haine anti-Le Pen qui était un classique depuis 1995.
Sans qualifier l’État à venir de “fasciste”, le quinquennat de Sarkozy
sera probablement difficile pour les militant-e-s. Il sera nécessaire de
se serrer les coudes pour maintenir de simples réflexes de luttes
collectives, en arrachant des victoires sur des petites luttes, qui
redonnent espoir. Mais de telles petites victoires ne pèseront pas grand
chose si elles sont noyées dans une défaite sur une bataille plus
importante, comme le droit de grève ou le contrat unique.
L’hypothèse Royal, ou la glaciation sociale-libérale
Si le PS l’emporte, le gouvernement poursuivra, pour l’essentiel, la
politique menée par Raffarin et Villepin. Sur l’essentiel des sujets,
ils sont en accord, depuis les privatisations et la casse des retraites
jusqu’à la politique sécuritaire et de fermeture des frontières. Il va
de soi que jamais le PS ne reviendra sur la réforme Fillon des
retraites, ni sur la casse de l’assurance-maladie. Durant la campagne,
il n’a d’ailleurs pas vraiment tenté de mentir à ce sujet.
Seules avancées éventuelles : une loi-cadre contre les violences faites
aux femmes (mais sans doute débarrassé du volet “service public” et
réduit à un binôme éducation/répression) et la suppression du CNE,
rendue obligée par le mouvement anti-CPE du printemps 2006. Plus
plausible, pour ne pas entrer en conflit avec le patronat, ce serait
plutôt la transformation du CNE en un nouveau contrat précaire que le PS
inventerait pour l’occasion.
Avec Royal au pouvoir, le danger ne serait pas, comme avec Sarkozy,
celui d’une épreuve de force dont on pourrait sortir vaincu-e-s. Ce
serait l’absence d’une épreuve de force, par démobilisation des
mouvements sociaux, du fait que “la gauche est au pouvoir”. Un phénomène
classique s’il en est. Cette fois le chantage pourrait être d’autant
plus fort que Sarkozy serait en embuscade dans l’opposition, et que la
crainte existerait dans les mouvements sociaux de fragiliser le
gouvernement en allant à l’offensive. À titre d’exemple, on pourrait
craindre la démobilisation d’une partie des soutiens au mouvement des
sans-papiers, endormie par une loi de régularisation partielle – tandis
que le PS assumerait totalement le Ceseda version Sarkozy. Le maintien
de la fermeture des frontières continuerait de jeter des dizaines de
milliers de travailleuses et de travailleurs immigré-e-s dans la
clandestinité. Et, tels les Danaïdes, les socialistes continueront à
remplir les charters à coup de matraques.
Si l’anesthésie du mouvement social est un risque, on peut aussi
envisager, comme le précédent gouvernement de gauche plurielle l’a
montré, qu’il y ait malgré tout du répondant et des luttes. C’est encore
plus probable si Ségolène Royal tente de faire passer des projets tels
que le “contrat première chance”, parodie de CPE version PS.
Que penser de la forte participation au scrutin ?
Le taux d’abstention au premier tour a été un des plus bas qu’a connu la
Ve République : 16,23 % contre 28,4 % en 2002. Dans certains quartiers
populaires, la mobilisation a été forte. Dans certains endroits, on a vu
des groupes de gens aller voter en groupe, drapeaux tricolores au vent,
manifestement contre Nicolas Sarkozy. Évidemment, même si ce n’est pas
la révolution, cela dénote un phénomène de politisation intéressant.
Cela signifie-t-il que l’État républicain a résolu la crise de
légitimité et de représentation qui le mine depuis longtemps ?
Nullement. Au contraire, il y a de fortes chances qu’après cet épisode,
la désillusion sur l’utilité du vote soit à la mesure des espoirs un peu
naïfs suscités, et que l’abstention atteigne de nouveau des sommets, en
tout cas dans les classes populaires. La société continue d’être régie
par le marché, pas par les élections, et là réside le nœud du discrédit
des institutions républicaines.
L’extrême droite est-elle en recul ?
Avec 10,51 % des voix, Jean-Marie Le Pen rate sa sortie ! C’est le plus
mauvais score du leader frontiste depuis sa percée en 1988 à 14,38 % –
notons d’ailleurs que, pour la première fois, les sondages avaient
surévalué son score. La stratégie “moderniste” de Marine Le Pen, qui
avait beaucoup contribué à retravailler l’image de son père, a
visiblement dérouté l’électorat d’extrême droite. Pour le FN, il est
encore un peu tôt pour tendre la main aux gens issus de l’immigration
arabe. Il faut donc s’attendre à un retour aux fondamentaux du racisme
petit-blanc sur fond de guerre de succession entre Marine Le Pen et
Bruno Gollnish.
Cependant, même si le FN a perdu un million de voix entre 2002 et 2007,
il va de soi que l’extrême droite, en elle-même, n’est pas en recul.
Elle a simplement été pour partie captée par Nicolas Sarkozy qui a su
montrer ce que le mot “décomplexée” signifiait pour la droite.
Cette configuration nouvelle, si elle se confirme à l’avenir, va en tout
cas poser des questions de refondation stratégique aux antifascistes, le
rejet du Front national ayant structuré, depuis 15 ans, l’essentiel des
mobilisations antifascistes, notamment dans la jeunesse.
Que sortira-t-il du tassement de la “gauche de la gauche” ?
La “gauche de la gauche” – si l’on y inclut le PCF, la LCR, LO,
Schivardi et Bové – totalise 9 % des voix, ce qui représente un fort
tassement par rapport aux précédents scrutins (13,81 % en 2002, 13,94 %
en 1995). Sur cet espace réduit, Olivier Besancenot se taille la part du
lion.
Avec 1,94 % des voix, le PCF fait le plus mauvais score depuis sa
fondation en 1920. Cela peut permettre à Robert Hue (3,37 % en 2002)
d’opérer un retour et de se faire le promoteur d’une accélération de la
social-démocratisation du PCF. La direction Buffet, qui a joué
alternativement, et parfois en même temps, sur les orthodoxes et les
refondateurs, est indéniablement affaiblie. Elle pourra toutefois
pointer l’échec du courant refondateur qui, pour la première fois dans
l’histoire du PCF, a été jusqu’à soutenir un candidat concurrent.
À moins d’un miracle, les législatives devraient à présent amener la
disparition du groupe parlementaire du PCF (s’il passe en dessous de 20
députés). Tant que le PCF conservait un groupe parlementaire, il pouvait
gérer sa crise en s’alliant avec le PS. Sans groupe parlementaire, le
PCF perd son dernier motif d’unité, et les risques de scission voire
d’explosion deviennent très sérieux. D’ores et déjà certains
refondateurs y songent sérieusement. La mise en vente du siège du parti,
place du Colonel-Fabien à Paris, et la liquidation de L’Humanité, sont
les deux autres cataclysmes symboliques qui lui pendent au nez.
Cependant, si scission il doit y avoir, vers quoi pourra-t-elle mener ?
À la fondation d’un nouveau petit parti à la gauche de la gauche,
attrape-tout, sans stratégie claire (donc, par défaut, électoraliste),
du genre de ce qu’avait pu être l’éphémère expérience de la Convention
pour une alternative progressiste (CAP) entre 1994 et 1998.
L’“insurrection électorale” fait pschiiiiit
Las, la désastreuse expérience de la campagne de José Bové condamne,
d’emblée, cette option. L’aventure Bové a démontré, du début à la fin,
comment il ne fallait pas mener campagne. Avec un état-major mexicain
composé de transfuges des différents partis, se tirant dans les pattes
les uns des autres, parfois se détestant cordialement. Un agglomérat de
morceaux d’appareils (LCR, PCF, Alternatifs) et d’“électrons libres”
calamiteux (se disant “libertaires” pour certains). Ce staff, qui
n’avait d’autre cohésion que la personnalité de José Bové – argument
majeur de la campagne, d’où cette inquiétante tendance à la
personnification – a continuellement révisé ses objectifs à mesure que
la campagne piétinait. Alors qu’au début on comparait Bové au président
bolivien Evo Morales, et qu’on espérait faire un score à deux chiffres,
les ambitions se sont rétrécies à vitesse grand V. Dernièrement, dans
les coulisses, les distingués stratèges n’espéraient plus que de petites
choses vraiment infra-politiques : “détruire le PCF” (pour les ex-liguards)
ou “faire chier la Ligue” (pour les autres).
À présent que le naufrage est consommé, on peut être sûr qu’il n’y aura
aucun bilan critique de la part de nos grands stratèges. Chacun va
repartir vivre d’autres aventures : Patrick Braouezec sauver sa
circonscription ; Christophe Aguiton échafauder de nouveaux châteaux en
Espagne ; Michel Onfray s’enivrer de sa propre logorrhée de girouette
parlante, etc.
Pour les nombreuses et nombreux militants qui ont fait la campagne à la
base, avec sincérité, la déconvenue est sévère. Le manque de critique
des institutions et l’erreur consistant à croire au “débouché politique”
des luttes dans les élections se paie au prix fort. C’est, d’une
certaine façon, rassurant. Un certain nombre de personnes ayant
participé à la campagne Bové sont des militantes et des militants des
mouvements sociaux, faisant preuve d’un certain savoir-faire pour
organiser des mobilisations, des grèves, des manifestations. Sur un
terrain institutionnel, ils et elles se sont fait laminer. José Bové
lui-même incarne cet échec : de tribun syndicaliste il est devenu un
politicien nain.
Cela ne veut pas dire qu’il faille renoncer à faire de la politique.
Cela veut simplement dire qu’on ne peut pas faire de politique sans une
analyse claire du capitalisme, de ses institutions, du rôle de la
social-démocratie. La vacuité du slogan emblématique de la campagne Bové,
“l’insurrection électorale contre le libéralisme” démontrait assez
largement la confusion dans les esprits sur la portée possible d’une
campagne électorale.
Le rôle des anticapitalistes
De ce point de vue, la grande perdante de ce scrutin est Lutte ouvrière.
Sa candidate, qui avait été jusqu’à flirter avec les 10 % dans les
sondages en 2002, avait finalement fait 5,72 %. Cette fois, elle fait
1,33 %, le plus mauvais score de sa carrière, et la LCR ramasse la mise.
Dans la tête des dirigeants de cette dernière, c’est la fin (provisoire)
d’un “accident de l’histoire” qui depuis plus de trente ans les
reléguait derrière LO. Cette infidélité de l’électorat d’extrême gauche,
qui ne concerne pas qu’Arlette Laguiller, est une donnée à prendre en
compte. On avait déjà pu le constater avec les échecs électoraux de
l’extrême gauche en 2004, quelques mois après les grèves de mai-juin
2003 : les luttes sociales ne se laissent pas forcément enfermer dans
des urnes. Les électeurs et les électrices sensibles au discours de
l’extrême gauche semblent être justement ceux qui se font le moins
d’illusions sur la portée du vote d’extrême gauche, et peuvent
s’abstenir ou porter leurs votes ailleurs sans état d’âme, de façon
parfaitement utilitariste, en fonction des circonstances. De ce point de
vue, on ne peut qu’être sceptique sur le projet parfois agité par la LCR
de constituer un “parti des luttes” ou un “parti des grèves” pour
transformer la réalité vivante de la lutte des classes en pourcentages
électoraux…
Encore une fois, cela ne signifie pas qu’il ne faille pas articuler les
luttes à un projet politique, anticapitaliste. Au contraire, il le faut,
pour leur donner un sens offensif. Mais ce projet politique n’existe pas
dans le cadre des institutions républicaines. Comme nous le disions plus
haut, avec Royal ou Sarkozy au pouvoir, bien que dans des contextes
différents, il faudra se battre. Impulser des luttes mais refuser les
batailles sans stratégie et autres “journées d’action” morcelées,
refuser toute complaisance à l’égard du Parti socialiste et de ses
satellites, défendre une stratégie autonome du mouvement social,
déconnectée des calendriers politiciens… Les anticapitalistes auront un
rôle à jouer, toutes tendances confondues (communistes libertaires,
trotskistes, anarchistes, communistes déstalinisés, “bovétistes”
désillusionnés ou non…), pour proposer cette orientation offensive au
sein des mouvements sociaux. À ce stade, et avant la coordination
fédérale d’AL le 12 mai, il n’est pas possible de s’avancer davantage en
matière de stratégie politique. Constatons simplement que, comme à
l’accoutumée, la révolution dans les urnes n’a pas eu lieu. La
révolution dans les luttes est déjà plus plausible !
Guillaume
Davranche,
avec Édith Soboul (secrétariat fédéral d’AL),
le 24-04-2007
--------------------------------------------------------------------------------
AL et le 2e tour
Comme nous l’avions annoncé dès janvier, AL n’a donné aucune consigne de
vote pour le 1er tour, pas davantage pour le second, ni pour les
législatives. Nous avons sans détour dit la vérité sur le programme des
uns et des autres, et réaffirmé que la meilleure voie de défense des
intérêts des classes populaires, c’était l’action directe, les luttes
collectives, les mouvements sociaux. Notons qu’une position minoritaire
a été exprimée dans l’organisation par le collectif de Seine-Saint-Denis
: “L’UMP n’est pas le Front national. Sarkozy n’est pas Le Pen. Mais les
rapprochements sont suffisamment flagrants et inquiétants pour que le
barrage à Nicolas Sarkozy devienne indispensable”, ont estimé nos
camarades.