
|
Exigences pour
la validation du cours
Lecture d’une série de textes classiques sur la guerre (en français, anglais, allemand ou italien) Rédaction en français ou en anglais de deux brefs essais, l’un portant sur un texte, l’autre sur un ou plusieurs concepts qui se trouvent dans les textes. Le premier à mi-semestre, le second en fin de semestre. |
|
LECTURES OBLIGATOIRES
|
| Clausewitz, De la
guerre, Livre I, chapitre 1er, « Qu'est-ce que la guerre ?" et
Livre VIII chap. 6, A et B, en allemand http://www.clausewitz.com/readings/VomKriege1832/Book1.htm#1- http://www.clausewitz.com/readings/VomKriege1832/Book8.htm#6 ou trad. de l’allemand, chez Minuit ou Tempus (celle-ci partielle mais suffisante) Constant, Benjamin, « De la liberté chez les Anciens comparée à celle des Modernes » http://www.panarchy.org/constant/liberte.1819.html Hobbes, Léviathan, chapter XIII of the natural condition of mankind as concerning their felicity and misery ; chapter XIV of the first and second natural laws, and of contracts http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan-c.html#CHAPTERXIII http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan-c.html#CHAPTERXIV Ou l'édition du Projet Gutenberg : http://www.gutenberg.org/files/3207/3207-h/3207-h.htm Machiavel, Le Prince, en italien (http://it.wikisource.org/wiki/Il_Principe) ou traduction française par Yves Lévy, Garnier Flammarion, 1980 (la meilleure traduction en français) Marx, La guerre civile en France,1871 en allemand (http://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1871/05/burfrndx.htm) ou traduction française ( http://www.marxists.org/francais/ait/1871/05/km18710530.htm ) Carl Schmitt, La notion du politique, trad. de l'allemand, Calman-Lévy. 1963 Xénophon, Constitution de Sparte, introduction de D. Colas, Gallimard, « Tel », 1996 Supplemental readings Aron, Raymond, Penser la guerre, Gallimard, 2 vol., 1976 Colas, Dominique, Sociologie politique, Puf, 2006, ( spécialement le chapitre « Modes de destruction ») Derrida, Jacques, Politique de l’amitié, GalilIée, 1994 Foucault, Michel, « Il faut défendre la société », Cours au Collège de France, 1976, Gallimard, 1997 - Sécurité,Territoire, Population, Cours au Collège de France, 1977-1978, Gallimard, 2004 Girard, René, Achever Clausewitz, Champs, Flammarion, 2011 Weber, Max, La politique comme vocation, (http://de.wikisource.org/wiki/Politik_als_Beruf ) in Le Savant et le Politique, trad. de Freund, préface de R. Aron, 10/18. |
| Pourquoi
l’importance accordée au marxisme ? Doctrine officielle de
l’URSS et de la Chine communiste et a pénétré les
mouvements nationaux du tiers monde. Combinaison marxisme et
nationalisme en URSS et Chine. |
|
Concepts à
construire (et déconstruire)
|
| Guerre/politique Guerre/paix Guerre étrangère/guerre civile Polemos/stasis (guerre, guerre intestine) Ami/ennemi, Amitié/inimitié/hostilité Guerre symétrique/guerre asymétrique Conflit/compétition/concurrence/duel Crime de guerre/crime contre l’humanité/Génocide stratégie/tactique Territoire, frontière, population Etat, nation, société civile |
| Martin, Philippe & Mayer, Thierry
& Thoenig, Mathias, 2005. "Make Trade not War?," CEPR Discussion
Papers 5218, C.E.P.R. Discussion Papers. Abstract: This paper analyses theoretically and empirically the relationship between military conflicts and trade. We show that the conventional wisdom that trade promotes peace is only partially true even in a model where trade is economically beneficial, military conflicts reduce trade, and leaders are rational. When war can occur because of the presence of asymmetric information, the probability of escalation is lower for countries that trade more bilaterally because of the opportunity cost associated with the loss of trade gains. However, countries more open to global trade have a higher probability of war because multilateral trade openness decreases bilateral dependence to any given country and the cost of a bilateral conflict. We test our predictions on a large data set of military conflicts on the 1950-2000 period. Using different strategies to solve the endogeneity issues, including instrumental variables, we find robust evidence for the contrasting effects of bilateral and multilateral trade openness. For proximate countries, we find that trade has had a surprisingly large effect on their probability of military conflict. |
| Constant : la guerre
inévitable dans l'antiquité |
| « Les peuples
guerriers de l'antiquité devaient pour la plupart à leur
situation leur esprit belliqueux. Divisés en petites peuplades,
ils se disputaient à main armée un territoire
resserré. Poussés par la nécessité les uns
contre les autres, ils se combattaient ou se menaçaient sans
cesse. Ceux qui ne voulaient pas être conquérants ne
pouvaient néanmoins déposer le glaive sous peine
d'être conquis. Tous achetaient leur sûreté, leur
indépendance, leur existence entière au prix de la
guerre. » Benjamin Constant, DE L'ESPRIT DE CONQUÊTE, chap. 2 |
| Le rôle du commerce dans l'accumulation du capital : Marx, Le Capital, Livre I, Huitième section : l'accumulation primitive, chap. XXXI, "La génèse du capitalisme industriel" (extraits) (1867) |
| La découverte des
contrées aurifères et
argentifères de l'Amérique, la réduction des
indigènes en esclavage, leur enfouissement dans les mines ou
leur extermination, les commencements de conquête et de pillage
aux Indes orientales, la transformation de l'Afrique en une sorte de
garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires, voilà les
procédés idylliques d'accumulation primitive qui
signalent l'ère capitaliste à son aurore. Aussitôt
après, éclate la guerre mercantile; elle a le globe
entier pour théâtre. S'ouvrant par la révolte de la
Hollande contre l'Espagne, elle prend des proportions gigantesques dans
la croisade de l'Angleterre contre la Révolution
française et se prolonge, jusqu'à nos jours, en
expéditions de pirates, comme les fameuses guerres d'opium
contre la Chine. Les différentes méthodes d'accumulation primitive que l'ère capitaliste fait éclore se partagent d'abord, par ordre plus ou moins chronologique, le Portugal, l'Espagne, la Hollande, la France et l'Angleterre, jusqu'à ce que celle-ci les combine toutes, au dernier tiers du XVII° siècle, dans un ensemble systématique, embrassant à la fois le régime colonial, le crédit public, la finance moderne et le système protectionniste. Quelques-unes de ces méthodes reposent sur l'emploi de la force brutale, mais toutes sans exception exploitent le pouvoir de l'État, la force concentrée et organisée de la société, afin de précipiter violemment le passage de l'ordre économique féodal à l'ordre économique capitaliste et d'abréger les phases de transition. Et, en effet, la force est l'accoucheuse de toute vieille société en travail. La force est un agent économique. [....] Le régime colonial donna un grand essor à la navigation et au commerce. Il enfanta les sociétés mercantiles, dotées par les gouvernements de monopoles et de privilèges et servant de puissants leviers à la concentration des capitaux. Il assurait des débouchés aux manufactures naissantes, dont la facilité d'accumulation redoubla, grâce au monopole du marché colonial. Les trésors directement extorqués hors de l'Europe par le travail forcé des indigènes réduits en esclavage, par la concussion, le pillage et le meurtre refluaient à la mère patrie pour y fonctionner comme capital. La vraie initiatrice du régime colonial, la Hollande, avait déjà, en 1648, atteint l'apogée de sa grandeur. Elle était en possession presque exclusive du commerce des Indes orientales et des communications entre le sud-ouest et le nord-est de l'Europe. Ses pêcheries, sa marine, ses manufactures dépassaient celles des autres pays. Les capitaux de la République étaient peut-être plus importants que tous ceux du reste de l'Europe pris ensemble. De nos jours, la suprématie industrielle implique la suprématie commerciale, mais à l'époque manufacturière proprement dite, c'est la suprématie commerciale qui donne la suprématie industrielle. De là le rôle prépondérant que joua alors le régime colonial. Il fut « le dieu étranger » qui se place sur l'autel, à coté des vieilles idoles de l'Europe; un beau jour il pousse du coude ses camarades, et patatras ! voilà toutes les idoles à bas ! [...] |
| http://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-31.htm |
| L'homme n'est pas un être doux, en besoin d'amour, qui serait tout au plus en mesure de se défendre quand il est attaqué, mais qu'au contraire il compte aussi à juste titre parmi ses aptitudes pulsionnelles une très forte part de penchant à l'agression. En conséquence de quoi, le prochain n'est pas seulement pour lui un aide et un objet sexuel possibles, mais aussi une tentation, celle de satisfaire sur lui son agression, d'exploiter sans dédommagement sa force de travail, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ce qu'il possède, de l'humilier, de lui causer des douleurs, de le martyriser et de le tuer: homo homini lupus ; qui donc, d'après toutes les expériences de la vie et de l'histoire, a le courage de contester cette maxime? Cette cruelle agression attend en règle générale une provocation ou se met au service d'une autre visée dont le but pourrait être atteint aussi par des moyens plus doux. Dans des circonstances qui lui sont favorables, lorsque sont absentes les contre-forces animiques qui d'ordinaire l'inhibent, elle se manifeste d'ailleurs spontanément, dévoilant dans l'homme la bête sauvage, à qui est étrangère l'idée de ménager sa propre espèce. Quiconque se remémore les atrocités de la migration des peuples, des invasions des Huns, de ceux qu'on appelait Mongols sous Gengis Khan et Tamerlan, de la conquête de Jérusalem par les pieux croisés, et même encore les horreurs de la dernière guerre mondiale ne pourra que s'incliner humblement devant la confirmation de cette conception par les faits. |
| Sigmund
Freud, Le Malaise dans la culture,
(1930), trad. P Cotet, R. Lainé et J.
Stute-Cadiot, Éd. PUF, coll. Quadrige, 3` éd.
corrigée, 1998, pp.
53-54. |
| "Totalitarisme" entrée dans
Colas, Dictionnaire de la
pensée politique, Larousse
(légèrement modifié) |
| Totalitarisme, forme
spécifique de domination qui vise à
l'hégémonie idéologique, sociale et politique d'un
parti unique et qui s'emploie à épurer la société d'éléments considérés comme nuisibles. La distinction entre totalitarisme et fascisme, totalitarisme et régime autoritaire comme la pertinence même de la notion font l'objet de vifs débats . Ency. La notion de régime totalitaires a été forgée et a connu un large essor en raison de la novation que seraient certains régimes nés au XXe siècle, essentiellement le communisme stalinien et le nationalisme hitlerien, par rapport à tous les autres régimes politiques antérieurs. Le totalitarisme est pensé comme autre chose que le despotisme, la tyrannie ou la dictature, non en raison d'une différence de degré mais de nature. Il faut, à la fois, suivre l'itinéraire du mot, et les variations du concept. Au printemps 1923, alors que, sous la direction de Mussolini, la mise sur pied de la dictature fasciste s'accentue en Italie, des libéraux font entendre leur condamnation du régime qui s'installe. Entre autres Giovanni Amandola dans son journal Il Mondo. Dans un article du 12 mai 1923, "Majorité et minorité" Amendola fait référence au "système totalitaire" (sistema totolitario) crée par les éléctions municipales où se manifestent chez les fascistes le désir d'un triomphe sans partage : partout les deux listes en concurrence aux éléctions sont contrôlées par les fascistes, ce qui leur assure donc une victoire absolue. C'est la première occurence connue du terme "totalitaire". En novembre 1923, à l'occasion de l'anniversaire de la marche sur Rome, Amendola affirme que "pour les historiens futurs, la caractéristique la plus importante du mouvement fasciste sera son esprit "totalitaire"" . Il est victime du manganello, la bastonnade, une des formes, avec l'ingestion forcée d'huile de ricin des brutalités des fascistes, qui n'hésitent pas à tuer dans des affrontements de rue. Dans la même période Don Luigi Sturzo, le leader du parti populaire libéral, utilise lui aussi la notion pour critiquer le fascisme. Une nouvelle loi électorale pour le parlement est mitonnée : elle prévoit que la liste ayant obtenu au moins 25% des voix aura les deux tiers des sièges. Cette loi est adoptée à l'automne. Le 15 janvier 1924, le journal La Rivoluzione liberale publie les bonnes feulles d'un livre de Sturzo où on lit que "la vision fasciste du monde, va dans le sens d'une transformation totalitaire de toute force morale, culturelle, politique ou religieuse". Le 25 janvier dissolution de la chambre et nouvelles élections annoncées pour avril. Les fascistes préparent une liste nationale où se trouveront aussi des non-fascistes : le Listone. Pour qualifier la loi éléctorale, préparée par le fasciste Giacomo Acerbo, Amendola parle, une nouvelle fois, de l'"esprit totalitaire" du fascisme, et on trouve la même formule sous d'autres plumes pour qualifier ces élections qui ne peuvent que laminer l'opposition comme l'avait fait les éléctions municipales, qui ont été leur ban d'essai. De fait, la listone obtient 65% des suffrages et à eux seuls les fascistes ont la majorité absolue. En mai 1924 Il Popolo, organe de la gauche du Parti populaire parle "d'éléctions totalitaires" et de l'"âme totalitaire" du fascisme. Le socialiste Matteoti est assassiné en juin1924 et l'opposition quitte le parlement, : empruntant à l'Antique Rome et à la sécession de la plèbe, on dira qu'elle se réfugie sur l'Aventin. Un ancien collaborateur de Mussolini, Rossi, accuse le leader fasciste d'avoir crée un équivalent de la Tchéka communiste, dans un texte qu'Il Mondo publie fin 1924. Début 1925, vague de terreur fasciste légale et illégale. Fermeture de journaux, interdiction de groupes d'opposition. Bandes armées. Violences. Le 21 juin 1925, Mussolini, lui même, dans un discours affirme "notre inflexible volonté totalitaire " ("la nostra feroce voluntà totalitaria"). Parmi bien d'autres Amendola est à nouveau bastonné, le 20 juillet 1925. Il mourra, réfugié en France, à Cannes, en 1926. Et Mussolini, parle du "Stato totalitario" en 1925 comme d'un objectif. Ainsi, comme le montre M-I. Brudny qui a recensé les apparitions initiales de "totalitaire" en Italie, le mot est apparu chez des opposants au fascisme, bientôt victimes de sa violence, avant que le vocable stigmatisant ne soit repris comme un titre de gloire par les fascistes eux-mêmes. Et, fin 1926, visible notamment avec l'OVRA - Organisation de vigilance et de répression de l'anificascisme- on peut dire, en reprennant une formule de P. Milza et S. Bernstein, que Mussolini et les siens établi en Italie "l'odre fasciste totalitaire". Dans les nombreux débats que l'interprétation du fascisme, du nazisme et du commuisme provoqueront certains auteurs distingueront fascisme et nazisme et réserveront à celui-ci et au communisme le terme de totalitarisme. Le communisme chinois ne sera par inclus dans ce groupe par Hannah Arendt, tandis que d'autres analyses considéreront qu'il existe un totalitarisme chinois (Jean-Luc Domenach). Les usages du terme et du concept sont liés à des conditons politiques : en France de Gaulle attaque violement les "totalitaires" dans les années 1950, mais il ne dénonce pas l'URSS pour son totalitarisme, ni même le passé stalinien, quand il revient au pouvoir et en mai 1968 il manifeste lors d'un voyage une grande complaisance à l'égard de la dictature roumaine. C'est que de Gaulle pense d'abord en termes de politiques internationales et considère les régimes politiques comme moins importants que les nations. Le poids des communistes dans la vie politique française et dans certains secteurs de la vie intellectuelle explique que les rapprochements entre nazisme et communisme soient dénoncés violement, souvent avec le rappel de la deuxième guerre, de la Résistance, du rôle des communistes en son sein. Stalingrad devrait faire oublier que Staline et Hitler s'allièrent et que l'un et l'autre étaient à la tête de système où les camps de concentration n'était pas des accidents provisoirs ou des armes nécessaires contre un ennemi, mais des appareils réguliers du pouvoir et des dispositifs destinés à l'épuration de la société. La parution, en 1974, de l'Archipel du Goulag de A. Soljénitsyne donna ainsi lieu à une véhémente campagne du Parti communiste français qui cherchait à accréditer l'idée que la mise en lumière de l'existence du système concentrationnaire soviétique était une calomnie d'extrême droite. Mais avec la perestroïka de Gorbatchev le terme totalitaire allait être repris en URSS par ceux qui entreprirent (et pour certains sans avoir cherché cet objectif) de liquider la dictature de parti unique (dont on a discuté si après la mort de Staline elle était toujours totalitaire, ou post-totalitaire, ou encore d'un autre type). Quand Mussolini s'installe au pouvoir, des camps de concentration pour ennemis du régime ont déja été ouverts en Russie, où Lénine a justifié le recours à la "terreur de masse". Il a forgé la conception d'un dictature de Parti-Etat visant à instaurer une nouvelle société et privilégiant la surveillance et le contrôle ainsi que l'épuration où une police de lutte contre la contre révolution, la Tchéka, dispose de larges prérogatibes. Il pose, lui-même, ce qui est un des aspects fondamentaux de la notion de totalitarisme, l'équivalence des deux grands sytèmes politiques terroristes du XXe siècle en affirmant : "Ou bien la terreur blanche, la terreur bourgeoise, formule américaine, anglaise (Irlande) italenne (fascistes), allemande, hongroise et autres, ou bien la terreur rouge, prolétarienne. Il n'y a pas de milieu" (Œuvres t. 32, 379). Pour les totalitaires la logique est celle d'un partage du monde en deux : ceux qui détiennent la vérité et sont une élite qui doivent détruire tous les autres pour imposer leur règne. Et dans la même période, où le parti marxiste-léniniste impose sa domination en Russie, en Allemagne des nationaux-bolchévisks entendent conduire une révolution populaire et ultra-nationaliste qui ne serait pas détournée de ses objectifs par les Juifs, contrairement à la Révolution russe, comme le proclame Goebbels en 1926. On comprend donc que ce soit des marxistes anti-bolchéviks qui, parmi les premiers, aient dénoncé l'identite du bolchévimse et du fascisme, tel Kautsky qui affirme : "le fascisme n'est que le pendant du bolchevisme, Mussolini est le singe de Lénine" (les Chemins du bolchévisme, p. 122). Plus tard d'autres marxistes, de la tradition conseilliste, dénonceront le "fascisme brun" et le "fascisme rouge" comme équivalents. Ainsi la relation en miroir du nazisme et du communisme soviétique n'est pas, d'abord, posée par des historiens ou des sociologues, mais elle est revendiquée par des fascistes, des nazis, des communistes, ou elle est dénonçée par des acteurs politiques, et spécialement par des sociaux-démocrates. Ceux-ci, cependant oscillent pour des raisons politiques : Léon Blum, en 1936, au moment du Front Populaire, distingue entre les régimes totalitaires (Italie, Allemagne) et la dictature soviétique. Mais la figure majeure de la sociologe française, et militant socialiste, le neveu de Durkheim, Marcel Mauss, qui a refusé, le principe de l'adhésion à l'Internationale communiste au moment du Congrés de Tours en décembre1920, établit, en 1936, un parallèle entre nazisme et communisme soviétique où il leur trouve une identité profonde, sans toutefois employer le terme totalitarisme. Ainsi un des éléments du concept du totalitarisme - l'identité des deux systèmes de domination institutionnalisée par la terreur - a été énoncé bien avant le pacte germano-soviétique et donc, a fortiori, la notion de totalitarisme n'est pas une invention idéologique de la guerre froide, même si celle-ci l'a sans doute durçie, mais elle est bien un stigmate et un concept forgés par les opposants au système de domination totale. En 1940 est publié aux Etats-Unis un numéro spécial de revue sur "L'Etat totalitaire". 1942 voit la publication du Béhémot de Franz Neumann (proche de l'Ecole de Francfort) : le premier chapitre de cette étude sociologique du nazisme s'intitule : "L'Etat totalitaire" . Goebbels déclarait, en 1933 : "notre parti a toujours aspiré à l'Etat totalitaire [...] Le but de la révolution doit être un Etat totalitaire pénétrant toutes les sphères de la vie publique" (p. 62). Neumann s'arrête sur les "techniques de la pensée constitutionnelle anti-démocratique" qui rejettent la théorie de l'"Etat de droit* social" que réclamaient les socialistes et qui comportait un mélange de droits civiques, d'égalité politique et de socialisation de l'industrie où les syndicats joueraient un grand rôle (La lois fondamentale de la République Fédérale allemande en1949, une sorte de manifeste de rupture avec le totalitarisme, la définira comme un Etat de droit, républicain, démocratique et social). Les théoriciens du droit au service du nazisme vont définir l'Etat nazi comme un "nationaler Rechsstaat" (Etat de droit national) au servie du volk (la communauté raciale). Carl Schmitt*, en 1932, devant une association d'industriels, distingua entre la "totalité romaine" et la "totalité germanique", la première est quantitative et intervient dans toutes les sphères de la vie tandis que la totalité germanique, quantitative, se contente d'un Etat fort dans la sphère politique mais laisse les activités économique libres. Et Hitler dans son discours du 23 mars 1933 devant le Reichstage se prononce en faveur de la propriété privée. Ces théorisations et affirmations devaient permettre de se rallier des mileux d'affaires. Selon Neumann la théorie de l'Etat totalitaire avait l'avantage de satisfaire tout le monde, bureaucrates et soldats, mais aussi d'aller dans le sens de la tradition occidentale qui a toujours valorisé l'Etat. Le totalitarisme se traduisit dans des processus d'unificatin et de concentration du pouvoir (comme par exemple l'abolition du statut indépendant des Länder) qui aboutirent à donner au Fürher des pouvoirs très étendus pendant la guerre (édit de janvier 1941), aussi bien exécutifs que législatifs. "La guerre a donc pleinement réalisé l'Etat totalitaire" (Béhémot, p. 71). Mais les exigences du parti n'allaient pas dans le sens d'une hégémonie de l'Etat. Hitler n'accordait que peu de place à l'Etat dans Mein Kampf et au congrès du parti de septembre 1934 il affirma : "l'Etat n'est pas notre maître ; nous sommes les maîtres de l'Etat". Selon Neumann, (qui écrivait en 1941) en Italie le parti était incorporé dans l'Etat, en URSS le parti contrôlait l'Etat et en Allemagne la situation était intermédiaire, ainsi dans le domaine de la police c'est le parti avec les S.S. qui domine l'Etat, alors que dans l'administration de l'armée, c'est l'inverse. "Quatre organes totalitaires", le parti, l'armée, la bureaucratie, l'industrie, "groupes compacts et centralisés" se disputent et passent des compromis entre eux (p.437). Dans une préface à l'édition de 1944, Neumann envisageait la possibilité d'une destruction de tout les vestiges de l'Etat au profit du Mouvement amorphe et informe (p. 15). Si la terreur policière, la violence du régime, sont présents dans son ouvrage, il ne sait pas que les persécutions contre les Juifs obéissaient à une logique de génocide. Le totalitarisme est, pour lui, une forme spécifique de domination où n'existe ni droit ni même peut-être d'Etat. Dans la postface en forme d'hommage que T. W. Adorno rédigea à Béhémot, en 1967, il soulignait comme un des mérites principaux de Neumann d'avoir montré que le "soi disant monolithisme" était en fait une "pluralité" où la "volonté politique se forgeait à travers la concurrence sauvage des lobbies sociaux les plus puissants" (p.597). Bien qu'il ait beaucoup écrit et réfléchit sur les luttes et les conflits en URSS, Trotsky, avait pour sa part plutôt mis l'accent, à la fin de sa vie, sur le pouvoir de l'Un dans l'URSS de Staline. A la fin de son ouvrage sur Staline, qui resta inachevé en raison de son assassinat, en août 1940, il écrivait : ""L'Etat c'est moi" est presque une formule libérale en comparaison avec les réalités du régime totalitaire de Staline. Louis XIV ne s'identifiait qu'avec l'Etat. Les papes de Rome s'identifient avec l'Etat et avec l'Eglise — mais seulement durant les époques du pouvoir temporel. L'Etat totalitaire va bien adelà du césaro-papisme, car il embrasse l'économie entière du pays. A la diffèrence du Roi Soleil, Staline peut dire à bon droit : "La Société, c'est moi."" (Staline, t. 2, p. 338). L'attaque de l'URSS par l'Allemagne nazie, en faisant de Staline et de son régime, un allié des démocraties contre le nazisme, suspendit les analyses sur le totalitarismeen termes d'assimilation du communisme et du nazisme. En 1951 Hanna Arendt publie Les Origines du totalitarisme* qui, bien que très discuté, constitue un ouvrage majeur. Elle participe avec d'autres (dont Karl Deutsch dont la contribution porte sur la possibilité de désintégraton du monolithe totalitaire et renvoie à Béhémot), en 1953, à un séminaire pluridisciplinaire réunissant économistes, juristes, sociologues, historiens, philosophes, où Carl J. Frierdrich propose une caractérisation du syndrome du totalitarisme, qui sera complété ultérieurement par Zbigniew Brezinsky pour aboutir à six facteurs qui doivent se retrouver tous ensemble pour que la notion soit applicable : 1) Une idéologie officielle, comportant un corps doctrinal couvrant tous les aspects de l'existence humaine, auquel tout ceux qui vivent dans la société sont supposés adhérer, au moins passivement ; cette idéologie est organisée autour de thèmes millénaristes qui décrivent la société humaine parfaite. 2) un parti de masse unique rassemblant un pourcentage relativement faible de la population (moins de 10%) d'hommes et de femmes, passionnément et indéfectiblement dévoués à l'idéologie officielle et recherchant à lui assurer une acceptation générale ; ce parti est organisé selon un ordre strictement hiérarchique, selon une forme oligarchique, habituellement avec un chef unique et il est supérieur à l'administration étatique ou il est imbriquée avec elle. 3) Un étroit monopole, techniquement conditionné, et aux mains du parti et de ses cadres subalternes dans l'administration ou les forces armés, du contrôle de tous les moyens effectifs de combat armé. 4) Un étroit monopole, techniquement conditionné, dans les mêmes mains, des moyens de communication de masse. 5) Un contôle centralisé et la direction de toute l'économie par la coordination bureaucratique d'entités jadis indépendantes ; typiquement cette coordination s'étend à beaucoup d'autres associations et activités de groupe. 6) un système de pouvoir policier terroriste dépendant pour son efficacité des points 3 et 4 et s'attaquant non seulement à des "ennemis" manifestes du régime, mais aussi à des groupes arbitrairement désignés de la population, les "ennemis objectifs". Diffèrents théoriciens mettront l'accent sur un aspect ou sur un autre. C'est à l'économie planifiée qu'une fonction causale de la servitude totalitaire est attribuée comme le fait F. Hayek, tandis que Leonard Shapiro, spécialiste de l'histoire politique de la Russie soviétique et notamment de l'élimination des oppositions lors des premières années du régime, insiste sur l'importance du chef dans le régime totalitaire. Le sociologue et philosophe français Claude Lefort en s'appuyant sur Soljénitsyne (et Trotsky) parle d'''Egocratie" et s'intéresse, à rebours, à la démocratie et aux limites de la domination totalitaire. Certains auteurs soulignent la fonction de l'idéologie et, reprennant un mot de C. Milozs, parle d'idéocratie (A. Besançon, qui veut montrer la logique suréelle du régime soviétique), enfin d'autres auteurs soulignent l'importance du système du parti unique et de l'épuration, sans nécessairement utiliser la notion de totalitarisme (D. Colas). Les débats entre spécialistes sont diffèrents quant à l'Allemagne où une querelle forte et complexe s'est développée sur l'"intentionnalité" ou non du génocide des Juifs, et quant à l'URSS où une école dite revisionniste, principalement américaine, née dans les années 1980, entend montrer que le système soviétique comportait de nombreux dysfonctionnements qui interdissent de surévaluer son unité et qui analyse le sytème concentrationnaire plutôt comme dans la perspective d'une sociologie de la politique pénitentiaire que d'une théorisation de son rôle dans le système politique global. Mais, en tout état de cause, le concept est-il encore fondé et pertinent s'il ne sert pas à penser une similarité profonde entre communisme et nazisme ? N'est-il pas, au contraire, judicieux de l'utiliser si l'on souhaite marquer la ressemblance nazisme-communisme plutôt que celle entre fascisme italien et national-socialisme allemand ? Ainsi, en 1985, l'historien du nazisme, K.D. Bracher estimait que le remplacement du "concept de totalitairsme" par celui de fascisme revenait à privilégier l'opposition socialisme-capitalisme par rapport à l'opposition démocratie-dictature et aussi à une "minimisation des conséquences, non seulement du communisme, mais du national-socialisme lui-même" (La Dictature allemande, p.15). Au delà se pose des problèmes éthiques liés au savoir et au désir de vérité : dans certains cas le refus d'utiliser la notion de totalitarisme se présente comme une forme de nihilisme des valeurs aux allures de positivisme méthodologique : ne pas porter le moindre jugement qui pourrait véhiculer une évaluation, se garder de toute appréciation ou dépréciation (sauf l'éloge implicite ou explicite de la discipline universitaire à laquelle on se rattache et la dévalorisation des autres). Mais la notion de totalitarisme a reçu des définitions différentes de celles indiquées plus haut. Ainsi à la suite des théorisations de Lesek Kolakowski la société totalitaire a été conçue comme tendant à la fusion de la société civile et de l'Etat. Cette analyse critique du philosophe polonais (puis anglais) retourne, en quelque sorte, l'appareil conceptuel de Marx contre le socialisme réel. La notion de totalitarisme est quasiment refondée comme une notion qui s'applique d'abord au système communiste et à sa tentative moniste. Ernest Gellner dans le même esprit que Kolakowski auquel il se réfère caractérise le communisme soviétique comme un régime cesaro-papiste-mamoniste (confusion des sphères politique, hiérocratique et économique), qui a voulu édifier une umma * sécularisé est qui a échoué. La transition de certaines des anciennes démocraties populaires vers la démocratie pourrait, en ce sens, s'analyser comme un retour à la conception hégelienne de la société civile que Marx avait entendu renverser et de l'Etat de droit* pour laquelle les idéologues du droit ralliés au nazisme comme Carl Schmitt ou léninistes, tel Pasukanis (Le marxisme et la théorie du droit) avaient le plus grand mépris. La fin du communisme soviétique s'interpréte, sous l'angle de la validation de la notion de totalitarisme, de deux façons contradictoires : puisque le système s'est écroulé cela signifierait qu'il n'était ni monolithique ni tout puissant et donc point totalitaire ; ou au contraire : l'écroulement du système ne ferait nullement apparaître une société civile (du moins au sens d'une société capable d'autorganisation), ce qui montre que, s'il n'avait pas réussi positivement, le Parti-Etat a remporté une victoire négative (absence totale d'une culture civique, mépris pour le droit, primat accordé à la force, et même préparation à l'idéologie du "nettoyage ethnique" par celle de l'épuration de classe). Sous un autre angle encore on pourrait chercher des modèles d'intelligibilité du totalitarisme chez La Boëtie et son Discours de la Servitude volontaire ou dans la "monarchie" telle que la dépeint Spinoza*, dans la préface du Traité théologico-politique, comme une manipulation de la superstition qui obscurcit la "saine raison" au point que "les hommes combattent pour leur servitude, comme s'il s'agissait de leur salut, et pensent non s'avilir, mais s'honorer au plus haut point lorsqu'ils répandent leur sang et sacrifient leur vie pour appuyer les bravades d'un unique individu ". Mais une des spécificités du totalitarisme est l'existence d'un parti unique et pas seulement d'"un unique individu", d'un leader unique, au point du reste que, du moins dans la cas de la Russie léniniste et stalinienne, le dictateur est à comprendre comme un effet de l'appareil de la dictature plutôt que l'inverse. Ainsi l'explication avancée par Khrouchtchev sur le "culte de la personnalité" de Staline, parfois exprimée par d'autres en vocabulaire psychiatrique qui pointe la supposée paranoïa de Staline, oublie que le stalinisme ne fut pas une pathologie du système ou d'un individu mais un de ses registres normaux et un de ses produits. La fréquence du phénomène du culte de la personnalité, dans les pays communistes et dans les partis communistes, même dans des sociétés démocratiques, montrent bien qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène fortuit. On redonnerait dans ce cas une large extension à "totalitaire" en désignant ainsi des partis politiques qui n'exerçaient pas le pouvoir mais où se retrouvaient les mécanismes qui fonctionnaient en grand, et avec le monopole de la violence, dans les dites "démocraties populaires" (qui étaient en fait des dictatures du parti), sans même tenir compte de leur louange adressé à l'URSS et à Staline : le Parti communiste français pourrait être qualifié de "totalitaire". La critique de la bureaucratie communiste, comme groupe tendant à l'hégémonie, a pu donc viser aussi bien les partis communistes au pouvoir à l'Est que dans l'opposition à l'Ouest, notamment quand les seconds applaudissaient à la repression de la révolution hongroise de 1956 par les premiers. Particulièrement actif intellectuellement en ce sens en France, la revue Socialisme ou Barbarie, plus proche de Rosa Luxemburg que du bolchévisme, et du communisme des conseils (qui insistent sur le rôle des soviets dans la révolution russe) que des tenants du "centralisme démocratique", revue animée par Claude Lefort et Cornelius Castoriadis et aussi par J. F. Lyotard. C'est celui-ci qui, ultérieurement, à proposé une définition du totalitarisme qui s'inscrit dans une réflexion sur la modernité (et donc est aussi un aperçu sur la post-modernité*). Selon Lyotard les habitants des pays totalitaires étaient à la fois sujets d'une narration unique, les destinataires de cette narration et les supposés auteurs de cette narration dont ils n'avaient pas le droit de s'écarter (Instructions païennes, 1977). Dans cette perspective le totalitarisme apparait non comme un régime politique mais comme une tentative délibérée (dont l'impossibilité est patente) d'annihilation de toute subjectivité libre et de toute autonomie par rapport à l'instance sociale centrale, le Parti-Etat, où les écarts par rapport à la grande énonciation sont traités comme des parasites à éliminer. Ce type d'interprétation fait du totalitarisme l'accomplissement et la fin de la modernité qui ne peut que laisser place à d'autres formes sociales. Au contraire d'autres courants ont vu dans le totalitarisme un accident dramatique dans la modernité mais qui ne reposait pas sur ses principes et qui traduirait la difficulté de la modernisation politique et économique dans certaines socitétés. Dans les deux cas le totalitarisme apparait bien comme une spécificité politique du XXe siècle, siècle des guerres totales et de la mobilisation générale (totale) de la population pour les gagner sur le front idéologique, économique, militaire dans une volonté de fondation d'un monde nouveau au nom soit de la classe, soit de la race. Biblio. Arch Getty, J., Maning, R. T., Stalinist terror. New perspectives., Cambridge, UP. 1994. Bracher, K. D. La Dictature allemande, Privat, 1986. Besançon, A., Les Origines inetellectuelles du léninisme, Calmann Lévy, 1981. Colas, D., Lénine et le léninisme, PUF, 1982. Dupeux, Louis Le national-bolchevisme dans l'Allemagne de Weimar. Paris. Champion, 1979. Friedrich, C.J., Totalitarianism. Grosset et Dunlap. New York. 1964, Friedrich et Brezinski, Totalitarian dictatorship and Autocraty. Hermet, G., Hassner, P., Totalitarisme. Economica. Kautsky, K. Les Chemins du bolchévisme. (19??)? PUF, 1982. La question du totalitarisme, Communisme. n°47-48, 1996, (spécialement l'article de M.I. Brudny). Kolakowski, L. "The Myth of Human Self-Idenbity : Unity of Civil Society and Political Society in Socialist Thought", in Hampshire et Kolakowski, (ed.) The Socialist Idea. A reappraisal. Londres. 1977. Mauss, M. Ecrits politiques Fayard. 1997. Neumann, F., Béhémot. structure et pratique du national-socialisme, (1941,1944), Payot, 1987. Trotsky, Staline, (1940) UGE, 10/18, 1979 Discours prononcé par Mussolini à l'Augusteo le 21 juin 1925 au Congrès fasciste : http://www.mussolinibenito.it/discorsodel21_06_1925.htm |
| classe ("genos" : lignée, race) |
|
|
|
|
|
| rois- philosophes |
sagesse | tête | raison | bergers | or |
| guerriers | courage | poitrine | colère | chiens | argent |
| producteurs |
tempérance | ventre | désir | troupeau |
bronze fer |
| (Les Lois, Livre XII, 942) traduction Chambry, http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/loisindex.htm#LOIS Texte utilisé par Karl Popper dans la Sociéte ouverte et ses ennemis pour montrer que Platon est l'ancêtre des théoriciens de la "société fermée" |
| "En
ce qui concerne les expéditions militaires, il y aurait, pour
bien faire, bien des conseils à donner et bien des lois à
faire. Mais ce qui importe le plus,
c'est qu'il n'y ait personne, ni
homme ni femme, qui échappe à l'autorité d'un chef
et qui s'accoutume, soit dans les combats sérieux, soit dans les
jeux à agir seul et de son chef, mais que toujours, en paix
comme en guerre, tout le monde ait les yeux sur le chef, le suive et se
laisse gouverner par lui, jusque dans les plus petites choses ;
que,
par exemple, lorsqu'il le commande, on s'arrête, on marche, on
s'exerce, on prenne un bain ou un repas, on s'éveille la nuit
pour monter la garde ou transmettre des ordres : qu'au milieu
même des dangers on ne poursuive personne et qu'on ne recule
devant qui que ce soit que sur un signe des chefs, en un mot qu'on ne
prenne pas l'habitude de faire quoi que ce soit seul, en dehors des
autres, et qu'on ne cherche pas à connaître et qu'on ne
sache absolument rien sans eux, mais qu'on vive tous et toujours,
autant que possible, groupés dans une vie commune. Il n'y a pas
en effet et il n'y aura jamais de meilleur moyen, d'invention, ni d'art
plus efficace pour assurer à l'État le salut et la
victoire à la guerre. C'est à cela que les citoyens
doivent s'exercer dès l'enfance, même en temps de paix ;
il faut qu'ils apprennent à commander et à obéir ;
il faut bannir l'esprit
d'indépendance de toute la vie de tous
les hommes et des animaux soumis aux hommes". (Souligné
par nous) |
| Société close | Société ouverte |
| tyrannie | démocratie |
| holisme |
individualisme |
| tribalisme | confrontation à des décisions personnelles |
| primat de la race, de la nation ou de la classe | primat de l'individu |
| gestion sociale utopique | gestion sociale fragmentaire |
| changement de gouvernement avec effusion de sang | changement de gouvernement sans effusion de sang |
| Fichte, Hegel, Heidegger | Kant, 1789, Russell |
| politisation de la morale | moralisation de la politique |
| nationalisme totalitaire | fraternité humaine |
| La stasis selon
Schmitt
in Théologie politique,
(1969) (postface, p.173-174), trad. de l'allemand par Jean Louis Schlegel, Gallimard, 1988 |
| En
revanche il est nécessaire de revenir encore sur le
critère du politique et de la théologie politique, en
l'occurence à la distinction entra ami et ennemi. (Erik)
Peterson fait une référnce décisive, pour la
doctrine de la Trinité chrétienne, à un passage de
Grégoire
de Nazianze,
qui contient en son noyau la formulaton suivante : l'Un - to hen - est toujours en
révolte - stasiazon -
contre lui même - pros heauton. Au coeur de la fomulation la plus irréprochable de l'épineux dogme (de la Trinité), apparait le mot stasis, au sens de révolte. L'histoire du sens du mot et du concept de stasis mérité d'être évoquée dans ce contexte ; elle s'étend de Platon aux pères et aux docteurs de l'Eglise grecque (...) Stasis signifie en premier lieu repos, état de repos, position, arrêt (status), la notion inverse est kinesis : mouvement. Mais, en second lieu stasis signifie aussi trouble (politique), mouvement, révolte et guerre civile. |
| TRADUCTION EN
ANGLAIS
DEPUIS LE GREC DU TEXTE DE Grégoire de
Nazianze
(329-390) auquel renvoie Erik Peterson cité par Schmitt. (j'ai
souligné le passage qui correspond à ce qui est
cité par Schmitt : cette traduction euphémise ce passage
par rapport au grec) http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf207.iii.xv.html |
II. The three most ancient opinions concerning God are Anarchia, Polyarchia, and Monarchia. The first two are the sport of the children of Hellas, and may they continue to be so. For Anarchy is a thing without order; and the Rule of Many is factious, and thus anarchical, and thus disorderly. For both these tend to the same thing, namely disorder; and this to dissolution, for disorder is the first step to dissolution. But Monarchy is that which we hold in honour. It is, however, a Monarchy that is not limited to one Person, for it is possible for Unity if at variance with itself to come into a condition of plurality; but one which is made of an equality of Nature and a Union of mind, and an identity of motion, and a convergence of its elements to unity—a thing which is impossible to the created nature—so that though numerically distinct there is no severance of Essence. Therefore Unity having from all eternity having from all eternity arrived by motion at Duality, found its rest in Trinity. This is what we mean by Father and Son and Holy Ghost. The Father is the Begetter and the Emitter. without passion of course, and without reference to time, and not in a corporeal manner. The Son is the Begotten, and the Holy Ghost the Emission; for I know not how this could be expressed in terms altogether excluding visible things. For we shall not venture to speak of “an overflow of goodness,” as one of the Greek Philosophers dared to say, as if it were a bowl overflowing, and this in plain words in his Discourse on the First and Second Causes. Let us not ever look on this Generation as involuntary, like some natural overflow, hard to be retained, and by no means befitting our conception of Deity. Therefore let us confine ourselves within our limits, and speak of the Unbegotten and the Begotten and That which proceeds from the Father, as somewhere God the Word Himself saith. |
| Sur le pouvoir comme art à
Florence lire : La Civilisation de
la Renaissance en Italie (1860) de Jacob Burckardt
(1818-1897) dont les
théories ont
influencé Nietzsche (Humain,
trop humain) qui fut son
collègue à Bâle et suivi son cours sur l’histoire. Le texte en français sur Gallica :http://gallica.bnf.fr/Catalogue/noticesInd/FRBNF37261299.htm Gallica (http://gallica.bnf.fr/) est le site la bibliothèque "virtuelle" créé par la Bibliothèque nationale de France. |
|
L’objet du Prince selon Michel Foucault
« Cette
principauté comme rapport du Prince
à ses sujets et à son territoire, c’est cela qu’il s’agit
de protéger, et non pas directement ou immédiatement ou
fondamentalement ou premièrement, le territoire et ses
habitants »
Michel Foucault, Sécurité,
territoire, population, cours au collège de France, 1977-1978.Gallimard,
Seuil 2004
|
|
Capitolo XII Quot sint genera militiae
et de mercennariis militibus.
|
Le Prince - Chapitre 12 Combien il y a de sortes de milices et de troupes mercenaires |
| Avete dunque a intendere come, tosto che in questi ultimi tempi lo imperio cominciò a essere ributtato di Italia, e che il papa nel temporale vi prese più reputazione, si divise la Italia in più stati; perché molte delle città grosse presono l'arme contra a' loro nobili, li quali, prima favoriti dallo imperatore, le tennono oppresse; e la Chiesia le favoriva per darsi reputazione nel temporale; di molte altre e' loro cittadini ne diventorono principi. Onde che, essendo venuta l'Italia quasi che nelle mani della Chiesia e di qualche Repubblica, et essendo quelli preti e quelli altri cittadini usi a non conoscere arme, cominciorono a soldare forestieri. El primo che dette reputazione a questa milizia fu Alberigo da Conio, romagnolo. Dalla disciplina di costui discese, intra li altri, Braccio e Sforza, che ne' loro tempi furono arbitri di Italia. Dopo questi, vennono tutti li altri che fino a' nostri tempi hanno governato queste arme. Et il fine della loro virtù è stato, che Italia è suta corsa da Carlo, predata da Luigi, sforzata da Ferrando e vituperata da' Svizzeri. | Il faut donc savoir que lorsque, dans
les derniers temps, l’empire [germanique] eut commencé à
être repoussé de l’Italie, et que le pape eut acquis plus
de prestige quant au temporel, l'Italie se divisa en un grand
nombre d’États. Plusieurs grandes villes, en effet, prirent
les
armes contre leurs nobles,
qui, à l’ombre de l’autorité
impériale [germanique], les tenaient sous l’oppression, et elles
se rendirent indépendantes, favorisées en cela par
l’Église, qui cherchait à accroître le
prestige temporel qu’elle avait gagné. Dans plusieurs autres
villes, le pouvoir suprême fut usurpé ou obtenu par
quelque citoyen qui s’y établit prince. De là s’ensuivit
que la plus grande partie de l’Italie se trouva sous la
dépendance, et en quelque sorte sous la domination de
l’Église ou de quelque république ; et comme des
prêtres, des citoyens paisibles, ne connaissaient nullement le
maniement des armes, on commença à prendre en solde des
étrangers. Le premier qui mit ce genre de milice en honneur fut
Alberigo da Conio, natif de la Romagne : c’est sous sa discipline que
se formèrent, entre autres, Braccio et Sforza, qui furent, de
leur temps, les arbitres de l’Italie, et après lesquels ou a eu
successivement tous ceux qui, jusqu’à nos jours, ont tenu dans
leurs mains le commandement de ses armées. Et le résultat
de leur valeur a a été de voir prise à et que
l'Italie a été envahie par Charles VIII [de
France], ravagée par Louis XII [de France], violée par
Ferdinand [d'Espagne], et insultée par les Suisses. |
| T |
|
Chapitre XIV
Ce qui convient au prince en
matière militaire
|
Capitolo
XIV Quello che s'appartenga a uno principe circa la milizia Quod principem deceat circa militiam. |
| 1. Donc un prince ne doit pas avoir
d'autre objet ni d'autre pensée, ni prendre quoique ce soir pour
son art, en dehors de la guerre et des institituons et de la discipline
de celle-ci, car c'est le seul art qu'on attend de qui commande. Et il
a une telle vertu (virtù)
que non seulement il maintient ceux qui sont nés prince, mais
souvent il fait monter au rang de prince des hommes de condition
(fortuna) privée ; et
inversemenent on voit que quand des hommes
ont plus penser aux plaisirs qu'aux armes, ils ont perdu leur Etat. Et
la première cause qui te le fait perdre et de négliger
cet art, et la raison qui te le fait acquérir est d'être
un expert de cet art. |
1. - Debbe adunque uno principe non avere altro obietto né altro pensiero, né prendere cosa alcuna per sua arte, fuora della guerra et ordini e disciplina di essa; perché quella è sola arte che si espetta a chi comanda. Et è di tanta virtù, che non solamente mantiene quelli che sono nati principi, ma molte volte fa li uomini di privata fortuna salire a quel grado; e per avverso si vede che, quando e principi hanno pensato più alle delicatezze che alle arme, hanno perso lo stato loro. E la prima cagione che ti fa perdere quello, è negligere questa arte; e la cagione che te lo fa acquistare, è lo essere professo di questa arte. http://www.classicitaliani.it/machiav/mac09.htm#cap14 |
I LE
PRINCE, un
manuel dont l'objet est la
relation
de domination
" m'en
tenir à la
vérité effective des choses" (chap.XV)
A) Le
Prince pose un problème spécifique : la
conservation du pouvoir dans
un Etat (stato) pour un
souverain
non héréditaire. Comment
"tenir (tenere) un Etat nouvellement
conquis" (début
du chap. IV) ?
Il faut au
Prince arriver à "conserver un Etat stable et ferme" (conservare uno stato che sia già
stabilito
e fermo) (dernière ligne du chap. XX)
a) l'Etat est à la fois
territoire et pouvoir
| Conviene avere, nello esaminare le qualità di questi principati, un'altra considerazione: cioè, se uno principe ha tanto stato che possa, bisognando, per sé medesimo reggersi, o vero se ha sempre necessità della defensione di altri | Il
convient, lorsqu’on examine la qualité de ces monarchies, de
s’arrêter
à une autre considération : à savoir si un prince
à un Etat suffisant pour
pouvoir en cas de besoin tenir par lui-même ou s’il est toujours
dans
la nécessité d’être défendu par un autre. |
| Etat (stato) | ||||||
| Républiques |
Monarchies |
|||||
| Héréditaires |
Nouvelles |
|||||
| Entièrement
nouvelles |
Ajoutées
à
l’ Etat héréditaire du prince qui les conquiert |
|||||
| Habituées à vivre libres | Habituées à vivre sous un prince | |||||
| Etat
acquis
par les armes du prince |
Etat
acquis
par les armes d’un autre prince |
Etat
acquis par les armes du prince |
Etat acquis par les armes d’un autre prince | |||
| Par fortune ou
par talent (virtù) |
Par fortune
ou par talent (virtù) |
|||||
| CHAPITRE
I |
LES
DIFFÉRENTS TYPES DE MONARCHIES |
| CHAPITRE
II À XI |
COMMENT
ACQUÉRIR ET CONSERVER LES MONARCHIES |
| CHAPITRE
XI A XIV |
LES
QUESTIONS MILITAIRES |
| CHAPITRE
XV A XXIII |
LE
PRINCE : SES SUJETS ET SES AMIS |
| CHAPITRE
XXIV A XXVI |
LA
QUESTION DE L'ITALIE |
D)
Le pouvoir comme
art ;
la
notion de virtù.
Opposé à « vice »
dans chap. XV
et XVI mais sens essentiel : force, habilité, courage,
mérite.
Donc "virtuose "
signifie "habile" ou "virtuose" plutôt que
"vertueux"
Parfois opposé ou
distingué de « fortuna
»
: "chance", "à la faveur de …". Mais les deux sont
articulés : voir César
Borgia : fortune et habilité
Il faut distinguer
"conquérir" et "garder" : Il est plus
facile
de "conquérir" (occupare)
le royaume de France que le "conserver" (tener), alors qu''il est plus
difficile
de "conquérir" (occupare)
la Turquie que de la "garder". En effet en France des "seigneurs"
et
en Turquie seulement des "esclaves" : il suffit donc après avoir
conquis
la Turquie de "liquider"
(spegnere)
la famille régnante. Dans l'antiquité Alexandre a pu
s'emparer facilement du Royaume de Darius car après l'avoir
battu il ne trouvait
plus de résistance en face de lui. (L'idée que le Grand
Turc
est un "despote" dont les sujets sont des "esclaves" est, en partie un
héritage
de la pensée grecque sur l'Asie)
B) En Italie : fragmentation et nécessité d'un chef unificateur. Et un projet transcendant : unifier l'Italie. Appel à un Moïse pour l'Italie.
A) Force
et loi.
Le centaure, le lion et le renard : supériorité de la ruse.
C'est un calcul rationnel : puisque je ne
puis être
sûr que l'autre est "bon", je dois me comporter comme s'il
était
méchant. Ceci relève de la "prudence".
D) "Bon gouvernement" et "cruauté"
a)
Annibal
et son armée : "inhumaine cruauté" du chef militaire
condition
de sa capacité à commander.
Le roi d'Espagne Ferdinand a fait
preuve d'une "pieuse cruauté" (pietosa
crudelta) en chassant les
Juifs
convertis d'Espagne (début du chap. XXI)
b) Bon et mauvais usage des
"cruautés" (chap. VIII, p.102). La cruauté mise en œuvre
pour un temps bref est efficace et permet de se défendre contre
les ennemis extérieurs sans crainte de conspiration
c) Si but est de conserver un pouvoir qui manque de
légitimité la notion de "bon gouvernement" va signifier
capacité à se maintenir au pouvoir au besoin par la
"cruauté". César
Borgia utilise celle de Ramiro d'Orco ("homme cruel et
expétiditif")
pour assurer son pouvoir en Romagne (chapitre VII) puis il est
cruel pour faire porter la responsabilité à son ministre.
1) Machiavel et l'éloge de la République (chap. V)
| Le
Prince chap. XXVI |
|
| et in Italia nom manca materia de
introdurvi ogni forrma |
et en Italie il ne manque pas de
matière où introduire quelque forme que ce soit |
| Machiavel
et César Borgia parle de l'avenir après la mort
d'Alexandre VI (1431-1503), père de César |
Le Prince chapitre VII, p. 96 de la
traduction Lévy chez Garnier Flammarion |
| Ma, se nella morte di Alessandro fussi stato sano, ogni cosa li era facile. E lui mi disse, ne' di che fu creato Iulio II, che aveva pensato a ciò che potessi nascere, morendo el padre, et a tutto aveva trovato remedio, eccetto che non pensò mai, in su la sua morte, di stare ancora lui per morire. | Si sa santé n’eût point
éprouvé d’atteinte au moment de la mort d’Alexandre [VI],
tout lui [ à César Borgia] aurait été
facile. Aussi me [ à moi Machiavel] disait-il, lors de la
nomination de Jules II [ nouveau Pape], qu’il avait pensé
à tout ce qui pouvait arriver si son père venait à
mourir, et qu’il avait trouvé remède à tout ;
excepté qu il n’avait jamais imaginé, lors de sa mort,
qu'il
se trouvait lui-même en danger de mort. |
| Le Centaure Chiron |
|
Sur les animaux en politique Jacques Derrida, La bête et le souverain. Volume 1, (2001-2002), Gallilée, 2008 |
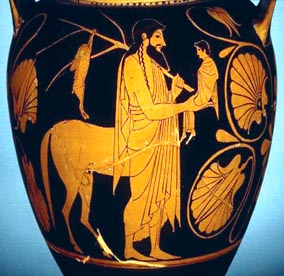 |
| Et
sur le chapitre XVIII du Prince
dans ce livre qui reprend les textes des séminaires de Derrida
on lira la
troisième séance pp. 97-139 |
Le centaure Chiron
dont parle
Machiavel dans le chap. XVIII du Prince, (infra) : il tient Achille
dans
sa main et lu parle. Il est homme et cheval mâle. Il porte un
lapin : le centaure est carnassier. Vase par Pamphalos et Ottos, 520 avant J-C. Musée du Louvre Photograph by Maria Daniels, courtesy of the Musée du Louvre, January 1992 Sur la base Perseus : http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/image?lookup=1992.06.0304 consultée le 11 novembre 2008 |
| Le prince peut
utiliser des mercenaires |
|
Le Prince - Chapitre 12 Combien il y a de sortes de milices et de troupes mercenaires |
Capitolo XII Quot sint genera militiae
et de mercennariis militibus.
|
| Si les Vénitiens et les
Florentins, en employant de telles troupes [ mercenaires], accrurent
néanmoins leurs puissance, et si les commandants, au lieu de les
subjuguer, les défendirent, je réponds, pour ce qui
regarde les Florentins, qu’ils en furent redevables à leur bonne
fortune, qui fit que, de tous les généraux habiles qu’ils
avaient et qu’ils pouvaient craindre, les uns ne furent point
victorieux ; d’autres rencontrèrent des obstacles ; d’autres
encore tournèrent ailleurs leur ambition. L’un des premiers fut Giovanni Acuto, dont la fidélité, par cela même qu’il n’avait pas vaincu, ne fut point mise à l’épreuve ; mais on doit avouer que, s’il avait remporté la victoire, les Florentins seraient demeurés à sa discrétion. |
E, se Viniziani e Fiorentini hanno per lo adrieto cresciuto lo imperio loro con queste arme, e li loro capitani non se ne sono però fatti principi ma li hanno difesi, respondo che Fiorentini in questo caso sono suti favoriti dalla sorte; perché de' capitani virtuosi, de' quali potevano temere, alcuni non hanno vinto, alcuni hanno avuto opposizione, altri hanno volto la ambizione loro altrove. Quello che non vinse fu Giovanni Aucut, del quale, non vincendo, non si poteva conoscere la fede; ma ognuno confesserà che, vincendo, stavano Fiorentini a sua discrezione. |
Une traduction en français sur internet : Leviathan Traduction originale de M. Philippe Folliot, Professeur de philosophie au Lycée Ango, Dieppe, Normandie. Autres traduction en français : Tricaud chez Vrin, Mairet chez Gallimard
Le texte du Leviathan
existe aussi dans une version en latin, due
à
Hobbes de 1668.
| Sur la "cité"
particulière qu' est celle de "l'honneur" chez Hobbes, lire Luc
Boltanski et Laurent Thévenot, De la
Justification. Les économies de la grandeur, Gallimard, 1991, p. 126-137 :
"construction d'une grandeur fondée sur l'arbitraire des signes"
|
| For it can never be that Warre shall preserve life, and Peace destroy it." |
| (LEVIATHAN
CHAP. XV) (TEXTE DU "PROJECT GUTEMBERG" : http://www.gutenberg.org/etext/3207) |
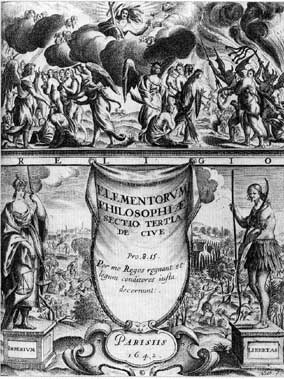
Frontispice du De Cive de Hobbes (Paris 1642)
En bas à gauche "Dominium", le pouvoir politique et une
société régulée.
En bas à droite "Libertas" et des groupes en guerre.
| Hobbes : l'homme
n'est pas un "animal politique" La plupart de ceux qui ont écrit touchant les républiques, supposent ou demandent, comme une chose qui ne leur doit pas être refusée, que l'homme est un animal politique,"zoon politicon" selon le langage des Grecs, né avec une certaine disposition naturelle à la société. Sur ce fondement-là ils bâtissent la doctrine civile; de sorte que pour la conservation de la paix, et pour la conduite de tout le genre humain, il ne faut plus rien sinon que les hommes s'accordent et conviennent de l'observation de certains pactes et conditions, auxquelles alors ils donnent le titre de lois. Cet axiome, quoique reçu si communément, ne laisse pas d'être faux, et l'erreur vient d'une trop légère contemplation de la nature humaine Du citoyen, livre I, chap. I, 2 |
| "A
Restlesse Desire Of Power", In All Men LEVIATHAN CHAP. IX |
So that in the first place, I put for a generall inclination of all mankind, a perpetuall and restlesse desire of Power after power, that ceaseth onely in Death. And the cause of this, is not alwayes that a man hopes for a more intensive delight, than he has already attained to; or that he cannot be content with a moderate power: but because he cannot assure the power and means to live well, which he hath present, without the acquisition of more. And from hence it is, that Kings, whose power is greatest, turn their endeavours to the assuring it a home by Lawes, or abroad by Wars: and when that is done, there succeedeth a new desire; in some, of Fame from new Conquest; in others, of ease and sensuall pleasure; in others, of admiration, or being flattered for excellence in some art, or other ability of the mind. |
POWER Leviathan, Part. I, chap. X |
The POWER of a Man, (to take it Universally,) is his present means, to obtain some future apparent Good. And is either Originall, or Instrumentall. Naturall Power, is the eminence of the Faculties of Body, or Mind: as extraordinary Strength, Forme, Prudence, Arts, Eloquence, Liberality, Nobility. Instrumentall are those Powers, which acquired by these, or by fortune, are means and Instruments to acquire more: as Riches, Reputation, Friends, and the Secret working of God, which men call Good Luck. For the nature of Power, is in this point, like to Fame, increasing as it proceeds; or like the motion of heavy bodies, which the further they go, make still the more hast. |
A) l'état de nature comme "guerre de tous contre tous"
son statut. Historique/Logique ?
Passé/ Présent ? Individus/groupes ?
Quatre exemples :
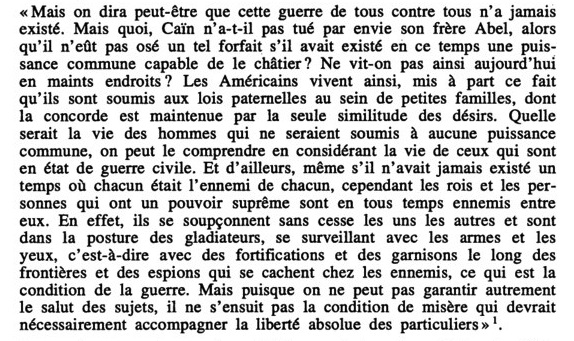
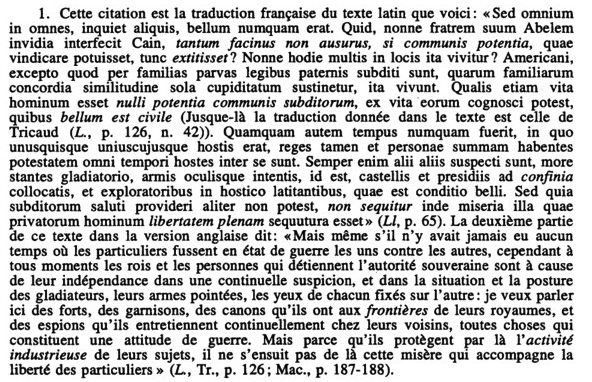
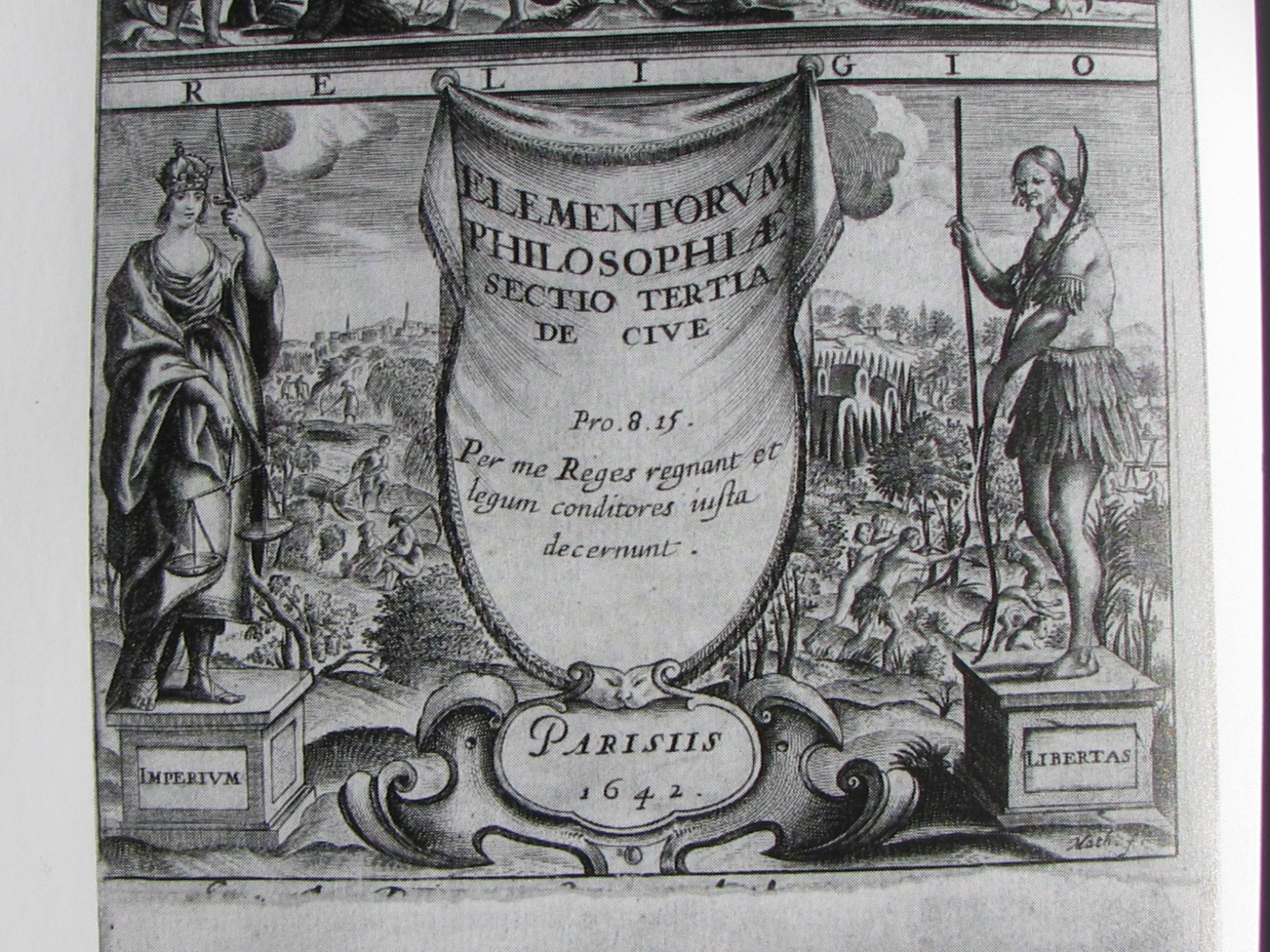
| Hobbes, Leviathan, CHAPTER XIII. OF THE NATURALL CONDITION OF MANKIND |
| Out Of Civil States, There Is Alwayes Warre Of Every One Against Every One Hereby it is manifest, that during the time men live without a common Power to keep them all in awe, they are in that condition which is called Warre; and such a warre, as is of every man, against every man. For WARRE, consisteth not in Battell onely, or the act of fighting; but in a tract of time, wherein the Will to contend by Battell is sufficiently known: and therefore the notion of Time, is to be considered in the nature of Warre; as it is in the nature of Weather. For as the nature of Foule weather, lyeth not in a showre or two of rain; but in an inclination thereto of many dayes together: So the nature of War, consisteth not in actuall fighting; but in the known disposition thereto, during all the time there is no assurance to the contrary. All other time is PEACE. |
| Les trois types de
conflit qu'on trouve dans la nature humaine (Leviathan, chap. XIII) |
||
| Causes de compétition entre les hommes | But
du combat |
Usage de la violence pour |
| Profit | competition
|
Se rendre maître d’autres hommes, femmes, enfants et bétails |
| Defiance
|
Sécurité | Pour défendre ceux-ci |
| Gloire |
Réputation | Pour des bagatelles (trifles) : un mot, un sourire, une opintion différente qui les sous estime, soit eux même dans leur personne, soit par projection, qui sous estime leur famille, leurs amis, leur nation, leur profession, leur nom |
A) Le calcul rationnel d'individus chez Hobbes : le passage
de
«
l’état
de nature » à la « société civile
», qui apporte
1) la sécurité
2) la possiblité du bien
être (welfare)
B) Le souverain (individu ou collectif).
Il existe plusieurs formes de
souveraineté où le plus faible, le vaincu,
reconnait son infériorité. (chap. 20 du Léviathan)
- Par institution : un représentant
- Par acquisition : un conquérant.
- Par dépendance : mère de l'enfant
Ce dernier exemple montre que le souverain pour Hobbes n'est
pas doué d'une toute puissance arbitraire. Il est un
législateur auquel on doit obéir (avec des limites : s'il
veut vous obliger à faire la guerre vous pouvez trouver un
remplaçant mais si vous vous êtes engagé vous ne
pouvez abandonner votre poste). Il doit être souverain temporel
(le glaive) et spirituel (la crosse d'évêque)
C) Hobbes penseur de « l’absolutisme »,
mais l'homme garde un droit à la vie qui est
inaliénable
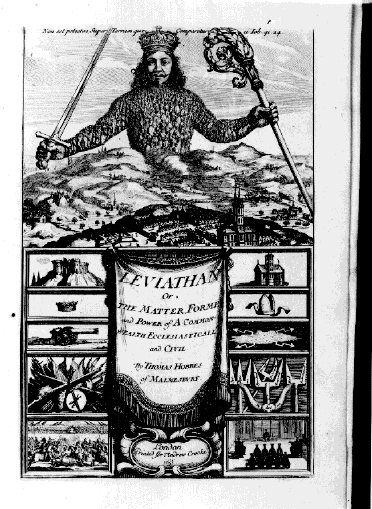
| côté
du glaive (Etat) |
Leviathan |
côté
de la crosse (Eglise) |
| château |
or
The Matter, Forme, |
église |
| couronne |
and Power of a common | mitre |
| canon |
wealth
Ecclesiasticall and Civil |
tonnerre |
| trophée
militaire |
by
Thomas Hobbes of Malmesbury |
argumentation
scolastique |
| bataille |
London Printed for Andrew Crooke 1651 |
cours
éclésiastique catholique |
| Introduction Leviathan (1651) |
Introduction Leviathan |
Nature (the art whereby God hath made and governs the world) is by the art of man, as in many other things, so in this also imitated, that it can make an artificial animal. For seeing life is but a motion of limbs, the beginning whereof is in some principal part within, why may we not say that all automata (engines that move themselves by springs and wheels as doth a watch) have an artificial life? For what is the heart, but a spring; and the nerves, but so many strings; and the joints, but so many wheels, giving motion to the whole body, such as was intended by the Artificer? Art goes yet further, imitating that rational and most excellent work of Nature, man. For by art is created that great LEVIATHAN called a COMMONWEALTH, or STATE (in Latin, CIVITAS), which is but an artificial man, though of greater stature and strength than the natural, for whose protection and defence it was intended; and in which the sovereignty is an artificial soul, as giving life and motion to the whole body; the magistrates and other officers of judicature and execution, artificial joints; reward and punishment (by which fastened to the seat of the sovereignty, every joint and member is moved to perform his duty) are the nerves, that do the same in the body natural; the wealth and riches of all the particular members are the strength; salus populi (the people's safety) its business; counsellors, by whom all things needful for it to know are suggested unto it, are the memory; equity and laws, an artificial reason and will; concord, health; sedition, sickness; and civil war, death. Lastly, the pacts and covenants, by which the parts of this body politic were at first made, set together, and united, resemble that fiat, or the Let us make man, pronounced by God in the Creation. To describe the nature of this artificial man, I will consider First, the matter thereof, and the artificer; both which is man. Secondly, how, and by what covenants it is made; what are the rights and just power or authority of a sovereign; and what it is that preserveth and dissolveth it. Thirdly, what is a Christian Commonwealth. Lastly, what is the Kingdom of Darkness. |
La nature (l'art par lequel Dieu a fait le monde et le gouverne) est si bien imitée par l’art de l'homme, en ceci comme en de nombreuses autres choses, que cet art peut fabriquer un animal artificiel. Car, étant donné que la vie n'est rien d'autre qu'un mouvement de membres, dont le commencement est en quelque partie principale intérieure, pourquoi ne pourrions-nous pas dire que tous les automates (des engins qui se meuvent eux-mêmes , par des ressorts et des roues, comme une montre ) ont une vie artificielle ? Car qu'est-ce que le coeur, sinon un ressort, les nerfs, sinon de nombreux fils , et les jointures , sinon autant de nombreuses roues qui donnent du mouvement au corps entier, comme cela a été voulu par l'artisan. L'art va encore plus loin, imitant cet ouvrage raisonnable et le plus excellent de la Nature , l'homme. Car par l'art est créé ce grand LEVIATHAN appelé RÉPUBLIQUE , ou ÉTAT (en latin, CIVITAS), qui n'est rien d'autre qu'un homme artificiel, quoique d'une stature et d'une force supérieures à celles de l'homme naturel, pour la protection et la défense duquel il a été destiné, et en lequel la souveraineté est une âme artificielle, en tant qu'elle donne vie et mouvement au corps entier, où les magistrats et les autres officiers affectés au jugement et à l'exécution sont des jointures artificielles, la récompense et la punition (qui, attachées au siège de la souveraineté, meuvent chaque jointure, chaque membre pour qu'il accomplisse son devoir) sont les nerfs, et [tout] cela s'accomplit comme dans le corps naturel : la prospérité et la richesse de tous les membres particuliers sont la force, le salus populi (la protection du peuple ) est sa fonction, les conseillers, qui lui proposent toutes les choses qu'il doit connaître, sont la mémoire, l'équité et les lois sont une raison et une volonté artificielles, la concorde est la santé, la sédition est la maladie, et la guerre civile est la mort. En dernier, les pactes et les conventions, par lesquels les parties de ce corps politique ont en premier lieu étaient faites, réunies et unifiées , ressemblent à ce Fiat ou au Faisons l'homme prononcé par Dieu lors de la création . Pour décrire la nature de cet homme artificiel, je considérerai : * Premièrement, la matière de cet homme artificiel, et l'artisan, les deux étant l'homme. * Deuxièmement, comment et par quelles conventions il est fait; quels sont les droits et le juste pouvoir d'un souverain, et ce qui le conserve et le détruit . * Troisièmement, ce qu'est une République chrétienne . * Enfin, ce qu'est le royaume des ténèbres |
|
|
From Diffidence Warre And from this diffidence of one another, there is no way for any man to secure himselfe, so reasonable, as Anticipation; that is, by force, or wiles, to master the persons of all men he can, so long, till he see no other power great enough to endanger him: And this is no more than his own conservation requireth, and is generally allowed. Also because there be some, that taking pleasure in contemplating their own power in the acts of conquest, which they pursue farther than their security requires; if others, that otherwise would be glad to be at ease within modest bounds, should not by invasion increase their power, they would not be able, long time, by standing only on their defence, to subsist. And by consequence, such augmentation of dominion over men, being necessary to a mans conservation, it ought to be allowed him. Againe, men have no pleasure, (but on the contrary a great deale of griefe) in keeping company, where there is no power able to over-awe them all. For every man looketh that his companion should value him, at the same rate he sets upon himselfe: And upon all signes of contempt, or undervaluing, naturally endeavours, as far as he dares (which amongst them that have no common power, to keep them in quiet, is far enough to make them destroy each other,) to extort a greater value from his contemners, by dommage; and from others, by the example. So that in the nature of man, we find three principall causes of quarrel. First, Competition; Secondly, Diffidence; Thirdly, Glory. The first, maketh men invade for Gain; the second, for Safety; and the third, for Reputation. The first use Violence, to make themselves Masters of other mens persons, wives, children, and cattell; the second, to defend them; the third, for trifles, as a word, a smile, a different opinion, and any other signe of undervalue, either direct in their Persons, or by reflexion in their Kindred, their Friends, their Nation, their Profession, or their Name. Out Of Civil States, There Is Alwayes Warre Of Every One Against Every One Hereby it is manifest, that during the time men live without a common Power to keep them all in awe, they are in that condition which is called Warre; and such a warre, as is of every man, against every man. For WARRE, consisteth not in Battell onely, or the act of fighting; but in a tract of time, wherein the Will to contend by Battell is sufficiently known: and therefore the notion of Time, is to be considered in the nature of Warre; as it is in the nature of Weather. For as the nature of Foule weather, lyeth not in a showre or two of rain; but in an inclination thereto of many dayes together: So the nature of War, consisteth not in actuall fighting; but in the known disposition thereto, during all the time there is no assurance to the contrary. All other time is PEACE. The Incommodites Of Such A War Whatsoever therefore is consequent to a time of Warre, where every man is Enemy to every man; the same is consequent to the time, wherein men live without other security, than what their own strength, and their own invention shall furnish them withall. In such condition, there is no place for Industry; because the fruit thereof is uncertain; and consequently no Culture of the Earth; no Navigation, nor use of the commodities that may be imported by Sea; no commodious Building; no Instruments of moving, and removing such things as require much force; no Knowledge of the face of the Earth; no account of Time; no Arts; no Letters; no Society; and which is worst of all, continuall feare, and danger of violent death; And the life of man, solitary, poore, nasty, brutish, and short. It may seem strange to some man, that has not well weighed these things; that Nature should thus dissociate, and render men apt to invade, and destroy one another: and he may therefore, not trusting to this Inference, made from the Passions, desire perhaps to have the same confirmed by Experience. Let him therefore consider with himselfe, when taking a journey, he armes himselfe, and seeks to go well accompanied; when going to sleep, he locks his dores; when even in his house he locks his chests; and this when he knows there bee Lawes, and publike Officers, armed, to revenge all injuries shall bee done him; what opinion he has of his fellow subjects, when he rides armed; of his fellow Citizens, when he locks his dores; and of his children, and servants, when he locks his chests. Does he not there as much accuse mankind by his actions, as I do by my words? But neither of us accuse mans nature in it. The Desires, and other Passions of man, are in themselves no Sin. No more are the Actions, that proceed from those Passions, till they know a Law that forbids them; which till Lawes be made they cannot know: nor can any Law be made, till they have agreed upon the Person that shall make it. It may peradventure be thought, there was never such a time, nor condition of warre as this; and I believe it was never generally so, over all the world: but there are many places, where they live so now. For the savage people in many places of America, except the government of small Families, the concord whereof dependeth on naturall lust, have no government at all; and live at this day in that brutish manner, as I said before. Howsoever, it may be perceived what manner of life there would be, where there were no common Power to feare; by the manner of life, which men that have formerly lived under a peacefull government, use to degenerate into, in a civill Warre. But though there had never been any time, wherein particular men were in a condition of warre one against another; yet in all times, Kings, and persons of Soveraigne authority, because of their Independency, are in continuall jealousies, and in the state and posture of Gladiators; having their weapons pointing, and their eyes fixed on one another; that is, their Forts, Garrisons, and Guns upon the Frontiers of their Kingdomes; and continuall Spyes upon their neighbours; which is a posture of War. But because they uphold thereby, the Industry of their Subjects; there does not follow from it, that misery, which accompanies the Liberty of particular men. In Such A Warre, Nothing Is Unjust To this warre of every man against every man, this also is consequent; that nothing can be Unjust. The notions of Right and Wrong, Justice and Injustice have there no place. Where there is no common Power, there is no Law: where no Law, no Injustice. Force, and Fraud, are in warre the two Cardinall vertues. Justice, and Injustice are none of the Faculties neither of the Body, nor Mind. If they were, they might be in a man that were alone in the world, as well as his Senses, and Passions. They are Qualities, that relate to men in Society, not in Solitude. It is consequent also to the same condition, that there be no Propriety, no Dominion, no Mine and Thine distinct; but onely that to be every mans that he can get; and for so long, as he can keep it. And thus much for the ill condition, which man by meer Nature is actually placed in; though with a possibility to come out of it, consisting partly in the Passions, partly in his Reason. The Passions That Incline Men To Peace The Passions that encline men to Peace, are Feare of Death; Desire of such things as are necessary to commodious living; and a Hope by their Industry to obtain them. And Reason suggesteth convenient Articles of Peace, upon which men may be drawn to agreement. These Articles, are they, which otherwise are called the Lawes of Nature: whereof I shall speak more particularly, in the two following Chapters. |
Chapter XIV: Of the First and Second Natural Laws, and of Contracts http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan-c.html#CHAPTERXIV |
Première
partie : De l’homme Chapitre XIV De la première et de la seconde Lois naturelles, et des Contrats http://classiques.uqac.ca/classiques/hobbes_thomas/leviathan/leviathan.html |
| If a covenant be made wherein
neither of the parties perform presently, but trust one another, in the
condition of mere nature (which is a condition of war of every man
against every man) upon any reasonable suspicion, it is void: but if
there be a common power set over them both, with right and force
sufficient to compel performance, it is not void. For he that
performeth first has no assurance the other will perform after, because
the bonds of words are too weak to bridle men's ambition, avarice,
anger, and other passions, without the fear of some coercive power;
which in the condition of mere nature, where all men are equal, and
judges of the justness of their own fears, cannot possibly be supposed.
And therefore he which performeth first does but betray himself to his
enemy, contrary to the right he can never abandon of defending his life
and means of living. But in a civil estate, where there a power set up to constrain those that would otherwise violate their faith, that fear is no more reasonable; and for that cause, he which by the covenant is to perform first is obliged so to do. The cause of fear, which maketh such a covenant invalid, must be always something arising after the covenant made, as some new fact or other sign of the will not to perform, else it cannot make the covenant void. For that which could not hinder a man from promising ought not to be admitted as a hindrance of performing. He that transferreth any right transferreth the means of enjoying it, as far as lieth in his power. As he that selleth land is understood to transfer the herbage and whatsoever grows upon it; nor can he that sells a mill turn away the stream that drives it. And they that give to a man the right of government in sovereignty are understood to give him the right of levying money to maintain soldiers, and of appointing magistrates for the administration of justice. To make covenants with brute beasts is impossible, because not understanding our speech, they understand not, nor accept of any translation of right, nor can translate any right to another: and without mutual acceptation, there is no covenant. To make covenant with God is impossible but by mediation of such as God speaketh to, either by revelation supernatural or by His lieutenants that govern under Him and in His name: for otherwise we know not whether our covenants be accepted or not. And therefore they that vow anything contrary to any law of nature, vow in vain, as being a thing unjust to pay such vow. And if it be a thing commanded by the law of nature, it is not the vow, but the law that binds them. |
Si une convention est faite de telle façon qu'aucune des parties ne s'exécute tout de suite, car chacune fait confiance à l'autre, dans l'état de nature (qui est un état de guerre de tout homme contre homme), au [moindre] soupçon bien fondé , cette convention est nulle. Mais si existe un pouvoir commun institué au-dessus des deux parties, avec une force et un droit suffisants pour les contraindre à s'exécuter, la convention n'est pas nulle. Car celui qui s'exécute le premier n'a aucune assurance que l'autre s'exécutera après, parce que les liens créés par les mots sont trop faibles pour brider, chez les hommes, l'ambition, la cupidité, la colère et les autres passions, sans la crainte de quelque pouvoir coercitif qu'il n'est pas possible de supposer dans l'état de simple nature, où tous les hommes sont égaux, et juges du bien-fondé de leurs propres craintes. C'est pourquoi celui qui s'exécute le premier ne fait que se livrer à son ennemi, contrairement au droit, qu'il ne peut jamais abandonner, de défendre sa vie et ses moyens de vivre. Mais dans un état civil, où existe un pouvoir institué pour contraindre ceux qui, autrement, violeraient leur parole, cette crainte n'est plus raisonnable; et pour cette raison , celui qui, selon la convention, doit s'exécuter le premier, est obligé de le faire. La cause de crainte, qui rend une telle convention invalide, doit toujours être quelque chose qui se produit après que la convention a été faite, comme quelque nouveau fait ou quelque autre signe de la volonté de ne pas s'exécuter . Autrement, la convention demeure valide, car on ne doit pas admettre que ce qui n'a pas pu empêcher un homme de promettre puisse l'empêcher de s'exécuter. Celui qui transmet un droit transmet les moyens d'en jouir, dans la mesure où c'est en son pouvoir. Par exemple, celui qui vend un terrain est censé transmettre l'herbe et tout ce qui y pousse; De même, celui qui vend un moulin ne peut pas détourner le cours d'eau qui le fait fonctionner. Et ceux qui donnent un homme le droit de gouverner comme souverain sont censés lui donner le droit de lever des impôts pour entretenir des troupes et nommer des magistrats pour l'administration de la justice. Faire des conventions avec des bêtes brutes est impossible parce que, ne compre-nant notre langage, elles ne comprennent et n'acceptent aucun transfert de droit, ni ne peuvent transférer un droit à un autre; et sans acceptation mutuelle, il n'y a pas de convention. Faire une convention avec Dieu est impossible, sinon par l'intermédiaire de ceux à qui Dieu parle, soit par révélation surnaturelle, soit par ses lieutenants qui gouvernent sous lui et en son nom, car autrement, nous ne savons pas si nos conventions sont acceptées ou non. Et c'est pourquoi ceux qui jurent quelque chose de contraire à une loi de nature, jurent en vain, car c'est une chose injuste de s'acquitter de ce qu'on a pu ainsi jurer . Et si c'est une chose ordonnée par la loi de nature, ce n'est pas le fait d'avoir juré, mais la loi, qui les lie . |
|
SPINOZA
E T H I C E S P A R S T E R T I A DE ORIGINE ET NATURA AFFECTUUM. http://users.telenet.be/rwmeijer/spinoza/indexfr.htm |
|
| PROPOSITIO IV. Nulla res nisi a
causa externa potest destrui. DEMONSTRATIO. Haec propositio per se patet. Definitio enim cuiuscumque rei ipsius rei essentiam affirmat, sed non negat; sive rei essentiam ponit, sed non tollit. Dum itaque ad rem ipsam tantum, non autem ad causas externas attendimus, nihil in eadem poterimus invenire, quod ipsam possit destruere. Q.E.D. PROPOSITIO V. Res eatenus contrariae sunt naturae, hoc est, eatenus in eodem subiecto esse nequeunt, quatenus una alteram potest destruere. DEMONSTRATIO. Si enim inter se convenire vel in eodem subiecto simul esse possent, posset ergo in eodem subiecto aliquid dari, quod ipsum posset destruere, quod (per prop. praeced.) est absurdum. Ergo res etc. Q.E.D. PROPOSITIO VI. Unaquaeque res, quantum in se est, in suo esse perseverare conatur. DEMONSTRATIO. Res enim singulares modi sunt, quibus Dei attributa certo et determinato modo exprimuntur (per coroll. prop. 25. P. 1.), hoc est (per prop. 34. P. 1.) res, quae Dei potentiam qua Deus est et agit, certo et determinato modo exprimunt. Neque ulla res aliquid in se habet, a quo possit destrui, sive quod eius existentiam tollat (per prop. 4. huius); sed contra ei omni, quod eiusdem existentiam potest tollere, opponitur (per prop. praeced.). Adeoque quantum potest et in se est, in suo esse perseverare conatur. Q.E.D. PROPOSITIO VII. Conatus, quo unaquaeque res in suo esse perseverare conatur, nihil est praeter ipsius rei actualem essentiam. DEMONSTRATIO. Ex data cuiuscumque rei essentia quaedam necessario sequuntur (per prop. 36. P. 1.), nec res aliud possunt, quam id quod ex determinata earum natura necessario sequitur (per prop. 29. P. 1.). Quare cuiuscumque rei potentia sive conatus, quo ipsa vel sola vel cum aliis quidquam agit, vel agere conatur, hoc est (per prop. 6. huius) potentia sive conatus, quo in suo esse perseverare conatur, nihil est praeter ipsius rei datam sive actualem essentiam. Q.E.D. PROPOSITIO VIII. Conatus, quo unaquaeque res in suo esse perseverare conatur, nullum tempus finitum, sed indefinitum involvit. DEMONSTRATIO. Si enim tempus limitatum involveret, quod rei durationem determinaret, tum ex sola ipsa potentia, qua res existit, sequeretur, quod res post limitatum illud tempus non posset existere, sed quod deberet destrui. Atqui hoc (per prop. 4. huius) est absurdum. Ergo conatus, quo res existit, nullum tempus definitum involvit, sed contra, quoniam (per eandem prop. 4. huius) si a nulla externa causa destruatur, eadem potentia, qua iam existit, existere perget semper, ergo hic conatus tempus indefinitum involvit. Q.E.D |
PROPOSITION IV Aucune chose ne
peut être détruite que par une cause
extérieure. Démonstration : Cette proposition est évidente par elle-même ; car la définition d'une chose quelconque contient l'affirmation et non la négation de l'essence de cette chose ; en d'autres termes, elle pose son essence, elle ne la détruit pas. Donc, tant que l'on considérera seulement la chose, abstraction faite de toute cause extérieure, on ne pourra rien trouver en elle qui soit capable de la détruire. C. Q. F. D. PROPOSITION V Deux choses sont de nature contraire ou ne peuvent exister en un même sujet, quand l'une peut détruire l'autre. Démonstration : Car si ces deux choses pouvaient se convenir ou exister ensemble dans un même sujet, il pourrait donc y avoir en un sujet quelque chose qui fût capable de le détruire, ce qui est absurde (par la Propos. précéd.). Donc, etc. C. Q. F. D. PROPOSITION VI Toute chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Démonstration : En effet, les choses particulières sont des modes qui expriment les attributs de Dieu d'une certaine façon déterminée (par le Corollaire de la Propos. 25, partie 1), c'est-à-dire (par la Propos. 34, partie 1) des choses qui expriment d'une certaine façon déterminée la puissance divine par qui Dieu est et agit. De plus, aucune chose n'a en soi rien qui la puisse détruire, rien qui supprime son existence (par la Propos. 4, partie 3) ; au contraire, elle est opposée à tout ce qui peut détruire son existence (par la Propos. précéd.), et par conséquent, elle s'efforce, autant qu'il est en elle, de persévérer dans son être. C. Q. F. D. PROPOSITION VII L'effort par lequel toute chose tend à persévérer dans son être n'est rien de plus que l'essence actuelle de cette chose. Démonstration : L'essence d'un être quelconque étant donnée, il en résulte nécessairement certaines choses (par la Propos. 36, partie 1) ; et tout être ne peut rien de plus que ce qui suit nécessairement de sa nature déterminée (par la Propos. 29, partie 1). Par conséquent, la puissance d'une chose quelconque, ou l'effort par lequel elle agit ou tend à agir, seule ou avec d'autres choses, en d'autres termes (par la Propos. 6, partie 3), la puissance d'une chose, ou l'effort par lequel elle tend à persévérer dans son être, n'est rien de plus que l'essence donnée ou actuelle de cette chose. C. Q. F. D. PROPOSITION VIII L'effort par lequel toute chose tend à persévérer dans son être n'enveloppe aucun temps fini, mais un temps indéfini. Démonstration : Si, en effet, il enveloppait un temps limité, qui déterminât la durée de la chose, il s'ensuivrait de cette puissance même par laquelle la chose existe, qu'après un certain temps elle ne pourrait plus exister et devrait être détruite. Or, cela est absurde (par la Propos. 4, partie 3) ; donc l'effort par lequel une chose existe n'enveloppe aucun temps déterminé ; mais, au contraire, puisque cette chose (en vertu de cette même Propos.), si elle n'est détruite par aucune cause extérieure, devra, par cette même puissance qui la fait être, toujours continuer d'être, il s'ensuit que l'effort dont nous parlons enveloppe un temps indéfini. C. Q. F. D. |
| Extrait de Jacques
LACAN, Communication au congrès international de
psychanalyse, à Zürich, le 17 Juillet 1949 Le stade du miroir comme formateur de la fonction du "Je" |
C'est ce moment qui décisivement fait basculer tout le savoir humain dans la médiatisation par le désir de l'autre, constitue ses objets dans une équivalence abstraite par la concurrence d'autrui, et fait du je cet appareil pour lequel toute poussée des instincts sera un danger, répondît-elle à une maturation naturelle, - la normalisation même de cette maturation dépendant dès lors chez l'homme d'un truchement culturel : comme il se voit pour l'objet sexuel dans le complexe d'Oedipe. Le terme de narcissisme primaire par quoi la doctrine désigne l'investissement libidinal propre à ce moment, révèle chez ses inventeurs, au jour de notre conception, le plus profond sentiment des latences de la sémantique. Mais elle éclaire aussi l'opposition dynamique qu'ils ont cherché à définir, de cette libido à la libido sexuelle, quand ils ont invoqué des instincts de destruction, voire de mort, pour expliquer la relation évidente de la libido narcissique à la fonction aliénante du je, à l'agressivité qui s'en dégage dans toute relation à l'autre, fût-ce celle de l'aide la plus samaritaine. C'est qu'ils ont touché à cette négativité existentielle, dont la réalité est si vivement promue par la philosophie contemporaine de l'être et du néant. |
| Le stade du miroir
chez Lacan présenté par Merleau-Ponty Maurice Merleau-Ponty, Les relations à autrui chez l’enfant, éd. Les cours de la Sorbonne, pp.55-57. |
| “La compréhension de l’image spéculaire consiste, chez l’enfant, à reconnaître pour sienne cette apparence visuelle qui est dans le miroir. Jusqu’au moment où l’image spéculaire intervient, le corps pour l’enfant est une réalité fortement sentie, mais confuse. Reconnaître son visage dans le miroir, c’est pour lui apprendre qu’il peut y avoir un spectacle de lui-même. Jusque là il ne s’est jamais vu, ou il ne s’est qu’entrevu du coin de l’œil en regardant les parties de son corps qu’il peut voir. Par l’image dans le miroir il devient spectateur de lui-même. Par l’acquisition de l’image spéculaire l’enfant s’aperçoit qu’il est visible et pour soi et pour autrui. Le passage du moi interoceptif au ” je spéculaire “, comme dit encore Lacan, c’est le passage d’une forme ou d’un état de la personnalité à un autre. La personnalité avant l’image spéculaire, c’est ce que les psychanalystes appellent chez l’adulte le soi, c’est-à-dire l’ensemble des pulsions confusément senties. L’image du miroir, elle, va rendre possible une contemplation de soi-même, en termes psychanalytiques d’un sur-moi, que d’ailleurs cette image soit explicitement posée, ou qu’elle soit simplement impliquée par tout ce que je vis à chaque minute. On comprend alors que l’image spéculaire prenne pour les psychanalystes l’importance qu’elle a justement dans la vie de l’enfant. Ce n’est pas seulement l’acquisition d’un nouveau contenu, mais d’une nouvelle fonction, la fonction narcissique. Narcisse est cet être mythique qui, à force de regarder son image dans l’eau, a été attiré comme par un vertige et a rejoint dans le miroir de l’eau son image. L’image propre en même temps qu’elle rend possible la connaissance de soi, rend possible une sorte d’aliénation : je ne suis plus ce que je me sentais être immédiatement, je suis cette image de moi que m’offre le miroir. Il se produit, pour employer les termes du docteur Lacan, une ” captation ” de moi par mon image spatiale. Du coup je quitte la réalité de mon moi vécu pour me référer constamment à ce moi idéal, fictif ou imaginaire, dont l’image spéculaire est la première ébauche. En ce sens je suis arraché à moi-même, et l’image du miroir me prépare à une autre aliénation encore plus grave, qui sera l’aliénation par autrui. Car de moi-même justement les autres n’ont que cette image extérieure analogue à celle qu’on voit dans le miroir, et par conséquent autrui m’arrachera à l’intimité immédiate bien plus sûrement que le miroir. L’image spéculaire, c’est ” la matrice symbolique, dit Lacan, où le je se précipite en une forme primordiale avant qu’il ne s’objective dans la dialectique de l’identification à l’autre. “ M. Merleau-Ponty, Les relations à autrui chez l’enfant, éd. Les cours de la Sorbonne, pp.55-57. |
|
"Homo homini lupus" "L'homme est un loup pour l'homme" Répères sur l'histoire de la formule |
|
Plaute La formule se trouve chez Plaute (254 -184 av. J.-C) auteur latin de comédie dans l'Asinaria. Un homme met pour condition au mariage de son fils qu'il puisse passer une nuit avec la jeune femme. Comme c'est une comédie, cet inceste n'aura pas lieu et tout se terminera bien... Mercator Fortassis ! sed tamen me_numquam hodie induces, ut tibi credam hoc argentum ignoto._Lupus est homo homini, non homo, quom, qualis sit, non gnovit. 495 Plaute, Asinaria, Acte II, scène 4 Traduction LE MARCHAND Peut-être; mais tu ne me persuaderas point de te livrer cet argent sans savoir qui tu es. L'homme est un loup pour l’homme, et non un homme si c’est quelqu’un qu’on ne connaît pas. |
Erasme
le grand humaniste de Rotterdam (1469-1536) a rédigé un receuil d'adages ou proverbes commentés qui a donnné lieu à des éditions diverses dont certaines sont beaucoup plus longues que d'autres. J'ai fait des recherches dans quatre éditions. Dans une édition de 1514 on trouve l'expression "homo homini deus" ("l'homme est un dieu pour l'homme") [l'absence de majuscule est importante, quand dans le même texte Erasme parle du Dieu chrétien il y y a une majuscule], commentée longument . Et à la suite l'expression "homo homini lupus" d'abord en grec puis l'objet d'un bref commentaire en latin avec reférence explicite à Plaute. Texte de 1514 (Erasmi Roterodami Adagiorum Chiliades Tres, Tubingen): Homo homini lupus. 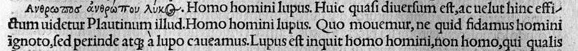 Dans une édtion de 1520 on trouve une entrée où apparait l'expression "l'homme est un dieu pour l'homme" ("homo homini deus"). Très clairement il s'agit d'un "dieu" pour les païens puique Erasme cite un celèbre fragment de Virgile (70-29 av. J.-C.) : "deus nobis haec otia fecit" ("Un dieu nous a procuré ce repos"), (Bucolique I, v. 6) où "deus", le dieu est l'empereur romain Auguste. Il y a aussi dans cette éditon la formule de Plaute "homo homini lupus"; mais comme les deux formules ne se suivent pas et que le texte emploi le mot grec "daimon" comme synonyme de "deus" l'effet de parallèle entre les deux formules ("l'homme est un dieu pour l'homme", "l'homme est un homme pour l'homme") est moins fort que dans d'autres éditions. 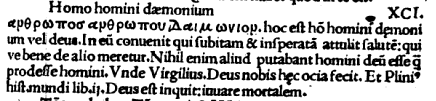 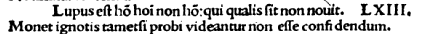 (La première ligne est la fomule de Plaute en écriture abrégée : le papier est cher en 1520 !.Et ici la formule n'est pas traduit en grec) Texte légèrement différent (le nom de la pièce de Plaute est précisé) dans une édition de 1540 à Lyon : Adagiorum opus Des Erasmi Roterodami Texte repris et augmenté dans une édition de Florence en 1575, qui a la particulartié d'être préfacée par le pape Grégoire XIII et ne pas être présenté comme une oeuvre d'Erasme : 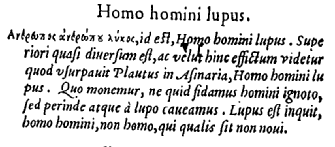 Sources : Pour l'édition de 1514 voir : Erasmus, Desiderius, Adagiorum Chiliades tres, ac centuriae fere totidem (Tubingae : in aedibus Thomae Anshelmi Badensis, impensis prouidi uiri Lodouici Hornecken Coloniensis incolae), sur le site : "Les Bibliothèques virtuelles humanistes" http://www.bvh.univ-tours.fr/index.htm de l'Université François-Rabelais de Tours Pour l'éditon de 1520, pour l'édition de 1540 et pour l'édition de 1575 le site Gallica 2 de la BNF. |
Hobbes
Dans la dédicace du De Cive (1642) qui écrit en latin et traduit en français sous le titre Du Citoyen par Sorbière en 1646, traduction revue par Hobbes on lit : "Le peuple romain peu favorable envers les rois, et à cause de la mémoire du nom des Tarquins et par les lois de la République, disait autrefois par la bouche de Caton le Censeur, que tous les monarques étaient de la nature de ces animaux qui ne vivent que de rapine. Comme si ce même peuple qui a pillé presque tout le monde par ses Africains, ses Asiatiques, ses Macédoniques, ses Achaïques, et par ses autres citoyens renommés à cause des dépouilles qu'ils ont emportées de différentes nations, n'était pas une bête plus formidable ? De sorte que Pontius Telesinus n'avait pas moins de raison lorsque dans le combat qui se fit à la porte Colline contre Sylla, il s'écria passant au travers des rangs de ses soldats, qu'il fallait démolir la ville de Rome, parce qu'on trouverait toujours des loups ravissants qui envahiraient la liberté de l'Italie, si l’on n'abattait la forêt où ils avaient coutume de se retirer. Et certainement il est également vrai, et qu'un homme est un dieu à un autre homme, et qu'un homme est aussi un loup à un autre homme. L'un dans la comparaison des Citoyens les uns avec les autres; et l'autre dans la considération des Républiques; là, par le moyen de la Justice et de la Charité, qui sont les vertus de la paix, on s'approche de la ressemblance de Dieu; et ici, les désordres des méchants contraignent ceux mêmes qui sont les meilleurs de recourir, par le droit d'une légitime défense, à la force et à la tromperie, qui sont les vertus de la guerre, c'est-à-dire à la rapacité des bêtes farouches; laquelle, quoique les hommes, par une coutume qui est née avec eux, se l'imputent mutuellement à outrage, se représentant leurs actions dans la personne des autres ainsi que dans un miroir où les choses qui sont à la main gauche paraissent à la droite, et celles qui sont à la droite, à la gauche, n'est pas toutefois condamnée comme un vice par ce droit naturel qui dérive de la nécessité de sa propre conservation." (souligné par nous) |
SPINOZA
L'ETHIQUE (TRADUCTION APPUHN), publié en 1677 LIVRE IV PROPOSITIION XXXV Rien dans la nature des choses n’est plus utile à l’homme que l’homme lui-même, quand il vit selon la raison. Car ce qu’il y a de plus utile pour l’homme, c’est ce qui s’accorde le mieux avec sa nature , c’est à savoir, l’homme (cela est évident de soi). Or, l’homme agit absolument selon les lois de sa nature quand il vit suivant la raison, et à cette condition seulement la nature de chaque homme s’accorde toujours nécessairement avec celle d’un autre homme. Donc rien n’est plus utile à l’homme entre toutes choses que l’homme lui-même, etc. C. Q. F. D. Nihil singulare in rerum natura datur quod homini sit utilius quam homo qui ex ductu rationis vivit. Nam id homini utilissimum est quod cum sua natura maxime convenit (per corollarium propositionis 31 hujus) hoc est (ut per se notum) homo. At homo ex legibus suæ naturæ absolute agit quando ex ductu rationis vivit (per definitionem 2 partis III) et eatenus tantum cum natura alterius hominis necessario semper convenit (per propositionem præcedentem) ; ergo homini nihil inter res singulares utilius datur quam homo etc. Q.E.D. Proposition XXXV Ce que nous venons de montrer, l’expérience le confirme par des témoignages si nombreux et si décisifs que c’est une parole répétée de tout le monde : L’homme est pour l’homme un Dieu. Il est rare pourtant que les hommes dirigent leur vie d’après la raison, et la plupart s’envient les uns les autres et se font du mal. Cependant, ils peuvent à peine supporter la vie solitaire, et cette définition de l’homme leur plaît fort : L’homme est un animal sociable. La vérité est que la société a beaucoup plus d’avantages pour l’homme qu’elle n’entraîne d’inconvénients. Que les faiseurs de satires se moquent donc tant qu’il leur plaira des choses humaines ; que les théologiens les détestent à leur gré, que les mélancoliques vantent de leur mieux la vie grossière des champs, qu’ils méprisent les hommes et prennent les bêtes en admiration ; l’expérience dira toujours aux hommes que des secours mutuels leur donneront une facilité plus grande à se procurer les objets de leurs besoins, et que c’est seulement en réunissant leurs forces qu’ils éviteront les périls qui les menacent de toutes parts. Mais je m’abstiens d’insister ici, pour montrer qu’il est de beaucoup préférable et infiniment plus digne de notre intelligence de méditer sur les actions des hommes que sur celles des bêtes. Tout cela sera développé plus tard avec étendue. Quæ modo ostendimus, ipsa etiam experientia quotidie tot tamque luculentis testimoniis testatur ut omnibus fere in ore sit : hominem homini Deum esse. Fit tamen raro ut homines ex ductu rationis vivant sed cum iis ita comparatum est ut plerumque invidi atque invicem molesti sint. At nihilominus vitam solitariam vix transigere queunt ita ut plerisque illa definitio quod homo sit animal sociale, valde arriserit et revera res ita se habet ut ex hominum communi societate multo plura commoda oriantur quam damna. Rideant igitur quantum velint res humanas satyrici easque detestentur theologi et laudent quantum possunt melancholici vitam incultam et agrestem hominesque contemnant et admirentur bruta ; experientur tamen homines mutuo auxilio ea quibus indigent multo facilius sibi parare et non nisi junctis viribus pericula quæ ubique imminent, vitare posse ; ut jam taceam quod multo præstabilius sit et cognitione nostra magis dignum hominum quam brutorum facta contemplari. Sed de his alias prolixius. SUR LE SITE "HYPER SPINOZA" |
Rousseau
L'homme à l'état de nature (ou le sauvage qui en est proche) n'est pas un loup pour l'homme, mais un loup (ou un ours) pour le loup (ou l'ours) "Mettez un ours, ou un loup aux prises avec un sauvage robuste ; agile, courageux comme ils sont tous, armé de pierres, et d’un bon bâton, et vous verrez que le péril sera tout au moins réciproque, et qu’après plusieurs expériences pareilles, les bêtes féroces, qui n’aiment point à s’attaquer l’une à l’autre, s’attaqueront peu volontiers à l’homme, qu’elles auront trouvé tout aussi féroce qu’elles." Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes - Première partie |
Freud
le malaise dans la civilisation est lié à l'agressité de l'homme qui est une propriété de l'espère tout entière "L'homme n'est pas un être doux, en besoin d'amour, qui serait tout au plus en mesure de se défendre quand il est attaqué, mais qu'au contraire il compte aussi à juste titre parmi ses aptitudes pulsionnelles une très forte part de penchant à l'agression. En conséquence de quoi, le prochain n'est pas seulement pour lui un aide et un objet sexuel possibles, mais aussi une tentation, celle de satisfaire sur lui son agression, d'exploiter sans dédommagement sa force de travail, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ce qu'il possède, de l'humilier, de lui causer des douleurs, de le martyriser et de le tuer: homo homini lupus ; qui donc, d'après toutes les expériences de la vie et de l'histoire, a le courage de contester cette maxime? Cette cruelle agression attend en règle générale une provocation ou se met au service d'une autre visée dont le but pourrait être atteint aussi par des moyens plus doux. Dans des circonstances qui lui sont favorables, lorsque sont absentes les contre-forces animiques qui d'ordinaire l'inhibent, elle se manifeste d'ailleurs spontanément, dévoilant dans l'homme la bête sauvage, à qui est étrangère l'idée de ménager sa propre espèce. Quiconque se remémore les atrocités de la migration des peuples, des invasions des Huns, de ceux qu'on appelait Mongols sous Gengis Khan et Tamerlan, de la conquête de Jérusalem par les pieux croisés, et même encore les horreurs de la dernière guerre mondiale ne pourra que s'incliner humblement devant la confirmation de cette conception par les faits." Sigmund Freud, Le Malaise dans la culture (1930), trad. P Cotet, R. Lainé et J. Stute-Cadiot, Éd. PUF, coll. Quadrige, 3` éd. corrigée, 1998, pp. 53-54. |
|
Lacan
parmi les "poncifs" il range : "Homo homini lupus" Les complexes familaux dans la formation de l'individu (1938) in Autres Ecrits, |
| Bibliographie : un article en
ligne sur la possibilité de
résoudre un conflit par une politique de "reconnaissance" "Sauver la face, sauver la paix. La politique de reconnaissance dans les crises internationales" 3 janvier 2009, Revue du Mauss http://www.journaldumauss.net/spip.php?article446 "Dans les quatre crises que je propose d’examiner, la plupart des décideurs ont davantage agi par sentiment de vulnérabilité que par sentiment d’opportunité. Les guerres effectivement déclenchées n’étaient pas inévitables. Ce qui caractérise ces crises qui ont culminé dans une guerre, c’est leur gestion contraire à une politique de reconnaissance. J’examine dans cette optique quatre grandes crises inter-étatiques, les unes au dénouement belliqueux (la guerre des Six Jours 1967, la guerre contre l’Irak 2003), les autres au dénouement pacifique (la crise de Cuba en 1962, la crise américano- libyenne de 1986 à 2004) afin de voir si une variation de la variable dépendante (la paix ou la guerre ) va de pair avec une variation de la variable indépendante (la présence ou l’absence d’une politique de reconnaissance). Thomas Lindemann |
| "La forme scientifique
consiste à scruter l’essence (Wesen)
des phénomènes
(Erscheinung) de guerre, de
montrer leur lien (Verbindung
mit der Natur der Dinge)
avec la nature de la chose » Clausewitz. |
Digression sur la nation et sur la distinction empire, nation (à partir de Gellner) |
| La définition de l'Etat
par Max Weber et la définition de la Nation par Gellner L'Etat : institution qui cherche à détenir le monopole de la violence physique légitime sur un territoire donné. (pas distinction d'avec l'Elgise) La Nation : structure qui chercher à détenir le monopole de la culture légitime sur un territoire étatique donné ; son moyen l'école Opposition empire argro-lettré et Etat-Nation. (Empire austro-hongrois avant 1914 et République Tchèque en 2014) |
| Ce n'est pas une très bonne
traduction |
Book I—On the Nature of War Chapter I What is War? 1. Introduction. |
| WE propose to consider first the
single elements of our subject, then
each branch or part, and, last of all, the whole, in all its
relations—therefore to advance from the simple to the complex. But it
is necessary for us to commence with a glance at the nature of the
whole, because it is particularly necessary that in the consideration
of any of the parts the whole should be kept constantly in view. 2. Definition. We shall not enter into any of the abstruse definitions of war used by publicists. We shall keep to the element of the thing itself, to a duel. War is nothing but a duel on an extensive scale. If we would conceive as a unit the countless number of duels which make up a war, we shall do so best by supposing to ourselves two wrestlers. Each strives by physical force to compel the other to submit to his will: his first object is to throw his adversary, and thus to render him incapable of further resistance. War therefore is an act of violence to compel our opponent to fulfil our will. Violence arms itself with the inventions of Art and Science in order to contend against violence. Self-imposed restrictions, almost imperceptible and hardly worth mentioning, termed usages of International Law, accompany it without essentially impairing its power. Violence, that is to say physical force (for there is no moral force without the conception of states and law), is therefore the means; the compulsory submission of the enemy to our will is the ultimate object. In order to attain this object fully, the enemy must be disarmed; and this is, correctly speaking, the real aim of hostilities in theory. It takes the place of the final object, and puts it aside in a manner as something not properly belonging to war. 3. Utmost use of force. Now, philanthropists may easily imagine there is a skilful method of disarming and overcoming an enemy without causing great bloodshed, and that this is the proper tendency of the art of War. However plausible this may appear, still it is an error which must be extirpated; for in such dangerous things as war, the errors which proceed from a spirit of benevolence are just the worst. As the use of physical power to the utmost extent by no means excludes the co-operation of the intelligence, it follows that he who uses force unsparingly, without reference to the quantity of bloodshed, must obtain a superiority if his adversary does not act likewise. By such means the former dictates the law to the latter, and both proceed to extremities, to which the only limitations are those imposed by the amount of counteracting force on each side. This is the way in which the matter must be viewed; and it is to no purpose, and even acting against one's own interest, to turn away from the consideration of the real nature of the affair, because the coarseness of its elements excites repugnance. If the wars of civilised people are less cruel and destructive than those of savages, the difference arises from the social condition both of states in themselves and in their relations to each other. Out of this social condition and its relations war arises, and by it war is subjected to conditions, is controlled and modified. But these things do not belong to war itself; they are only given conditions; and to introduce into the philosophy of war itself a principle of moderation would be an absurdity. The fight between men consists really of two different elements, the hostile feeling and the hostile view. In our definition of war, we have chosen as its characteristic the latter of these elements, because it is the most general. It is impossible to conceive the passion of hatred of the wildest description, bordering on mere instinct, without combining with it the idea of a hostile intention. On the other hand, hostile intentions may often exist without being accompanied by any, or at all events, by any extreme hostility of feeling. Amongst savages views emanating from the feelings, amongst civilised nations those emanating from the understanding, have the predominance; but this difference is not inherent in a state of barbarism, and in a state of culture in themselves it arises from attendant circumstances, existing institutions, etc., and therefore is not to be found necessarily in all cases, although it prevails in the majority. In short, even the most civilised nations may burn with passionate hatred of each other. We may see from this what a fallacy it would be to refer the war of a civilised nation entirely to an intelligent act on the part of the Government, and to imagine it as continually freeing itself more and more from all feeling of passion in such a way that at last the physical masses of combatants would no longer be required; in reality, their mere relations would suffice—a kind of algebraic action. Theory was beginning to drift in this direction until the facts of the last war taught it better. If war is an act of force, it belongs necessarily also to the feelings. If it does not originate in the feelings, it re-acts more or less upon them, and this more or less depends not on the degree of civilisation, but upon the importance and duration of the interests involved. Therefore, if we find civilised nations do not put their prisoners to death, do not devastate towns and countries, this is because their intelligence exercises greater influence on their mode of carrying on war, and has taught them more effectual means of applying force than these rude acts of mere instinct. The invention of gunpowder, the constant progress of improvements in the construction of firearms are sufficient proofs that the tendency to destroy the adversary which lies at the bottom of the conception of war, is in no way changed or modified through the progress of civilisation. We therefore repeat our proposition, that war is an act of violence, which in its application knows no bounds; as one dictates the law to the other, there arises a sort of reciprocal action, which in the conception, must lead to an extreme. This is the first reciprocal action, and the first extreme with which we meet (first reciprocal action). 4.—The aim is to disarm the enemy. We have already said that the aim of the action in war is to disarm the enemy, and we shall now show that this in theoretical conception at least is necessary. If our opponent is to be made to comply with our will, we must place him in a situation which is more oppressive to him than the sacrifice which we demand; but the disadvantages of this position must naturally not be of a transitory nature, at least in appearance, otherwise the enemy, instead of yielding, will hold out, in the prospect of a change for the better. Every change in this position which is produced by a continuation of the war, should therefore be a change for the worse, at least, in idea. The worst position in which a belligerent can be placed is that of being completely disarmed. If, therefore, the enemy is to be reduced to submission by an act of war, he must either be positively disarmed or placed in such a position that he is threatened with it according to probability. From this it follows that the disarming or overthrow of the enemy, whichever we call it, must always be the aim of warfare. Now war is always the shock of two hostile bodies in collision, not the action of a living power upon an inanimate mass, because an absolute state of endurance would not be making war; therefore what we have just said as to the aim of action in war applies to both parties. Here then is another case of reciprocal action. As long as the enemy is not defeated, I have to apprehend that he may defeat me, then I shall be no longer my own master, but he will dictate the law to me as I did to him. This is the second reciprocal action and leads to a second extreme (second reciprocal action). 5.—Utmost exertion of powers. If we desire to defeat the enemy, we must proportion our efforts to his powers of resistance. This is expressed by the product of two factors which cannot be separated, namely, the sum of available means and the strength of the will. The sum of the available means may be estimated in a measure, as it depends (although not entirely) upon numbers; but the strength of volition, is more difficult to determine, and can only be estimated to a certain extent by the strength of the motives. Granted we have obtained in this way an approximation to the strength of the power to be contended with, we can then take a review of our own means, and either increase them so as to obtain a preponderance, or in case we have not the resources to effect this, then do our best by increasing our means as far as possible. But the adversary does the same; therefore there is a new mutual enhancement, which in pure conception, must create a fresh effort towards an extreme. This is the third case of reciprocal action, and a third extreme with which we meet (third reciprocal action). 6.—Modification in the reality. Thus reasoning in the abstract, the mind cannot stop short of an extreme, because it has to deal with an extreme, with a conflict of forces left to themselves, and obeying no other but their own inner laws. If we should seek to deduce from the pure conception of war an absolute point for the aim which we shall propose and for the means which we shall apply, this constant reciprocal action would involve us in extremes, which would be nothing but a play of ideas produced by an almost invisible train of logical subtleties. If adhering closely to the absolute, we try to avoid all difficulties by a stroke of the pen, and insist with logical strictness that in every case the extreme must be the object, and the utmost effort must be exerted in that direction, such a stroke of the pen would be a mere paper law, not by any means adapted to the real world. Even supposing this extreme tension of forces was an absolute which could easily be ascertained, still we must admit that the human mind would hardly submit itself to this kind of logical chimera. There would be in many cases an unnecessary waste of power, which would be in opposition to other principles of statecraft; an effort of will would be required disproportioned to the proposed object, and which therefore it would be impossible to realise, for the human will does not derive its impulse from logical subtleties. But everything takes a different form when we pass from abstractions to reality. In the former everything must be subject to optimism, and we must imagine the one side as well as the other, striving after perfection and even attaining it. Will this ever take place in reality? It will if 1, War becomes a completely isolated act, which arises suddenly and is in no way connected with the previous history of the states; 2, If it is limited to a single solution, or to several simultaneous solutions; 3, If it contains within itself the solution perfect and complete, free from any reaction upon it, through a calculation beforehand of the political situation which will follow from it. 7.—War is never an isolated act. With regard to the first point, neither of the two opponents is an abstract person to the other, not even as regards that factor in the sum of resistance, which does not depend on objective things, viz., the will. This will is not an entirely unknown quantity; it indicates what it will be to-morrow by what it is to-day. War does not spring up quite suddenly, it does not spread to the full in a moment; each of the two opponents can, therefore, form an opinion of the other, in a great measure, from what he is and what he does; instead of judging of him according to what he, strictly speaking, should be or should do. But, now, man with his incomplete organisation is always below the line of absolute perfection, and thus these deficiencies, having an influence on both sides, become a modifying principle. 8.—It does not consist of a single instantaneous blow. The second point gives rise to the following considerations:— If war ended in a single solution, or a number of simultaneous ones, then naturally all the preparations for the same would have a tendency to the extreme, for an omission could not in any way be repaired; the utmost, then, that the world of reality could furnish as a guide for us would be the preparations of the enemy, as far as they are known to us; all the rest would fall into the domain of the abstract. But if the result is made up from several successive acts, then naturally that which precedes with all its phases may be taken as a measure for that which will follow, and in this manner the world of reality here again takes the place of the abstract, and thus modifies the effort towards the extreme. Yet every war would necessarily resolve itself into a single solution, or a sum of simultaneous results, if all the means required for the struggle were raised at once, or could be at once raised; for as one adverse result necessarily diminishes the means, then if all the means have been applied in the first, a second cannot properly be supposed. All hostile acts which might follow would belong essentially to the first, and form in reality only its duration. But we have already seen that even in the preparation for war the real world steps into the place of mere abstract conception—a material standard into the place of the hypotheses of an extreme: that therefore in that way both parties, by the influence of the mutual reaction, remain below the line of extreme effort, and therefore all forces are not at once brought forward. It lies also in the nature of these forces and their application, that they cannot all be brought into activity at the same time. These forces are the armies actually on foot, the country, with its superficial extent and its population, and the allies. In point of fact the country, with its superficial area and the population, besides being the source of all military force, constitutes in itself an integral part of the efficient quantities in war, providing either the theatre of war or exercising a considerable influence on the same. Now it is possible to bring all the moveable military forces of a country into operation at once, but not all fortresses, rivers, mountains, people, etc., in short not the whole country, unless it is so small that it may be completely embraced by the first act of the war. Further, the co-operation of allies does not depend on the will of the belligerents; and from the nature of the political relations of states to each other, this co-operation is frequently not afforded until after the war has commenced, or it may be increased to restore the balance of power. That this part of the means of resistance, which cannot at once be brought into activity, in many cases is a much greater part of the whole than might at first be supposed, and that it often restores the balance of power, seriously affected by the great force of the first decision, will be more fully shown hereafter. Here it is sufficient to show that a complete concentration of all available means in a moment of time, is contradictory to the nature of war. Now this, in itself, furnishes no ground for relaxing our efforts to accumulate strength to gain the first result, because an unfavourable issue is always a disadvantage to which no one would purposely expose himself, and also because the first decision, although not the only one, still will have the more influence on subsequent events, the greater it is itself. But the possibility of gaining a later result causes men to take refuge in that expectation owing to the repugnance, in the human mind, to making excessive efforts; and therefore forces are not concentrated and measures are not taken for the first decision with that energy which would otherwise be used. Whatever one belligerent omits from weakness, becomes to the other a real objective ground for limiting his own efforts, and thus again, through this reciprocal action, extreme tendencies are brought down to efforts on a limited scale. 9.—The result in war is never absolute. Lastly, even the final decision of a whole war is not always to be regarded as absolute. The conquered state often sees in it only a passing evil, which may be repaired in after times by means of political combinations. How much this also must modify the degree of tension and the vigour of the efforts made is evident in itself. 10.—The probabilities of real life take the place of the conceptions of the extreme and the absolute. In this manner the whole act of war is removed from under the rigorous law of forces exerted to the utmost. If the extreme is no longer to be apprehended, and no longer to be sought for, it is left to the judgment to determine the limits for the efforts to be made in place of it; and this can only be done on the data furnished by the facts of the real world by the laws of probability. Once the belligerents are no longer mere conceptions but individual states and governments, once the war is no longer an ideal, but a definite substantial procedure, then the reality will furnish the data to compute the unknown quantities which are required to be found. From the character, the measures, the situation of the adversary, and the relations with which he is surrounded, each side will draw conclusions by the law of probability as to the designs of the other, and act accordingly. 11.—The political object now reappears. Here, now, forces itself again into consideration a question which we had laid aside (see No. 2), that is, the political object of the war. The law of the extreme, the view to disarm the adversary, to overthrow him, has hitherto to a certain extent usurped the place of this end or object. Just as this law loses its force, the political object must again come forward. If the whole consideration is a calculation of probability based on definite persons and relations, then the political object, being the original motive, must be an essential factor in the product. The smaller the sacrifice we demand from our opponent, the smaller it may be expected will be the means of resistance which he will employ; but the smaller his are, the smaller will ours require to be. Further, the smaller our political object, the less value shall we set upon it, and the more easily shall we be induced to give it up altogether. Thus, therefore, the political object, as the original motive of the war, will be the standard for determining both the aim of the military force, and also the amount of effort to be made. This it cannot be in itself; but it is so in relation to both the belligerent states, because we are concerned with realities, not with mere abstractions. One and the same political object may produce totally different effects upon different people, or even upon the same people at different times; we can, therefore, only admit the political object as the measure, by considering it in its effects upon those masses which it is to move, and consequently the nature of those masses also comes into consideration. It is easy to see that thus the result may be very different according as these masses are animated with a spirit which will infuse vigour into the action or otherwise. It is quite possible for such a state of feeling to exist between two states that a very trifling political motive for war may produce an effect quite disproportionate, in fact, a perfect explosion. This applies to the efforts which the political object will call forth in the two states, and to the aim which the military action shall prescribe for itself. At times it may itself be that aim, as for example the conquest of a province. At other times, the political object itself is not suitable for the aim of military action; then such a one must be chosen as will be an equivalent for it, and stand in its place as regards the conclusion of peace. But, also, in this, due attention to the peculiar character of the states concerned is always supposed. There are circumstances in which the equivalent must be much greater than the political object in order to secure the latter. The political object will be so much the more the standard of aim and effort, and have more influence in itself, the more the masses are indifferent, the less that any mutual feeling of hostility prevails in the two states from other causes, and, therefore, there are cases where the political object almost alone will be decisive. If the aim of the military action is an equivalent for the political object, that action will in general diminish as the political object diminishes, and that in a greater degree the more the political object dominates; and so is explained how, without any contradiction in itself, there may be wars of all degrees of importance and energy, from a war of extermination, down to the mere use of an army of observation. This, however, leads to a question of another kind which we have hereafter to develop and answer. 12.— A suspension in the action of war unexplained by anything said as yet. However insignificant the political claims mutually advanced, however weak the means put forth, however small the aim to which military action is directed, can this action be suspended even for a moment? This is a question which penetrates deeply into the nature of the subject. Every transaction requires for its accomplishment a certain time which we call its duration. This may be longer or shorter, according as the person acting throws more or less despatch into his movements. About this more or less we shall not trouble ourselves here. Each person acts in his own fashion; but the slow person does not protract the thing because he wishes to spend more time about it, but because, by his nature, he requires more time, and if he made more haste, would not do the thing so well. This time, therefore, depends on subjective causes, and belongs to the length, so-called, of the action. If we allow now to every action in war this, its length, then we must assume, at first sight at least, that any expenditure of time beyond this length, that is, every suspension of hostile action appears an absurdity; with respect to this it must not be forgotten that we now speak not of the progress of one or other of the two opponents, but of the general progress of the whole action of the war. 13.—There is only one cause which can suspend the action, and this seems to be only possible on one side in any case. If two parties have armed themselves for strife, then a feeling of animosity must have moved them to it; as long now as they continue armed, that is do not come to terms of peace, this feeling must exist; and it can only be brought to a standstill by either side by one single motive alone, which is, that he waits for a more favourable moment for action. Now at first sight it appears that this motive can never exist except on one side, because it, eo ipso, must be prejudicial to the other. If the one has an interest in acting, then the other must have an interest in waiting. A complete equilibrium of forces can never produce a suspension of action, for during this suspension he who has the positive object (that is the assailant) must continue progressing; for if we should imagine an equilibrium in this way, that he who has the positive object, therefore the strongest motive, can at the same time only command the lesser means, so that the equation is made up by the product of the motive and the power, then we must say, if no alteration in this condition of equilibrium is to be expected, the two parties must make peace; but if an alteration is to be expected, then it can only be favourable to one side, and therefore the other has a manifest interest to act without delay. We see that the conception of an equilibrium cannot explain a suspension of arms, but that it ends in the question of the expectation of a more favourable moment. Let us suppose, therefore, that one of two states has a positive object, as, for instance, the conquest of one of the enemy's provinces—which is to be utilised in the settlement of peace. After this conquest his political object is accomplished, the necessity for action ceases, and for him a pause ensues. If the adversary is also contented with this solution he will make peace, if not he must act. Now, if we suppose that in four weeks he will be in a better condition to act, then he has sufficient grounds for putting off the time of action. But from that moment the logical course for the enemy appears to be to act that he may not give the conquered party the desired time. Of course, in this mode of reasoning a complete insight into the state of circumstances on both sides, is supposed. 14.—Thus a continuance of action will ensue which will advance towards a climax. If this unbroken continuity of hostile operations really existed, the effect would be that everything would again be driven towards the extreme; for irrespective of the effect of such incessant activity in inflaming the feelings and infusing into the whole a greater degree of passion, a greater elementary force, there would also follow from this continuance of action, a stricter continuity, a closer connection between cause and effect, and thus every single action would become of more importance, and consequently more replete with danger. But we know that the course of action in war has seldom or never this unbroken continuity, and that there have been many wars in which action occupied by far the smallest portion of time employed, the whole of the rest being consumed in inaction. It is impossible that this should be always an anomaly, and suspension of action in war must be possible, that is no contradiction in itself. We now proceed to show this, and how it is. 15.—Here, therefore, the principle of polarity is brought into requisition. As we have supposed the interests of one commander to be always antagonistic to those of the other, we have assumed a true polarity. We reserve a fuller explanation of this for another chapter, merely making the following observation on it at present. The principle of polarity is only valid when it can be conceived in one and the same thing, where the positive and its opposite the negative, completely destroy each other. In a battle both sides strive to conquer; that is true polarity, for the victory of the one side destroys that of the other. But when we speak of two different things, which have a common relation external to themselves, then it is not the things but their relations which have the polarity. 16.—Attack and defence are things differing in kind and of unequal force. Polarity is, therefore, not applicable to them. If there was only one form of war, to wit the attack of the enemy, therefore no defence; or in other words, if the attack was distinguished from the defence merely by the positive motive, which the one has and the other has not, but the fight precisely one and the same: then in this sort of fight every advantage gained on the one side would be a corresponding disadvantage on the other, and true polarity would exist. But action in war is divided into two forms, attack and defence, which, as we shall hereafter explain more particularly, are very different and of unequal strength. Polarity, therefore, lies in that to which both bear a relation, in the decision, but not in the attack or defence itself. If the one commander wishes the solution put off, the other must wish to hasten it; but certainly only in the same form of combat. If it is A's interest not to attack his enemy at present but four weeks hence, then it is B's interest to be attacked, not four weeks hence, but at the present moment. This is the direct antagonism of interests, but it by no means follows that it would be for B's interest to attack A at once. That is plainly something totally different. 17.—The effect of Polarity is often destroyed by the superiority of the Defence over the Attack, and thus the suspension of action in war is explained. If the form of defence is stronger than that of offence, as we shall hereafter show, the question arises, Is the advantage of a deferred decision as great on the one side as the advantage of the defensive form on the other? If it is not, then it cannot by its counter-weight overbalance the latter, and thus influence the progress of the action of the war. We see, therefore, that the impulsive force existing in the polarity of interests may be lost in the difference between the strength of the offensive and defensive, and thereby become ineffectual. If, therefore, that side for which the present is favourable is too weak to be able to dispense with the advantage of the defensive, he must put up with the unfavourable prospects which the future holds out; for it may still be better to fight a defensive battle in the unpromising future than to assume the offensive or make peace at present. Now, being convinced that the superiority of the defensive (rightly understood) is very great, and much greater than may appear at first sight, we conceive that the greater number of those periods of inaction which occur in war are thus explained without involving any contradiction. The weaker the motives to action are, the more will those motives be absorbed and neutralised by this difference between attack and defence, the more frequently, therefore, will action in warfare be stopped, as indeed experience teaches. 18.—A second ground consists in the imperfect knowledge of circumstances. But there is still another cause which may stop action in war, that is an incomplete view of the situation. Each commander can only fully know his own position; that of his opponent can only be known to him by reports, which are uncertain; he may, therefore, form a wrong judgment with respect to it upon data of this description, and, in consequence of that error, he may suppose that the initiative is properly with his adversary when it is really with himself. This want of perfect insight might certainly just as often occasion an untimely action as untimely inaction, and so it would in itself no more contribute to delay than to accelerate action in war. Still, it must always be regarded as one of the natural causes which may bring action in war to a standstill without involving a contradiction. But if we reflect how much more we are inclined and induced to estimate the power of our opponents too high than too low, because it lies in human nature to do so, we shall admit that our imperfect insight into facts in general must contribute very much to stop action in war, and to modify the principle of action. The possibility of a standstill brings into the action of war a new modification, inasmuch as it dilutes that action with the element of Time, checks the influence or sense of danger in its course, and increases the means of reinstating a lost balance of force. The greater the tension of feelings from which the war springs, the greater, therefore, the energy with which it is carried on, so much the shorter will be the periods of inaction; on the other hand, the weaker the principle of warlike activity, the longer will be these periods: for powerful motives increase the force of the will, and this, as we know, is always a factor in the product of force. 19.—Frequent periods of inaction in war remove it further from the absolute, and make it still more a calculation of probabilities. But the slower the action proceeds in war, the more frequent and longer the periods of inaction, so much the more easily can an error be repaired; therefore so much the bolder a general will be in his calculations, so much the more readily will he keep them below the line of absolute, and build everything upon probabilities and conjecture. Thus, according as the course of the war is more or less slow, more or less time will be allowed for that which the nature of a concrete case particularly requires, calculation of probability based on given circumstances. 20.—It therefore now only wants the element of chance to make of it a game, and in that element it is least of all deficient. We see from the foregoing how much the objective nature of war makes it a calculation of probabilities; now there is only one single element still wanting to make it a game, and that element it certainly is not without: it is chance. There is no human affair which stands so constantly and so generally in close connection with chance as war. But along with chance, the accidental, and along with it good luck, occupy a great place in war. 21.—As war is a game through its objective nature, so also is it through its subjective. If we now take a look at the subjective nature of war, that is at those powers with which it is carried on, it will appear to us still more like a game. The element in which the operations of war are carried on is danger; but which of all the moral qualities is the first in danger? Courage. Now certainly courage is quite compatible with prudent calculation, but still they are things of quite a different kind, essentially different qualities of the mind; on the other hand, daring reliance on good fortune, boldness, rashness, are only expressions of courage, and all these propensities of the mind look for the fortuitous (or accidental), because it is their element. We see therefore how from the commencement, the absolute, the mathematical as it is called, no where finds any sure basis in the calculations in the art of war; and that from the outset there is a play of possibilities, probabilities, good and bad luck, which spreads about with all the coarse and fine threads of its web, and makes war of all branches of human activity the most like a game of cards. 22.—How this accords best with the human mind in general. Although our intellect always feels itself urged towards clearness and certainty, still our mind often feels itself attracted by uncertainty. Instead of threading its way with the understanding along the narrow path of philosophical investigations and logical conclusions, in order almost unconscious of itself, to arrive in spaces where it feels itself a stranger, and where it seems to part from all well known objects, it prefers to remain with the imagination in the realms of chance and luck. Instead of living yonder on poor necessity, it revels here in the wealth of possibilities; animated thereby, courage then takes wings to itself, and daring and danger make the element into which it launches itself, as a fearless swimmer plunges into the stream. Shall theory leave it here, and move on, self satisfied with absolute conclusions and rules? Then it is of no practical use. Theory must also take into account the human element; it must accord a place to courage, to boldness, even to rashness. The art of war has to deal with living and with moral forces; the consequence of which is that it can never attain the absolute and positive. There is therefore everywhere a margin for the accidental; and just as much in the greatest things as in the smallest. As there is room for this accidental on the one hand, so on the other there must be courage and self-reliance in proportion to the room left. If these qualities are forthcoming in a high degree, the margin left may likewise be great. Courage and self reliance are therefore principles quite essential to war; consequently theory must only set up such rules as allow ample scope for all degrees and varieties of these necessary and noblest of military virtues. In daring there may still be wisdom also, and prudence as well, only that they are estimated by a different standard of value. 23.—War is always a serious means for a serious object. Its more particular definition. Such is war; such the commander who conducts it; such the theory which rules it. But war is no pastime; no mere passion for venturing and winning; no work of a free enthusiasm; it is a serious means for a serious object. All that appearance which it wears from the varying hues of fortune, all that it assimilates into itself of the oscillations of passion, of courage, of imagination, of enthusiasm, are only particular properties of this means. The war of a community—of whole nations and particularly of civilised nations—always starts from a political condition, and is called forth by a political motive. It is therefore a political act. Now if it was a perfect, unrestrained and absolute expression of force, as we had to deduce it from its mere conception, then the moment it is called forth by policy it would step into the place of policy, and as something quite independent of it would set it aside, and only follow its own laws, just as a mine at the moment of explosion cannot be guided into any other direction than that which has been given to it by preparatory arrangements. This is how the thing has really been viewed hitherto, whenever a want of harmony between policy and the conduct of a war has led to theoretical distinctions of the kind. But it is not so, and the idea is radically false. War in the real world, as we have already seen, is not an extreme thing which expends itself at one single discharge; it is the operation of powers which do not develop themselves completely in the same manner and in the same measure, but which at one time expand sufficiently to overcome the resistance opposed by inertia or friction, while at another they are too weak to produce an effect; it is therefore, in a certain measure, a pulsation of violent force more or less vehement, consequently making its discharges and exhausting its powers more or less quickly, in other words conducting more or less quickly to the aim, but always lasting long enough to admit of influence being exerted on it in its course, so as to give it this or that direction, in short to be subject to the will of a guiding intelligence. Now if we reflect that war has its root in a political object, then naturally this original motive which called it into existence should also continue the first and highest consideration in the conduct of it. Still the political object is no despotic lawgiver on that account; it must accommodate itself to the nature of the means, and through that is often completely changed, but it always remains that which has a prior right to consideration. Policy therefore is interwoven with the whole action of war, and must exercise a continuous influence upon it as far as the nature of the forces exploding in it will permit. 24.—War is a mere continuation of policy by other means. We see, therefore, that war is not merely a political act, but also a real political instrument, a continuation of political commerce, a carrying out of the same by other means. All beyond this which is strictly peculiar to war relates merely to the peculiar nature of the means which it uses. That the tendencies and views of policy shall not be incompatible with these means, the art of war in general and the commander in each particular case may demand, and this claim is truly not a trifling one. But however powerfully this may react on political views in particular cases, still it must always be regarded as only a modification of them; for the political view is the object, war is the means, and the means must always include the object in our conception. 25.—Diversity in the nature of wars. The greater and more powerful the motives of a war, the more it affects the whole existence of a people, the more violent the excitement which precedes the war, by so much the nearer will the war approach to its abstract form, so much the more will it be directed to the destruction of the enemy, so much the nearer will the military and political ends coincide, so much the more purely military and less political the war appears to be; but the weaker the motives and the tensions, so much the less will the natural direction of the military element—that is, force—be coincident with the direction which the political element indicates; so much the more must therefore the war become diverted from its natural direction, the political object diverge from the aim of an ideal war, and the war appear to become political. But that the reader may not form any false conceptions, we must here observe that, by this natural tendency of war, we only mean the philosophical, the strictly logical, and by no means the tendency of forces actually engaged in conflict, by which would be supposed to be included all the emotions and passions of the combatants. No doubt in some cases these also might be excited to such a degree as to be with difficulty restrained and confined to the political road; but in most cases such a contradiction will not arise, because, by the existence of such strenuous exertions a great plan in harmony therewith would be implied. If the plan is directed only upon a small object, then the impulses of feeling amongst the masses will be also so weak, that these masses will require to be stimulated rather than repressed. 26.—They may all be regarded as political acts. Returning now to the main subject, although it is true that in one kind of war the political element seems almost to disappear, whilst in another kind it occupies a very prominent place, we may still affirm that the one is as political as the other; for if we regard the state policy as the intelligence of the personified state, then amongst all the constellations in the political sky which it has to compute, those must be included which arise when the nature of its relations imposes the necessity of a great war. It is only if we understand by policy not a true appreciation of affairs in general, but the conventional conception of a cautious, subtle, also dishonest craftiness, averse from violence, that the latter kind of war may belong more to policy than the first. 27.—Influence of this view on the right understanding of military history, and on the foundations of theory. We see, therefore, in the first place, that under all circumstances war is to be regarded not as an independent thing, but as a political instrument; and it is only by taking this point of view that we can avoid finding ourselves in opposition to all military history. This is the only means of unlocking the great book and making it intelligible. Secondly, just this view shows us how wars must differ in character according to the nature of the motives and circumstances from which they proceed. Now, the first, the grandest, and most decisive act of judgment which the statesman and general exercises is rightly to understand in this respect the war in which he engages, not to take it for something, or to wish to make of it something which, by the nature of its relations, it is impossible for it to be. This is, therefore, the first, the most comprehensive of all strategical questions. We shall enter into this more fully in treating of the plan of a war. For the present we content ourselves with having brought the subject up to this point, and having thereby fixed the chief point of view from which war and its theory are to be studied. 28.—Result for theory. War is, therefore, not only a true chameleon, because it changes its nature in some degree in each particular case, but it is also, as a whole, in relation to the predominant tendencies which are in it, a wonderful trinity, composed of the original violence of its elements, hatred and animosity, which may be looked upon as blind instinct; of the play of probabilities and chance, which make it a free activity of the soul; and of the subordniate nature of a political instrument, by which it belongs purely to the reason. The first of these three phases concerns more the people; the second more the general and his army; the third more the Government. The passions which break forth in war must already have a latent existence in the peoples. The range which the display of courage and talents shall get in the realm of probabilities and of chance depends on the particular characteristics of the general and his army; but the political objects belong to the Government alone. These three tendencies, which appear like so many different lawgivers, are deeply rooted in the nature of the subject, and at the same time variable in degree. A theory which would leave any one of them out of account, or set up any arbitrary relation between them, would immediately become involved in such a contradiction with the reality, that it might be regarded as destroyed at once by that alone. The problem is, therefore, that theory shall keep itself poised in a manner between these three tendencies, as between three points of attraction. The way in which alone this difficult problem can be solved we shall examine in the book on the "Theory of War." In every case the conception of war, as here defined, will be the first ray of light which shows us the true foundation of theory, and which first separates the great masses, and allows us to distinguish them from one another. |
| 24. Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln | 24.—War is a mere continuation of policy by other means. |
So sehen wir also, daß der Krieg nicht bloß ein politischer Akt, sondern ein wahres politisches Instrument ist, eine Fortsetzung des politischen Verkehrs, ein Durchführen desselben mit anderen Mitteln. Was dem Kriege nun noch eigentümlich bleibt, bezieht sich bloß auf die eigentümliche Natur seiner Mittel. Daß die Richtungen und Absichten der Politik mit diesen Mitteln nicht in Widerspruch treten, das kann die Kriegskunst im allgemeinen und der Feldherr in jedem einzelnen Falle fordern, und dieser Anspruch ist wahrlich nicht gering; aber wie stark er auch in einzelnen Fällen auf die politischen Absichten zurückwirkt, so muß dies doch immer nur als eine Modifikation derselben gedacht werden, denn die politische Absicht ist der Zweck, der Krieg ist das Mittel, und niemals kann das Mittel ohne Zweck gedacht werden. |
We see, therefore, that war is not merely a political act, but also a real political instrument, a continuation of political commerce, a carrying out of the same by other means. All beyond this which is strictly peculiar to war relates merely to the peculiar nature of the means which it uses. That the tendencies and views of policy shall not be incompatible with these means, the art of war in general and the commander in each particular case may demand, and this claim is truly not a trifling one. But however powerfully this may react on political views in particular cases, still it must always be regarded as only a modification of them; for the political view is the object, war is the means, and the means must always include the object in our conception. |
| Les
trois "tendances" légistlatrices de la guerre |
nature de la tendance |
lieu spécificique de ces tendances |
| violence
originelle, haine, animosité, |
impulsion
naturelle aveugle : passion |
peuple |
| jeu
des probabilités, hasard |
libre
activité de l'âme : volonté |
commandement
et son armée |
| instrument
subordonnée de la politique |
relève de l'entendement
pur : entendement |
gouvernement |
| 28. Resultat für die
Theorie* |
Howard/Paret translation 28. THE CONSEQUENCES FOR THEORY |
Der Krieg ist also nicht nur ein wahres Chamäleon, weil er in jedem konkreten Falle seine Natur etwas ändert, sondern er ist auch seinen Gesamterscheinungen nach, in Beziehung auf die in ihm herrschenden Tendenzen eine wunderliche Dreifaltigkeit, zusammengesetzt aus der ursprünglichen Gewaltsamkeit seines Elementes, dem Haß und der Feindschaft, die wie ein blinder Naturtrieb anzusehen sind, aus dem Spiel der Wahrscheinlichkeiten und des Zufalls, die ihn zu einer freien Seelentätigkeit machen, und aus der untergeordneten Natur eines politischen Werkzeuges, wodurch er dem bloßen Verstande anheimfällt. Die erste dieser drei Seiten ist mehr dem Volke, die zweite mehr dem Feldherrn und seinem Heer, die dritte mehr der Regierung zugewendet. Die Leidenschaften, welche im Kriege entbrennen sollen, müssen schon in den Völkern vorhanden sein; der Umfang, welchen das Spiel des Mutes und Talents im Reiche der Wahrscheinlichkeiten des Zufalls bekommen wird, hängt von der Eigentümlichkeit des Feldherrn und des Heeres ab, die politischen Zwecke aber gehören der Regierung allein an. Diese drei Tendenzen, die als ebenso viele verschiedene Gesetzgebungen erscheinen, sind tief in der Natur des Gegenstandes gegründet und zugleich von veränderlicher Größe. Eine Theorie, welche eine derselben unberücksichtigt lassen oder zwischen ihnen ein willkürliches Verhältnis feststellen wollte, würde augenblicklich mit der Wirklichkeit in solchen Widerspruch geraten, daß sie dadurch allein schon wie vernichtet betrachtet werden müßte. Die Aufgabe ist also, daß sich die Theorie zwischen diesen drei Tendenzen wie zwischen drei Anziehungspunkten schwebend erhalte. Auf welchem Wege dieser schwierigen Aufgabe noch am ersten genügt werden könnte, wollen wir in dem Buche von der Theorie des Krieges untersuchen. In jedem Fall wird die hier geschehene Feststellung des Begriffs vom Kriege der erste Lichtstrahl, der für uns in den Fundamentalbau der Theorie fällt, der zuerst die großen Massen sondern und sie uns unterscheiden lassen wird. |
War is more than a true chameleon that slightly adapts its characteristics to the given case. As a total phenomenon its dominant tendencies always make war a paradoxical trinity--composed of primordial violence, hatred, and enmity, which are to be regarded as a blind natural force; of the play of chance and probability within which the creative spirit is free to roam; and of its element of subordination, as an instrument of policy, which makes it subject to reason alone. The first of these three aspects mainly concerns the people; the second the commander and his army; the third the government. The passions that are to be kindled in war must already be inherent in the people; the scope which the play of courage and talent will enjoy in the realm of probability and chance depends on the particular character of the commander and the army; but the political aims are the business of government alone. These three tendencies are like three different codes of law, deep-rooted in their subject and yet variable in their relationship to one another. A theory that ignores any one of them or seeks to fix an arbitrary relationship between them would conflict with reality to such an extent that for this reason alone it would be totally useless. Our task therefore is to develop a theory that maintains a balance between these three tendencies, like an object suspended between three magnets. |
| SIEYÈS
Qu’est-ce que le Tiers-État ? Chapitre II Qu’est-ce que le Tiers-État a été jusqu’à présent ? Rien. Nous n’examinerons point l’état de servitude où le Peuple a gémi longtemps, non plus que celui de contraintes et d’humiliation où il est encore retenu. Sa condition civile a changé ; elle doit changer encore ! il est bien impossible que la Nation en corps, ou même qu’aucun Ordre en particulier devienne libre, si le Tiers-État ne l’est pas. On n’est pas libre par des privilèges, mais par les droits de Citoyen : droits qui appartiennent à tous. Que si les Aristocrates entreprennent, au prix même de cette liberté, dont ils se montreraient indignes, de retenir le Peuple dans l’oppression, il osera demander à quel titre. Si l’on répond à titre de conquête : il faut en convenir, ce sera vouloir remonter un peu haut. Mais le tiers ne doit pas craindre de remonter dans les temps passés. Il se rapportera à l’année qui a précédé la conquête ; et puisqu’il est aujourd’hui assez fort pour se pas se laisser conquérir, sa résistance sans doute sera plus efficace. Pourquoi ne renverrait-il pas dans les forêts de la Franconie toutes ces familles qui conservent la folle prétention d’être issues de la race des Conquérants, et d’avoir succédé à des droits de conquête ? La Nation, alors épurée, pourra se consoler, je pense, d’être réduite à ne se plus croire composée que des descendants des Gaulois et des Romains. En vérité, si l’on tient à vouloir distinguer naissance et naissance, ne pourrait-on pas révéler à nos pauvres concitoyens que celle qu’on tire des Gaulois et des Romains, vaut au moins autant que celle qui viendrait des Sicambres, des Welchez, et autre Sauvages sortis des bois et des marais de l’ancienne Germanie ? Oui, dira-t-on ; mais la conquête a dérangé tous les rapports, et la Noblesse de naissance a passé du côté des Conquérants. Eh bien ! il faut la faire repasser de l’autre côté ; le Tiers redeviendra Noble en devenant Conquérant à son tour. Mais, si tout est mêlé dans les races, si le sang des Francs, qui n’en vaudrait pas mieux séparé, coule confondu avec celui des Gaulois, si les ancêtres du Tiers-État sont les pères de la Nation entière, ne peut-on espérer de voir cesser un jour ce long parricide qu’une classe s’honore de commettre journellement contre toutes les autres ? |
| http://classiques.uqac.ca/classiques/sieyes_emmanuel_joseph/qu_est_ce_que_tiers_etat/qu_est_ce_que_tiers_etat.html |
| La Nouvelle Gazette Rhénane K. Marx - F. Engels Les journées de juin 1848 Le 23 juin (extraits) |
| La révolution de Juin est
la révolution du désespoir et c'est avec la colère
muette, avec le sang-froid sinistre du désespoir qu'on combat
pour elle; les ouvriers savent qu'ils mènent une lutte à
la vie et à la mort, et devant la gravité terrible de
cette lutte le vif esprit français lui-même se tait. L'histoire ne nous offre que deux moments ayant quelque ressemblance avec la lutte qui continue probablement encore en ce moment à Paris : la guerre des esclaves de Rome et l'insurrection lyonnaise de 1834. L'ancienne devise lyonnaise, elle aussi : « Vivre en travaillant ou mourir en combattant », a de nouveau surgi, soudain, au bout de quatorze ans, inscrite sur les drapeaux. La révolution de Juin est la première qui divise vraiment la société tout entière en deux grands camps ennemis qui sont représentés par le Paris de l'est et le Paris de l'ouest. L'unanimité de la révolution de Février a disparu, cette unanimité poétique, pleine d'illusions éblouissantes, pleine de beaux mensonges et qui fut représentée si dignement par le traître aux belles phrases, Lamartine. Aujourd'hui, la gravité implacable de la réalité met en pièces toutes les promesses séduisantes du 25 février. Les combattants de Février luttent aujourd'hui eux-mêmes les uns contre les autres, et, ce qu'on n'a encore jamais vu, il n'y a plus d'indifférence, tout homme en état de porter les armes participe vraiment à la lutte sur la barricade ou devant la barricade. |
| http://wwhw.marxists.org/francais/engels/works/1848/06/fe18480628c.htm |
| Les luttes de
classes en France K. Marx (1850) Introduction par Friedrich Engels (1895) |
Le présent ouvrage de Marx fut sa première tentative d'explication d'un fragment d'histoire contemporaine à l'aide de sa conception matérialiste et en partant des données économiques qu'impliquait la situation. Dans le Manifeste communiste, la théorie avait été employée pour faire une vaste esquisse de toute l'histoire moderne, dans les articles de Marx et de moi qu'avait publiés la Neue Rheinische Zeitung nous l'avions utilisée pour interpréter les événements politiques du moment. Ici, il s'agissait, par contre, de démontrer l'enchaînement interne des causes dans le cours d'un développement de plusieurs années qui fut pour toute l'Europe aussi critique que typique, c'est-à-dire dans l'esprit de l'auteur, de réduire les événements politiques aux effets de causes, en dernière analyse, économiques. Dans l'appréciation d'événements et de suites d'événements empruntés à l'histoire quotidienne, on ne sera jamais en mesure de remonter jusqu'aux dernières causes économiques. Même aujourd'hui où la presse technique compétente fournit des matériaux si abondants, il sera encore impossible, même en Angleterre, de suivre jour par jour la marche de l'industrie et du commerce sur le marché mondial et les modifications survenues dans les méthodes de production, de façon à pouvoir, à n'importe quel moment, faire le bilan d'ensemble de ces facteurs infiniment complexes et toujours changeants, facteurs dont, la plupart du temps, les plus importants agissent, en outre, longtemps dans l'ombre avant de se manifester soudain violemment au grand jour. Une claire vision d'ensemble de l'histoire économique d'une période donnée n'est jamais possible sur le moment même; on ne peut l'acquérir qu'après coup, après avoir rassemblé et sélectionné les matériaux. La statistique est ici une ressource nécessaire et elle suit toujours en boitant. Pour l'histoire contemporaine en cours on ne sera donc que trop souvent contraint de considérer ce facteur, le plus décisif, comme constant, de traiter la situation économique que l'on trouve au début de la période étudiée comme donnée et invariable pour toute celle-ci ou de ne tenir compte que des modifications à cette situation qui résultent des événements, eux-mêmes évidents, et apparaissent donc clairement elles aussi. En conséquence la méthode matérialiste ne devra ici que trop souvent se borner à ramener les conflits politiques à des luttes d'intérêts entre les classes sociales et les fractions de classes existantes, impliquées par le développement économique, et à montrer que les divers partis politiques sont l'expression politique plus ou moins adéquate de ces mêmes classes et fractions de classes. Il est bien évident que cette négligence inévitable des modifications simultanées de la situation économique, c'est-à-dire de la base même de tous les événements à examiner, ne peut être qu'une source d'erreurs. Mais toutes les conditions d'un exposé d'ensemble de l'histoire qui se fait sous nos yeux renferment inévitablement des sources d'erreurs; or, cela ne détourne personne d'écrire l'histoire du présent. Lorsque Marx entreprit ce travail, cette source d'erreurs était encore beaucoup plus inévitable. Suivre pendant l'époque révolutionnaire de 1848-1849 les fluctuations économiques qui se produisaient au même moment, ou même en conserver une vue d'ensemble, était chose purement impossible. Il en fut de même pendant les premiers mois de l'exil à Londres - pendant l'automne et l'hiver de 1849-1850. Or, ce fut précisément le moment où Marx commença son travail. Et malgré ces circonstances défavorables, sa connaissance exacte de la situation économique de la France avant la révolution de Février, ainsi que de l'histoire politique de ce pays depuis lors, lui a permis de faire une description des événements qui en révèle l'enchaînement interne d'une façon qui reste inégalée, description qui a subi brillamment la double épreuve que Marx lui-même lui a imposée par la suite. La première épreuve eut lieu lorsque Marx, à partir du printemps de 1850, retrouva le loisir de se livrer à des études économiques et qu'il entreprit tout d'abord l'étude de l'histoire économique des dix dernières années. Ainsi, des faits eux-mêmes, il tira une vue tout à fait claire de ce que jusque-là il n'avait fait que déduire, moitié a priori, de matériaux insuffisants : à savoir que la crise commerciale mondiale de 1847 avait été la véritable mère des révolutions de Février et de Mars [1] et que la prospérité industrielle, revenue peu à peu dès le milieu de 1848 et parvenue à son apogée en 1849 et 1850, fut la force vivifiante où la réaction européenne puisa une nouvelle vigueur. Ce fut une épreuve décisive. Tandis que dans les trois premiers articles (parus dans les fascicules de janvier, février et mars de la Neue Rheinische Zeitung, revue d'économie politique, Hambourg, 1850) passe encore l'espoir d'un nouvel essor prochain de l'énergie révolutionnaire, le tableau historique du dernier fascicule double (de mai à octobre) paru en automne 1850 et qui fut composé par Marx et par moi, rompt une fois pour toutes avec ces illusions : « Une nouvelle révolution n'est possible qu'à la suite d'une nouvelle crise. Mais elle est aussi sûre que celle-ci. » Ce fut d'ailleurs la seule modification essentielle à faire. Il n'y avait absolument rien de changé à l'interprétation des événements donnée dans les chapitres précédents ni aux enchaînements de cause à effet qui y étaient établis, ainsi que le prouve la suite du récit donnée dans ce même tableau d'ensemble et qui va du 10 mars à l'automne de 1850. Voilà pourquoi j'ai inséré cette suite comme quatrième article dans cette nouvelle édition. La deuxième épreuve fut plus dure encore. Immédiatement après le coup d'État de Louis Bonaparte du 2 décembre 1851, Marx travailla de nouveau à l'histoire de France de février 1848 jusqu'à cet événement qui marquait provisoirement la fin de la période révolutionnaire. (Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, 3° édition, Meissner Hambourg, 1885.) [2] Dans cette brochure, la période qu'il expose dans notre ouvrage est traitée à nouveau, quoique de façon plus brève. Que l'on compare avec la nôtre cette deuxième description écrite à la lumière de l'événement décisif survenu plus d'un an après, et l'on constatera que l'auteur n'eut que fort peu à y changer. Ce qui donne encore à notre ouvrage une importance toute particulière, c'est le fait qu'il prononce pour la première fois sous sa forme condensée la formule par laquelle, à l'unanimité, les partis ouvriers de tous les pays du monde réclament la réorganisation de l'économie : l'appropriation des moyens de production par la société. Dans le deuxième chapitre, à propos du « droit au travail », qui est caractérisé comme « la première formule maladroite dans laquelle se résument les prétentions révolutionnaires du prolétariat », on peut lire : Mais derrière le droit au travail il y a le pouvoir sur le capital, derrière le pouvoir sur le capital, l'appropriation des moyens de production, leur subordination à la classe ouvrière associée, c'est-à-dire la suppression du travail salarié ainsi que du capital et de leurs rapports réciproques. Donc, pour la première fois, se trouve formulée ici la thèse par laquelle le socialisme ouvrier moderne se distingue nettement aussi bien de toutes les diverses nuances du socialisme féodal, bourgeois, petit-bourgeois, etc. que de la confuse communauté des biens du socialisme utopique et du communisme ouvrier primitif. Si, plus tard, Marx a élargi la formule à l'appropriation des moyens d'échange eux aussi, cette extension qui, d'ailleurs, allait de soi après le Manifeste communiste, n'exprimait qu'un corollaire de la thèse principale. Puis, quelques gens avisés en Angleterre ont encore ajouté dernièrement que l'on doit transférer aussi les « moyens de répartition » à la société. Il serait difficile à ces messieurs de dire quels sont donc ces moyens de répartition économiques différents des moyens de production et d'échange, à moins que l'on ne parle des moyens de répartition politiques, impôts, secours aux indigents, y compris le Sachsenwald [3] et autres dotations. Mais, premièrement, ceux-ci ne sont-ils pas déjà maintenant des moyens de répartition en possession de la collectivité, de l'État ou de la commune, et, deuxièmement, ne voulons-nous pas précisément les faire disparaître ? *
** Lorsque éclata la révolution de Février, nous étions tous, quant à la façon dont nous concevions les conditions et le cours des mouvements révolutionnaires, sous la hantise de l'expérience historique passée, et notamment de celle de la France. N'était-ce pas précisément de cette dernière qui, depuis 1789, avait dominé toute l'histoire de l'Europe, qu'était parti encore une fois le signal du bouleversement général ? Aussi, était-il évident et inévitable que nos idées sur la nature et la marche de la révolution « sociale » proclamée à Paris en février 1848, de la révolution du prolétariat, fussent fortement teintées des souvenirs des modèles de 1789 et de 1830 ! Et, notamment, lorsque le soulèvement de Paris trouva son écho dans les soulèvements victorieux de Vienne, Milan et Berlin, lorsque toute l'Europe jusqu'à la frontière russe fut entraînée. dans le mouvement, lorsque ensuite au mois de juin à Paris la première grande bataille pour le pouvoir se livra entre le prolétariat et la bourgeoisie, lorsque la victoire même de sa classe ébranla la bourgeoisie de tous les pays au point qu'elle se réfugia à nouveau dans les bras de la réaction monarchiste-féodale qu'on venait seulement de renverser, nous ne pouvions dans les circonstances d'alors absolument plus douter que le grand combat décisif était commencé, qu'il faudrait le livrer dans une seule période révolutionnaire de longue durée et pleine d'alternatives, mais qu'il ne pouvait se terminer que par la victoire définitive du prolétariat. Après les défaites de 1849, nous ne partagions nullement les illusions de la démocratie vulgaire groupée autour des Gouvernements provisoires in partibus [4]. Celle-ci comptait sur une victoire prochaine, décisive une fois pour toutes, du « peuple » sur les « oppresseurs », nous sur une longue lutte, après l'élimination des « oppresseurs », entre les éléments antagonistes cachés précisément dans ce « peuple ». la démocratie vulgaire attendait le nouveau déclenchement du jour au lendemain; dès l'automne de 1850, nous déclarions que la première tranche au moins de la période révolutionnaire était close et qu'il n'y avait rien à attendre jusqu'à l'explosion d'une nouvelle crise économique mondiale. C'est pourquoi nous fûmes mis au ban comme des traîtres à la révolution par les mêmes gens qui, par la suite, ont fait presque sans exception leur paix avec Bismarck, pour autant que Bismarck trouva qu'ils en valaient la peine. Mais l'histoire nous a donné tort à nous aussi, elle a révélé que notre point de vue d'alors était une illusion. Elle est encore allée plus loin : elle n'a pas seulement dissipé notre erreur d'alors, elle a également bouleversé totalement les conditions dans lesquelles le prolétariat doit combattre. Le mode de lutte de 1848 est périmé aujourd'hui sous tous les rapports, et c'est un point qui mérite d'être examiné de plus près à cette occasion. Toutes les révolutions ont abouti jusqu'à présent à l'évincement de la domination d'une classe déterminée par celle d'une autre; mais toutes les classes dominantes n'étaient jusqu'à présent que de petites minorités par rapport à la masse du peuple dominé. C'est ainsi qu'une minorité dominante était renversée, qu'une autre minorité se saisissait à sa place du gouvernail de l'État et transformait les institutions publiques selon ses intérêts. Et, chaque fois, cette minorité était le groupe rendu apte au pouvoir et qualifié par l'état du développement économique et c'est précisément pour cela, et pour cela seulement, que lors du bouleversement la majorité dominée ou bien y participait en faveur de la minorité ou du moins l'acceptait paisiblement. Mais si nous faisons abstraction du contenu concret de chaque cas, la forme commune de toutes ces révolutions était d'être des révolutions de minorités. Même lorsque la majorité y collaborait, elle ne le faisait - sciemment ou non - qu'au service d'une minorité; mais par là, et déjà aussi du fait de l'attitude passive et sans résistance de la majorité, la minorité avait l'air d'être le représentant du peuple tout entier. Après le premier grand succès, c'était la règle que la minorité victorieuse se scindât en deux : une des moitiés était satisfaite du résultat obtenu, l'autre voulait encore aller plus loin, posait de nouvelles revendications qui étaient au moins partiellement dans l'intérêt réel ou prétendu de la grande foule du peuple. Ces revendications plus radicales s'imposaient bien dans certains cas, mais fréquemment pour un instant seulement; le parti plus modéré reprenait la suprématie, les dernières acquisitions étaient perdues à nouveau en totalité ou partiellement; les vaincus criaient alors à la trahison ou rejetaient la défaite sur le hasard. Mais en réalité la chose était le plus souvent ainsi, les conquêtes de la première victoire n'étaient assurées que par la deuxième victoire du parti plus radical une fois cela acquis, c'est-à-dire ce qui était momentanément nécessaire, les éléments radicaux disparaissaient à nouveau du théâtre d'opérations et leurs succès aussi. Toutes les révolutions des temps modernes, à commencer par la grande révolution anglaise du XVIIe siècle [5], présentèrent ces caractéristiques qui paraissaient inséparables de toute lutte révolutionnaire. Elles parurent également applicables aux luttes du prolétariat pour son émancipation; d'autant plus applicables que, précisément, en 1848, on pouvait compter les gens capables de comprendre, ne fût-ce que passablement, dans quelle direction il fallait chercher cette émancipation. Même à Paris, les masses prolétariennes elles-mêmes, n'avaient encore, après la victoire, absolument aucune idée claire de la voie à suivre. Et pourtant le mouvement était là instinctif, spontané, impossible à étouffer. N'était-ce pas là précisément la situation dans laquelle devait nécessairement réussir, une révolution conduite, il est vrai, par une minorité, mais cette fois non pas dans l'intérêt de la minorité, mais dans l'intérêt le plus immédiat de la majorité ? Si dans toutes les périodes révolutionnaires un peu longues, les grandes masses populaires pouvaient être gagnées si facilement par de simples supercheries présentées de façon plausible par les minorités poussant de l'avant, comment auraient-elles été moins accessibles à des idées qui étaient le reflet le plus caractéristique de leur situation économique et n'étaient autre chose que l'expression claire, rationnelle de leurs besoins qu'elles ne comprenaient pas encore elles-mêmes et dont elles n'avaient qu'un sentiment encore indistinct ? Cet état d'esprit révolutionnaire des masses, il est vrai, avait presque toujours fait place, et très vite le plus souvent, à une dépression ou même à un revirement en sens contraire, dès que l'illusion était dissipée et que la déception s'était produite. Mais il ne s'agissait point ici de supercheries, mais au contraire de la réalisation des intérêts les plus spécifiques de la grande majorité elle-même, d'intérêts qui, il est vrai, n'étaient point du tout clairs alors à cette grande majorité, mais qui devaient nécessairement lui devenir bientôt assez clairs au cours de la réalisation pratique par l'aspect convaincant de leur évidence. Et si, au printemps de 1850, comme Marx l'a démontré dans son troisième article, le développement de la République bourgeoise sortie de la révolution « sociale » de 1848 avait désormais concentré le véritable pouvoir dans les mains de la grande bourgeoisie - qui était en outre d'esprit monarchiste - et avait groupé par contre toutes les autres classes de la société, paysans comme petits bourgeois, autour du prolétariat, de telle sorte que dans et après la victoire commune ce n'étaient pas eux; mais bien le prolétariat qui avait profité des leçons de l'expérience et qui devait nécessairement devenir le facteur décisif, - n'y avait-il pas là toutes les perspectives de transformation de cette révolution de la minorité en révolution de la majorité ? L'histoire nous a donné tort à nous et à tous ceux qui pensaient de façon analogue. Elle a montré clairement que l'état du développement économique sur le continent était alors bien loin encore d'être mûr pour la suppression de la production capitaliste; elle l'a prouvé par la révolution économique qui depuis 1848 a gagné tout le continent et qui n'a véritablement donné droit de cité qu'à ce moment à la grande industrie en France, en Autriche, en Hongrie, en Pologne et dernièrement en Russie et fait vraiment de l'Allemagne un pays industriel de premier ordre - tout cela sur une base capitaliste, c'est-à-dire encore très capable d'extension en 1848. Or, c'est précisément cette révolution industrielle qui, la première, a partout fait la lumière dans les rapports de classes, supprimé une foule d'existences intermédiaires provenant de la période manufacturière et en Europe orientale issues même des corps de métier, engendrant une véritable bourgeoisie et un véritable prolétariat de grande industrie et les poussant l'un et l'autre au premier plan du développement social. Mais, c'est à ce moment seulement, que la lutte de ces deux grandes classes qui, en 1848, en dehors de l'Angleterre, ne s'était produite qu'à Paris et tout au plus dans quelques grands centres industriels, s'élargit à toute l'Europe, prenant une intensité encore inimaginable en 1848. Alors, c'était encore la pléiade des évangiles fumeux de petits groupes avec leurs panacées, aujourd'hui c'est la seule théorie de Marx universellement reconnue, d'une clarté lumineuse et qui formule de façon décisive les fins dernières de la lutte; alors, c'étaient les masses séparées et divisées selon les localités et les nationalités, unies seulement par le sentiment de leurs souffrances communes, peu évoluées, ballottées entre l'enthousiasme et le désespoir, aujourd'hui, c'est la seule grande armée internationale des socialistes, progressant sans cesse, croissant chaque jour en nombre, en organisation, en discipline, en clairvoyance et en certitude de victoire. Même si cette puissante armée du prolétariat n'a toujours pas atteint le but, si, bien loin de remporter la victoire d'un seul grand coup, il faut qu'elle progresse lentement de position en position dans un combat dur, obstiné, la preuve est faite une fois pour toutes qu'il était impossible en 1848 de conquérir la transformation sociale par un simple coup de main. Une bourgeoisie divisée en deux fractions, monarchistes dynastiques [6], mais qui demandait avant toute chose le calme et la sécurité pour ses affaires financières; en face d'elle, un prolétariat vaincu, il est vrai, mais toujours menaçant et autour duquel petits bourgeois et paysans se groupaient de plus en plus - la menace continuelle d'une explosion violente qui, malgré tout, n'offrait aucune perspective de solution définitive, - telle était la situation qu'on aurait dit faite pour le coup d'État du troisième larron, du prétendant pseudo-démocratique Louis Bonaparte. Se servant de l'armée, celui-ci mit fin le 2 décembre 1851 à la situation tendue, assurant bien à l'Europe la tranquillité intérieure, mais la gratifiant, par contre, d'une nouvelle ère de guerres [7]. La période des révolutions par en bas était close pour un instant; une période de révolutions par en haut lui succéda. La réaction impériale de 1851 fournit une nouvelle preuve du manque de maturité des aspirations prolétariennes de cette époque. Mais elle devait elle-même créer les conditions dans lesquelles celles-ci ne pouvaient manquer de mûrir. La tranquillité intérieure assura le plein développement du nouvel essor industriel, la nécessité d'occuper l'armée et de détourner vers l'extérieur les courants révolutionnaires engendra les guerres où Bonaparte chercha, sous le prétexte de faire prévaloir le « principe des nationalités », à ramasser quelques annexions pour la France. Son imitateur Bismarck adopta la même politique pour la Prusse : il fit son coup d'État, sa révolution par en haut en 1866 face à la Confédération allemande et à l'Autriche, et tout autant face à la Chambre des conflits de Prusse. Mais l'Europe était trop petite pour deux Bonaparte, et l'ironie de l'histoire voulut que Bismarck renversât Bonaparte et que le roi Guillaume de Prusse instaurât non seulement le petit Empire allemand, mais aussi la République française [8]. Or, le résultat général fut qu'en Europe l'indépendance et l'unification interne des grandes nations, à la seule exception de la Pologne, furent établies en fait, A l'intérieur, il est vrai, de limites relativement modestes - mais néanmoins dans des proportions suffisantes pour que le processus de développement de la classe ouvrière ne trouvât plus d'obstacles sérieux dans les complications nationales. Les fossoyeurs de la révolution de 1848 étaient devenus ses exécuteurs testamentaires. Et à côté d'eux se dressait déjà menaçant l'héritier de 1848, le prolétariat, dans l'Internationale. Après la guerre de 1870-1871, Bonaparte disparaît de la scène, et la mission de Bismarck est terminée, de sorte qu'il peut de nouveau redescendre au rang de vulgaire hobereau. Mais c'est la Commune de Paris qui constitue la fin de cette période. Une tentative sournoise de Thiers pour voler ses canons à la garde nationale de Paris, provoqua une insurrection victorieuse. Il s'avéra de nouveau qu'à Paris il n'y a plus d'autre révolution possible qu'une révolution prolétarienne. Après la victoire, le pouvoir échut tout à fait de lui-même, de façon absolument indiscutée à la classe ouvrière. Et on put voir une fois de plus combien à ce moment-là, ce pouvoir de la classe ouvrière était encore impossible vingt ans après l'époque que nous décrivons ici. D'une part, la France fit faux bond à Paris, le regardant perdre son sang sous les balles de Mac-Mahon, d'autre part, la Commune se consuma dans la querelle stérile des deux partis qui la divisaient, les blanquistes (majorité) et les proudhoniens (minorité), tous deux ne sachant ce qu'il y avait à faire. Le cadeau de la victoire en 1871 ne porta pas plus de fruits que le coup de main en 1848. Avec la Commune de Paris on crut le prolétariat combatif définitivement enterré. Mais, tout au contraire, c'est de la Commune et de la guerre franco-allemande que date son essor le plus formidable. Le bouleversement total de toutes les conditions de la guerre par l'enrôlement de toute la population apte à porter les armes dans les armées qui ne se comptèrent plus que par millions, les armes à feu, les obus, et les explosifs d'un effet inconnu jusque-là, d'une part mirent une brusque fin à la période des guerres bonapartistes et assurèrent le développement industriel paisible en rendant impossible toute autre guerre qu'une guerre mondiale d'une cruauté inouïe et dont l'issue serait absolument incalculable. D'autre part, du fait que les dépenses de guerre s'accroissaient en progression géométrique, les impôts s'élevèrent à une hauteur vertigineuse, jetant les classes populaires les plus pauvres dans les bras du socialisme. L'annexion de l’Alsace-Lorraine, cause immédiate de la folle course aux armements, a bien pu exciter le chauvinisme des bourgeoisies française et allemande l'un contre l'autre; pour les ouvriers des deux pays, elle devint un élément nouveau d'union. Et l'anniversaire de la Commune de Paris fut le premier jour de fête universel de tout le prolétariat. La guerre de 1870-1871 et la défaite de la Commune avaient, comme Marx l'avait prédit, transféré pour un temps de France en Allemagne le centre de gravité du mouvement ouvrier européen. En France, il va de soi qu'il fallut des années pour se remettre de la saignée de mai 1871. En Allemagne, par contre, où l'industrie, favorisée en outre par la manne des milliards français [9], se développait vraiment comme en serre chaude à un rythme toujours accéléré, la social-démocratie grandissait avec une rapidité et un succès plus grands encore. Grâce à l'intelligence avec laquelle les ouvriers allemands ont utilisé le suffrage universel institué en 1866, l'accroissement étonnant du Parti apparaît ouvertement aux yeux du monde entier dans des chiffres indiscutables. En 1871, 102 000; en 1874, 352 000; en 1877, 493 000 voix social-démocrates. Ensuite, vint la reconnaissance de ces progrès par les autorités supérieures sous la forme de la loi contre les socialistes [10]; le Parti fut momentanément dispersé, le nombre de voix tomba en 1881 à 312 000. Mais ce coup fut rapidement surmonté, et, dès lors, c'est seulement sous la pression de la loi d'exception, sans presse, sans organisation extérieure, sans droit d'association et de réunion, que l'extension rapide va vraiment commencer : 1884 : 550 000, 1887 : 763 000, 1890 : 1 427 000 voix. Alors, la main de l'État fut paralysée. La loi contre les socialistes disparut, le nombre des voix socialistes monta à 1787 000, plus du quart de la totalité des voix exprimées. Le gouvernement et les classes régnantes avaient épuisé tous leurs moyens - sans utilité, sans but, sans succès. Les preuves tangibles de leur impuissance, que les autorités, depuis le veilleur de nuit jusqu'au chancelier d'Empire, avaient dû encaisser, - et cela de la part d'ouvriers méprisés ! - ces preuves se comptaient par millions. L'État était au bout de son latin, les ouvriers n'étaient qu'au commencement du leur. Mais, outre le premier service que constituait leur simple existence, en tant que Parti socialiste, parti le plus fort, le plus discipliné et qui grandissait le plus rapidement, les ouvriers allemands avaient rendu encore à leur cause un autre grand service. En montrant à leurs camarades de tous les pays comment on se sert du suffrage universel, ils leur avaient fourni une nouvelle arme des plus acérée. Depuis longtemps déjà, le suffrage universel avait existé en France, mais il y était tombé en discrédit par suite du mauvais usage que le gouvernement bonapartiste en avait fait. Après la Commune, il n'y avait pas de parti ouvrier pour l'utiliser. En Espagne aussi, le suffrage universel existait depuis la République, mais en Espagne l'abstention aux élections fut de tout temps la règle chez tous les partis d'opposition sérieux. Les expériences faites en Suisse avec le suffrage universel étaient rien moins qu'un encouragement, pour un parti ouvrier. Les ouvriers révolutionnaires des pays romans s'étaient habitués à regarder le droit de suffrage comme un piège, comme un instrument d'escroquerie gouvernementale. En Allemagne, il en fut autrement. Déjà le Manifeste communiste avait proclamé la conquête du suffrage universel, de la démocratie, comme une des premières et des plus importantes tâches du prolétariat militant, et Lassalle avait repris ce point. Lorsque Bismarck se vit contraint d'instituer ce droit de vote [11] comme le seul moyen d'intéresser les masses populaires à ses projets, nos ouvriers prirent aussitôt cela au sérieux et envoyèrent August Bebel au premier Reichstag constituant. Et à partir de ce jour-là, ils ont utilisé le droit de vote de telle sorte qu'ils en ont été récompensés de mille manières et que cela a servi d'exemple aux ouvriers de tous les pays. Ils ont transformé le droit de vote, selon les termes du programme marxiste français [12] de moyen de duperie qu'il a été jusqu'ici en instrument d'émancipation . Et si le suffrage universel n'avait donné d'autre bénéfice que de nous permettre de nous compter tous les trois ans, que d'accroître par la montée régulièrement constatée, extrêmement rapide du nombre des voix, la certitude de la victoire chez les ouvriers, dans la même mesure que l'effroi chez les adversaires, et de devenir ainsi notre meilleur moyen de propagande; que de nous renseigner exactement sur notre propre force ainsi que sur celle de tous les partis adverses et de nous fournir ainsi pour proportionner notre action un critère supérieur à tout autre, nous préservant aussi bien d'une pusillanimité inopportune que d'une folle hardiesse tout aussi déplacée - si c'était le seul bénéfice que nous ayons tiré du droit de suffrage, ce serait déjà plus que suffisant. Mais il a encore fait bien davantage. Avec l'agitation électorale, il nous a fourni un moyen qui n'a pas son égal pour entrer en contact avec les masses populaires là où elles sont encore loin de nous, pour contraindre tous les partis à défendre devant tout le peuple leurs opinions et leurs actions face à nos attaques : et, en outre, il a ouvert à nos représentants au Reichstag une tribune du haut de laquelle ils ont pu parler à leurs adversaires au Parlement ainsi qu'aux masses au dehors, avec une tout autre autorité et une tout autre liberté que dans la presse et dans les réunions. A quoi servait au gouvernement et à la bourgeoisie leur loi contre les socialistes si l'agitation électorale et les discours des socialistes au Reichstag la battaient continuellement en brèche. Mais en utilisant ainsi efficacement le suffrage universel le prolétariat avait mis en œuvre une méthode de lutte toute nouvelle et elle se développa rapidement. On trouva que les institutions d'État où s'organise la domination de la bourgeoisie fournissent encore des possibilités d'utilisation nouvelles qui permettent à la classe ouvrière de combattre ces mêmes institutions d'État. On participa aux élections aux différentes Diètes, aux conseils municipaux, aux conseils de prud'hommes, on disputa à la bourgeoisie chaque poste dont une partie suffisante du prolétariat participait à la désignation du titulaire. Et c'est ainsi que la bourgeoisie et le gouvernement en arrivèrent à avoir plus peur de l'action légale que de l'action illégale du Parti ouvrier, des succès des élections que de ceux de la rébellion. Car, là aussi, les conditions de la lutte s'étaient sérieusement transformées. La rébellion d'ancien style, le combat sur les barricades, qui, jusqu'à 1848, avait partout été décisif, était considérablement dépassé. Ne nous faisons pas d'illusions à ce sujet : une véritable victoire de l'insurrection sur les troupes dans le combat de rues, une victoire comme dans la bataille entre deux armées est une chose des plus rares. Mais d'ailleurs il était rare aussi que les insurgés l'aient envisagée. Il ne s'agissait pour eux que d'amollir les troupes en les influençant moralement, ce qui ne joue aucun rôle ou du moins ne joue qu'un rôle beaucoup moins grand dans la lutte entre les armées de deux pays belligérants. Si cela réussit, la troupe refuse de marcher, ou les chefs perdent la tête, et l'insurrection est victorieuse. Si cela ne réussit pas alors, même avec des troupes inférieures en nombre, c'est la supériorité de l'équipement et de l'instruction, de la direction unique, de l'emploi systématique des forces armées et de la discipline qui l'emporte. Le maximum de ce que l'insurrection peut atteindre dans une action vraiment tactique, c'est l'établissement dans les règles et la défense d'une barricade isolée. Soutien réciproque, constitution et utilisation des réserves, bref, la coopération et la liaison des différents détachements indispensables déjà pour la défense d'un quartier, à plus forte raison de toute une grande ville, ne sauraient être réalisées que d'une façon tout à fait insuffisante et le plus souvent pas du tout; la concentration des forces armées sur un point décisif n'a naturellement pas lieu. La résistance passive est, par conséquent, la forme de lutte prédominante; l'attaque, ramassant ses forces, fera bien à l'occasion çà et là, mais encore de façon purement exceptionnelle, des avances et des attaques de flanc, mais en règle générale elle se bornera à l'occupation des positions abandonnées par les troupes battant en retraite. A cela s'ajoute encore que du côté de l'armée l'on dispose de canons et de troupes de génie complètement équipées et exercées, moyens de combat qui presque toujours font complètement défaut aux insurgés. Rien d'étonnant donc que même les combats de barricades disputés avec le plus grand héroïsme - à Paris en juin 1848, à Vienne en octobre 1848, à Dresde en mai 1849, - finirent par la défaite de l'insurrection dès que, n'étant pas gênés par des considérations politiques, les chefs dirigeant l'attaque agirent selon des points de vue purement militaires et que leurs soldats leur restèrent fidèles. Les nombreux succès des insurgés jusqu'en 1848 sont dus à des causes très variées. A Paris, en juillet 1830 et en février 1848, comme dans la plupart des combats de rues en Espagne, il y avait entre les insurgés et les soldats une garde civile qui, ou bien passait directement du côté de l'insurrection ou bien, par son attitude flottante, irrésolue, amenait également un flottement dans les troupes et fournissait en outre des armes à l'insurrection. Là où cette garde civile se dressa dès le début contre l'insurrection, comme en juin 1848 à Paris, celle-ci fut aussi vaincue. A Berlin, en 1848, le peuple fut vainqueur, soit grâce à l'afflux considérable de nouvelles forces armées pendant la nuit et la matinée du 19, soit par suite de l'épuisement et du mauvais approvisionnement des troupes, soit enfin par suite de la paralysie du commandement. Mais, dans tous les cas, la victoire fut remportée parce que la troupe refusa de marcher, parce que l'esprit de décision manquait chez les chefs militaires ou parce qu'ils avaient les mains liées. Même à l'époque classique des combats de rues, la barricade avait donc un effet plus moral que matériel. Elle était un moyen d'ébranler la fermeté des soldats. Si elle tenait jusqu'à ce que celle-ci flanche, la victoire était acquise; sinon, on était battu. (Tel est le point principal qu'il faut également avoir à l'esprit dans l'avenir lorsque l'on examine la chance d'éventuels combats de rues.) Les chances d'ailleurs étaient assez mauvaises dès 1849. La bourgeoisie était passée partout du côté des gouvernements. « La civilisation et la propriété » saluaient et traitaient les soldats qui partaient contre les insurgés. La barricade avait perdu son charme, les soldats ne voyaient plus derrière elle le « peuple », mais des rebelles, des excitateurs, des pillards, des partageux, le rebut de la société; l'officier avait appris avec le temps les formes tactiques du combat de rues, il ne marchait plus directement et sans se couvrir sur la barricade improvisée, mais il la tournait en se servant des jardins, des cours et des maisons. Et avec quelque adresse, cela réussissait maintenant neuf fois sur dix. Mais depuis lors, beaucoup de choses se sont encore modifiées, et toutes en faveur des soldats. Si les grandes villes ont pris une extension considérable, les armées ont grandi davantage encore. Depuis 1848, Paris et Berlin n'ont pas quadruplé, or, leurs garnisons se sont accrues au delà. Ces garnisons peuvent être plus que doublées en vingt-quatre heures grâce aux chemins de fer, et grossir, jusqu'à devenir des armées gigantesques en quarante-huit heures. L'armement de ces troupes énormément renforcées est incomparablement plus efficace. En 1848, c'était le simple fusil à percussion, aujourd'hui c'est le fusil à magasin de petit calibre qui tire quatre fois aussi loin, dix fois plus juste et dix fois plus vite que le premier. Autrefois, c'étaient les boulets et les obus de l'artillerie relativement peu efficaces : aujourd'hui ce sont les obus à percussion dont un seul suffit pour mettre en miettes la meilleure barricade. Autrefois, c'était le pic du pionnier pour percer les murs, aujourd'hui ce sont les cartouches de dynamite. Du côté des insurgés, par contre, toutes les conditions sont devenues pires. Une insurrection qui a la sympathie de toutes les couches du peuple se reproduira difficilement; dans la lutte de classes toutes les couches moyennes ne se grouperont sans doute jamais d'une façon assez exclusive autour du prolétariat pour que, en contre-partie, le parti réactionnaire rassemblé autour de la bourgeoisie disparaisse à peu près complètement. Le « peuple » apparaîtra donc toujours divisé, et, partant, c'est un levier puissant, d'une si haute efficacité en 1848, qui manquera. Si du côté des insurgés viennent un plus grand nombre de combattants ayant fait leur service, leur armement n'en sera que plus difficile. Les fusils de chasse et de luxe des boutiques d'armuriers - même si la police ne les a pas rendus inutilisables au préalable en enlevant quelque pièce de la culasse - sont même dans la lutte rapprochée loin de valoir le fusil à magasin du soldat. Jusqu'en 1848, on pouvait faire soi-même avec de la poudre et du plomb les munitions nécessaires, aujourd'hui, la cartouche diffère pour chaque fusil et elle n'a partout qu'un seul point de commun, à savoir qu'elle est un produit de la technique de la grande industrie et que, par conséquent, on ne peut pas la fabriquer ex tempore [13]; la plupart des fusils sont donc inutiles tant qu'on n'a pas les munitions qui leur conviennent spécialement. Enfin, les quartiers construits depuis 1848 dans les grandes villes ont des rues longues, droites et larges, et semblent adaptés à l'effet des nouveaux canons et des nouveaux fusils. Il serait insensé, le révolutionnaire qui choisirait les nouveaux districts ouvriers du nord et de l'est de Berlin pour un combat de barricades. [Cela veut-il dire qu'à l'avenir le combat de rues ne jouera plus aucun rôle ? Pas du tout. Cela veut dire seulement que les conditions depuis 1848 sont devenues beaucoup moins favorables pour les combattants civils, et beaucoup plus favorables pour les troupes. Un combat de rues ne peut donc à l'avenir être victorieux que si cette infériorité de situation est compensée par d'autres facteurs. Aussi, se produira-t-il plus rarement au début d'une grande révolution qu'au cours du développement de celle-ci, et il faudra l'entreprendre avec des forces plus grandes. Mais alors celles-ci, comme dans toute la Révolution française, le 4 septembre et le 31 octobre 1870 à Paris [14], préféreront sans doute l'attaque ouverte à la tactique passive de la barricade.] [15] Le lecteur comprend-il maintenant pourquoi les pouvoirs dirigeants veulent absolument nous mener là où partent les fusils et où frappent les sabres ? Pourquoi on nous accuse aujourd'hui de lâcheté, parce que nous ne descendons pas carrément dans la rue où nous sommes certains à l'avance d'être défaits ? Pourquoi on nous supplie si instamment de vouloir bien enfin jouer un jour à la chair à canon ? C'est inutilement et pour rien que ces messieurs gaspillent leurs suppliques comme leurs provocations. Nous ne sommes pas si bêtes. Ils pourraient aussi bien exiger de leur ennemi dans la prochaine guerre qu'il veuille bien se disposer en formations de ligne comme au temps du vieux Fritz ou en colonnes de divisions tout entières à la Wagram et à la Waterloo [16], et cela avec le fusil à pierre à la main. Si les conditions ont changé pour la guerre des peuples, elles n'ont pas moins changé pour la lutte de classes. Le temps des coups de main, des révolutions exécutées par de petites minorités conscientes à la tête des masses inconscientes, est passé. Là où il s'agit d'une transformation complète de l'organisation de la société, il faut que les masses elles-mêmes y coopèrent, qu'elles aient déjà compris elles-mêmes de quoi il s'agit, pour quoi elles interviennent (avec leur corps et avec leur vie). Voilà ce que nous a appris l'histoire des cinquante dernières années. Mais pour que les masses comprennent ce qu'il y a à faire, un travail long, persévérant est nécessaire; c'est précisément ce travail que nous faisons maintenant, et cela avec un succès qui met au désespoir nos adversaires. Dans les pays romans aussi on comprend de plus en plus qu'il faut réviser l'ancienne tactique. Partout, [le déclenchement sans préparation de l'attaque passe au second plan, partout] on a imité l'exemple allemand de l'utilisation du droit de vote, de la conquête de tous les postes qui nous sont accessibles, [sauf si les gouvernements nous provoquent ouvertement à la lutte]. En France, où pourtant le terrain est miné depuis plus de cent ans par des révolutions successives, où il n'y a pas de parti qui n'ait eu sa part de conspirations, d'insurrections et d'autres actions révolutionnaires de toutes sortes, en France, où, par conséquent, l'armée n'est pas sûre du tout pour le gouvernement et où, en général, les circonstances sont beaucoup plus favorables pour un coup de main insurrectionnel qu'en Allemagne - même en France les socialistes comprennent de plus en plus qu'il n'y a pas pour eux de victoire durable possible, à moins de gagner auparavant la grande masse du peuple, c'est-à-dire ici les paysans. Le lent travail de propagande et l'activité parlementaire sont reconnus là aussi comme la tâche immédiate du Parti. Les succès n'ont pas manqué. Non seulement on a conquis toute une série de conseils municipaux; aux Chambres siègent cinquante socialistes et ceux-ci ont déjà renversé trois ministères et un président de la République. En Belgique, les ouvriers ont arraché l'année dernière le droit de vote et triomphé dans un quart des circonscriptions électorales. En Suisse, en Italie, au Danemark, voire même en Bulgarie et en Roumanie, les socialistes sont représentés au Parlement. En Autriche, tous les partis sont d'accord pour dire qu'on ne saurait nous fermer plus longtemps l'accès au Reichsrat (Conseil d'Empire). Nous y entrerons, c'est une chose certaine, on se querelle seulement sur la question de savoir par quelle porte. Et même si en Russie le fameux Zemski Sobor se réunit, cette Assemblée nationale contre laquelle se cabre si vainement le jeune Nicolas, même là nous pouvons compter avec certitude que nous y serons représentés également. Il est bien évident que nos camarades étrangers ne renoncent nullement pour cela à leur droit à la révolution. Le droit à la révolution n'est-il pas après tout le seul « droit historique », réel, le seul sur lequel reposent tous les États modernes sans exception, y compris le Mecklembourg dont la révolution de la noblesse s'est terminée en 1755 par le « pacte héréditaire », glorieuse consécration écrite du féodalisme encore en vigueur aujourd'hui. Le droit à la révolution est ancré de façon si incontestable dans la conscience universelle que même le général de Bogouslavski fait remonter à ce droit du peuple seul, le droit au coup d'État qu'il réclame à son empereur. Mais quoi qu'il arrive dans d'autres pays, la social-démocratie allemande a une situation particulière et, de ce fait, du moins dans l'immédiat, aussi une tâche particulière. Les deux millions d'électeurs qu'elle envoie au scrutin, y compris les jeunes gens et les femmes qui sont derrière eux en qualité de non-électeurs, constituent la masse la plus nombreuse, la plus compacte, le « groupe de choc » décisif de l'armée prolétarienne internationale. Cette masse fournit dès maintenant plus d'un quart des voix exprimées; et, comme le prouvent les élections partielles au Reichstag, les élections aux Diètes des différents pays, les élections aux conseils municipaux et aux conseils de prud'hommes, elle augmente sans cesse. Sa croissance se produit aussi spontanément, aussi constamment, aussi irrésistiblement et, en même temps, aussi tranquillement qu'un processus naturel. Toutes les interventions gouvernementales pour l'empêcher se sont avérées impuissantes. Dès aujourd'hui, nous pouvons compter sur deux millions et quart d'électeurs. Si cela continue ainsi, nous conquerrons d'ici la fin du siècle la plus grande partie des couches moyennes de la société, petits bourgeois ainsi que petits paysans, et nous grandirons jusqu'à devenir la puissance décisive dans le pays, devant laquelle il faudra que s'inclinent toutes les autres puissances, qu'elles le veuillent ou non. Maintenir sans cesse cet accroissement, jusqu'à ce que de lui-même il devienne plus fort que le système gouvernemental au pouvoir (ne pas user dans des combats d'avant-garde, ce « groupe de choc » qui se renforce journellement, mais le garder intact jusqu'au jour décisif), telle est notre tâche principale. Or, il n'y a qu'un moyen qui pourrait contenir momentanément le grossissement continuel des forces combattantes socialistes en Allemagne et même le faire régresser quelque temps, c'est une collision de grande envergure avec les troupes, une saignée comme en 1871 à Paris. A la longue, on surmonterait bien cette chose aussi. Rayer à coups de fusil de la surface du globe un parti qui se compte par millions, tous les fusils à magasin d'Europe et d'Amérique n'y suffisent pas. Mais le développement normal serait paralysé (le « groupe de choc » ne serait peut-être pas disponible au moment critique), le combat décisif serait retardé, prolongé et s'accompagnerait de sacrifices plus lourds. L'ironie de l'histoire mondiale met tout sens dessus dessous. Nous, les « révolutionnaires », les « chambardeurs », nous prospérons beaucoup mieux par les moyens légaux que par les moyens illégaux et le chambardement. Les partis de l'ordre, comme ils se nomment, périssent de l'état légal qu'ils ont créé eux-mêmes. Avec Odilon Barrot, ils s'écrient désespérés : la légalité nous tue, alors que nous, dans cette légalité, nous nous faisons des muscles fermes et des joues roses et nous respirons la jeunesse éternelle. Et si nous ne sommes pas assez insensés pour nous laisser pousser au combat de rues pour leur faire plaisir, il ne leur restera finalement rien d'autre à faire qu'à briser eux-mêmes cette légalité qui leur est devenue si fatale. En attendant, ils font de nouvelles lois contre le chambardement. Tout est à nouveau mis sens dessus dessous. Ces fanatiques de l'antichambardement d'aujourd'hui, ne sont-ils pas eux-mêmes les chambardeurs d'hier ? Est-ce nous peut-être qui avons provoqué la guerre civile de 1866 ? Est-ce nous qui avons chassé de leurs pays héréditaires légitimes, le roi de Hanovre, le prince électeur de Hesse, le duc, de Nassau et annexé ces pays héréditaires ? Et ces chambardeurs du Bund allemand et de trois couronnes par la grâce de Dieu se plaignent du chambardement ? Quis tulerit Gracchos de seditione querentes [17] ? Qui pourrait permettre aux adorateurs de Bismarck de se répandre en invectives sur le chambardement ? Cependant, ils peuvent bien faire passer leurs projets de lois contre la révolution, ils peuvent les aggraver encore, transformer toutes les lois pénales en caoutchouc, ils ne feront rien que donner une nouvelle preuve de leur impuissance. Pour s'attaquer sérieusement à la social-démocratie, il leur faudra encore de tout autres mesures. Sur la révolution sociale-démocrate qui se porte justement si bien parce qu'elle se conforme aux lois, ils ne pourront avoir prise que par le chambardement du parti de l'ordre, lequel ne peut vivre sans briser les lois. M. Roessler, le bureaucrate prussien, et M. de Bogouslavski, le général prussien, leur ont montré la seule voie par laquelle on peut peut-être encore avoir prise sur les ouvriers qui ne se laisseront pas, tant pis, pousser au combat de rues. Rupture de la Constitution, dictature, retour à l'absolutisme, regis voluntas suprema lex [18] ! Donc, ayez seulement du courage, messieurs, il ne s'agit plus ici de faire semblant, il s'agit de siffler. Mais n'oubliez pas que l'Empire allemand, comme tous les petits États et en général tous les États modernes, est le produit d'un pacte; du pacte d'abord des princes entre eux, ensuite des princes avec le peuple. Si une des parties brise le pacte, tout le pacte tombe et alors l'autre partie n'est plus liée non plus. [Comme Bismarck nous en a si bien donné l'exemple en 1866. Si donc vous brisez la Constitution impériale, la social-démocratie est libre, libre de faire ce qu'elle veut à votre égard. Mais ce qu'elle fera ensuite, elle se gardera bien de vous le dire aujourd'hui.] Il y a maintenant presque exactement mille six cents ans que dans l'Empire romain sévissait également un dangereux parti révolutionnaire. Il sapait la religion et tous les fondements de l'État. Il niait carrément que la volonté de l'empereur fût la loi suprême, il était sans patrie, international, il s'étendait sur tout l'Empire depuis la Gaule jusqu'à l'Asie, débordait les limites de l'Empire, Il avait fait longtemps un travail de sape souterrain, secret. Mais depuis assez longtemps déjà il se croyait assez fort pour paraître au grand jour. Ce parti révolutionnaire qui était connu sous le nom de chrétien avait aussi sa forte représentation dans l'armée; des légions tout entières étaient chrétiennes. Lorsqu'ils recevaient l'ordre d'aller aux sacrifices solennels de l'Église païenne nationale pour y rendre les honneurs, les soldats révolutionnaires poussaient l'insolence jusqu'à accrocher à leur casque des insignes particuliers - des croix, - en signe de protestation. Même les chicanes coutumières des supérieurs à la caserne restaient vaines. L'empereur Dioclétien ne put conserver plus longtemps son calme en voyant comment on sapait l'ordre, l'obéissance et la discipline dans son armée. Il intervint énergiquement, car il était temps encore. Il promulgua une loi contre les socialistes, je voulais dire une loi contre les chrétiens. Les réunions des révolutionnaires furent interdites, leurs locaux fermés ou même démolis, les insignes chrétiens, croix, etc., furent interdits, comme en Saxe les mouchoirs rouges. Les chrétiens furent déclarés incapables d'occuper des postes publics, on ne leur laissait même pas le droit de passer caporaux. Comme on ne disposait pas encore à l'époque de juges aussi bien dressés au « respect de l'individu » que le suppose le projet de loi contre la révolution de M. de Koeller [19], on interdit purement et simplement aux chrétiens de demander justice devant les tribunaux. Cette loi d'exception resta elle aussi sans effet. Par dérision, les chrétiens l'arrachèrent des murs; bien mieux, on dit qu'à Nicomédie, ils incendièrent le palais au-dessus de la tête de l'empereur. Alors, celui-ci se vengea par la grande persécution des chrétiens de l'année 303 de notre ère. Ce fut la dernière de ce genre. Et elle fut si efficace que dix-sept années plus tard, l'armée était composée en majeure partie de chrétiens et que le nouvel autocrate de l'Empire romain qui succède à Dioclétien, Constantin, appelé par les curés le Grand, proclamait le christianisme religion d'État. Londres, le 6 mars 1895. Notes Les passages en bleu sont en français dans le texte. [1] La révolution de 1848 a commencé en France le 24 février, à Vienne le 13 mars, à Berlin le 18 mars. [2] Éditions sociales, 1963. [3] Une grande propriété qui fut offerte au chancelier Bismarck. [4] Sur des territoires étrangers. Se dit de l'évêque dont le titre est purement honorifique et ne donne droit à aucune juridiction. On dit, par ironie, gouvernement, ministre, ambassadeur, etc., in partibus. [5] Sur la révolution anglaise, voir l'étude d'Engels : « Le matérialisme historique » dans K. Marx et F. Engels : Études philosophiques, pp. 116-137, Éditions sociales, Paris, 1961. [6] Il s'agit des légitimistes, partisans de la monarchie « légitime » des Bourbons qui fut au pouvoir jusqu'à la Révolution de 1789 et pendant la Restauration (1815-1830), et des orléanistes, partisans de la dynastie des Orléans qui vint au pouvoir au moment de la révolution de juillet 1830 et qui fut renversée par la révolution de 1848. Les premiers étaient les représentants de la grande propriété foncière, les seconds de la banque. [7] Sous le règne de Napoléon III, la France participa à la guerre de Crimée (1854-1855); elle fit la guerre à l'Autriche (1859), organisa une expédition en Syrie (1860), participa avec l'Angleterre à la guerre contre la Chine, conquit le Cambodge (Indochine) et participa à l'expédition du Mexique en 1863 et en 1870 fit la guerre contre l'Allemagne. [8] Le résultat de la victoire sur la France dans la guerre franco-allemande de 1870-71, fut la formation de l'Empire allemand à l'exclusion de l'Autriche (de là l'appellation « le petit Empire allemand »). La défaite de Napoléon III donna le signal de la révolution en France. La révolution renversa Napoléon III et conduisit à la proclamation de la République le 4 septembre 1870. [9] La guerre franco-allemande une fois terminée, l'Allemagne annexa, conformément au traité de paix de 1871, l'Alsace-Lorraine et contraignit la France à payer une contribution de 5 milliards. [10] C'est le 19 octobre 1878 qu'entra en vigueur en Allemagne la loi d'exception contre les socialistes, interdisant le Parti social-démocrate et le poussant à l'illégalité. Elle ne fut abolie qu'en 1890. [11] Le suffrage universel fut introduit par Bismarck en 1866 lors des élections au Reichstag de l'Empire allemand unifié. [12] Il s'agit du programme du Parti ouvrier français qui avait été élaboré par Jules Guesde et Paul Lafargue sous la direction personnelle de Marx. [13] Sur le champ. [14] Il s'agit du 4 septembre 1870, journée où le gouvernement de Louis Bonaparte fut renversé et la République proclamée, ainsi que de l'échec du soulèvement des blanquistes contre le gouvernement de la défense nationale le 31 octobre de cette même année. [15] Les passages entre crochets, ici et par la suite, ont été rayés par Engels lui-même. [16] Dans la bataille de Wagram en 1809, Napoléon ler vainquit l'armée autrichienne; à Waterloo, 18 juin 1815, les armées alliées (anglaise, prussienne, etc.), lui infligèrent une défaite décisive. [17] Qui supportera que les Gracques se plaignent d'une sédition ? [18] La volonté du roi est la loi suprême. [19] Le 5 décembre 1894, un nouveau projet de loi contre les socialistes fut déposé au Reichstag. Ce projet fut renvoyé à une commission qui le discuta jusqu'au 25 avril 1895. |
| LETTRES MARX ENGELS PENDANT LA GUERRE
FRANCO PRUSSIENNE DE 1870 |
| Marx à Engels Ramsgate, le 15 août 1870 Cher Fred, Tu liras dans le Daily News - et reproduit dans la Pall Mall d'aujourd'hui - qu'un éminent écrivain vient de lancer un pamphlet anglais en faveur de l'annexion de l'Alsace à l'Allemagne. L'éminent homme de lettres qui a réussi à insérer lui-même cette nouvelle dans le Daily News, n'est naturellement personne d'autre que l'ex-étudiant Karl Blind. Cette misérable fripouille peut faire beaucoup de mal en ce moment avec ses intrigues dans la presse anglaise. Comme tu as maintenant des rapports avec la Pall Mall, il faut que tu prennes note de cet animal afin de l'étriller sérieusement, sitôt qu'il lancera son pamphlet. Soit dit entre nous, les Prussiens pourraient faire un grand coup diplomatique, sans réclamer pour eux le moindre pouce de territoire français, s'ils demandaient que la Savoie et Nice soient restituées à l'Italie et que la bande de territoire neutralisée par les accords de 1815 soit rendue à la Suisse. [25]. Personne n'aurait rien à y objecter. Mais ce n'est pas à nous de donner des conseils pour des échanges de territoires. Toute la famille s'amuse royalement ici. Tussy et la petite Jenny ne veulent pas quitter la mer et se font de belles réserves de force et de santé. En revanche, je reste plus ou moins immobilisé à cause de rhumatismes et d'insomnies. Salut. Ton K. M. Engels à Marx Manchester, le 15 août 1870 J'ignore dans quelle mesure le très faible Bracke s'est laissé entraîner par l'enthousiasme national et comme en 15 jours j'ai reçu tout au plus un numéro du Volksstaat, je ne suis pas en mesure de juger le Comité sur ce point, sauf à partir de la lettre de Bonhorst à Wilhelm [Liebknecht], qui est plutôt réservée, mais révèle des incertitudes théoriques. Par contraste, l'assurance bornée et l'invocation pédante des principes de la part de Liebknecht font, bien sûr, meilleur effet, comme nous le savons tous. Il me semble que les choses se présentent comme suit: l'Allemagne a été entraînée par Badinguet dans une guerre pour son existence nationale. Si elle succombait, le bonapartisme serait consolidé pour longtemps, et l'Allemagne serait fichue pour des années, voire des générations. Il ne pourrait plus être question d'un mouvement ouvrier indépendant en Allemagne, la revendication de l'existence nationale absorbant toutes les énergies. Les ouvriers allemands seraient pris en remorque, dans le meilleur des cas, par les ouvriers français. Si l'Allemagne triomphait, le bonapartisme français serait fichu en toute occurrence; les sempiternelles chamailleries autour de la réalisation de l'unité allemande étant enfin écartées, les ouvriers allemands pourraient s'organiser à l'échelle nationale, ce qu'ils ne pouvaient faire jusqu'ici, et les ouvriers français - quel que soit le gouvernement issu de ce bouleversement - auraient certainement les coudées plus franches que sous le bonapartisme. Toute la masse du peuple allemand et toutes les classes ont reconnu qu'il y allait avant tout de l'existence nationale, et elles ont aussitôt réagi. Il me semble que, dans ces conditions, il ne soit pas possible qu'un parti politique allemand prêche l'obstruction totale, en plaçant toutes sortes de considérations secondaires au-dessus de l'essentiel, comme le fait Wilhelm [Liebknecht]. Il y a, en outre, le fait que Badinguet n'eût pu mener cette guerre sans le chauvinisme des masses de la population française, des bourgeois et petits-bourgeois, aussi bien que des paysans et du prolétariat impérial du bâtiment, issu de paysans chargés dans les villes de réaliser les plans à la Haussmann. Tant que ce chauvinisme n'en prend pas un bon coup, il n'est pas de paix possible entre l'Allemagne et la France. On aurait pu s'attendre à ce qu'une révolution prolétarienne se charge de cette oeuvre, mais depuis qu'il y a la guerre, il ne reste plus aux Allemands qu'à s'en charger eux-mêmes dès à présent. Venons-en maintenant aux considérations secondaires: si cette guerre est dirigée par Lehmann, Bismarck et Cie, et sert, pour le moment du moins, leur gloire; s'ils parviennent à la gagner, nous le devons à cette lamentable bourgeoisie allemande. Certes, c'est écœurant, mais il n'y a rien à y changer. Dans ces conditions, il serait absurde, pour cette seule raison, de faire de l'anti-bismarckisme le principe directeur unique de notre politique. Tout d'abord, jusqu'ici - et notamment en 1866 - Bismarck n'a-t-il pas accompli une partie de notre travail, à sa façon et sans le vouloir certes, mais en l'accomplissant tout de même. Il nous procure une place plus nette qu'auparavant. Et puis, nous ne sommes plus en l'an 1815. Les Allemands du Sud ne manqueront pas, à présent, d'entrer au Reichstag, ce qui créera un contrepoids au prussianisme. En outre, il y a des devoirs nationaux qui lui incombent et - comme tu l'as déjà écrit - empêchent d'emblée une alliance avec la Russie. Bref, il est absurde de vouloir, comme Liebknecht, que l'histoire tout entière fasse marche arrière jusque 1866, parce qu'elle lui déplaît. Ne connaissons-nous pas les citoyens modèles que sont les Allemands du Sud. Tout cela est absurde. J'estime que nos gens peuvent: 1. se joindre au mouvement national dans la mesure où il se limite à la défense de l'Allemagne et tant qu'il s'y tient (ce qui n'exclut pas, au demeurant, l'offensive jusqu'à la paix). [27]. Dans sa lettre, Kugelmann a montré combien ce mouvement national est puissant. 2. souligner la différence entre les intérêts nationaux de l'Allemagne et les intérêts dynastiques et prussiens. 3. s'opposer à toute annexion de l'Alsace-Lorraine (Bismarck laisse percer maintenant son intention de la rattacher au pays de Bade et à la Bavière). 4. agir en faveur d'une paix honorable, dès l'instauration à Paris d'un gouvernement républicain, non chauvin. 5. mettre sans cesse en évidence l'unité d'intérêts des ouvriers allemands et français, qui n'ont pas approuvé la guerre, et ne se font pas la guerre. 6. la Russie, comme il en est question dans l'Adresse internationale [28]. Wilhelm [Liebknecht] est amusant lorsqu'il déclare que la véritable position, c'est de rester neutre, parce que Bismarck a été dans le temps le compère de Badinguet. Si telle était l'opinion générale en Allemagne, nous en serions de nouveau à la Confédération rhénane, [29] et notre noble Wilhelm serait étonné de voir quel rôle il pourrait y jouer, et ce qui resterait du mouvement ouvrier. L'idéal pour faire la révolution sociale, ce serait alors un peuple qui ne reçoit que des coups de pied et des coups de bâton et se trouve coincé dans la série de ces petits États chers à Wilhelm ! As-tu remarqué comment le misérable cherche à me dénoncer pour quelque chose qui est paru dans la Gazette d'Elberfeld ! [30]. Pauvre bête ! La débâcle en France semble terrible. Tout se décompose, s'achète et se vend. De mauvaise fabrication, les chassepots lâchent dans la bataille; comme il n'y en a plus, il faut aller chercher les vieux fusils à silex. Malgré tout, un gouvernement révolutionnaire - s'il vient rapidement - n'a pas à désespérer. Mais, il devra abandonner Paris à son sort et continuer la guerre dans le Sud. Il sera toujours possible alors de tenir assez longtemps pour acheter des armes et organiser des armées nouvelles, grâce à quoi l'ennemi sera progressivement repoussé jusqu'aux frontières. Ce serait en réalité la meilleure issue de la guerre, les deux pays se prouvant mutuellement leur invincibilité. Mais, si cela ne se produit pas bientôt, la comédie sera finie. Les opérations de Moltke sont tout à fait exemplaires; il semble que le vieux Guillaume lui laisse les mains libres pour tout, et les quatrièmes bataillons viennent déjà grossir l'armée, alors que les français n'existent pas encore. Si Badinguet n'a pas déjà évacué Metz, cela pourrait mal tourner pour lui. |
| http://www.marxists.org/francais/marx/works/00/commune/kmfecom02.htm |
| Qui ne sait, en effet, que
l'histoire de toutes les révolutions montre la transformation
inévitable, et non fortuite, de la lutte des classes en guerre
civile ? |
| Lénine, O.C., t. 25, p.276 |
| Types |
Ennemis subjectifs et objectifs | Ennemis objectifs |
Ennemis objectifs mais amis subjectifs
|
||||
| À visage découvert |
Masqués |
||||||
| Hors du parti | Dans le parti | Hors du parti | Dans le parti | Hors du parti | Dans le parti | ||
| Noms
Génériques |
-Ennemis -Blancs Vendéens -Contre-révolutionnaires |
Traîtres Saboteurs |
Ennemis intérieurs Traîtres Saboteurs Bureaucra-tes Canailles |
Nuiseurs Parasites Vampires Punaises, Poux, Fumier moyenâgeux |
Déserteurs Mauvais communistes |
Hystériques Salauds Merde Braillards Phraseurs |
|
| Institution
de l’épuration |
-Armée
rouge -Tcheka puis Guépéou |
Tcheka
puis Guépéou |
CC ou CCC en liaison avec Tcheka |
-Armée
rouge -Tcheka puis Guépéou, NKVD |
CC ou CCC en liaison avec Tcheka puis Guépéou NKVD, |
Armée
rouge -Tcheka |
CC ou CCC en liaison avec la
Tcheka puis Guépéou |
| Modalités
de l’épuration |
-Victoire
militaire -Terreur de masse -Terreur rouge |
Exécution
immédiate -Procès, condamna- tion |
Terreur, -Exécution sans phrase |
Epuration
du sol russe -Extermi-nation -Camp de concentration |
-Epuration du parti -Terreur, exécution sans phrase |
-Hôpital
psychiatrique -Prison -Camp de concentration |
-Epuration du parti. -Prison -Camp de concentration |
| Moments
exemplaires positifs |
Commune
de Paris -Guerre civile -Répression de Cronstadt -guerre civile internatio-nale en 1922 |
-Lutte
contre les cheminots mencheviks en 1917 -procès des “fabricants de charrue” en 1922 |
Epuration de 99% des mencheviks
en 1921 |
Eté
1918 Printemps 1921 Printemps 1922 |
-Epuration de 1921 |
Tentative
de coup d’État des S.R. de gauche en Juillet 1918 |
Rupture avec les mencheviks en
1903 -Paix de Brest-Litovsk en 1918 contre les gauchistes |
| Figures
typiques |
-Milioukov
en 1917 Kornilov -Wrangel -fascistes italiens |
Saboteurs
dans les chemins de fer en 1917 |
Mencheviks infiltrés dans
le parti 1921 |
Les
koulaks en tant que classe |
Les koulaks en tant que classe |
Maria
Spiridonova en 1918 |
-Martov en 1902 -Boukharine en 1920 |
| Figures
positives inverses |
-Rouges -Armée Rouge -Tcheka |
Dzerdjinski CCC, CC Vieille garde bolchevik en 1923 |
Prolétaires
conscients des villes et campagnes |
Lénine, CCC, CC Vieille garde bolchevik |
Trotski
en 1917-1923 |
Bataillons de fer du
prolétariat |
|
| Lénine
: Under a False
Flag Written: Written not earlier than February 1915 Published: First published in 1917, in the first Collection of the Priliv Publishers, Moscow. Signed: N. Konstantinov. Published according to the text in the Collection. Source: Lenin Collected Works, Progress Publishers, [197[4]], Moscow, Volume 21, pages 135-157. Translated: Transcription\Markup: D. Walters and R. Cymbala Public Domain: Lenin Internet Archive 2002 (2005). You may freely copy, distribute, display and perform this work; as well as make derivative and commercial works. Please credit “Marxists Internet Archive” as your source. |
Issue No. 1 of Nashe Dyelo (Petrograd, January 1915)[4] published a highly characteristic programmatic article by Mr. A. Potresov, entitled “At the Juncture of Two Epochs”. Like an earlier magazine article by the same author, the present article sets forth the ideas underlying an entire bourgeois trend of public thought in Russia—the liquidationist—regarding the important and burning problems of the times. Strictly speaking, we have before us not articles but the manifesto of a definite trend, and anyone who reads them carefully and gives thought to their content will see that only fortuitous considerations, i.e., such that have nothing in common with purely literary interests, have prevented the author’s ideas (and those of his friends, since the author does not stand alone) from being expressed in the more appropriate form of a declaration or credo. Potresov’s main idea is that present-day democracy stands at the juncture of two epochs, the fundamental difference between the old epoch and the new consisting in a transition from national isolation to internationalism. By present-day democracy, Potresov understands the kind that marked the close of the nineteenth century and the beginning of the twentieth, as distinct from the old bourgeois democracy that marked the end of the eighteenth century and the first two-thirds of the nineteenth. At first glance it may seem that the author’s idea is absolutely correct, that we have before us an opponent to the national-liberal tendency predominant in present-day democracy, and that the author is an “internationalist”, not a national-liberal. Indeed, this defence of internationalism, this reference to national narrow-mindedness and national exclusiveness as features of an outworn and bygone epoch—is it not a breakaway from the wave of national-liberalism, that bane of present-day democracy or, rather, of its official representatives. That, at first glance, is not only the possible but the almost inevitable impression. Yet it would be a gross error to think so. The author is transporting his cargo under a false flag. Consciously or otherwise—that does not matter in this instance—he has resorted to a stratagem by hoisting the flag of “internationalism” so as the more securely to transport under this flag his contraband cargo of national-liberalism. After all, Potresov is a most undeniable national-liberal. The gist of his article (and of his programme, platform, and credo) is in the employment of this little—and if you wish even innocent—stratagem, in carrying opportunism under the flag of internationalism. One must go into all the details of this manoeuvre, for the matter is of prime and tremendous importance. Potresov’s use of a false flag is the more dangerous since he not only cloaks himself with the principle of “internationalism” but also assumes the title of an adherent of “Marxist methodology”. In other words, Potresov pretends to be a true follower and exponent of Marxism, whereas in actual fact he substitutes national-liberalism for Marxism. Potresov tries to “amend” Kautsky, accusing him of “playing the advocate”, i.e., of defending liberalism now of one shade, now of another, that is to say, the liberalism of shades peculiar to various nations. Potresov is out to contrast national-liberalism (for it is absolutely indubitable and indisputable that Kautsky has become a national-liberal) with internationalism and Marxism. In reality, Potresov is contrasting particoloured national-liberalism with national-liberalism of a single colour, whereas Marxism is hostile—and in the present historical situation, absolutely hostile—to any kind of national-liberalism. We shall now go on to show that such is the case, and why. I The highlight of Potresov’s misadventures, which led to his setting out under a national-liberal flag, can be best understood if the reader examines the following passage in his article: “With their characteristic temperament, they [Marx and his comrades] attacked the problem, no matter how difficult it was; they diagnosed the conflict, and attempted to determine the success of which side opened up broader vistas for possibilities desirable from their point of view; thus they laid down a certain basis on which to build their tactics” (p. 73, our italics in excerpts). “The success of which side is more desirable”—this is what has to be determined, and that from an international, not a national point of view. This is the essence of the Marxist methodology. This is what Kautsky does not do, thus turning from a “judge” (a Marxist) into an “advocate” (a national-liberal). Such is Potresov’s line of argument. Potresov himself is most deeply convinced that he is not “playing the advocate” when he defends the desirability of success for one side (namely, his own) and that, conversely, he is guided by truly international considerations with regard to the egregious sins of the other side. Potresov, Maslov, Plekhanov, etc., who are all guided by truly international considerations, have reached the same conclusions as Potresov has. This is a simple-mindedness that borders on—well, we shall not make undue haste, but shall first complete an analysis of the purely theoretical question. “The success of which side is more desirable” was established by Marx in the Italian war of 1859, for instance. Potresov dwells on this particular instance, which, he says, “has a special interest for us because of certain of its features”. We too, for our part, are willing to take the instance chosen by Potresov. In 1859 Napoleon III declared war on Austria, allegedly for the liberation of Italy, but in reality for his own dynastic aims. “Behind the back of Napoleon III,” says Potresov, “could be discerned the figure of Gorchakov, who had just signed a secret agreement with the Emperor of the French.” What we have here is a tangle of contradictions: on the one side, the most reactionary European monarchy, which has been oppressing Italy; on the other, the representatives of revolutionary Italy, including Garibaldi, fighting for her liberation, side by side with the ultra-reactionary Napoleon III, etc. “Would it not have been simpler,” Potresov writes, “to step aside and to say that the two are equally bad? However, neither Engels, Marx, nor Lassalle were attracted by the “simplicity” of such a solution, but started to search the problem [Potresov means to say, to study and explore the problem], of the particular outcome of the conflict which might provide the greatest opportunities for a cause dear to all three.” Lassalle notwithstanding, Marx and Engels came to the conclusion that Prussia must intervene. Among their considerations, as Potresov himself admits, was that “of the possibility, as a result of a conflict with the enemy coalition, of a national movement in Germany, which might develop over the heads of its numerous rulers; there was also the consideration as to which Power in the Concert of Europe was the main evil: the reactionary Danubian monarchy, or other outstanding representatives of this Concert”. “To us, it is not important who was right, Marx or Lassalle,” Potresov concludes; “what is important is that all were agreed on the necessity of determining, from an international point of view, the success of which side was more desirable.” This is the instance cited by Potresov, and the way our author pursues the argument. If Marx was then able “to appraise international conflicts” (Potresov’s expression), notwithstanding the highly reactionary character of the governments of both belligerent sides, then Marxists too are at present obliged to make a similar appraisal, Potresov concludes. This conclusion is either naïve childishness or crass sophistry, since it boils down to the following: since, in 1859, Marx was working on the problem of the desirability of success for which particular bourgeoisie, we, over half a century later, must solve the problem in exactly the same way. Potresov has failed to notice that, to Marx in 1859 (as well as in a number of later cases), the question of “the success of which side is more desirable” meant asking “the success of which bourgeoisie is more desirable”. Potresov has failed to notice that Marx was working on the problem at a time when there existed indubitably progressive bourgeois movements, which moreover did not merely exist, but were in the forefront of the historical process in the leading states of Europe. Today, it would be ridiculous even to imagine a progressive bourgeoisie, a progressive bourgeois movement, in, for instance, such key members of the “Concert” of Europe, as Britain and Germany. The old bourgeois “democracy” of these two key states has turned reactionary. Potresov has “forgotten” this, and has substituted the standpoint of the old (bourgeois) so-called democracy for that of present-day (non-bourgeois) democracy. This shift to the standpoint of another class, and moreover of an old and outmoded class, is sheer opportunism. There cannot be the least doubt that a shift like this cannot be justified by an analysis of the objective content of the historical process in the old and the new epochs. It is the bourgeoisie—for instance in Germany, and in Britain too, for that matter—that endeavours to effect the kind of substitution accomplished by Potresov, viz., replacing of the imperialist epoch by that of bourgeois-progressive, national and democratic movements for liberation. Potresov is uncritically following in the wake of the bourgeoisie. This is the more unpardonable, since, in the instance he has selected, Potresov has himself been obliged to recognise and specify the considerations guiding Marx, Engels, and Lassalle in those bygone days.[1] First of all, these were considerations on the national movement (in Germany and Italy)—on the latter’s development over the heads of the “representatives of medievalism”; secondly, these were considerations on the “main evil” of the reactionary monarchies (the Austrian, the Napoleonic, etc.) in the Concert of Europe. These considerations are perfectly clear and indisputable. Marxists have never denied the progressiveness of bourgeois national-liberation movements against feudal and absolutist forces. Potresov cannot but know that nothing like this does or can exist in the major, i.e., the leading rival states of today. In those days there existed, both in Italy and in Germany, popular national-liberation movements with decades of struggle behind them. In those days the Western bourgeoisie did not give financial support to certain other states; on the contrary, those states were really “the main evil”. Potresov cannot but know—as he admits in the same article—that today none of the other states is or can be the “main evil”. The bourgeoisie (in Germany, for instance, though not in that country alone) is, for selfish reasons, encouraging the ideology of national movements, attempting to translate that ideology into the epoch of imperialism, i.e., an entirely different epoch. As usual, the opportunists are plodding along in the rear of the bourgeoisie, abandoning the standpoint of present-day democracy and shifting over to that of the old (bourgeois) democracy. That is the chief shortcoming in all the articles, as well as in the entire position and the entire line of Potresov and his liquidationist fellow-thinkers. At the time of the old (bourgeois) democracy Marx and Engels were working on the problem of the desirability of success for which particular bourgeoisie; they were concerned with a modestly liberal movement developing into a tempestuously democratic one. In the period of present-day (non-bourgeois) democracy, Potresov is preaching bourgeois national-liberalism at a time when one cannot even imagine bourgeois progressive movements, whether modestly liberal or tempestuously democratic, in Britain, Germany, or France. Marx and Engels were ahead of their epoch, that of bourgeois-national progressive movements; they wanted to give an impetus to such movements so that they might develop “over the heads” of the representatives of medievalism. Like all social-chauvinists, Potresov is moving backwards, away from his own period, that of present-day democracy, and skipping over to the outworn, dead, and therefore intrinsically false viewpoint of the old (bourgeois) democracy. That is why Potresov’s following appeal to democracy reveals his muddled thinking and is highly reactionary: “Do not retreat, but advance, not towards individualism, but towards internationalist consciousness in all its integrity and all its vigour. To advance means, in a certain sense, to go also back—back to Engels, Marx, and Lassalle, to their method of appraising international conflicts, and to their finding it possible to utilise inter-state relations for democratic purposes.” Potresov drags present-day democracy backwards, not “in a certain sense” but in all senses; he drags it back to the slogans and the ideology of the old bourgeois democracy, to the dependence of the masses upon the bourgeoisie. . . . Marx’s method consists, first of all, in taking due account of the objective content of a historical process at a given moment, in definite and concrete conditions; this in order to realise, in the first place, the movement of which class is the mainspring of the progress possible in those concrete conditions. In 1859, it was not imperialism that comprised the objective content of the historical process in continental Europe, but national-bourgeois movements for liberation. The mainspring was the movement of the bourgeoisie against the feudal and absolutist forces. Fifty-five years later, when the place of the old and reactionary feudal lords has been taken by the not unsimilar finance capital tycoons of the decrepit bourgeoisie, the knowledgeable Potresov is out to appraise international conflicts from the standpoint of the bourgeoisie, not of the new class.[2] Potresov has not given proper thought to the significance of the truth he uttered in the above words. Let us suppose that two countries are at war in the epoch of bourgeois, national-liberation movements. Which country should we wish success to from the standpoint of present-day democracy? Obviously, to that country whose success will give a greater impetus to the bourgeoisie’s liberation movement, make its development more speedy, and undermine feudalism the more decisively. Let us further suppose that the determining feature of the objective historical situation has changed, and that the place of capital striving for national liberation has been taken by international, reactionary and imperialist finance capital. The former country, let us say, possesses three-fourths of Africa, whereas the latter possesses one-fourth. A repartition of Africa is the objective content of their war. To which side should we wish success? It would be absurd to state the problem in its previous form, since we do not possess the old criteria of appraisal: there is neither a bourgeois liberation movement running into decades, nor a long process of the decay of feudalism. It is not the business of present-day democracy either to help the former country to assert its “right” to three-fourths of Africa, or to help the latter country (even if it is developing economically more rapidly than the former) to take over those three-fourths. Present-day democracy will remain true to itself only if it joins neither one nor the other imperialist bourgeoisie, only if it says that the two sides are equally bad, and if it wishes the defeat of the imperialist bourgeoisie in every country. Any other decision will, in reality, be national-liberal and have nothing in common with genuine internationalism. The reader should not let himself be deceived by the pretentious terminology Potresov employs to conceal his switch over to the standpoint of the bourgeoisie. When Potresov exclaims: “. . . not towards individualism, but towards internationalist consciousness in all its integrity and all its vigour”, his aim is to contrast his own point of view with that of Kautsky. He calls the latter’s view (and that of others like him) “individualism”, because of Kautsky’s refusal to decide “the success of which side is more desirable”, and his justification of the workers’ national-liberalism in each “individual” country. We, on the contrary, he, as it were, says, we—Potresov, Cherevanin, Muslov, Plekhanov, and others—appeal to “internationalist consciousness in all its integrity and all its vigour”, for we stand for national-liberalism of a definite shade, in no way from the standpoint of an individual state (or an individual nation) but from a standpoint that is genuinely internationalist. This line of reasoning would be ridiculous if it were not so—disgraceful. Both Potresov and Co. and Kautsky, who have betrayed the standpoint of the class which they are trying hard to represent, are following in the wake of the bourgeoisie. II Potresov has entitled his article “At the Juncture of Two Epochs”. We are undoubtedly living at the juncture of two epochs, and the historic events that are unfolding before our eyes can be understood only if we analyse, in the first place, the objective conditions of the transition from one epoch to the other. Here we have important historical epochs; in each of them there are and will always be individual and partial movements, now forward now backward; there are and will always be various deviations from the average type and mean tempo of the movement. We cannot know how rapidly and how successfully the various historical movements in a given epoch will develop, but we can and do know which class stands at the hub of one epoch or another, determining its main content, the main direction of its development, the main characteristics of the historical situation in that epoch, etc. Only on that basis, i.e., by taking into account, in the first place, the fundamental distinctive features of the various “epochs” (and not single episodes in the history of individual countries), can we correctly evolve our tactics; only a knowledge of the basic features of a given epoch can serve as the foundation for an understanding of the specific features of one country or another. It is to this region that both Potresov’s and Kautsky’s main sophism, or their fundamental historical error, pertains (Kautsky’s article was published in the same issue of Nashe Dyelo ), an error which has led both of them to national-liberal, not Marxist, conclusions. The trouble is that the instance chosen by Potresov, which has presented a “special interest” to him, namely, the instance of the Italian campaign of 1859, as well as a number of similar historical instances quoted by Kautsky, “in no way pertain to those historical epochs”, “at the juncture” of which we are living. Let us call the epoch we are entering (or have entered, and which is in its initial stage) the present-day (or third) epoch. Let us call that which we have just emerged from the epoch of yesterday (or the second). In that case we shall have to call the epoch from which Potresov and Kautsky cite their instances, the day-before-yesterday (or first) epoch. Both Potresov’s and Kautsky’s revolting sophistry, the intolerable falseness of their arguments, consist in their substituting for the conditions of the present-day (or third) epoch the conditions of the day-before-yesterday (or first) epoch. I shall try to explain what I mean. The usual division into historical epochs, so often cited in Marxist literature and so many times repeated by Kautsky and adopted in Potresov’s article, is the following: (1) 1789-1871; (2) 1871-1914; (3) 1914 - ? Here, of course, as everywhere in Nature and society, the lines of division are conventional and variable, relative, not absolute. We take the most outstanding and striking historical events only approximately, as milestones in important historical movements. The first epoch from the Great French Revolution to the Franco-Prussian war is one of the rise of the bourgeoisie, of its triumph, of the bourgeoisie on the upgrade, an epoch of bourgeois-democratic movements in general and of bourgeois-national movements in particular, an epoch of the rapid breakdown of the obsolete feudal-absolutist institutions. The second epoch is that of the full domination and decline of the bourgeoisie, one of transition from its progressive character towards reactionary and even ultra-reactionary finance capital. This is an epoch in which a new class—present-day democracy—is preparing and slowly mustering its forces. The third epoch, which has just set in, places the bourgeoisie in the same “position” as that in which the feudal lords found themselves during the first epoch. This is the epoch of imperialism and imperialist upheavals, as well as of upheavals stemming from the nature of imperialism. It was none other than Kautsky who, in a series of articles and in his pamphlet Der Weg zur Macht (which appeared in 1909), outlined with full clarity the basic features of the third epoch that has set in, and who noted the fundamental differences between this epoch and the second (that of yesterday), and recognised the change in the immediate tasks as well as in the conditions and forms of struggle of present-day democracy, a change stemming from the changed objective historical conditions. Kautsky is now burning that which he worshipped yesterday; his change of front is most incredible, most unbecoming and most shameless. In the above-mentioned pamphlet, he spoke forthrightly of symptoms of an approaching war, and specifically of the kind of war that became a fact in 1914. It would suffice simply to place side by side for comparison a number of passages from that pamphlet and from his present writings to show convincingly how Kautsky has betrayed his own convictions and solemn declarations. In this respect Kautsky is not an individual instance (or even a German instance); he is a typical representative of the entire upper crust of present-day democracy, which, at a moment of crisis, has deserted to the side of the bourgeoisie. All the historical instances quoted by Potresov and Kautsky belong to the first epoch. The main objective content of the historical wartime phenomena, not only of 1855, 1859, 1864, 1866, or 1870, but also of 1877 (the Russo-Turkish war) and 1896-1897 (the wars between Turkey and Greece and the Armenian disturbances) were bourgeois-national movements or “convulsions” in a, bourgeois society ridding itself of every kind of feudalism. At that time there could have been no possibility of really independent action by present-day democracy, action of the kind befitting the epoch of the over-maturity, and decay of the bourgeoisie, in a number of leading countries. The bourgeoisie was then the chief class, which was on the upgrade as a result of its participation in those wars; it alone could come out with overwhelming force against the feudal-absolutist institutions. Represented by various strata of propertied producers of commodities, this bourgeoisie was progressive in various degrees in the different countries, sometimes (like part of the Italian bourgeoisie in 1859) being even revolutionary. The general feature of the epoch, however, was the progressiveness of the bourgeoisie, i.e., its unresolved and uncompleted struggle against feudalism. It was perfectly natural for the elements of present-day democracy, and for Marx as their representative, to have been guided at the time by the unquestionable principle of support for the progressive bourgeoisie (i.e., capable of waging a struggle) against feudalism, and for them to be dealing with the problem as to “the success of which side”, i.e., of which bourgeoisie, was more desirable. The popular movement in the principal countries affected by the war was generally democratic at that time, i.e., bourgeois-democratic in its economic and class content. It is quite natural that no other question could have been posed at the time except the following: the success of which bourgeoisie, the success of which combination of forces, the failure of which reactionary forces (the feudal-absolutist forces which were hampering the rise of the bourgeoisie) promised contemporary democracy more “elbow room”. As even Potresov has had to admit, Marx was guided, in his “appraisal” of international conflicts springing from bourgeois national and liberation movements, by considerations as to whose success was more capable of contributing to the “development” (p. 74 of Potresov’s article) of national and, in general, popular democratic movements. That means that, during military conflicts stemming from the bourgeoisie’s rise to power within the various nationalities, Marx was, as in 1848, most of all concerned with extending the scope of the bourgeois-democratic movement and bringing it to a head through the participation of broader and more “plebeian” masses, the petty bourgeoisie in general, the peasantry in particular, and finally of the poor classes as a whole. This concern of Marx for the extension of the movement’s social base and its development is the fundamental distinction between Marx’s consistently democratic tactics and Lassalle’s inconsistent tactics, which veered towards an alliance with the national-liberals. The international conflicts in the third epoch have, in form, remained the same kind of international conflicts as those of the first epoch, but their social and class content has changed radically. The objective historical situation has grown quite different. The place of the struggle of a rising capital, striving towards national liberation from feudalism, has been taken by the struggle waged against the new forces by the most reactionary finance capital, the struggle of a force that has exhausted and outlived itself and is heading downward towards decay. The bourgeois-national state framework, which in the first epoch was the mainstay of the development of the productive forces of a humanity that was liberating itself from feudalism, has now, in the third epoch, become a hindrance to the further development of the productive forces. From a rising and progressive class the bourgeoisie has turned into a declining, decadent, and reactionary class. It is quite another class that is now on the upgrade on a broad historical scale. Potresov and Kautsky have abandoned the standpoint of that class; they have turned back, repeating the false bourgeois assertion that today too the objective content of the historical process consists in the bourgeoisie’s progressive movement against feudalism. In reality, there can now be no talk of present-day democracy following in the wake of the reactionary imperialist bourgeoisie, no matter of what “shade” the latter may be. In the first epoch, the objective and historical task was to ascertain how, in its struggle against the chief representatives of a dying feudalism, the progressive bourgeoisie should “utilise” international conflicts so as to bring the greatest possible advantage to the entire democratic bourgeoisie of the world. In the first epoch, over half a century ago, it was natural and inevitable that the bourgeoisie, enslaved by feudalism, should wish the defeat of its “own” feudal oppressor, all the more so that the principal and central feudal strongholds of all-European importance were not so numerous at the time. This is how Marx “appraised” the conflicts: he ascertained in which country, in a given and concrete situation, the success of the bourgeois-liberation movement was more important in undermining the all-European feudal stronghold. At present, in the third epoch, no feudal fortresses of all-European significance remain. Of course, it is the task of present-day democracy to “utilise” conflicts, but—despite Potresov and Kautsky—this international utilisation must be directed, not against individual national finance capital, but against international finance capital. The utilisation should not be effected by a class which was on the ascendant fifty or a hundred years ago. At that time it was a question of “international action” (Potresov’s expression) by the most advanced bourgeois democracy; today it is another class that is confronted by a similar task created by history and advanced by the objective state of affairs. III The second epoch or, as Potresov puts it, “a span of forty-five years” (1870-1914), is characterised very inconclusively by him. The same incompleteness is the shortcoming in Trotsky’s characterisation of the same period, given in his German work, although he does not agree with Potresov’s practical conclusions (this, of course, standing to the former’s credit). Both writers hardly realise the reason for their standing so close to each other, in a certain sense. Here is what Potresov writes of this epoch, which we have called the second, that of yesterday: “A detailed restriction of work and the struggle and an all-pervading gradualism—these signs of the times, which by some have been elevated to a principle, have become to others an ordinary fact in their lives, and, as such, have become part of their mentality, a shade of their ideology” (p. 71). “Its [this epoch’s] talent for a smooth and cautious advance had, as its reverse, firstly, a pronounced non-adaptability to any break in gradualness and to catastrophic phenomena of any kind and secondly, an exceptional isolation within the sphere of national action—the national milieu. . .” (p. 72). “Neither revolution, nor war. . .” (p. 70). “Democracy became the more effectively nationalist, the longer the period of its ‘position warfare’ was protracted and the longer there lingered on the stage that spell of European history which . . . knew of no international conflicts in the heart of Europe, and consequently experienced no unrest extending beyond the boundaries of national state territories, and felt no keen interest on a general European or world scale” (75-76). The chief shortcoming in this characterisation, as in Trotsky’s characterisation of the same epoch, is a reluctance to discern and recognise the deep contradictions in modern democracy, which has developed on the foundation described above. The impression is produced that the democracy contemporary with the epoch under review remained a single whole, which, generally speaking, was pervaded with gradualism, turned nationalist, was by degrees weaned away from breaks in gradualness and from catastrophes, and grew petty and mildewed. In reality this could not have happened, since, side by side with the aforesaid tendencies, other and reverse tendencies were undoubtedly operating: the day-by-day life of the working masses was undergoing an internationalisation—the cities were attracting ever more inhabitants, and living conditions in the large cities of the whole world were being levelled out; capital was becoming internationalised, and at the big factories townsmen and country-folk, both native and alien, were intermingling. The class contradictions were growing ever more acute; the employers’ associations were exercising ever greater pressure on the workers’ unions; sharper and more bitter forms of struggle were arising, as, for instance, mass strikes; the cost of living was rising; the pressure of finance capital was becoming intolerable, etc., etc. In actual fact, events did not follow the pattern described by Potresov. This we know definitely. In the period under discussion, none, literally not one, of the leading capitalist countries of Europe was spared by the struggle between the two mutually opposed currents within contemporary democracy. In each of the big countries, this struggle at times assumed most violent forms, including splits, this despite the general “peaceful”, “sluggish”, and somnolent character of the epoch. These contradictory currents have affected all the various fields of life and all problems of modern democracy without exception, such as the attitude towards the bourgeoisie, alliances with the liberals, the voting for war credits, the attitude towards such matters as colonial policies, reforms, the character of economic struggle, the neutrality of the trade unions, etc. “All-pervading gradualism” was in no way the predominant sentiment in all contemporary democracy, as the writings of Potresov and Trotsky imply. No, this gradualism was taking shape as a definite political trend, which at the time often produced individual groups, and sometimes even individual parties, of modern democracy in Europe. That trend had its own leaders, its press organs, its policy, and its own particular—and specially organised—method of influencing the masses of the population. Moreover, this trend was more and more basing itself—and ultimately based itself solidly—on the interests of a definite social stratum within the democracy of the time. “All-pervading gradualism” naturally attracted into the ranks of that democracy a number of petty-bourgeois fellow-travellers; furthermore, the specifically petty-bourgeois conditions, and consequently, a petty-bourgeois political orientation, became the rule with a definite stratum of parliamentarians, journalists, and trade union officials; a kind of bureaucracy and aristocracy of the working class was arising in a manner more or less pronounced and clear-cut. Take, for instance, the possession of colonies and the expansion of colonial possessions. These were undoubted features of the period dealt with above, and with the majority of big states. What did that mean in the economic sense? It meant a sum of super-profits and special privileges for the bourgeoisie. It meant, moreover, the possibility of enjoying crumbs from this big cake for a small minority of the petty bourgeois, as well as for the better placed employees, officials of the labour movement, etc. The enjoyment of crumbs of advantage from the colonies, from privileges, by an insignificant minority of the working class in Britain, for instance, is an established fact, recognised and pointed out by Marx and Engels. Formerly confined to Britain alone, this phenomenon became common to all the great capitalist countries of Europe, as their colonial possessions expanded, and in general as the imperialist period of capitalism grew and developed. In a word, the “all-pervading gradualism” of the second epoch (the one of yesterday) has created, not only a certain “non-adaptability to any break in gradualness”, as Potresov thinks, not only certain “possibilist” tendencies, as Trotsky supposes, but an entire opportunist trend based on a definite social stratum within present-day democracy, and linked with the bourgeoisie of its own national “shade” by numerous ties of common economic, social, and political interests—a trend directly, openly, consciously, and systematically hostile to any idea of a “break in gradualness”. A number of Trotsky’s tactical and organisational errors (to say nothing of Potresov’s) spring from his fear, or his reluctance, or inability to recognise the fact of the “maturity” achieved by the opportunist trend, and also its intimate and unbreakable link with the national-liberals (or social-nationalists) of our times. In practice, this failure to recognise this “maturity” and this unbreakable link leads, at least, to absolute confusion and helplessness in the face of the predominant social-nationalist (or national-liberal) evil. The link between opportunism and social-nationalism is, generally speaking, denied by Potresov, by Martov, Axelrod, V. Kosovsky (who has talked himself into defending the German democrats’ national-liberal vote for war credits) and by Trotsky. Their main “argument” is that no full coincidence exists between yesterday’s division of democracy “along the line of opportunism” and today’s division “along the line of social-nationalism”. This argument is, firstly, incorrect in point of fact, as we shall presently show; secondly, it is absolutely one-sided, incomplete and untenable from the standpoint of Marxist principles. Persons and groups may shift from one side to the other; that is not only possible, but even inevitable in any great social upheaval; however, it does not at all affect the nature of a definite trend, or the ideological links between definite trends, or their class significance. All these considerations might seem so generally known and indisputable that one feels almost embarrassed at having to lay such emphasis on them. Yet the above-mentioned writers have lost sight of these very considerations. The fundamental class significance of opportunism—or, in other words, its social-economic content—lies in certain elements of present-day democracy having gone over (in fact, though perhaps unconsciously) to the bourgeoisie, on a number of individual issues. Opportunism is tantamount to a liberal-labour policy. Anyone who is fearful of the “factional” look of these words would do well to go to the trouble of studying the opinions of Marx, Engels, and Kautsky (is the latter not an “authority” highly suitable to the opponents of “factionalism”?) on, let us say, British opportunism. There cannot be the slightest doubt that such a study would lead to a recognition of the coincidence of fundamentals between opportunism and a liberal-labour policy. The basic class significance of today’s social-nationalism is exactly the same. The fundamental idea of opportunism is an alliance or a drawing together (sometimes an agreement, bloc, or the like) between the bourgeoisie and its antipode. The fundamental idea of social-nationalism is exactly the same. The ideological and political affinity, connection, and even identity between opportunism and social-nationalism are beyond doubt. Naturally, we must take as our basis, not individuals or groups, but a class analysis of the content of social trends, and an ideological and political examination of their essential and main principles. Approaching the same subject from a somewhat different angle, we shall ask: whence did social-nationalism appear? How did it grow and mature? What gave it significance and strength? He who has been unable to find answers to these questions has completely failed to understand what social nationalism is, and is consequently quite incapable of drawing an “ideological line” between himself and social-nationalism, no matter how vehemently he may assert that he is ready to do so. There can be only one answer to this question: social nationalism has developed from opportunism, and it was the latter that gave it strength. How could social-nationalism have appeared “all of a sudden”? In the same fashion as a babe appears “all of a sudden” if nine months have elapsed since its conception. Each of the numerous manifestations of opportunism during the entire second (or yesterday) epoch in all the European countries was a rivulet, which now flowed “all of a sudden” into a big though very shallow (and, we might add parenthetically, muddy and dirty) river of social-nationalism. Nine months after conception the babe must separate from its mother; many decades after opportunism was conceived, social-nationalism, its ripe fruit, will have to separate from present-day democracy within a period that is more or less brief (as compared with decades). No matter how good people may scold, rage or vociferate over such ideas and words, this is inevitable, since it follows from the entire social development of present-day democracy and from the objective conditions in the third epoch. But if division “along the line of opportunism” and division “along the line of social-nationalism” do not fully coincide, does that not prove that no substantial link exists between these two facts? It does not, in the first place, just as the fact that individual bourgeois at the end of the eighteenth century went over either to the side of the feudal lords or that of the people does not prove that there was “no link” between the growth of the bourgeoisie and the Great French Revolution of 1789. Secondly, taken by and large, there is such a coincidence (and we are speaking only in a general sense and of movements as a whole). Take, not one individual country but a number of them, let us say ten European countries: Germany, Britain, France, Belgium, Russia, Italy, Sweden, Switzerland, Holland, and Bulgaria. Only the three countries given in italics may seem the exceptions. In the others, the trends of uncompromising antagonists to opportunism have given birth to trends hostile to social-nationalism. Compare the well-known Monatshefte and its opponents in Germany, Nashe Dyelo and its opponents in Russia, the party of Bissolati and its opponents in Italy, the adherents of Greulich and Grimm in Switzerland, Branting and Höglund in Sweden, and Troelstra, Pannekoek and Gorter in Holland, and finally the Obshcho Dyelo adherents and the Tesnyaki in Bulgaria.[5] The general coincidence between the old and the new division is a fact; as for complete coincidences, they do not occur even in the simplest of natural phenomena, any more than there is complete coincidence between the Volga before the Kama joins it, and the Volga below that point; neither is there full similarity between a child and its parents. Britain only seems the exception; in reality, there were two main currents in Britain prior to the war, these being identified with two dailies—which is the truest objective indication of the mass character of these currents—namely, the Daily Citizen,[6] the opportunists’ newspaper, and the Daily Herald,[7] the organ of the opponents of opportunism. Both papers have been swamped by the wave of nationalism; yet, opposition has been expressed by under one-tenth of the former’s adherents and by some three-sevenths of the adherents of the latter. The usual method of comparison, whereby only the British Socialist Party is compared with the Independent Labour Party, is erroneous because it overlooks the existence of an actual bloc of the latter with the Fabians[8] and the Labour Party. It follows, then, that only two out of the ten countries are exceptions, but even here the exceptions are not complete, since the trends have not changed places; only (for reasons so obvious that they need not be dwelt on) the wave has swamped almost all the opponents of opportunism. This undoubtedly proves the strength of the wave, but it does not in any way disprove coincidence between the old division and the new for all Europe. We are told that division “along the line of opportunism” is outmoded, and that only one division is of significance, namely, that between the adherents of internationalism and the adherents of national self-sufficiency. This opinion is fundamentally wrong. The concept of “adherents of internationalism” is devoid of all content and meaning, if we do not concretely amplify it; any step towards such concrete amplification, however, will be an enumeration of features of hostility to opportunism. In practice, this will prove truer still. An adherent of internationalism who is not at the same time a most consistent and determined adversary of opportunism is a phantom, nothing more. Perhaps certain individuals of this type will honestly consider themselves “internationalists”. However, people are judged, not by what they think of themselves but by their political behaviour. The political behaviour of “internationalists” who are not consistent and determined adversaries of opportunism will always aid and abet the nationalist trend. On the other hand, nationalists, too, call themselves “internationalists” (Kautsky, Lensch, Haenisch, Vandervelde, Hyndman, and others); not only do they call themselves so, but they fully acknowledge an international rapprochement, an agreement, a union of persons sharing their views. The opportunists are not against “internationalism”; they are only in favour of international approval for and international agreement among the opportunists. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notes [1] Incidentally Potresov refuses to make up his mind as to whether Marx or Lassalle was right in appraising the conditions of the war of 1859. We think that (Mehring notwithstanding) Marx was right, whereas Lassalle was then an opportunist, just as he was during his flirtation with Bismarck. Lassalle was adapting himself to the victory of Prussia and Bismarck, to the lack of sufficient strength in the democratic national movements of Italy and Germany. Thus Lassalle deviated towards a national-liberal labour policy, whereas Marx encouraged and developed an independent, consistently democratic policy hostile to national-liberal cowardice (Prussia’s intervention in 1859 against Napoleon would have stimulated the popular movement in Germany). Lassalle was casting glances, not downwards but upwards, as he was fascinated by Bismarck. Bismarck’s “success” was no justification of Lassalle’s opportunism. —Lenin [2] “Indeed,” Potresov writes, “it was during that period of seeming stagnation that tremendous molecular processes were taking place in every country, the international situation too was gradually changing, the policy of colonial acquisitions, of militant imperialism becoming its determining feature.” —Lenin [3] A number of changes were made in Lenin’s article “Under a False Flag” by the editors of the Collection issued in March 1917 by Priliv Publishers. [4] Nashe Dyelo (Our Cause )—a monthly of the Menshevik liquidators; mouthpiece of social-chauvinists in Russia. It began publication in 1915 in Petrograd to replace Nasha Zarya, which had been suppressed in October 1914. [5] Obshcho Dyelo (The Common Cause ) adherents (also known as Shiroki socialists)—an opportunist trend in Bulgarian Social-Democratic Party. The journal Obshcho Dyelo was published from 1900 onwards. After a split at the Tenth Congress of the Social-Democratic Party in 1903 in Ruse they formed a reformist Bulgarian Social-Democratic Party (of Shiroki socialists). During the world imperialist war of 1914-18 the Obshcho Dyelo adherents took a chauvinist stand. Tesnyaki—a revolutionary trend in the Bulgarian Social-Democratic Party, which in 1903 took shape as an independent Bulgarian Workers’ Social-Democratic Party. The founder and leader of Tesnyaki was D. Blagoyev, his followers, Georgy Dimitrov and Vasil Kolarov, among others, later heading that Party. In 1914-18 the Tesnyaki came out against the imperialist war. In 1919 they joined the Communist International and formed the Communist Party of Bulgaria. [6] The Daily Citizen—originally organ of the opportunist bloc—the Labour Party, Fabians and the Independent Labour Party of Britain, published in London from 1912 to 1915. [7] The Daily Herald—organ of the British Socialist Party, published in London since 1912. [8] The Fabians—members of the Fabian Society, a British reformist organisation founded in 1884. The name is an allusion to the Roman commander Quintus Fabius Maximus (d. 203), called Cunctator, i.e., the Delayer, for his tactics of harassing Hannibal’s army without risking a pitched battle. Most of the Society’s members were bourgeois intellectuals: scholars, writers, politicians (such as Sidney and Beatrice Webb, Bernard Shaw, Ramsay MacDonald), who denied the need for the class struggle of the proletariat and a socialist revolution, and insisted that the transition from capitalism to socialism lay only through petty reform and a gradual transformation of society. Lenin said it was “an extremely opportunist trend” (see present edition, Vol. 13, p. 358). The Fabian Society, which was affiliated to the Labour Party in 1900, is one of the ideological sources of Labour Party policy. During World War I, the Fabians took a social-chauvinist stand. For Lenin’s description of the Fabians, see “British Pacifism and the British Dislike of Theory” (the present volume, pp. 260-65). |
Lenin How to Organise Competition? Written: December 24-27, 1917 Source: Collected Works, Volume 26, p. 404-15 Publisher: Progress Publishers First Published: Pravda No. 17, January 20, 1929. Translated: Yuri Sdobnikov and George Hanna Online Version: marx.org 1997; marxists.org 1999 Transcribed: Robert Cymbala HTML Markup: Brian Baggins and David Walters |
Bourgeois authors have been using up reams of paper praising competition, private enterprise, and all the other magnificent virtues and blessings of the capitalists and the capitalist system. Socialists have been accused of refusing to understand the importance of these virtues, and of ignoring "human nature". As a matter of fact, however, capitalism long ago replaced small, independent commodity production, under which competition could develop enterprise, energy and bold initiative to any considerable extent, by large- and very large-scale factory production, joint-stock companies, syndicates and other monopolies. Under such capitalism, competition means the incredibly brutal suppression of the enterprise, energy and bold initiative of the mass of the population, of its overwhelming majority, of ninety-nine out of every hundred toilers; it also means that competition is replaced by financial fraud, nepotism, servility on the upper rungs of the social ladder. Far from extinguishing competition, socialism, on the contrary, for the first time creates the opportunity for employing it on a really wide and on a really mass scale, for actually drawing the majority of working people into a field of labour in which they can display their abilities, develop the capacities, and reveal those talents, so abundant among the people whom capitalism crushed, suppressed and strangled in thousands and millions. Now that a socialist government is in power our task is to organise competition. The hangers-on and spongers on the bourgeoisie described socialism as a uniform, routine, monotonous and drab barrack system. The lackeys of the money-bags, the lickspittles of the exploiters, the bourgeois intellectual gentlemen used socialism as a bogey to "frighten" the people, who, under capitalism, were doomed to the penal servitude and the barrack-like discipline of arduous, monotonous toil, to a life of dire poverty and semi-starvation. The first step towards the emancipation of the people from this penal servitude is the confiscation of the landed estates, the introduction of workers’ control and the nationalisation of the banks. The next steps will be the nationalisation of the factories, the compulsory organisation of the whole population in consumers’ societies, which are at the same time societies for the sale of products, and the state monopoly of the trade in grain and other necessities. Classification of . Only now is the opportunity created for the truly mass display of enterprise, competition and bold initiative. Every factory from which the capitalist has been ejected, or in which he has at least been curbed by genuine workers’ control, every village from which the landowning exploiter has been smoked out and his land confiscated has only now become a field in which the working man can reveal his talents, unbend his back a little, rise to his full height, and feel that he is a human being. For the first time after centuries of working for others, of forced labour for the exploiter, it has become possible to work for oneself and moreover to employ all the achievements of modern technology and culture in one’s work. Of course, this greatest change in human history from working under compulsion to working for oneself cannot take place without friction, difficulties, conflicts and violence against the inveterate parasites and their hangers-on. No worker has any illusions on that score. The workers and poor peasants, hardened by dire want and by many long years of slave labour for the exploiters, by their countless insults and acts of violence, realise that it will take time to break the resistance of those exploiters. The workers and peasants are not in the least infected with the sentimental illusions of the intellectual gentlemen, of the Novaya Zhizn crowd and other slush, who "shouted" themselves hoarse "denouncing" the capitalists and "gesticulated" against them, only to burst into tears and to behave like whipped puppies when it came to deeds, to putting threats into action, to carrying out in practice the work of removing the capitalists. The great change from working under compulsion to working for oneself, to labour planned and organised on a gigantic, national (and to a certain extent international, world) scale, also requires—in addition to "military" measures for the suppression of the exploiters’ resistance—tremendous organisational, organising effort on the part of the proletariat and the poor peasants. The organisational task is interwoven to form a single whole with the task of ruthlessly suppressing by military methods yesterday’s slave-owners (capitalists) and their packs of lackeys—the bourgeois intellectual gentlemen. Yesterday’s slave-owners and their "intellectual" stooges say and think, "We have always been organisers and chiefs. We have commanded, and we want to continue doing so. We shall refuse to obey the ’common people’, the workers and peasants. We shall not submit to them. We shall convert knowledge into a weapon for the defence of the privileges of the money-bags and of the rule of capital over the people." That is what the bourgeoisie and the bourgeois intellectuals say, think, and do. From the point of view of self-interest their behaviour is comprehensible. The hangers-on and spongers on the feudal landowners, the priests, the scribes, the bureaucrats as Gogol depicted them, and the "intellectuals" who hated Belinsky, also found it "hard" to part with serfdom. But the cause of the exploiters and of their "intellectual" menials is hopeless. The workers and peasants are beginning to break down their resistance—unfortunately, not yet firmly, resolutely and ruthlessly enough—and break it down they will. "They" think that the "common people", the "common" workers and poor peasants, will be unable to cope with the great, truly heroic, in the world-historic sense of the word, organisational tasks which the socialist revolution has imposed upon the working people. The intellectuals who are accustomed to serving the capitalists and the capitalist state say in order to console themselves: "You cannot do without us." But their insolent assumption has no truth in it; educated men are already making their appearance on the side of the people, on the side of the working people, and are helping to break the resistance of the servants of capital. There are a great many talented organisers among the peasants and the working class, and they are only just beginning to become aware of themselves, to awaken, to stretch out towards great, vital, creative work, to tackle with their own forces the task of building socialist society. One of the most important tasks today, if not the most important, is to develop this independent initiative of the workers, and of all the working and exploited people generally, develop it as widely as possible in creative organisational work. At all costs we must break the old, absurd, savage, despicable and disgusting prejudice that only the so-called "upper classes", only the rich, and those who have gone through the school of the rich, are capable of administering the state and directing the organisational development of socialist society. This is a prejudice fostered by rotten routine, by petrified views, slavish habits, and still more by the sordid selfishness of the capitalists, in whose interest it is to administer while plundering and to plunder while administering. The workers will not forget for a moment that they need the power of knowledge. The extraordinary striving after knowledge which the workers reveal, particularly now, shows that mistaken ideas about this do not and cannot exist among the proletariat. But every rank-and-file worker and peasant who can read and write, who can judge people and has practical experience, is capable of organisational work. Among the "common people", of whom the bourgeois intellectuals speak with such haughtiness and contempt, there are many such men and women. This sort of talent among the working class and the peasants is a rich and still untapped source. The workers and peasants are still "timid", they have not yet become accustomed to the idea that they are now the ruling class; they are not yet resolute enough. The revolution could not at one stroke instill these qualities into millions and millions of people who all their lives had been compelled by want and hunger to work under the threat of the stick. But the Revolution of October 1917 is strong, viable and invincible because it awakens these qualities, breaks down the old impediments, removes the worn-out shackles, and leads the working people on to the road of the independent creation of a new life. Accounting and control--this is the main economic task of every Soviet of Workers’, Soldiers’ and Peasant’ Deputies, of every consumers’ society, of every union or committee of supplies, of every factory committee or organ of workers’ control in general. We must fight against the old habit of regarding the measure of labour and the means of production from the point of view of the slave whose sole aim is to lighten the burden of labour or to obtain at least some little bit from the bourgeoisie. The advanced, class-conscious workers have already started this fight, and they are offering determined resistance to the newcomers who flocked to the factory world in particularly large numbers during the war and who now would like to treat the people’s factory, the factory that has come into the possession of the people, in the old way, with the sole aim of "snatching the biggest possible piece of the pie and clearing out". All the class-conscious, honest and thinking peasants and working people will take their place in this fight by the side of the advanced workers. Accounting and control, if carried on by the Soviets of Workers’, Soldiers’ and Peasants’ Deputies as the supreme state power, or on the instructions, on the authority, of this power -- widespread, general, universal accounting and control, the accounting and control of the amount of labour performed and of the distribution of products—is the essence of socialist transformation, once the political rule of the proletariat has been established and secured. The accounting and control essential for the transition to socialism can be exercised only by the people. Only the voluntary and conscientious co-operation of the mass of the workers and peasants in accounting and controlling the rich, the rogues, the idlers and the rowdies, a co-operation marked by revolutionary enthusiasm, can conquer these survivals of accursed capitalist society, these dregs of humanity, these hopelessly decayed and atrophied limbs, this contagion, this plague, this ulcer that socialism has inherited from capitalism. Workers and peasants, working and exploited people! The land, the banks and the factories have now become the property of the entire people! You yourselves must set to work to take account of and control the production and distribution of products—this, and this alone is the road to the victory of socialism, the only guarantee of its victory, the guarantee of victory over all exploitation, over all poverty and want! For there is enough bread, iron, timber, wool, cotton and flax in Russia to satisfy the needs of everyone, if only labour and its products are properly distributed, if only a business-like, practical control over this distribution by the entire people is established, provided only we can defeat the enemies of the people: the rich and their hangers-on, and the rogues, the idlers and the rowdies, not only in politics, but also in everyday economic life. No mercy for these enemies of the people, the enemies of socialism, the enemies of the working people! War to the death against the rich and their hangers-on, the bourgeois intellectuals; war on the rogues, the idlers and the rowdies! All of them are of the same brood—the spawn of capitalism, the offspring of aristocratic and bourgeois society; the society in which a handful of men robbed and insulted the people; the society in which poverty and want forced thousands and thousands on to the path of rowdyism, corruption and roguery, and caused them to lose all human semblance; the society which inevitably cultivated in the working man the desire to escape exploitation even by means of deception, to wriggle out of it, to escape, if only for a moment, from loathsome labour, to procure at least a crust of bread by any possible means, at any cost, so as not to starve, so as to subdue the pangs of hunger suffered by himself and by his near ones. The rich and the rogues are two sides of the same coin, they are the two principal categories of parasites which capitalism fostered; they are the principal enemies of socialism. These enemies must be placed under the special surveillance of the entire people; they must be ruthlessly punished for the slightest violation of the laws and regulations of socialist society. Any display of weakness, hesitation or sentimentality in this respect would be an immense crime against socialism. In order to render these parasites harmless to socialist society we must organise the accounting and control of the amount of work done and of production and distribution by the entire people, by millions and millions of workers and peasants, participating voluntarily, energetically and with revolutionary enthusiasm. And in order to organise this accounting and control, which is fully within the ability of every honest, intelligent and efficient worker and peasant, we must rouse their organising talent, the talent that is to be found in their midst; we must rouse among them—and organise on a national scale -- competition in the sphere of organisational achievement; the workers and peasants must be brought to see clearly the difference between the necessary advice of an educated man and the necessary control by the "common" worker and peasant of the slovenliness that is so usual among the "educated". This slovenliness, this carelessness, untidiness, unpunctuality, nervous haste, the inclination to substitute discussion for action, talk for work, the inclination to undertake everything under the sun without finishing anything, are characteristics of the "educated"; and this is not due to the fact that they are bad by nature, still less is it due to their evil will; it is due to all their habits of life, the conditions of their work, to fatigue, to the abnormal separation of mental from manual labor, and so on, and so forth. Among the mistakes, shortcomings and defects of our revolution a by no means unimportant place is occupied by the mistakes, etc., which are due to these deplorable—but at present inevitable—characteristics of the intellectuals in our midst, and to the lack of sufficient supervision by the workers over the organisational work of the intellectuals. The workers and peasants are still "timid"; they must get rid of this timidity, and they certainty will get rid of it. We cannot dispense with the advice, the instruction of educated people, of intellectuals and specialists. Every sensible worker and peasant understands this perfectly well, and the intellectuals in our midst cannot complain of a lack of attention and comradely respect on the part of the workers and peasants. Advice and instruction, however, is one thing, and the organisation of practical accounting and control is another. Very often the intellectuals give excellent advice and instruction, but they prove to be ridiculously, absurdly, shamefully "unhandy" and incapable of carrying out this advice and instruction, of exercising practical control over the translation of words into deeds. In this very respect it is utterly impossible to dispense with the help and the leading role of the practical organisers from among the "people", from among the factory workers and working peasants. "It is not the gods who make pots"—this is the truth that the workers and peasants should get well drilled into their minds. They must understand that the whole thing now is practical work; that the historical moment has arrived when theory is being transformed into practice, vitalised by practice, corrected by practice, tested by practice; when the words of Marx, "Every step of real movement is more important than a dozen programmes", become particularly true—every step in really curbing in practice, restricting, fully registering the rich and the rogues and keeping them under control is worth more than a dozen excellent arguments about socialism. For, "theory, my friend, is grey, but green is the eternal tree of life". Competition must be arranged between practical organisers from among the workers and peasants. Every attempt to establish stereotyped forms and to impose uniformity from above, as intellectuals are so inclined to do, must be combated. Stereotyped forms and uniformity imposed from above have nothing in common with democratic and socialist centralism. The unity of essentials, of fundamentals, of the substance, is not disturbed but ensured by variety in details, in specific local features, in methods of approach, in methods of exercising control, in ways of exterminating and rendering harmless the parasites (the rich and the rogues, slovenly and hysterical intellectuals, etc., etc.). The Paris Commune gave a great example of how to combine initiative, independence, freedom of action and vigour from below with voluntary centralism free from stereotyped forms. Our Soviets are following the same road. But they are still "timid"; they have not yet got into their stride, have not yet "bitten into" their new, great, creative task of building the socialist system. The Soviets must set to work more boldly and display greater initiative. All "communes"—factories, villages, consumers’ societies, and committees of supplies—must compete with each other as practical organisers of accounting and control of labour and distribution of products. The programme of this accounting and control is simple, clear and intelligible to all—everyone to have bread; everyone to have sound footwear and good clothing; everyone to have warm dwellings; everyone to work conscientiously; not a single rogue (including those who shirk their work) to be allowed to be at liberty, but kept in prison, or serve his sentence of compulsory labour of the hardest kind; not a single rich man who violates the laws and regulations of socialism to be allowed to escape the fate of the rogue, which should, in justice, be the fate of the rich man. "He who does not work, neither shall he eat"—this is the practical commandment of socialism. This is how things should be organised practically. These are the practical successes our "communes" and our worker and peasant organisers should be proud of. And this applies particularly to the organisers among the intellectuals (particularly, because they are too much, far too much in the habit of being proud of their general instructions and resolutions). Thousands of practical forms and methods of accounting and controlling the rich, the rogues and the idlers must be devised and put to a practical test by the communes themselves, by small units in town and country. Variety is a guarantee of effectiveness here, a pledge of success in achieving the single common aim—to clean the land of Russia of all vermin, of fleas—the rogues, of bugs—the rich, and so on and so forth. In one place half a score of rich, a dozen rogues, half a dozen workers who shirk their work (in the manner of rowdies, the manner in which many compositors in Petrograd, particularly in the Party printing-shops, shirk their work) will be put in prison. In another place they will be put to cleaning latrines. In a third place they will be provided with "yellow tickets" after they have served their time, so that everyone shall keep an eye on them, as harmful persons, until they reform. In a fourth place, one out of every ten idlers will be shot on the spot. In a fifth place mixed methods may be adopted, and by probational release, for example, the rich, the bourgeois intellectuals, the rogues and rowdies who are corrigible will be given an opportunity to reform quickly. The more variety there will be, the better and richer will be our general experience, the more certain and rapid will be the success of socialism, and the easier will it be for practice to devise—for only practice can devise—the best methods and means of struggle. In what commune, in what district of a large town, in what factory and in what village are there no starving people, no unemployed, no idle rich, no despicable lackeys of the bourgeoisie, saboteurs who call themselves intellectuals? Where has most been done to raise the productivity of labour, to build good new houses for the poor, to put the poor in the houses of the rich, to regularly provide a bottle of milk for every child of every poor family? It is on these points that competition should develop between the communes, communities, producer-consumers’ societies and associations, and Soviets of Workers’, Soldiers’ and Peasants’ Deputies. This is the work in which talented organisers should come to the fore in practice and be promoted to work in state administration. There is a great deal of talent among the people. It is merely suppressed. It must be given an opportunity to display itself. It and it alone, with the support of the people, can save Russia and save the cause of socialism. Vl. Ilyin Collected Works Volume 26 Collected Works Table of Contents Lenin Works Archive (souligné par moi DC) |
| Dominique Colas, La
logique de l'épuration des paysans du sol russe
théorisée pas Lénine en 1907 (texte inédit
en français). |
Le texte principalement utilisé dans ce texte est : V. I. Lenin The Agrarian Question and the “Critics of Marx” http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1907/agrarcom/index.htm Conclusion : Lénine et le modèle d’ accumulaton du Capital chez Marx ` Le léninisme, à la fois comme idéologie et comme période de la révolution russe, ne peut nullement être considére, comme une sorte de moment de pureté qui aurait ultérieurement subi une série de dégradations ou de souillures. Bien sûr l’histoire de l’URSS et des pays communistes est une histoire au sens le plus simple du terme : des événements non prévus s’y sont produits, des phénomènes inédits y sont apparus. Mais si l’on s’en tient, ce qui pour un régime de dictature de parti unique visant à la construction d’une société nouvelle après destruction de l’ancien, aux pratiques et aux théorisations de la repression est essentiel, au discours (à la fois la formulation d’une forme de rationalité et les pratiques qu’elle fonde) léniniste, il ne contient rien de moins que ce qui se développera ultérieurement. L’épuration n’est pas un accident du socialisme réel qu’on pourrait mettre entre parenthèses pour soutenir qu’il existe un socialisme vrai qui aurait été perverti : d’emblée le léninisme à opérier dans le double registre de la terreur de masse et de la purification mise en œuvre dans une recherche forcénée de l’unité par un parti unique et unifié. Il reste qu’il n’est pas absurde de se demander si ce socialisme vrai est l’invention du bolchévisme ou se trouve déjà dans le marxisme de Marx. Et l’on sait que l’idée « d’un retour à Marx » dont le mauvais usage, la lecture erronée auraient entrainé la catastrophe stalinienne a été avancée, notamment dans l’Ecole de Louis Althusser. On peut noter sur un point clef, la question du parasitisme l’écart entre certains des textes de Marx que Lénine a lus et cités et les décisions qu’il a prises. Lénine dans L’Etat et la révolution- s’est beaucoup appuyé sur l’ouvrage de Marx sur la Commune de Paris en 1871. Dans son texte Marx propose une rapide sociologie historique de l’Etat en France (qui reprend des arguments exposés dans la deuxième édition, de 1868, de Louis Napoléon Bonaparte et le coup d’Etat du 2 décembre) : l’histoire de l’Etat en France est caractérisé par une lente différenciation de l’Etat et de la société civile (bürgerliche Gesselschaft) comme on l’observe, avec des spécificités propres, aussi en Angleterre. Mais avec l’apparition du bonapartisme se produit un phénomène nouveau : faute de disposer d’une base de classe suffisante (son soutien essentiel ce sont les petits paysans parcellaires qui reportent sur lui la vénération religieuse qu’ils ont pour son oncle, Napoléon Ier), Napoléon III développe une « bureaucratie » qui étaye son pouvoir.Cette bureaucratie, tout le contraire de la bureaucratie weberienne efficace et rationalisatrice, est composée d’employés de bureau surnuméraires et de sous-officiers inutiles. Aussi pour Marx avec le bonapartisme, l’Etat, dont un des aspects est la fête impériale où l’on dépense sans compter dans un tourbillon de plaisir, est-il le « parasite « de la société civile, son vampire, sa goule. Dans la Commune de Paris il faut voir la révolte de la société civile contre un buveur de sang, une lutte contre un boa constrictor qui l’enserrait dans ses anneaux. Lénine, effectuant une relecture des textes de Marx sur la Commune et une réinterprétation de celle-ci, à la lumière de la révolution de 1905 et de l’insurrection de décembre 1905 à Moscou considère que les communards ont commis deux erreurs. D’une part ils n’ont pas procédé à « l’expropriation des expropriateurs », en ne saississant pas, par exemple, les banques ; la deuxième faute du prolétariat sur « sa trop grande magnanimité » : « au lieu d’exterminer ses ennemis, il chercha à exercer une influence morale sur eux » et ne marcha pas sur Versailles. Lénine réaffirme que la lutte des classes se transforme à certains moments en guerre civile où les « intérêts du prolétariat » le conduisent à « l’extermination implacable de ses ennemis dans des combats déclarés » . La véhémence du texte est d’autant plus remarquable qu’il a été publié dans un journal en Russie, ce qui contraignait à une certaine prudence. Mais plus généralement encore Lénine dénonce moins l’Etat parasite qu’il ne dénonce les parasites : pour lui la destruction de l’Etat tsariste et de toutes les institutions qui lui sont liées, par la dictature du parti, s’accompagne d’une politique d’éradication des groupes sociaux considérés comme parasitaires. Mais si l’on peut marquer une solution de continuité entre Lénine et Marx (avec la réserve que la quantité de textes que celui-ci a produit limite notre affirmation au seul corpus cité plus haut), l’on pourrait relever que l’idée de parasites sociaux et plus généralement la vision de la politique comme hygiène sociale, est banale chez les socialistes du XIXe siècle. Pas plus que Lénine n’a inventé les camps de concentration, il n’a inventé la thématique de la nocifité de groupes de profiteurs qu’il faudrait éradiquer. Mais l’on peut redire de son usage de la notion de « parasite » ce qu’on a dit à propos des institutions de repression : on ne peut évacuer la spécificité du léninisme par référence à d’autres usages du même terme chez des socialistes contemporains, car « parasite « chez lui n’est pas seulement un motif idéologique, c’est une catégorie discursive et pratique qui conduit ceux qu’elle désigne à l’exclusion ou à la destruction. On sait que le « parasitisme « fut une catégorie pénale soviétique fort productive de sanctions. Sur un autre mode on pourrait dire que certains textes qui, chez Marx, avaient le statut de descriptions et d’analyses ont été érigés par Lénine en prescriptions. Le décalage est d’autant plus sensible que Lénine a pris comme des commandements pertinents pour la Russie des analyses que Marx avait présenté quant à l’Angleterre. L’exemple le plus net est la longue citation d’un passage du livre IV du Capital que Lénine fait en 1907 dans Le Programme agraire de la social)démocratie dans la première révolution russe de 1905-1917. Ce texte, un des plus longs de Lénine, qui essaye de trouver une réponse à la politique agraire de Stolypine qui s’en prend à la propriété féodale mais que Lénine doit cependant condamner comme bourgeois d’autant que certains socialistes la soutiennent, est d’autant plus pertinent pour montrer les origines de la théorie de l’épuration chez Lénine qu’il fut republié en septembre 1917. Cette continuité permet d’affirmer que la légitimité du « nettoyage de la terre russe » était affirmée par Lénine 10 ans avant la révolution et plus de 20 ans avant la dékoulokisation stalinienne. L’ouvrage est un plaidoyer pour la « nationalisation « de la terre contre la solution qui consisterait à un soutien, au travers par exemple, la « municipalisation » , de « la propriété paysanne parcellaire ». Cette solution ne permettrait pas de faire passer la Russie de la domination économique de l’agriculture à une domination économique de l’industrie ou, comme le dit Lénine, de passer de la « Russie du bois » à la « Russie du fer ». Pour ce faire il faut soutenir la solution qui permet le meilleur développement des forces productives : il faut suivre une voie qui ne soit pas celle de la lente transformation de l’exploitation féodale en exploitation paysanne (comme avec les junkers prussiens), mais de la destruction de la propriété féodale qui permette « la transformation du paysan patriarcal en fermier bourgeois » (une solution à l’américaine). Ainsi sera déblayé la voie qui accélera le développement du capitalisme. Citons ce texte en entier en indiquant les termes utilisés en russe pour traduire Marx et qui font bien apparaître la continuité entre le « clearing of estates » anglais et la ciska, l’épuration russe. « L’Angleterre est à cet égard [la destruction du régime agraire traditionnel] le pays le plus révolutionnaire du monde. Tous les régimes que l’histoire lui a légués, là où ils étaient contraires aux conditions de la production capitaliste dans l’agriculture, ou ne correspondaient pas à ces conditions, ont été balayés sans merci ; non seulement la disposition des localités rurales a été modifiée, mais ces localités elles-mêmes ont été balayées : balayés non seulement les logis et les lieux habités par la population agricole, mais même la population ; balayés les centres d’économie traditionnels, mais jusqu’à l’économie même. […] Chez les Anglais, le régime historique de l’agriculture s’est trouvé être progressivement constitué par le capital, à partir du XVe siècle. L’expression technique habituelle dans le Royaume-Uni clearing of estates (littéralement : éclaircissement des bien-fonds ou nettoyage (tchiska) des terres) ne se retrouve dans aucun autre pays continental. » Et Marx, toujours dans la citation donné par Lénine, poursuivait en décrivant les nethodes du clearing of estates, -explusion, destructin de bâtiments, modification des types de production - « bref, on n’adoptait pas toutes les conditions de la production sous la forme où elles existaient par tradition, mais on les créait historiquement sous une forme propre à répondre, dans chaque cas donné, aux exigences d’une application avantageuse du capital » . Création d’un nouveau mode de production par épuration (tchsicka), n’est-ce pas l’essentiel de la politique agraire léniniste-stalinienne ? L’évolution des théories agraires de Lénine n’a pas besoin d’être retracée ici, sinon pour souligner qu’il a pour thèse permanente celle d’une population excédentaire dont il faut nettoyer la terre russe. Dès ses premiers textes il parle des koulaks comme de « vampires » ou de « sangsues », dont le nombre est énorme par rapport à la quantité minime de produits dont disposent les paysans , tout en affirmant que ses usuriers et « les paysans bien assis » relèvent d’un même phénomène, le développement du capitalisme dans les campagnes. Ainsie est annoncé, dès avant 1900, l’assimilation que Lénine établie en 1918 entre « koulaks « et « élements exploiteurs des campagnes » ou « bourgeoisie rurale » . Du reste Lénine, dans le même texte de 1897, soutient que « dans son activité économique le moujik tend à devenir un koulak » . Il se peut que l’idée de parasitisme et de parasitisme de paysans riches ne soit par original, qu’elle ne soit par une invention de Lénine mais l’idée changera de statut que il le programme communiste sera de se débarasser de ces centaines de milliers de paysans aisés qu’il faut « écraser » par la violence comme le mot d’ordre est donné en 1920-1921 par Lénine . Si l’on peut souligner que Lénine à trouver chez Marx le modèle de l’institution efficace parce qu’épurée et la théorisation de la nécessaire élimination de groupes excédentaires dans la paysannerie, on doit aussi noter deux différences remarquables. Dans la théorisation de la coopération comme création d’un « corps collectif », Marx souligne que la « direction capitaliste » à une double face : « procès de production coopératif « et « procès d’extraction de plus-value » aussi la forme de cette direction devient nécessairement « despotique ». Ce despotisme de la fabrique Lénine l’oublie pour ne retenir de la coopération que le prodigieux gain d’efficacité qu’elle permet . Mais l’écart d’avec Marx est aussi remarquable dans la transformation de la notion d’Etat parasite, que l’on trouve chez Marx à la conception léniniste du parasitisme. En effet, dans La Commune de Paris, 1871, Marx présente l’Etat bonapartise comme un produit ultime de la différenciation entre société civile (bürgerlichte Gesselchaft) et Etat où l’Etat bureaucratique menace de dévorer la société civile : c’est un vampire, un buveur de sang, une goule, un parasite dit Marx. Mais si Marx qualifie l’Etat bourgeois de parasite et souhaite son remplacement par la dictature du parti, il ne ne parle jamais des bureaucrates comme de parasites qu’il faudrait exterminer . En ce sens, et dans la mesure même où l’épuration est au cœur même du dispositif qu’il a conçu, on peut dire que Lénine introduit un concept nouveau de la politique par rapport à Marx : sa théorisation n’est pas centrée sur la distinction entre société civile et Etat, mais entre parti épuré et société à épurer. Si l’on peut donc considérer qu’il y a une discontinuité entre Marx et Lénine quant à leur conception du corps social, ce corps collectif que Lénine voudrait exempt de toute impureté (et sans tenire compte des différences entre leur statut historique), on peut soutenir, au contraire la continuité entre Lénine et Staline. Quand Lénine meurt tous les instruments de la terreur de masse et des diffèrentes formes de violence ont été expérimentés sur une plus ou moins grande échelle : les camps de concentration (dont le premier ouvre en août 1918), la mise en place de l’extermination des koulaks en tant que classe (printemps 1918), l’internement dans des hôpitaux psychiatriques pour des opposants politiques (fevrier 1919), l’organisation de procès truqués, la lutte contre les opposants dans le parti par la mise en place d’une policie intérieure au parti, la rédaction d’articles du code pénal permettant une représsion illimitée. Et il a commençé à faire fonctionner des mécanismes de terreur sur le parti qui sont pour des auteurs comme Arendt ou Aron typique du totalitarisme, même si l’ampleur des violences n’est pas comparable à celle que Staline déploiera. |
| Dans
une bombe, avant l'explosion, les contraires, par suite de conditions
déterminées, coexistent dans l'unité. Et c'est
seulement avec l'apparition de nouvelles conditions (allumage) que se
produit l'explosion. Une situation analogue se retrouve dans tous les
phénomènes de la nature où, finalement, la
solution d'anciennes contradictions et la naissance de choses nouvelles
se produisent sous forme de conflits ouverts. Il est extrêmement important de connaître ce fait. Il nous aide à comprendre que, dans la société de classes, les révolutions et les guerres révolutionnaires sont inévitables, que, sans elles, il est impossible d'obtenir un développement par bonds de la société, de renverser la classe réactionnaire dominante et de permettre au peuple de prendre le pouvoir. |
| Mao tsé toung, De la contradiction, http://classiques.chez-alice.fr/mao/contradic7.html ON CONTRADICTION August 1937 |
Citations de Mao tsé toung : "Le Petit livre rouge " (1966) http://classiques.chez-alice.fr/mao/PLR.html |
| ONTENTS 1. The Communist Party 2. Classes and Class Struggle 3. Socialism and Communism3 4. The Correct Handling of Contradictions Among the People 5. War and Peace 6. Imperialism and All Reactionaries Are Paper Tigers 7. Dare to Struggle and Dare to Win 8. People's War 9. The People's Army 10. Leadership of Party Committees 11. The Mass Line 12. Political Work 13. Relations Between Officers and Men 14. Relations Between the Army and the People 15. Democracy in the Three Main Fields 16. Education and the Training of Troops 17. Serving the People 18. Patriotism and Internationalism 19. Revolutionary Heroism 20. Building Our Country Through Diligence and Frugality 21. Self-Reliance and Arduous Struggle 22. Methods of Thinking and Methods of Work 23. Investigation and Study 24. Correcting Mistaken Ideas 25. Unity 26. Discipline 27. Criticism and Self-Criticism 28. Communists 29. Cadres 30. Youth 31. Women 32. Culture and Art 33. Study |
Quotations from Mao Tse Tung (http://art-bin.com/art/omaotoc.html) ou : http://www.marxists.org/reference/archive/mao/works/red-book/ |
| Communists must use
the democratic
method of persuasion and education when working among the labouring
people and must on no account resort to commandism or coercion. The
Chinese Communist Party faithfully adheres to this Marxist-Leninist
principle. On the Correct Handling of Contradictions Among the People (February 27, 1957), 1st pocket ed., p. 15.* [ texte complet : ON THE CORRECT HANDLING OF CONTRADICTIONS AMONG THE PEOPLE |
| Our comrades must understand that
ideological remoulding involves long-term, patient and painstaking
work, and they must not attempt to change people's ideology, which has
been shaped over decades of life, by giving a few lectures or by
holding a few meetings. Persuasion, not compulsion, is the only way to
convince them. Compulsion will never result in convincing them. To try
to convince them by force simply won't work. This kind of method is
permissible in dealing with the enemy, but absolutely impermissible in
dealing with comrades or friends. Speech at the Chinese Communist Party's National Conference on Propaganda Work (March 12, 1957), lst pocket ed., p. 23. We must make a distinction between the enemy and ourselves, and we must not adopt an antagonistic stand towards comrades and treat them as we would the enemy. In speaking up, one must have an ardent desire to protect the cause of the people and raise their political consciousness, and there must be no ridiculing or attacking in one's approach. Ibid., p. 20.* |
| Mao
Tsétoung «Problèmes de la guerre et de la stratégie» (6 novembre 1938), Œuvres choisies, tome II |
« Chaque communiste doit s'assimiler cette vérité que «le pouvoir est au bout du fusil» ». "Notre principe, c'est : le Parti commande aux fusils, et il est inadmissible que les fusils commandent au Parti." |
| It is the peasants who are
the source of China's industrial workers. In the future, additional
tens of millions of peasants will go to the cities and enter factories.
If China is to build up powerful national industries and many large
modern cities, there will have to be a long process of transformation
of rural into urban inhabitants. It is the peasants who constitute the main market for China's industry. Only they can supply foodstuffs and raw materials in great abundance and absorb manufactured goods in great quantities. It is the peasants who are the source of the Chinese army. The soldiers are peasants in military uniform, the mortal enemies of the Japanese aggressors. It is the peasants who are the main political force for democracy in China at the present stage. Chinese democrats will achieve nothing unless they rely on the support of the 360 million peasants. It is the peasants who are the chief concern of China's cultural movement at the present stage. If the 360 million peasants are left out, do not the "elimination of illiteracy", "popularization of education", "literature and art for the masses" and "public health" become largely empty talk? In saying this, I am of course not ignoring the political, economic and cultural importance of the rest of the people numbering about 90 million, and in particular am not ignoring the working class, which is politically the most conscious and therefore qualified to lead the whole revolutionary movement. Let there be no misunderstanding. |
| Mao tsé toung Du Gouvernement de coalition, avril, 1945 |
| RAPPORT DE LIN PIAO AU IX
CONGRÈS DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS (avril 1969) |
| Les renégats et agents secrets,
les propriétaires fonciers, paysans riches, contre-révolutionnaires,
mauvais éléments, et droitiers, qui refusent de s'amender, les
contre-révolutionnaires agissants ainsi que les arrivistes et
individus à double face de la bourgeoisie, cette poignée de gens qui
se dissimulent parmi les masses, ne se révèlent pas tant qu'il n'y a
pas le climat voulu. Au cours de l'été 1967 et du printemps 1968, ils
déclenchèrent à nouveau un sinistre courant réactionnaire de
réhabilitation, de droite et d'extrême "gauche". Ils visaient le
quartier général du prolétariat dont le président Mao est le
commandant en chef, ainsi que l'Armée populaire de Libération et les
comités révolutionnaires nouvellement établis ; par ailleurs, ils
dressèrent une partie des masses contre une autre, organisèrent des
groupes de conspirateurs contre-révolutionnaires pour tenter de
reprendre le pouvoir au prolétariat. Cependant, cette poignée
d'individus furent finalement démasqués tout comme leur chef de file,
Liou Chao-chi. C'est là une importante victoire de la Grande
Révolution culturelle prolétarienne. |
| On
Guerrilla Warfare (http://www.marxists.org/reference/archive/mao/works/1937/guerrilla-warfare/index.htm) |
| 6.
The Political Problems Of Guerrilla Warfare (http://www.marxists.org/reference/archive/mao/works/1937/guerrilla-warfare/ch06.htm) In Chapter 1, I mentioned the fact that guerrilla troops should have a precise conception of the political goal of the struggle and the political organization to be used in attaining that goal. This means that both organization and discipline of guerrilla troops must be at a high level so that they can carry out the political activities that are the life of both the guerilla armies and of revolutionary warfare. First of all, political activities depend upon the indoctrination of both military and political leaders with the idea of anti-Japanism. Through them, the idea is transmitted to the troops. One must not feel that he is anti-Japanese merely because he is a member of a guerrilla unit. The anti-Japanese idea must be an ever-present conviction, and if it is forgotten, we may succumb to the temptations of the enemy or be overcome with discouragement. In a war of long duration, those whose conviction that the people must be emancipated is not deep rooted are likely to become shaken in their faith or actually revolt. Without the general education that enables everyone to understand our goal of driving out Japanese imperialism and establishing a free and happy China, the soldiers fight without conviction and lose their determination. The political goal must be clearly and precisely indicated to inhabitants of guerrilla zones and their national consciousness awakened. Hence, a concrete explanation of the political systems used is important not only to guerrilla troops but to all those who are concerned with the realization of our political goal. The Kuomintang has issued a pamphlet entitled System of National Organization for War, which should be widely distributed throughout guerrilla zones. If we lack national organization, we will lack the essential unity that should exist between the soldiers and the people. A study and comprehension of the political objectives of this war and of the anti-Japanese front is particularly important for officers of guerrilla troops. There are some militarists who say: 'We are not interested in politics but only in the profession of arms.' It is vital that these simple-minded militarists be made to realize the relationship that exists between politics and military affairs. Military action is a method used to attain a political goal. While military affairs and political affairs are not identical, it is impossible to isolate one from the other. It is to be hoped that the world is in the last era of strife. The vast majority of human beings have already prepared or are preparing to fight a war that will bring justice to the oppressed peopled of the world. No matter how long this war may last, there is no doubt that it will be followed by an unprecedented epoch of peace The war that we are fighting today for the freedom of all human beings, and the independent, happy, and liberal China that we are fighting to establish will be a part of that new world order. A conception like this is difficult for the simple-minded militarist to grasp and it must therefore be carefully explained to him. There are three additional matters that must be considered under the broad question of political activities. These are political activities, first, as applied to the troops; second, as applied to the people; and, third, as applied to the enemy. The fundamental problems are: first, spiritual unification of officers and men within the army; second spiritual unification of the army and the people; of the army and the people; and, last, destruction of the unity of the enemy. The concrete methods for achieving these unities are discussed in detail in pamphlet Number 4 of this series, entitled Political Activities in Anti-Japanese Guerrilla Warfare. A revolutionary army must have discipline that is established on a limited democratic basis. In all armies, obedience the subordinates to their superiors must be exacted. This is true in the case of guerrilla discipline, but the basis for guerrilla discipline must be the individual conscience. With guerrillas, a discipline of compulsion is ineffective. In any revolutionary army, there is unity of purpose as far as both officers and men are concerned, and, therefore, within such an army, discipline is self-imposed. Although discipline in guerrilla ranks is not as severe as in the ranks of orthodox forces, the necessity for discipline exists. This must be self-imposed, because only when it is, is the soldier able to understand completely, why he fights and why he must obey. This type of discipline becomes a tower of strength within the army, and it is the only type that can truly harmonize the relationship that exists between officers and soldiers. In any system where discipline is externally imposed, the relationship that exists between officer and man is characterized by indifference of the one to the other. The idea that officers can physically beat or severely tongue-lash their men is a feudal one and is not in accord with the conception of self-imposed discipline. Discipline of the feudal type will destroy internal unity and fighting strength. A discipline self-imposed is the primary characteristic of a democratic system in the army . A secondary characteristic is found in the degree of liberties accorded officers and soldiers. In a revolutionary army, all individuals enjoy political liberty and the question, for example, of the emancipation of the people must not only be tolerated but discussed, and propaganda must encouraged. Further, in such an army, the mode of living of the officers and the soldiers must not differ too much, and this is particularly true in the case of guerilla troops. Officers should live under the same conditions as their men, for that is the only way in which they can gain from their men the admiration and confidence so vital in war. It is incorrect to hold to a theory of equality in all things. But there must be equality of existence in accepting the hardships and dangers of war, thus we may attain to the unification of the officer and soldier groups a unity both horizontal within the group itself, and vertical, that is, from lower to higher echelons. It is only when such unity is present that units can be said to be powerful combat factors. There is also a unity of spirit that should exist between troops and local inhabitants. The Eighth Route Army put into practice a code known as 'Three Rules and the Eight Remarks', which we list here: Rules: All actions are subject to command. Do not steal from the people. Be neither selfish nor unjust. Remarks: Replace the door when you leave the house. Roll up the bedding on which you have slept. Be courteous. Be honest in your transactions. Return what you borrow. Replace what you break. Do not bathe in the presence of women. Do not without authority search those you arrest. The Red Army adhered to this code for ten years and the Eighth Route Army and other units have since adopted it. Many people think it impossible for guerrillas to exist for long in the enemy's rear. Such a belief reveals lack of comprehension of the relationship that should exist between the people and the troops. The former may be likened to water the latter to the fish who inhabit it. How may it be said that these two cannot exist together? It is only undisciplined troops who make the people their enemies and who, like the fish out of its native element cannot live. We further our mission of destroying the enemy by propagandizing his troops, by treating his captured soldiers with consideration, and by caring for those of his wounded who fall into our hands. If we fail in these respects, we strengthen the solidarity of our enemy. |
| Le parti,
l'armée et le peuple (en 1964) Talk On Putting Military Affairs Work Into Full Effect And Cultivating Successors To The Revolution http://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-9/mswv9_21.htm June 16, 1964 |
June 16, 1964 [SOURCE: Long Live Mao Tse-tung Thought, a Red Guard Publication.] I shall talk about two problems. The first is the question of local party committees paying attention to military affairs, and the second is the question of dealing with successors. . . it will not do to merely observe demonstrations. It is necessary to pay attention to troops, it is necessary to operate armament plants. . . the provinces must inquire into the matter of troop units and the militia. You first secretaries of provincial committees are also political commissars. You have not carried out your duties for a number of years, you have been political commissars in name only and have not paid attention to military affairs. When a problem arises, you become confused without help. Regardless of which direction the enemy may come, it is necessary that you be ready, then our country shall not perish. The various levels of party committees must all pay attention to military affairs work and to militia work. . . How can only we rely on the several millions of Liberation Army troops of the central government in a country such as ours and on such a large battle front? We cannot depend on them. You must make up your own minds. The local authorities have the responsibility. . . needless to say, they will want to fight an atomic war! We shall run away when they drop the atom bombs. When they enter the city, we shall also enter the city and the enemy will not dare to use the atom bomb. We shall engage in street fighting. At any rate, we shall fight them. It is necessary that the militia be organized a little better organizationally, politically, and militarily. Organizational improvement is to have some sort of an established organization of cadre-militiamen and ordinary militiamen, to have fighters, squad and platoon leaders, and company, battalion, regiment, and division commanders, and to become really functional. It is also necessary that political work personnel be organized so that in case something happens, they may take up their arms and go. Some people have said that their psychological outlook improved greatly after three months of service in the militia. The militia must have organization, it must have soldiers, it must have officers, and it must be put into full effect At present, many localities have not put it into full effect. It is necessary to carry out political work and the work of the people. To put politics into full effect, it is necessary to have a political structure, political commissars, political officers, and political instructors. To do political work is to perform the work of the people. It is necessary to distinguish between the good and the bad people in the militia and eliminate the bad ones. It is necessary to clearly explain to the militiamen that regardless of whatever important matter which may occur, they must not become flustered, for how can one win battles if one is flustered? One must not become flustered in fighting with rifles, guns, or atom bombs. One will not become flustered if one is well prepared politically. When the atom bomb is dropped, there is nothing else but to see Marx; since the days of old there has always been death. Without a belief, one cannot establish oneself. Those who are doomed to die shall die, and those who do not die shall go on. To kill all the Chinese people. I cannot see that, the imperialists will not do that, for who will they have to exploit!. . . . in 20 years of war, have we not lost many people? Huang Kung-lueh, Liu Hu-lan, and Huang Chikuang. . . we did not die, we are the! remaining dregs. When the burden is too heavy, death is the way out. Indeed, death called on Comrade XXX, but he did not go, so he is still alive. It is necessary to be prepared militarily. It is necessary to be prepared with rifles during peacetime, it will be too late when war starts. . . if one only cares about dealing with civil and not military affairs, if one only wants people and not rifles. When war begins, it will be necessary to depend upon China to hold on, it will not do to depend on the revisionists. When the enemy fight their way in, we will be able to fight our way out. In general, we must be ready to fight, we must not become flustered when the fighting starts, we also must not be flustered in fighting the atom bomb. Do not be afraid. It is nothing but a big disorder throughout the world. It is nothing but people dying. Man eventually must die, he may die standing up or lying down. Those who do not die will go on with their work, if one-half meets with death, there is still another half. . . Do not be afraid of imperialism. It will not do to be afraid, the more one is afraid, the less enthusiasm one will have. Being prepared and unafraid, one will have the enthusiasm. The second problem is to prepare for the future and to bring up successors. The imperialists have said that our first generation presented no problem, the second generation did not unchange, and that there is hope for the third and fourth generations. Will this hope of the imperialists be realized? Will these words of the imperialists come true? I hope that it will not come true; however, it can also come true. In the Soviet Union, it was the third generation that produced the Soviet Khrushchev Revisionism. We can also possibly produce revisionism. How can we guard against revisionism? How can we cultivate successors to the revolution? As I see it, there are five requirements. 1. It is necessary to regularly observe and educate our cadres, they must have some knowledge of Marxism-Leninism; it would be best if they have a bit more knowledge of Marxism-Leninism. They must practice Marxism-Leninism, not revisionism. 2. They must serve the majority of the people and not the minority. They must serve the majority of the people of China. They must serve the majority of the people of the world and not the minority, or the landlords, rich peasants, counter-revolutionaries, bad elements, and rightists. Without this prerequisite, one cannot serve as a party branch secretary. Moreover, one cannot serve as the central (committee) secretary or the central chairman, Khrushchev was for the minority, we are for the majority of the people. 3. They must be able to unite the majority of the people. What is meant by uniting the majority of the people includes those people who had previously and erroneously opposed ourselves. Regardless of which mountain peak they belong to, we must not seek revenge, we cannot have a new group of officials for each emperor. Our experiences have proven that we would not have been victorious in our revolution if it had not been for the correct guidelines of the 7th National Congress. |
| Mao et la bombe
atomique |
| THE CHINESE PEOPLE CANNOT BE COWED BY
THE ATOM BOMB January 28, 1955 |
| [Main points of a conversation with Ambassador Carl-Johan (Cay) Sundstrom, the first Finnish envoy to China, when he presented his credentials.] China and Finland are friendly countries. Our relations are based on the Five Principles of Peaceful Coexistence. China and Finland have never come into conflict. In the past, China's wars with European countries were only with Britain, France, Germany, tsarist Russia, Italy, the Austro-Hungarian Empire and Holland, these countries all came from afar to commit aggressions against China, as in the invasions by the Anglo-French allied forces and by the allied forces of the eight powers, including the United States and Japan. Sixteen countries took part in the war of aggression against Korea, including Turkey and Luxembourg. All these aggressor countries claimed to be peace-loving while branding Korea and China as aggressors Today, the danger of a world war and the threats to China come mainly from the warmongers in the United States. They have occupied our Taiwan and the Taiwan Straits and are contemplating an atomic war. We have two principles: first, we don't want war; second, we will strike back resolutely if anyone invades us. This is what we teach the members of the Communist Party and the whole nation. The Chinese people are not to be cowed by U.S. atomic blackmail. Our country has a population of 600 million and an area of 9,600,000 square kilometres. The United States cannot annihilate the Chinese nation with its small stack of atom bombs. Even if the U.S. atom bombs were so powerful that, when dropped on China, they would make a hole right through the earth, or even blow it up, that would hardly mean anything to the universe as a whole, though it might be a major event for the solar system. We have an expression, millet plus rifles. In the case of the United States, it is planes plus the A-bomb. However, if the United States with its planes plus the A-bomb is to launch a war of aggression against China, then China with its millet plus rifles is sure to emerge the victor. The people of the whole world will support us. As a result of World War I, the tsar, the landlords and the capitalists in Russia were wiped out; as a result of World War II, Chiang Kai-shek and the landlords were overthrown in China and the East European countries and a number of countries in Asia were liberated. Should the United States launch a third world war and supposing it lasted eight or ten years, the result would be the elimination of the ruling classes in the United States, Britain and the other accomplice countries and the transformation of most of the world into countries led by Communist Parties. World wars end not in favour of the warmongers but in favour of the Communist Parties and the revolutionary people in all lands. If the warmongers are to make war, then they mustn't blame us for making revolution or engaging in "subversive activities" as they keep saying all the time. If they desist from war, they can survive a little longer on this earth. But the sooner they make war the sooner they will be wiped from the face of the earth. Then a people's united nations would be set up, maybe in Shanghai, maybe somewhere in Europe, or it might be set up again in New York, provided the U.S. warmongers had been wiped out. |
| ALL REACTIONARIES ARE PAPER TIGERS November 18, 1957 |
[Excerpts from a speech at the Moscow Meeting of Representatives of the Communist and Workers' Parties. ] When Chiang Kai-shek started his offensive against us in 1946, many of our comrades and the people of the country were much concerned about whether we could win the war. I myself was concerned. But we were confident of one thing. At that time an American correspondent, Anna Louise Strong, came to Yenan. In an interview, I discussed many questions with her, including Chiang Kai-shek, Hitler, Japan, the United States and the atom bomb. I said all allegedly powerful reactionaries are merely paper tigers. The reason is that they are divorced from the people. Look! Wasn't Hitler a paper tiger? Wasn't he overthrown? I also said that the tsar of Russia was a paper tiger, as were the emperor of China and Japanese imperialism, and see, they were all overthrown. U.S. imperialism has not yet been overthrown and it has the atom bomb, but I believe it too is a paper tiger and will be overthrown. Chiang Kai-shek was very powerful, for he had a regular army of more than four million. We were then in Yenan. What was the population of Yenan? Seven thousand. How many troops did we have? We had 900,000 guerrillas, all isolated by Chiang Kai-shek in scores of base areas. But we said that Chiang Kai-shek was only a paper tiger and that we could certainly defeat him. We have developed a concept over a long period for the struggle against the enemy, namely, strategically we should despise all our enemies, but tactically we should take them all seriously. In other words, with regard to the whole we must despise the enemy, but with regard to each specific problem we must take him seriously. If we do not despise him with regard to the whole, we shall commit opportunist errors. Marx and Engels were but two individuals, and yet in those early days they already declared that capitalism would be overthrown throughout the world. But with regard to specific problems and specific enemies, if we do not take them seriously, we shall commit adventurist errors. In war, battles can only be fought one by one and the enemy forces can only be destroyed one part at a time. Factories can only be built one by one. Peasants can only plough the land plot by plot. The same is even true of eating a meal. Strategically, we take the eating of a meal lightly, we are sure we can manage it. But when it comes to the actual eating, it must be done mouthful by mouthful, you cannot swallow an entire banquet at one gulp. This is called the piecemeal solution and is known in military writings as destroying the enemy forces one by one. |
| People
Of The World, Unite And Defeat The U.S. Aggressors And All Their Running Dogs May 23, 1970 http://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-9/mswv9_86.htm |
[SOURCE: Peking Review (23 May, 1970).] A new upsurge in the struggle against U.S. imperialism is now emerging throughout the world. Ever since the Second World War, U.S. imperialism and its followers have been continuously launching wars of aggression and the people in various countries have been continuously waging revolutionary wars to defeat the aggressors. The danger of a new world war still exists, and the people of all countries must get prepared. But revolution is the main trend in the world today. Unable to win in Vietnam and Laos, the U.S. aggressors treacherously engineered the reactionary coup d’etat by the Lon Nol Sirik Matak clique, brazenly dispatched their troops to invade Cambodia and resumed the bombing of North Vietnam, and this has aroused the furious resistance of the three Indo Chinese peoples. I warmly support the fighting spirit of Samdech Norodom Sihanouk, Head of State of Cambodia, in opposing U.S. imperialism and its lackeys. I warmly support the Joint Declaration of the Summit Conference of the Indo Chinese Peoples. I warmly support the establishment of the Royal Government of National Union under the Leadership of the National United Front of Kampuchea. Strengthening their unity, supporting each other and persevering in a protracted people’s war, the three Indo-Chinese peoples will certainly overcome all difficulties and win complete victory. While massacring the people in other countries, U.S. imperialism is slaughtering the white and black people in its own country. Nixon’s fascist atrocities have kindled the raging flames of the revolutionary mass movement in the United States. The Chinese people firmly support the revolutionary struggle of the American people. I am convinced that the American people who are fighting valiantly will ultimately win victory and that the fascist rule in the United States will inevitably be defeated. The Nixon government is beset with troubles internally and externally, with utter chaos at home and extreme isolation abroad. The mass movement of protest against U.S. aggression in Cambodia has swept the globe. Less than ten days after its establishment, the Royal Government of National Union of Cambodia was recognized by nearly twenty countries. The situation is getting better and better in the war of resistance against U.S. aggression and for national salvation waged by the people of Vietnam, Laos and Cambodia. The revolutionary armed struggles of the people of the South-east Asian countries, the struggles of the people of Korea, Japan and other Asian countries against the revival of Japanese militarism by the U.S. and Japanese reactionaries, the struggles of the Palestinian and other Arab peoples against the U.S.-Israeli aggressors, the national-liberation struggles of the Asian, African and Latin American peoples, and the revolutionary struggles of the peoples of North America, Europe and Oceania are all developing vigorously. The Chinese people firmly support the people of the three Indo-Chinese countries and of other countries of the world in their revolutionary struggles against U.S. imperialism and its lackeys. U.S. imperialism, which looks like a huge monster, is in essence a paper tiger, now in the throes of its deathbed struggle. In the world of today, who actually fears whom? It is not the Vietnamese people, the Laotian people, the Cambodian people, the Palestinian people, the Arab people or the people of other countries who fear U.S. imperialism; it is U.S. imperialism which fears the people of the world. It becomes panic-stricken at the mere rustle of leaves in the wind. Innumerable facts prove that a just cause enjoys abundant support while an unjust cause finds little support. A weak nation can defeat a strong, a small nation can defeat a big. The people of a small country can certainly defeat aggression by a big country, if only they dare to rise in struggle, dare to take up arms and grasp in their own hands the destiny of their country. This is a law of history. People of the world, unite and defeat the U.S. aggressors and all their running dogs! Transcription by the Maoist Documentation Project. HTML revised 2004 by Marxists.org Selected Works of Mao Tse-tung |
| La Grande
révolution culturelle prolétarienne : la lutte des
classes continue après la révolution |
| Speech To The
Albanian Military Delegation May 1, 1967 [SOURCE: Long Live Mao Tse-tung Thought, a Red Guard Publication.] http://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-9/mswv9_74.htm |
| I say the revolutionary spirit
of the revolutionary little generals is very strong, and this is
excellent. But you cannot step onto the stage now, because if you step
onto the stage now, you will be kicked off the stage tomorrow. But this
word has been leaked out by a Vice Premier’s own mouth, and this is
highly inappropriate. As far as the revolutionary little generals are
concerned, it is a question of nurturing and training them. At a time
when they have committed certain errors, to use such words will only
dampen their spirits. Some say that elections are very good and very
democratic. As far as I am concerned, election is merely a fancy word,
and do not feel that there is any genuine election. I have been elected
by the Peking district to serve as a representative to the National
People’s Congress, but how many in Peking really understood me? I feel
that Chou En-lai’s premiership was an appointment by the Central
Committee. Others say that China is profoundly peace-loving, but I
cannot see how profound that love is. I think Chinese are militant. In regard to cadres, we must establish the belief that 95 percent or more of them are good or relatively good, and we must never depart from this class viewpoint! In regard to leading cadres who are revolutionary or want to be revolutionary, one should protect them, protect them forthrightly and bravely, and liberate them from their errors. Even though they have taken the capitalist road, we must allow them to make revolution after they have undergone long-term education and their errors have been rectified. There are not many really bad persons. Among the masses, they constitute at most 5 percent; within the party and league, 1 to 2 percent; and there are only a handful of power holders who stubbornly take the capitalist road. But we must regard this handful of power holder within the party who take the capitalist road as the principal target of attack because their influence and insidious poison are deep and far-reaching. Thus, this is the principal task of this Great Cultural Revolution. As for bad elements among the masses, they number at most 5 percent, and they are scattered, without much strength. If the 35 million of them, calculated at 5 percent, should band together to form an army and oppose us in an organized manner, that would be a problem deserving serious consideration. But since they are diffused in various localities and powerless, they cannot be the principal target of the Great Proletarian Cultural Revolution. However, it is necessary for us to heighten our vigilance and, especially at this crucial stage of the struggle, prevent these bad elements from wreaking havoc. Thus, there should be two premises for the great alliance: one is to destroy self-interest and foster devotion to the public interest; the other is that there must be a struggle. Without struggle the great alliance will not be effective. The fourth stage of this Great Cultural Revolution is the crucial stage of the struggle between the two classes, the two roads and the two lines. Thus, a relatively longer period of time will be needed to arrange mass criticism. It is still being discussed by the Cultural Revolution Group of the Central Committee. Some feel that the end of this year would be an appropriate time for this, and others feel that next May would be more appropriate. However, the time must conform to the laws of class struggle. |
| Intervención del Movimiento Popular Perú en la Conferencia Internacional para celebrar el XX° aniversario de la fundación del Movimiento Revolucionario Internacionalista (http://www.solrojo.org/conf2004/Conf2004_mpp1.htm) |
| (NOVEMBRE 2004) ¡Proletarios de todos los países, uníos! ¡Viva el XXº aniversario de la fundación del Movimiento Revolucionario Internacionalista! El Movimiento Popular Perú saluda con fervor revolucionario a la presente Conferencia Internacional, a los Partidos y organizaciones representados, a los que han enviado mensajes y saludos, y a todos los asistentes. El MPP ha convocado esta Conferencia Internacional para celebrar el 20 aniversario de la fundación del Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI), que el Partido Comunista del Perú considera como un paso adelante en la reunificación de los comunistas a nivel internacional, a la cual servirá en tanto se sustente y siga una línea ideológica y política justa y correcta. El Partido Comunista del Perú brega por imponer el maoísmo como único mando y guía de la revolución mundial y contribuye al desarrollo del MRI con el pensamiento gonzalo y con nuestra guerra popular.El Presidente Gonzalo aporta a la revolución mundial [consignas:] ¡Viva el XXº aniversario de la fundación del Movimiento Revolucionario Internacionalista! Desde la publicación de su acta de nacimiento, el Manifiesto Comunista, los comunistas vienen luchando incesantemente para unirse, y hoy más que nunca esto debe ser asumido con mayor tenacidad y resolución. La unidad de los comunistas tiene hoy que ser basada en el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo; en la lucha implacable contra el revisionismo; y en el servicio a la revolución proletaria mundial, haciendo la propia revolución a través de la guerra popular. Por ello es una necesidad fortalecer y desarrollar las relaciones entre los Partidos Comunistas y organizaciones revolucionarias del mundo. Hay que partir de que estamos en la nueva gran ola de la revolución proletaria mundial y que sólo el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente maoísmo, debe ser su único mando y guía. En la mayoría de los países aún no existen Partidos Comunistas, y la conformación o reconstitución de dichos Partidos como Partidos Comunistas marxistas-leninistas-maoístas militarizados es una tarea estratégica atrasada. La conformación del Partido de la clase para iniciar la Guerra Popular es una necesidad histórica, un Partido con una base de unidad partidaria marxista-leninista-maoísta, principalmente maoísta, porque es el más alto desarrollo de la ideología del proletariado, la tercera, nueva y superior etapa del marxismo. La lucha de los pueblos de los países oprimidos tiene gran trascendencia para el desarrrollo de la nueva gran ola de la revolución proletaria mundial, constituyendo su propia base. Los pueblos sumidos por siglos en la más cruel explotación y miseria, son fuente inagotable de lucha, claman por la guerra popular. Los pueblos sabrán asumir bajo la dirección del Partido; corresponde en cada país aplastar los planes del imperialismo de montar falsos “partidos comunistas”, con caudillos, que no hacen nada ni harán nunca nada para la clase, porque están hechos de podre revisionista, les importa un pepino la sangre derramada de las masas, son agentes pagados por el imperialismo. La reacción y el revisionismo están coludidos para que la guerra popular no se desarrolle, saben que será su fin, así como los imperialistas saben el papel decisivo que tendrán los pueblos oprimidos en la revolución proletaria mundial, para cercar a los Estados imperialistas, teniendo como bases de apoyo a las naciones oprimidas que desarrollan guerra popular. Lo que nos falta es más Partidos Comunistas que desarrollen guerra popular para cambiar la correlación de fuerzas. De esta manera, coordinadas estratégicamente las guerras populares de los Partidos Comunistas de las naciones oprimidas irán nucleando a los pueblos del mundo, y solo a través de ello se forjara un verdadero Movimiento Comunista Internacional, porque estarán los que quieren el comunismo, los que desarrollen la guerra popular. Así la unidad será sólida y cohesionada por el maoísmo; la unidad se da entre los que aplican el marxismo de hoy, el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo. Visto así, el MRI es solo un paso en la conformación del movimiento comunista internacional; es la guerra popular mundial la que lo va generar. El movimiento comunista internacional no se genera como consecuencia de conferencias, de foros, no es una amalgama de organizaciones, sino se conforma por los que aplican la guerra popular especificada a cada país, lo que demanda una Jefatura y un pensamiento guía para cada revolución específica..El movimiento comunista internacional será de los comunistas del mundo, es una tarea inmediata, tenemos una gran responsabilidad y cada Partido debe bregar para cumplir a cabalidad su jornada. Al plasmar la revolución democrática mediante la guerra popular, como parte de la revolución proletaria mundial, el Partido Comunista del Perú está sirviendo a la revolución mundial y el Presidente Gonzalo aporta a la misma. Es gracias a nuestra grandiosa ideología, el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo, principalmente pensamiento gonzalo, y a la guerra popular, pujante y victoriosa, que nuestro Partido cumple su honroso papel de bregar por poner el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo, como único mando y guía de la revolución mundial, que es obligación cada vez más creciente, es tarea para todos los comunistas de la Tierra, pues hoy no se es comunista si no se es maoísta. |
| Un ancêtre
de Mao et de la guerre asymétrique. L' ART DE LA GUERRE de Sun Tzu (entre 443 et 221 avant Jésus-Christ), le texte comporte en effet quelques références à ces Royaumes Combattants. Article XIII DE LA CONCORDE ET DE LA DISCORDE |
| Sun Tzu dit: Si, ayant sur pied une armée de cent mille hommes, vous devez la conduire jusqu'à la distance de cent lieues, il faut compter qu'au-dehors, comme au-dedans, tout sera en mouvement et en rumeur. Les villes et les villages dont vous aurez tiré les hommes qui composent vos troupes; les hameaux et les campagnes dont vous aurez tiré vos provisions et tout l'attirail de ceux qui doivent les conduire; les chemins remplis de gens qui vont et viennent, tout cela ne saurait arriver qu'il n'y ait bien des familles dans la désolation, bien des terres incultes, et bien des dépenses pour l'État. Sept cent mille familles dépourvues de leurs chefs ou de leurs soutiens se trouvent tout à coup hors d'état de vaquer à leurs travaux ordinaires; les terres privées d'un pareil nombre de ceux qui les faisaient valoir diminuent, en proportion des soins qu'on leur refuse, la quantité comme la qualité de leurs productions. Les appointements de tant d'officiers, la paie journalière de tant de soldats et l'entretien de tout le monde creusent peu à peu les greniers et les coffres du prince comme ceux du peuple, et ne sauraient manquer de les épuiser bientôt. Être plusieurs années à observer ses ennemis, ou à faire la guerre, c'est ne point aimer le peuple, c'est être l'ennemi de son pays; toutes les dépenses, toutes les peines, tous les travaux et toutes les fatigues de plusieurs années n'aboutissent le plus souvent, pour les vainqueurs eux-mêmes, qu'à une journée de triomphe et de gloire, celle où ils ont vaincu. N'employer pour vaincre que la voie des sièges et des batailles, c'est ignorer également et les devoirs de souverain et ceux de général; c'est ne pas savoir gouverner; c'est ne pas savoir servir l'État. Ainsi, le dessein de faire la guerre une fois formé, les troupes étant déjà sur pied et en état de tout entreprendre, ne dédaignez pas d'employer les artifices. Commencez par vous mettre au fait de tout ce qui concerne les ennemis; sachez exactement tous les rapports qu'ils peuvent avoir, leurs liaisons et leurs intérêts réciproques; n'épargnez pas les grandes sommes d'argent; n'ayez pas plus de regret à celui que vous ferez passer chez l'étranger, soit pour vous faire des créatures, soit pour vous procurer des connaissances exactes, qu'à celui que vous emploierez pour la paie de ceux qui sont enrôlés sous vos étendards: plus vous dépenserez, plus vous gagnerez; c'est un argent que vous placez pour en retirer un gros intérêt. Ayez des espions partout, soyez instruit de tout, ne négligez rien de ce que vous pourrez apprendre; mais, quand vous aurez appris quelque chose, ne la confiez pas indiscrètement à tous ceux qui vous approchent. Lorsque vous emploierez quelque artifice, ce n'est pas en invoquant les Esprits, ni en prévoyant à peu près ce qui doit ou peut arriver, que vous le ferez réussir; c'est uniquement en sachant sûrement, par le rapport fidèle de ceux dont vous vous servirez, la disposition des ennemis, eu égard à ce que vous voulez qu'ils fassent. Quand un habile général se met en mouvement, l'ennemi est déjà vaincu: quand il combat, il doit faire lui seul plus que toute son armée ensemble; non pas toutefois par la force de son bras, mais par sa prudence, par sa manière de commander, et surtout par ses ruses. Il faut qu'au premier signal une partie de l'armée ennemie se range de son côté pour combattre sous ses étendards: il faut qu'il soit toujours le maître d'accorder la paix et de l'accorder aux conditions qu'il jugera à propos. Le grand secret de venir à bout de tout consiste dans l'art de savoir mettre la division à propos; division dans les villes et les villages, division extérieure, division entre les inférieurs et les supérieurs, division de mort, division de vie. Ces cinq sortes de divisions ne sont que les branches d'un même tronc. Celui qui sait les mettre en usage est un homme véritablement digne de commander; c'est le trésor de son souverain et le soutien de l'empire. J'appelle division dans les villes et les villages celle par laquelle on trouve le moyen de détacher du parti ennemi les habitants des villes et des villages qui sont de sa domination, et de se les attacher de manière à pouvoir s'en servir sûrement dans le besoin. J'appelle division extérieure celle par laquelle on trouve le moyen d'avoir à son service les officiers qui servent actuellement dans l'armée ennemie. Par la division entre les inférieurs et les supérieurs, j'entends celle qui nous met en état de profiter de la mésintelligence que nous aurons su mettre entre alliés, entre les différents corps, ou entre les officiers de divers grades qui composent l'armée que nous aurons à combattre. La division de mort est celle par laquelle, après avoir fait donner de faux avis sur l'état où nous nous trouvons, nous faisons courir des bruits tendancieux, lesquels nous faisons passer jusqu'à la cour de son souverain, qui, les croyant vrais, se conduit en conséquence envers ses généraux et tous les officiers qui sont actuellement à son service. La division de vie est celle par laquelle on répand l'argent à pleines mains envers tous ceux qui, ayant quitté le service de leur légitime maître, ont passé de votre côté, ou pour combattre sous vos étendards, ou pour vous rendre d'autres services non moins essentiels. Si vous avez su vous faire des créatures dans les villes et les villages des ennemis, vous ne manquerez pas d'y avoir bientôt quantité de gens qui vous seront entièrement dévoués. Vous saurez par leur moyen les dispositions du grand nombre des leurs à votre égard, ils vous suggéreront la manière et les moyens que vous devez employer pour gagner ceux de leurs compatriotes dont vous aurez le plus à craindre; et quand le temps de faire des sièges sera venu, vous pourrez faire des conquêtes, sans être obligé de monter à l'assaut, sans coup férir, sans même tirer l'épée. Si les ennemis qui sont actuellement occupés à vous faire la guerre ont à leur service des officiers qui ne sont pas d'accord entre eux; si de mutuels soupçons, de petites jalousies, des intérêts personnels les tiennent divisés, vous trouverez aisément les moyens d'en détacher une partie, car quelque vertueux qu'ils puissent être d'ailleurs, quelque dévoués qu'ils soient à leur souverain, l'appât de la vengeance, celui des richesses ou des postes éminents que vous leur promettez, suffiront amplement pour les gagner; et quand une fois ces passions seront allumées dans leur coeur, il n'est rien qu'ils ne tenteront pour les satisfaire. Si les différents corps qui composent l'armée des ennemis ne se soutiennent pas entre eux, s'ils sont occupés à s'observer mutuellement, s'ils cherchent réciproquement à se nuire, il vous sera aisé d'entretenir leur mésintelligence, de fomenter leurs divisions; vous les détruirez peu à peu les uns par les autres, sans qu'il soit besoin qu'aucun d'eux se déclare ouvertement pour votre parti; tous vous serviront sans le vouloir, même sans le savoir. Si vous avez fait courir des bruits, tant pour persuader ce que vous voulez qu'on croie de vous, que sur les fausses démarches que vous supposerez avoir été faites par les généraux ennemis; si vous avez fait passer de faux avis jusqu'à la cour et au conseil même du prince contre les intérêts duquel vous avez à combattre; si vous avez su faire douter des bonnes intentions de ceux mêmes dont la fidélité à leur prince vous sera la plus connue, bientôt vous verrez que chez les ennemis les soupçons ont pris la place de la confiance, que les récompenses ont été substituées aux châtiments et les châtiments aux récompenses, que les plus légers indices tiendront lieu des preuves les plus convaincantes pour faire périr quiconque sera soupçonné. Alors les meilleurs officiers, leurs ministres les plus éclairés se dégoûteront, leur zèle se ralentira; et se voyant sans espérance d'un meilleur sort, ils se réfugieront chez vous pour se délivrer des justes craintes dont ils étaient perpétuellement agités, et pour mettre leurs jours à couvert. Leurs parents, leurs alliés ou leurs amis seront accusés, recherchés, mis à mort. Les complots se formeront, l'ambition se réveillera, ce ne seront plus que perfidies, que cruelles exécutions, que désordres, que révoltes de tous côtés. Que vous restera-t-il à faire pour vous rendre maître d'un pays dont les peuples voudraient déjà vous voir en possession? Si vous récompensez ceux qui se seront donnés à vous pour se délivrer des justes craintes dont ils étaient perpétuellement agités, et pour mettre leurs jours à couvert; si vous leur donnez de l'emploi, leurs parents, leurs alliés, leur amis seront autant de sujets que vous acquerrez à votre prince. Si vous répandez l'argent à pleines mains, si vous traitez bien tout le monde, si vous empêchez que vos soldats ne fassent le moindre dégât dans les endroits par où ils passeront, si les peuples vaincus ne souffrent aucun dommage, assurez-vous qu'ils sont déjà gagnés, et que le bien qu'ils diront de vous attirera plus de sujets à votre maître et plus de villes sous sa domination que les plus brillantes victoires. Soyez vigilant et éclairé; mais montrez à l'extérieur beaucoup de sécurité, de simplicité et même d'indifférence; soyez toujours sur vos gardes, quoique vous paraissiez ne penser à rien; défiez-vous de tout, quoique vous paraissiez sans défiance; soyez extrêmement secret, quoiqu'il paraisse que vous ne fassiez rien qu'à découvert; ayez des espions partout; au lieu de paroles, servez-vous de signaux; voyez par la bouche, parlez par les yeux; cela n'est pas aisé, cela est très difficile. On est quelquefois trompé lorsqu'on croit tromper les autres. Il n'y a qu'un homme d'une prudence consommée, qu'un homme extrêmement éclairé, qu'un sage du premier ordre qui puisse employer à propos et avec succès l'artifice des divisions. Si vous n'êtes point tel, vous devez y renoncer; l'usage que vous en feriez ne tournerait qu'à votre détriment. Après avoir enfanté quelque projet, si vous apprenez que votre secret a transpiré, faites mourir sans rémission tant ceux qui l'auront divulgué que ceux à la connaissance desquels il sera parvenu. Ceux-ci ne sont point coupables encore à la vérité, mais ils pourraient le devenir. Leur mort sauvera la vie à quelques milliers d'hommes et assurera la fidélité d'un plus grand nombre encore. Punissez sévèrement, récompensez avec largesse: multipliez les espions, ayez-en partout, dans le propre palais du prince ennemi, dans l'hôtel de ses ministres, sous les tentes de ses généraux; ayez une liste des principaux officiers qui sont à son service; sachez leurs noms, leurs surnoms, le nombre de leurs enfants, de leurs parents, de leurs amis, de leurs domestiques; que rien ne se passe chez eux que vous n'en soyez instruit. Vous aurez vos espions partout: vous devez supposer que l'ennemi aura aussi les siens. Si vous venez à les découvrir, gardez-vous bien de les faire mettre à mort; leurs jours doivent vous être infiniment précieux. Les espions des ennemis vous serviront efficacement, si vous mesurez tellement vos démarches, vos paroles et toutes vos actions, qu'ils ne puissent jamais donner que de faux avis à ceux qui les ont envoyés. Enfin, un bon général doit tirer parti de tout; il ne doit être surpris de rien, quoi que ce soit qui puisse arriver. Mais par-dessus tout, et de préférence à tout, il doit mettre en pratique ces cinq sortes de divisions. Rien n'est impossible à qui sait s'en servir. Défendre les États de son souverain, les agrandir, faire chaque jour de nouvelles conquêtes, exterminer les ennemis, fonder même de nouvelles dynasties, tout cela peut n'être que l'effet des dissensions employées à propos. Telle fut la voie qui permit l'avènement des dynasties Yin et Tcheou, lorsque des serviteurs transfuges contribuèrent à leur élévation. |
| SCHMITT EN 1941 : LA
MER ET LA TERRE RELÈVE DU PASSÉ, L'AVENIR DE L'ALLEMAGNE
DANS L'AIR IN D COLAS DICTIONNAIRE DE LA PENSÉE POLITIQUE, LAROUSSE |
| Schmitt*,
dans deux textes de 1941, a voulu faire apparaître le lien entre
l'Angleterre et la mer comme élément : il ne faut
pas penser la mer comme une partie de la terre, mais penser la terre
comme un prolongement, une dépendance de la mer. Avec Elisabeth
Iere, l'Angleterre a opté pour la mer contre la terre, et la
conquête en a été assurée par la "society"
et non par l'Etat, qui est un concept terrestre. L'Angleterre,
qui apparteint aux mers du globe, s'est assuré une
suprématie mondiale face au continent européen. Mais
pronostique Carl Schmitt, - à qui le destin de l'Etat nazi
vaincu par la mer (anglaise), la terre (soviétique) et l'air
(américain) apportera un démenti total -, l'avenir
appartient désormais à l'air, à l'espace. et
à l'Allemagne qui serait à la fois terrestre, maritime et
aérienne. ->frontières naturelles, Kant, Projet de paix perpétuelle. Biblio Schmitt, C., "La mer contre la terre" (1941) et "Souveraineté de l'Etat et liberté des mers. Opposition de la Terre et de la Mer dans le droit international moderne", in Du politique. Pardès : 1990 |
| ARTICLE
DONOSE CORTÈS DANS COLAS, DICTIONNAIRE
DE LA PENSÉE POLITIQUE, LAROUSSE |
| Donoso Cortès. Juan, marquis de
Valdegamas, (1809 -1853). Homme d'Etat et théoricien catholique
royaliste espagnol Ency. Il fut député aux Cortès et Ambassadeur d'Espagne à Paris et à Berlin et connu une certaine notoriété de son vivant. Son antagoniste imaginaire était Proudhon*, son grand traumatisme, la montée du socialisme et l'instauration, brève, de la République à Rome qui priva le pontife de sa souveraineté politique. Il se prononce pour la monarchie constitutionnelle et contre la monarchie parlementaire et la démocratie. Pour lui l'Eglise est l'institution sociale fondamentale et lorsque la religion "abandonne les sociétes elles sont condamnées à la stérilité et à la mort". Or, si "l'homme est par nature religieux, intelligent et libre", ces trois caractères n'ont été réunis que par le Christ et l'histoire de l'humanité est celle d'une décadence. Dans le "Discours sur la situation générale de l'Europe" (1850), il affirme que le mal est dans les peuples qui sont devenus ingouvernables car l'idée de "l'autorité divine et de l'autorité humaine" a disparu. Deux formes de civilisation l'une catholique, l'autre révolutionnaire s'opposent. Pour la première il y a un Dieu personnel, qui est présent partout et qui gouverne absolument les choses divines et humaines. et, dans l'ordre politique, un roi qui est présent partout par ses agents, qui règne sur ses sujets et les gouverne, ce qui peut prendre la forme d'une monarchie constitutionnelle ou absolue. En face, on trouve des degrés divers du mal : le parti progressiste, déiste, pour qui, si Dieu existe, il est trop éléve pour gouverner les choses humaines et, selon qu,i le Roi règne mais ne gouverne pas ; le panthéisme auquel correspond le républicanisme : le pouvoir est tout ce qui vit, c'est la multitude. Puis vient l'athée : Proudhon qui dit qu'il n'y a pas de gouvernement. Ainsi le socialisme, va plus loin, que la Révolution française de 1789 qui a dissous la société : en dépouillant les propriétaires, il tue les racines du patriotisme et il détruira les armées permanentes. Aussi, bientôt, tous les Slaves s'uniront sous le protectorat de la Russie qui, s'emparera de l'Occident, pour son "châtiment", avant de sombrer elle-même dans la "putréfaction". Face à cette décadence seul le christianisme apparait comme civilisé (alors que les Grecs et les Romains n'étaient que cultivés) car il a rendu l'autorité inviolable, l'obéissance sainte et la charité divine mais ces idées ne sont plus dans la "société civile*", seules "l'Eglise et l'Armée sont aujourd'hui les deux représentants de la civilisation européenne". Si chez Saint Augustin l'histoire de la cité terrestre voit alterner des phases de valeur différente (le règne pacifique d'Auguste vaut mieux que celui de Néron), Donoso Cortès propose une inversion absolue de l'idée de progrès telle qu'on pourrait la trouver chez Kant, Hegel et une multitude d'auteurs des XVIIIe et XIXe siècles. L'histoire de l'humanité est celle d'un accroissement constant du pouvoir politique qui conduit le monde vers un despotisme gigantesque et destructeur. Le Christ avait fondé une société de disciples sans gouvernement, mais depuis la "répression religieuse intérieure" diminue et le rôle du gouvernement politique augmente, hier, avec Luther et la monarchie absolue, aujourd'hui avec l'armée permanente où le soldat est un "esclave en uniforme", et où le gouvernement avec sa police, son administration, (qui s'appuie sur le nouvelles technologiques de l'information comme le télégraphe) devient omnipotent. Sans "réaction religieuse" le despotisme est inélécutable si bien que le choix est entre la dictature de l'insurrection ou celle du gouvernement et Donoso Cortès proclame qu'il choisit la dictature qui vient "d'en haut" contre celle qui vient "d'en bas", le sabre plutôt que le poignard. Par rapport aux autres réactionnaires catholiques du XIXe siècle sa doctrine n'est guère originale : il rejette l'érection de la raison en tribunal ce qui aboutit à la "négation de tout lien entre Dieu et l'homme". Il remonte à la Réforme pour chercher la responsabilité de 1789. Il refuse le principe même des révolutions car pour la théorie catholique le mal est dans l'homme et non dans les institutions, et elle "condamne tout bouleversement comme insensé ou inutile". Il dénonce dans la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen une prétention du philosophe à écrire de nouvelles Tables des lois. Il s'en prend au suffrage universel qui est une corruption généralisée : "les élus trafiquent de leur pouvoir, les électeurs trafiquent de leur influence, tous corrompent la foule par leurs promesses, et la foule les corrompt tous par ses demandes menaçantes et rugissantes" (Essai sur le catholicisme, le libéralisme et le socialisme, 1851). Il voit dans le socialisme un "paganisme" et la "dictature de la multitude". Il met en accusation la révolution de 1848, pour son mensonge, selon un argumentaire qui pourrait se retrouver chez d'autres, (partiellement chez Marx) : en guise de liberté, elle a instauré la dictature, en guise d'égalité, elle a fait naître une "aristocratie démocratique", en guise de fraternité, elle a organisé la répression sanglantes des journées de juin, ce qui confirme que seul le catholicisme pourrait instaurer véritablement la liberté, l'égalité et la fraternité mais ni le libéralisme, ni le socialisme. Herzen, en1850, tout en s'étonnant de l'image que le théocrate espagnol a de la Russie, s'en prend à l'appel de Donoso Cortès à l'union du prêtre catholique et du soldat pour sauver l'Europe de la décadence, car "une fois acceptée qu'il faut détester la terre et honorer le ciel [...] on parvient assez vite à accepeter aussi que l'individu n'est rien et que l'Etat est tout". Mais Schmitt se reconnaîtra dans une tentative de théologie politique réactionnaire comme celle de Donoso Cortès pour qui l'infaillibilité pontificale était le modèle du pouvoir. Il en a fait une de ses références quant à la définition de la souveraineté comme décision car Donose Cortès a montré que dans le combat entre socialisme athée et catholicisme, le libéralisme était incapable de se battre : la bourgeoisie est une "classe discutante", qui veut un roi mais impuissant et elle réclame liberté et égalité mais réduites aux classes possédantes. Donoso Cortès Œuvres, traduit de l'espagnol précédé d'une introducton par M. Louis Veuillot. Paris 3 vol. 1858. Schmitt, C.. Théologie Politique. Trad. de l'allemand par J.-L. Schlegel. Gallimard. Herzen . 1850. Réédition de la trad. française (depuis l'Allemand) de 1870 Slatkine, Genève, 1980 |
| Carl Schmitt, "hostis" et "inimicus" in
Théorie du politique, p. 69 ( polemios et exthros) |
| Le passage bien connu : "
Aimez
vos ennemis" (Math. 5, 44 ; Luc 6, 27) signifie diligite inimicos
vostros (αγαπατε τους εχθρους υμων) et non diligite hostes
vostros ; il n'y ait pas fait allusion à
l'ennemi poltique. Et dans la lutte millénaire entre le
christianisme et l'Islam, il ne serait venu à l'idée
d'aucun chrétien qu'il fallait, par amour pour les Sarrasins ou
pour les Turcs, livrer l'Europe à l'Islam au lieu de la
défendre. |
| Sur ce passage des Evangiles
voir les différentes traductions à la page : http://scripturetext.com/matthew/5-44.htm |
| Règlement concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre. SECTION I. - DES BELLIGERANTS. CHAPITRE I. - De la qualité de belligérant. Article Premier. Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes: 1°. d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ; 2°. d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ; 3°. de porter les armes ouvertement et 4°. de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre. Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l'armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d'' armée '. |
| Convention
(IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son
Annexe: Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre. La Haye, 18 octobre 1907. http://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=7C5A1DD850591B0FC12563140043A35B |
|
ARTICLE 13 [ Link ] . - La
présente Convention s'appliquera aux blessés et malades
appartenant aux catégories suivantes: 1) les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées; 2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes: a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés; b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance; c) de porter ouvertement les armes; d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre; 3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice; 4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou de services chargés du bien-être des militaires, à condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent; 5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres dispositions du droit international; 6) la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre. (souligné par moi, DC) |
| http://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/9ac284404d38ed2bc1256311002afd89/34ee8029 |
| La logique du
partisan, selon Mao (Théorie
du partisan, p.272) |
| La raison d'être de la guerre est
dans l'hostilité. La guerre étant la continuation de la
politique, la politique contient toujours, elle aussi, du moins
comme un possible, un élément d'hostilité
potentielle. |
| Structure
du monopole de la violence physique et de la violence psychique |
Mode
d’organisation politique et religieux |
Type-idéal
de guerre |
Exemples |
| Pas
d’Eglise Pas d’Etat |
Tribalisme, cultes locaux |
Guerres inter tribales |
Les Nuer du Soudan |
| Pas
d’Etat Une religion tribale |
Pouvoir religieux national |
Guerres externes |
Israël biblique |
| Un Etat Pluralité des Eglises |
Empire |
Guerres internes |
Russie tsariste et contemporaine |
| Un Etat Une Eglise nationale unique |
Théocratie (ou
idéocratie |
Guerres externes |
URSS, Iran |
| Un Etat,
une Eglise transnationale |
Centralisation du pouvoir
politique |
Guerres externes |
France de Louis XIV |
| Pas
d’Eglise |
Sectes, anarchie |
Guerres civiles
politico-religieuses |
Allemagne 1525 |