CHAPITRE I -LA SEQUENCE NORMATIVE DE L'OPTIMUM
Cette séquence part de l'optimum dans sa version la plus systématique (Debreu, 1960), en soulignant ses applications pratiques en planification du développement par application du théorème de Lange- Lerner.
Elle s'interroge sur la révélation de l'optimum, notamment dans un pays en voie de développement. Les atteintes à l'optimum sont inéluctables: externalités positives ou négatives. Elles permettent de définir des optima sectoriels ou de second rang. Ces problématiques permettent d'étudier les techniques de rationalisation des choix budgétaires dans un contexte d'optimum de second rang.
Mais l'essentiel du débat porte sur les "compensations " avec le célèbre débat entre Pigou ( la taxation) et Coase (le marchandage); cette dernière attitude pose le problème des droits de propriété et de là, les problèmes d'une économie institutionnelle. Ce dernier débat est tout
à fait lié aux discussions sur le préalable des droits de propriété dans le développement.
Section I: L'optimum
On distingue une situation optimale ( cf. Pareto) de la Pareto- Unanimité ( dérivée de la première).Une situation optimale se définit soit dans les termes de l'analyse différentielle ( marginale) soit dans les termes de l' analyse axiomatique.Elle est, pour un groupe d'agents donnés, soit une situation de repos dans la substitution des utilités ( d'où l'égalité des TMS/TTP) , soit encore une situation préféree à tout autre. La Pareto Unanimité est une condition sur l'agrégation des choix....et qui est paradoxale( cf. les critiques du Public Choice et les paradoxes du social choice ( Sen, 1970). On en dérive les Optima de second rang ( Lipsey, Lancaster), partiels, et surtout le bien être ( Pigou), obtenu par compensation.A un niveau microéconomique, l'optimum peut être replacé dans un contexte, par exemple de redistribution ou encore d 'allocations de temps et plus généralement de stratégies: on évoquera alors des stratégies optimales. Si les optima sont atteints par une politique délibérée ( ex. de l'ouverture des échanges décrétee contre les producteurs locaux), il faudra considérer une politique de compensation; quelle compensation ?
Sur le plan macroéconomique, il peut être replacé dans le contexte d'une petite économie dépendante comme équilibre possible entre secteurs ( tradable/ non tradable), non seulement du point de vue de la production mais aussi des utilités. L'optimum dans le développement est à replacer dans une problématique générale de l'altruisme et de la justice. quel optimum dans des stratégies interindividuelles, reflète t'il une quelconque bienveillance ou d'autres motifs plus égoïstes sinon malveillants ? Enfin, l'optimum doit être replacé dans le temps , en considérant la programmation du développement; d'où l'insistance sur la règle de Lange Lerner.
Si l'on considère l' optimum sous contrainte ( le bonheur sous contrainte), il n'est jamais une situation normative ( ce qui justiferait le droit au développement) mais le constat d'un choix, à un moment donné. Ce choix ( sur une situation ou une stratégie) , n'est pas assorti de valeur morale à priori et ne répond pas à l'équité ou la justice. D'où l' idée d'un optimum en coin. La question devient celle de l'information qui sied à cet optimum, notamment sur les contraintes et le contexte informationnel; bref le problème de la révélation de l'optimum et plus généralement des préférences en situation de demande de développement. Le problème de l'optimum se complique ici avec les possibilités de coordinalité, ou encore de préférences lexicographiques. Ces complications font partie d''un calcul sur le développement qui implique la complexité, dès que l'on abandonne des calculs économiques standards.
- 11 - La présentation axiomatique de l'optimum.
La "Théorie de la Valeur" de Gérard Debreu (1966) déduit de propriétés préétablies des ensembles de production et de consommation deux théorèmes fondamentaux :
-Le théorème d'existence d'un équilibre général par rapport
à un système de prix au sein d'une économie de propriété privèe.
-L'équivalence entre l'équilibre pour un système de prix et l'optimum dans le cadre d'une économie simplifièe.
Le cadre et le raisonnement correspondants sont inhabituels: faisant explicitement référence à l'axiomatique, dans quelle mesure font-ils appel à la logique déductive ? Cette question fait l'objet de cette présentation de la théorie de la valeur de Debreu.
Les applications de la logique déductive sont rares dans une science économique, plutôt plutôt disposèe à la logique inductive. Deux théories très particulières peuvent être citèes à ce titre:
- la théorie économique des choix collectifs (depuis Arrow, 1951) dont la formalisation est empruntèe à la logique déductive ( Tarski).
- la théorie des prix de production (Sraffa, 1960), dont le rapport à la logique, en particulier à Wittgenstein reste une énigme.
Elles témoignent, toutes les deux des difficultés à appliquer les deux conditions de la formalisation logique, l'homogénéité et l'atemporalité du raisonnement. Ces conditions lièes à la logique sont examinèes ici à travers le cadre général de raisonnement de Debreu que l'on rappelle initialement.Ce cadre se compose de conditions économiques et systémiques que nous présenterons successivement:
- Les conditions économiques tiennent aux conventions de la théorie micro économique à propos du comportement du producteur et du consommateur.
- Les conditions systèmiques ont trait à l'appareil démonstratif utilisé. Les deux principaux théorèmes sont démontrés à l'aide de deux propriétés de la topologie : le théorème du point fixe de Brouwer-Kakutani et le théorème de séparation de Minkowski.
Enfin, sous ces conditions complexes, Debreu démontre l'existence d'un équilibre général de marché sous des hypothèses fortes dans le cadre d'une économie de propriété privèe . Cela lui permet ensuite de déduire l'équivalence entre optimum et équilibre simplifié de marché.Cette équivalence logique, parmi d'autres, incite à comparer le raisonnement de Debreu avec celui utilisé par Sraffa (1960). En effet ces deux auteurs utilisent une méthode de raisonnement équivalente: démontrer sous des conditions fortes , un théorème d'existence, puis en faire un résultat intermédiaire permettant d'établir des équivalences logiques dans un cadre simplifié.
-- " Analyse axiomatique de l'équilibre économique" et formalisation logique.
La démarche axiomatique est assimilèe, de façon un peu vague, à un processus d'abstraction tel que "la théorie au sens strict est complétement disjointe de ses interprétations."(Debreu,1966, p.VIII). La démarche mathématique (topologique essentiellement) est confondue avec la logique d'exposition; en d'autres termes le processus de démonstration mathématique des théorèmes d'existence tend à masquer la logique enchainant les principaux résultats.
La base logique la plus évidente du raisonnement se trouve dans le système des préfèrences du consommateur; à la limite,la théorie de Debreu pourrait apparaitre comme une simple extension de la théorie des choix collectifs. Selon Malinvaud (1982),dans cette présentation "moderne","la notion d'utilité ou de satisfaction n'y est même pas nécessairement mentionnèe". La logique des préférences n'est qu'un point de départ dans la démonstration de Debreu. Celle- ci s'appuie sur les mathématiques ensemblistes, essentiellement la topologie.Fondèe initialement sur la logique déductive de la quantification, la validité axiomatique du raisonnement de Debreu subit par la suite toute la faiblesse axiomatique (inconsistance,incomplétude,indécidabilité) de ce type de mathématique Néanmoins,toutes les conditions de l'analyse déductive sont réunies dans cette présentation;notamment les deux conditions d'homogénéité et d'atemporalité.L'homogénéité réside dans le fait que les quelques concepts utilisés sont propres à l'analyse économique.Le cadre général du raisonnement ne nécessite que des agents(consommateurs et producteurs),des marchandises (inputs,outputs,ressources),des prix.Pour caractériser les plans d'action des agents et leur condition d'équilibre la théorie ne nécessite selon Debreu(ibid,p.32) que les "deux concepts généraux et abstraits de marchandise et de prix". Libre au lecteur d'introduire une hétérogénéité de l'espace,par exemple, en voulant étudier le commerce international ou le change. Les interprétations particulières qui seront ainsi introduites,n'ont ,rappelle Debreu, aucun rapport avec le développement logique de la théorie.
Le cadre socio-économique n'est que peu spécifié. On recherche un équilibre de marché,mais ni le marché,ni le cadre d'une quelconque concurrence pure et parfaite ne donnent lieu à précision. On sait seulement que l'économie "se compose d'un certain nombre d'agents(ibid p.40),que les producteurs sont price-takers et que l'horizon est certain (sauf dans le dernier chapitre). L'hypothèse d'une "économie de propriété privèe" signifie que les consommateurs possèdent les ressources et contrôlent les producteurs;de telle sorte que le producteur maximise le profit afin de le distribuer aux consommateurs actionnaires. En fait cette économie idéale ne correspond pas à la réalité du capitalisme,ni bien sûr à celle des économies socialistes. Elle constitue cependant l'utopie économique par excellence d'un capitalisme ou d'un socialisme parfait.
L'atemporalité du raisonnement se manifeste de plusieurs façons. Le temps historique ne joue absolument pas,l'utopie d'une économie multipropriétaire n'ayant pas d'application précise.
Le temps chronologique n'intervient pas dans le cas général.Si des changements de date interviennent,on pourra faire apparaitre des théories particulières telles que les théories de l'épargne, de l'investissement,du capital,et de l'intérêt.
L'atemporalité se manifeste encore par l'idèe que l'ensemble de production obéit à la loi des rendements constants (ibid p.45),dite hypothèse d'homogénéité;l'ensemble de production étant un cône de sommet 0.
Enfin le temps analogique,essentiel au raisonnement marginaliste,est expulsé du raisonnement. En aucun cas,la démonstration ne fait intervenir le calcul différentiel. De ce fait,le processus de tâtonnement à la Walras n'intervient pas dans la théorie de l'équilibre général; de même ne peuvent intervenir ni les phénomènes d'oscillation ou de réaction autour d'un équilibre,ni la comparaison entre des situations d'optimum.
Le prix est un pur nombre attaché à une marchandise. Il appartient à un système de prix qui sera déterminé par la détermination topologique de l'équilibre. Ainsi la monnaie n'intervient pas dans les échanges et l'hypothèse Walrasienne du numéraire(un bien déterminé servant de moyen d'échange) est abandonnèe.
On retrouve ici l'idèe d'une théorie de la valeur fondèe sur un pur nombre sans signification concrète. A la différence du pur nombre à la Sraffa (1960),celui-çi résulte non seulement des contraintes de la production, mais aussi des contraintes de la consommation.
La démonstration de l'équilibre général a pour but de montrer que les plans d'action des consommateurs et des producteurs au sein d'une économie peuvent être conciliés avec les ressources disponibles pour des prix donnés sous certaines conditions.
Cet équilibre est démontré initialement sous des conditions "fortes" dans le cadre d'une économie de propriété privèe (soit un ¯équilibre)
Dans cette situation,chaque producteur maximise son profit qu'il distribue aux consommateurs actionnaires.Ces derniers possèdent en effet les ressources et contrôlent les producteurs.Si ce cadre de propriété privé est abandonné,on aura sous des conditions plus faibles,un E-équilibre dans une économie simplifièe.
Les démonstrations de l'équilibre font intervenir deux types de conditions :
-Des conditions économiques : les concepts et les lois retenus répondent aux conventions de la théorie économique.
-Des conditions systémiques qui permettent à ce schéma économique d'obéir aux propriétés mathématiques utilisèes dans la démonstration.
a) Le plan du producteur consiste à maximiser le profit pour des prix donnés.Il se caractérise par un ensemble de production possible Y qui permet de spécifier ses inputs (négatifs) et des outputs (positifs).
Cet ensemble de production est possible sous certaines contraintes, en particulier des connaissances techniques limitèes,des rendements constants et le fait que le producteur est "price-taker".
B) Le consommateur cherche à obtenir un plan de consommation optimal sous certaines contraintes physiologiques et de revenu;
celui pour lequel aucun autre plan de consommation ne saurait être préféré.On admet que le consommateur est propriétaire des ressources et qu'il est toujours autosuffisant
Ce plan se caractérise par un point dans l'ensemble de consommation possible:Xi qui permet de spécifier ses inputs (positifs) et ses ouputs (négatifs).
-C- Les équivalences logiques dans le système de Debreu.
Le processus de raisonnement de Debreu (1966) peut être décomposé en cinq propositions principales que nous symboliserons successivement par A,B,C,D,E.
Proposition A : Soient des ensembles de production et de consommation qui sont admissibles du point de vue de la théorie économique et intégrables dans le système de résolution de l'équilibre général. En d'autres termes,ces conditions économiques et systèmiques déterminent un "système économique viable" .
Proposition B : Soient des états réalisables de l'économie E tels que s'il existe une consommation d'équilibre possible pour un consommateur et une production d'équilibre pour un producteur, un équilibre de marché soit possible (la demande nette doit égaler les ressources totales).
Proposition C : Il existe un équilibre général dans une économie de propriété privèe : soit un e équilibre.Plus précisément,il existe un système de prix d'équilibre,p*, tel que l'excès de demande soit 0 .
Proposition D : Soit pour tout équilibre général de marché un E équilibre correspondant qui est un équilibre simple par rapport à un système de prix.
Proposition E : Soit un optimum d'une économie E tel qu'il soit un état réalisable auquel n'est préféré aucun autre état réalisable.
Le processus déductif de la théorie de la valeur peut alors être écrit comme suit :
(1) (A . B) ![]() C
C ![]() (D E)
(D E)
Du fait de l'équivalence entre D et E,il est possible d'écrire
(2) (A . B)![]() (E
(E ![]() D)
D)
En d'autres termes,il est possible de déduire de l'optimum un E équilibre avec des conditions beaucoup plus faibles que celles exigées pour l' équilibre.
La démonstration de l'existence d'un équilibre général de marché sous des hypothèses fortes dans le cadre d'une économie de propriété privèe permet de déduire l'équivalence optimum équilibre simplifié de marché. Une fois cette déduction admise,il est donc possible de déduire de n'importe quel optimum un équilibre simplifié de marché sans avoir à spécifier la distribution des ressources.(note 2) Le schéma déductif de Debreu(1966) incite à la comparaison avec celui établi par Sraffa(1960). Dans les deux cas,la démonstration principale a trait à un théorème d'existence.
Existence d'un équilibre général de marché dans une économie de propriété privèe chez Debreu,la distribution des ressources étant spécifièe.
Existence d'un étalon des valeurs chez Sraffa dont on peut spécifier la composition.
Ce théorème d'existence joue un rôle intermédiaire. Il autorise à des équivalences qui permettent de s'en débarasser par la suite.Ainsi, il est possible dans la théorie de Debreu d'analyser directement l'optimum et l'équilibre de marché qui lui correspond en abandonnant les contraintes et les spécifications de l'économie de propriété privèe. De même chez Sraffa,la spécification de l'étalon peut être abandonnée. Le salaire n'est plus qu'un pur nombre (de même que le prix à la Debreu) et l'on peut raisonner directement sur une quantité de travail.La déduction et ses propriétés (implication,équivalence) permettent ainsi de présupposer le réél (l'économie de propriété privèe,la composition d'un étalon) afin de mieux établir le processus abstractif.Une telle théorie n'est pas faite de prédictions vérifiables pouvant être réfutèes à partir du monde réel, comme le souhaite Mark Blaug (1982), sinspirant de la méthode de Karl Popper. L'analyse du réél y est effectuèe au moyen de quelques conventions largement acceptèes de la théorie économique et n'a qu'une valeur intermédiaire.De ce fait, Blaug pense que la maitrise de l'Equilibre Général (Blaug, 1982, p. 220 ) est du "temps perdu" pour l'économiste empirique de même que l'étude de la théorie "peu réaliste" (Blaug, 1981, p.780) d'un Sraffa. Autant de motifs, peu raisonnables, de la méconnaissance de la théorie de Debreu, dans son propre milieu.
- 12- Analyse marginaliste de l'optimum
De nombreuses possibilités existent en matière de calcul économique de un à deux personnes par rapport à n biens.....
Cadre: hédonisme et utilitarisme
-121- L'utilitarisme social
L'utilitarisme est une philosophie qui évolue d'une morale individuelle ( Bentham) à une morale sociale avec Stuart Mill (1861) et surtout Sidgwick. Cet être social pour Stuart Mill est le produit du progrès:
" Chaque individu possède dès aujourd'hui la conviction bien enracinée qu'il est un être social; et cette conviction tend à lui faire apparaître comme un besoin naturel la mise en harmonie de ses sentiments et de ses buts avec ceux de ses semblables."
Cette morale sociale fonde implicitement une grande partie du calcul économique de l'individu social de la théorie contemporaine.
Rawls( 1971) résume bien cette nouvelle conception de l'utilitarisme social en rappellant que la satisfaction d'un désir quel qu'il soit à de la valeur en elle même en elle même et il faut la prendre en considération quand on décide de ce qui est juste. L'interprétation de Rawls s'appuie essentiellement sur le "method of ethics" de Sidgwick , comme résume du développement de la théorie morale utilitariste. Mais, il suffit de se reporter plus simplement à Stuart Mill et à son principe de non exclusion:
" Une société d'êtres humains, si on excepte la relation de maître à esclave, est manifestement impossible si elle ne repose pas sur le principe que les intérêts de tous seront consultés. Une société d'égaux ne peut exister s'il n'est pas bien entendu que les intérêts de tous doivent être également pris en considération."
Il est évident que ce principe "extrême" d'utilitarisme social n'a de sens que dans le cadre philosophique de l'idéal utilitariste du bonheur général. Mais cette force "extrême" n' a rien d'exceptionnel par rapport aux autres normes ; en particulier la Pareto Unanimité.
Arrow se situe dans cette tradition philosophique quand il élabore son cadre formel et utilise cette expression de la philosophie utilitariste:
" La relation globale de choix social, R, doit être déterminée par les relations d'ordre individuelles, R1, ..,Rn."
Il est donc fondé d'écrire cette relation sous la forme logiquement correcte:
Distinction utilité /ophélimité
( Pareto, 1896: Cours d'économie politique; 1909: Manuel d'économie politique.)
Deux distinctions importantes; l'une du vivant de Pareto: ophélimité/ utilité; l'autre postérieure: situation d'optimum et critère de Pareto unanimité.
La première est dynamique en faisant référence à un état de repos dans les mouvements des substitution possibles; l'autre est axiomatique et instantanée.
Le concept d'ophélimité est strictement économique, définie par quatre conditions:
- Il désigne les satisfactions que l'individu retire de ses consommations en biens et services physiques.
- Les préférences individuelles sont supposées indépendantes, tirées des propres consommations de l'individu, égoïstement.
- Les préférences s'expriment sur un marché.
- Les préférences sont supposées données.
L'utilité est sociale
L'utilité est sociologique... et concerne tous les types de satisfactions au delà de l'économie. Elles dépendent ( au moins pour l'"utilité indirecte" qu'évoque Pareto) des autres individus. L'utilité peut se révéler par d'autres moyens que le marché, par exemple le vote. Les préférences ne sont pas données et de façon interactive, se modifient.
Dans ce cadre, on peut définir l'optimum de plusieurs façons, soit dans un cadre "marginaliste" soit plus simplement ( Debreu, 1960), dans un cadre axiomatique.
-122 - Cadre marginaliste ( rappels).
------------------------------------------
Soient deux biens X et Y, et deux individus 1 et 2 et deux facteurs de production, K et L.
L'utilité marginale d'un bien Xi dépend de la fonction d'utilité
U = f ( xi...... xn)
Xi
Elle correspond à la dérivée partielle de U par rapport à i
UMX = d U ( x1...... xn)/ d Xi
La productivité ( utilité dans la production )marginale d'un facteur dépend de la même façon d'une fonction d'utilité
PM = d f ( x1.......xn) Ki / d Ki
Les taux marginaux de substitution sont:
En matière de consommation TMS = UMX /UMY
de X à Y
En matière de production TMST de K à L = Pmk/ PmL , au sein d'une fonction de production q = F ( K, L)
Il y a optimum si pour une paire de biens et tous les individus concernés:
TMSX = TMSY
Pour chaque paire de facteurs et tous les producteurs qui les utilisent
TMSTK = TMSTL
En concurrence pure et parfaite, la condition générale de l'optimum:
TMST = TMS= TT
Ce résultat doit résulter du comportement rationnel de chaque individu en situation de concurrence pure et parfaite. Comme on le sait, la maximisation sous contrainte aboutit à un système de prix ( les multiplicateurs de Lagrange) qui aboutissent à l'optimum social.
Règle de Lange Lerner
La proposition peut être renversée et aboutir à un autre résultat, en partant de l'optimum social et en faisant calculer par une agence ( socialisme planifié) la liste des "prix fictifs" pour tous les facteurs et les produits. Elle distribuera cette liste de prix à tous les membres de la société et les ( entrepreneurs et consommateurs) incitera à se comporter comme des maximisateurs de profits ou de satisfaction en concurrence pure et parfaite.
- Cadre graphique: le diagramme d' Edgeworth
Il permet avec deux agents d'obtenir , compte tenu de leurs préférences des courbes de contrat ou de conflit, reliant leurs points de tangence entre niveaux d'utilité ( courbes d'indifférence).
On peut faire figurer ce diagramme au sein d'un ensemble de production, ou encore le faire figurer avec une hypothèse de déséquilbire.
- 123- Optimum partiel et de second rang
On peut restreindre l'optimum à un secteur isolément en considérant la clause "ceteris paribus); cette démarche a été utilisée dans les modèles sectoriels ( agriculture, logement etc...) de la planification française et dans le cas très particulier de la Rationalisation des Choix Budgétaires ( RCB), inspirée de la PPBS (planing, programing, budgeting system) des USA. Ainsi on peut considérer le problème de l'exode rural ou de la regression des charbonnages en considérant que le perte de l'optimum résultant de la perte d'emploi peut être compensée par une subvention. Une technique souvent utilisée a consisté à faire l'hypothèse d'une répartition idéale des revenus et à maintenir, "au moins" la consommation globale. Cette démarche a connu un grand succès mais le rappel sur l'"optimum" ou le chemin intertemporel qui y mène , est souvent un exercice obligatoire sans grande application. Elle pose un problème complexe de décomposabilité de l'économie et des programmes de planification.
Dans ce cadre interviennent les prix "ombres" correspondant aux multiplicateurs de lagrange: Un choix optimal ( x1, x2) doit respecter la condition
p1
TMS (x1, x2) = - --
x1--> x2 p2
dU ( x1,x2) / d x1 p1
------------------ = --
dU ( x1,x2) / d x2 p2
sous la contrainte budgétaire
p1x1 + p2x2 = m
On commence par écrire la fonction auxiliaire de Lagrange ( ou lagrangien)
L = U ( x1, x2) - µ ( p1x1 + p2x2 - m)
Un choix optimal doit respecter les trois conditions du premier ordre suivantes:
dL dU ( x1,x2)
-- = -------------- - µ p1 = 0
dx1 dx1
dL dU ( x1,x2)
-- = -------------- - µ p2 = 0
dx2 dx2
dL
-- = p1x1 + p2x2 - m = 0
dµ
Le multiplicateur de Lagrange µ est en fait un "prix ombre". Notons que si l'on rapporte la première à la seconde condition, on retrouve la condition de l'optimum
dU ( x1,x2)/ dx1 p1
------------------- = -- = TMS
dU ( x1,x2)/ dx2 p2 x1 -> x2
Optimum de second rang (Lancaster/ Lipsey, 1956/1957)
Des contraintes supplémentaires, dites "exhorbitantes" peuvent être posées sur le cadre de raisonnement:
- quant au comportement des agents ( ex. effets d'imitation)
- quant au processus de production ( ex. rendements croissants à l'échelle).
- quant au marché ( monopole).
De façon générale, il peut y avoir des déviants, ne respectant pas les principes du calcul économique ( par ex. la tarification au coût marginal). Il y aura par exemple un afflux de facteurs de production vers les secteurs où il y a "péage", écart entre le prix de vente et tarification marginale. Cette déviation peut venir d'un agent économique, d'un bien ou de la structure du marché..... et ainsi la condition d'optimalité de premier rang ne peut être satisfaite.
Un exemple type de situation de second rang est l'union douanière régionale.
-124 La question de l'optimum social
La question est souvent éludée en "posant" une utilité sociale agrégée et une contrainte sociale agrégée...... et donc de poser un optimum social. En fait, il faudrait résoudre les problèmes d'agrégation des préférences et émettre des comparaisons interpersonnelles d'utilité.
La solution la plus simple est émise par Becker, en considérant ( cf supra) que chaque personne a une dotation composite effectée à la fois de revenu social et de revenu individuel. Le revenu social vient de ve que la personne peut faire des efforts ( h) pour surmonter sa simple contrainte sociale. Ces efforts peuvent avoir des résultats positifs ou négatifs. Jusqu'à un équilibre qui peut être un optimum social; ceci amène à réfléchir sur les stréggies optimales de redistribution.... puisque le revenu "social" doit émaner d'une libre volonté ou d'une contrainte pour un ou plusieurs partenaires sociaux.
En conclusion: appréciation critique de l'optimum
Sait- on reconnaitre un optimum ? sera t'on d'accord sur le meilleur des mondes ? Il existe autant de situations omtimale sque d'états possible de la répartition;or, la distribution des revenus est fondatalement indétérminée. L'optimum comme toutes les normative economics pose le problème des satisfactions individuelles. Terny ( Economie des services collectifs et de la dépense publique, 1971) estime que
"L'optimum de Pareto n'établit qu'un quasi- ordre entre tous les états accessibles dans l'espace des satisfactions"; un ordre doit être établi entre tous les optima de Pareto. Ceci pose le problème des procédures d'arbitrage entre états optimaux et donc de fonctions d'utilité collective. On retouvera toujours l'idée que l'on ne peut mesurer et comparer les satisfactions individuelles.
Les nombreuses imperfactions de nature sont opposées à la théorie de l'optimum: biens collectifs, effets externes, phénomènes de rendement croissant; mais aussi les imperfections des comportements des agents économiques, en particulier leur myopie.Mais l'optimum reste une référence normative, une mauvaise conscience de l'économiste; les préférences des agents ont elles été respectées ?
Ensuite ce cadre idéaltypique permet de mieux comprendre les atteintes à l'optimum que sont les externalités. On ne peut comprendre le contraire du bonheur...sans savoir ce que cette notion contient.Ainsi la théorie de l'optimum permet de poser la théorie des externalités et des compensations.
Section 12- Externalités et compensation
-121 - Les externalités
Définition
L'externalité correspond à un cas où un agent voit varier son utilité sous l'effet de l'action (ou abstention) économique d'un autre agent qui n'est pas pris en compte par les mécanismes de marché.
A distinguer
-----------
- Un agent émetteur d'effets externes et un agent recepteur d' effets externes
- Les externalités pécuniaires ( se traduisent par une augmentation du taux de profit, par exemple quand les profits d'une firme dépendent du montant des intrants et des extrants produits par une autre firme.
- Les externalités technologiques, à savoir les interférences entre producteurs.
- Les externalités économiques prennent souvent une signification très vague par exemple l'idée d'"externalités de développement" ( par ex. effets indirects du développement par industrialisation) de RosensteinRodan ( 1943). On évoque encore les externalités politiques émises par l'Etat, un groupe, ou une majorité contre d'autre agents ( cf.Buchanan, 1963). Pour ce dernier auteur, certaines externalités peuvent être compatibles avec la réalisation d'un optimum de Pareto.
Historique
La notion d'externalité provient de la reflexion sur les firmes. Déjà présente chez Marshall ( Principes..), elle est attribuée à l'oeuvre de Meade ( 1952). L'approche sera renouvelée par la prise en compte du rendement social.
Dans une première approche, on peut distinguer des externalités (économies) positives, d 'externalités négatives ou désexternalités. L'externalité peut naître d'une complémentarité non marchande par exemple entre arboriculteurs et apiculteurs..dans la fable bucolique de Meade.
L'externalité réside potentiellement, au delà de la concurrence et des conséquences négatives de l'activité d'une autre firme, de la rivalité, de l'envie, de la frustration. De façon plus générale, un individu peut augmenter les coût sociaux marginaux plus que son coût marginal privé, en polluant par exemple l'environnement. L'externalité peut être liée à la propriété; par exemple,une invention mal protégée peut ainsi être pillée. Dans une approche plus théorique, on montre que la recherche du profit individuel maximal ne conduit pas forcément à maximiser l'avantage collectif;
- des effets externes unilatéraux ou réciproques, divisibles ou non, reversibles ou irréversibles.
Premier Cas: les coûts externes ou externalités négatives
Figure: 1.
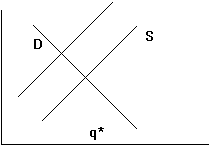
Prenons l'exemple d'une firme qui pollue une rivière et impose des coûts aux autres.
Soit un coût externe pour l'ensemble de la société que les producteurs n'ont pas à payer. Si ces derniers devaient payer ce coût supplémentaire, on aurait un déplacement de la courbe SS vers la gauche ( c'est à dire une réduction de la quantité offerte en Q1). En fait , le producteur est fictivement en Q alors qu'il devrait être en Q1, il y a surproduction, au delà de ce qui est socialement admissible, et mauvaise allocation des ressources.
Deuxième cas: les bénéfices externes ou externalités positives; Figure 2
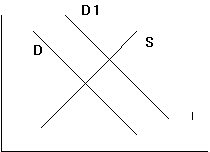
Exemple de familles villageoioses qui bénéficient gratuitement de la route privée construite par une société. L'externalité sociale positive est au centre de la théorie de la croissance endogène; dans l'exemple de Lucas ( Mechanics on developement, JME, Août 1988), des gains en capital humain proviennent de concentration de cadres ou d'intellectuels en ville.
L'équilibre est en q entre S et D. Il n'y a un bénéfice externe venant de producteurs qui ne sont payés en retour. Si les consommateurs devaient payer pour le bénéfice externe qu'ils en retirent, on aurait alors un changement de D en D1 : ils devraient payer plus cher pour avoir la même quantité de bien. Mais l'équilibre devrait alors avoir lieu en Q1; s'il est fictivement en Q, alors cela signifie qu' il y a sous production et mauvaise affectation des ressources.
Intuitivement, on perçoit mieux les externalités sociales négatives ( pollution) mais les externallités sociales positives ont été remises à l'honneur par la théorie de la croissance endogène ( Lucas, 1988). L' idée est de trouver des externalités sociales "gratuites" qui ne faussent pas le marché ( cf. les deux cas précèdemment évoqués) et ne pèsent pas sur la fonction de production. Ainsi pour prendre les cas évoqués par Lucas, des rencontres et des discussions dans les grandes villes ou encore pour élargir des phénomènes communautaires. La BIRD (1997) évoque le "capital social" comme le chaînon oublié du développement.
- 122- Les Compensations.
Afin de réparer les externalités, la théorie économique a imaginé de nombreux mécanismes de compensation. Deux débats sont effectués, l'un sur le "chemin de fer" ( Pigou/ Coase) , l'autre sur les "Corn laws "
- 1221- Le débat le plus célèbre sur les externalités négatives du chemin de fer oppose
- Pigou et l'économie du Bien Etre ( Welfare) dont la compensation repose sur la taxation et justifie l'intervention de l'Etat.
- Les néo-libéraux( par exemple) Coase et son principe de marchandage.
Pigou par de l'exemple célébre du chemin de fer et de la locomotive à vapeur qui crée des dommages aux récoltes.Selon Pigou, la taxation de la compagnie permettra de compenser les dommages occasionnés aux récoltes en diminuant la fréquence des trains.
Coase (1960) et l'école de Virginie soulignent au contraire l'importance du marchandage en situation d 'externalités négatives.Il faudra acheter l'abstinence de l'agent économique qui doit renoncer à ses droits de propriété; de même il faut évaluer les droits de propriété des pollués.
Il existe ainsi des coûts de transaction inhérents à de tels marchandages dont Coase sera l'un des grands théoriciens ( cf son influence originelle sur l'école néo insitutionnelle américaine contemporaine). Prenons l'exemple de la figure......utilisé par Coase dans sa démonstration du JLE de 1960. Pourquoi à la suite de Pigou, ne pas supprimer le chemin de fer ? Si le bénéfice créé par le train est inférieur au montant des dommages créés par les recettes,alors les propriétaires fonciers pourront indemniser les propriétaires du chemin de fer par arrangement privé.
Considérons en abcisse, le nombre de trains passant à travers les champs. Ce nombre a une limite qui correspond au fait qu'à ce stade le bénéfice marginal est nul.
Soit en ordonnée, les bénéfices. La courbe AB montre que le bénéfice des chemins de fer diminue avec le nombre de firmes.
Soit une ordonnée parallèle DX1, représentant les dommages éprouvés par les paysasn. Soit la courbe HD; on peut admettre que les deux parties se mettent d'accord à partir d'OX1 sur OX2. Si la rédudtion s'effectue jusqu'à OX3, il n'est pas sûr que les paysans arrivent à payer la diminution des bénéfices des chemins de fer.
-1222- Le débat sur les Corn Laws.
Ce débat a opposé en 1815 Ricardo à Malthus à propos du protectionisme qui favorisait la rente des propriétaires mais défavorise le reste de la Nation.
- Kaldor en 1939 revient sur ce débat en montrant que cette abrogation défavoriseront les propriétaires qui seront donc indemnisés. A l'inverse, ceux dont les revenus auront augmenté paieront une taxe...qui paiera la subvention aux propriétaires.... Ainsi chacun conservera ses capacités, mais tous profiteront de la hausse du revenu provenant de la baisse du prix du blé.
En fait, le critère de Kaldor est progressiste, car il permet d'atteindre un état social préférable dont tous profitent: le critère de Pareto Unanimité est respecté
- Un critère "inverse" est proposé par John Hicks ( 1940); admettons que les Corn Laws et donc le protectionisme soient rétablis: si la mesure est bonne, les propriétaires fonciers ne peuvent indemniser les victimes et donc la mesure première est bonne... Hicks propose donc un test " réactionnaire".
Scitovsky (1941) a proposé de réunir les deux tests, en comparant les deux compensations, et Samuelson (1950) en conclut que la mesure la meilleure est celle qui permet d'engendrer la hausse du revenu (du PNB), suffisamment pour abandonner toute compensation potentielle.
Critiques et prolongements du principe de compensation
De nombreux auteurs se sont exprimés sur ce thème ( Kaldor, Baumol, Scitovsky, et surtout Arrow). Les objections les plus graves viennent du philosophe Hans Jonas sur le principe responsabilité. Un marchandage est il possible avec des générations que nous ne connaîtrons pas ?
Questions posées par Arrow (1951)
Comment juger du préjudice ? pour établir un paiement ? En quoi l'ordre des utilités est il troublé ? il faudrait mesurer ce qui pose le problème redoutable des comparaisons interpersonnelles d'utilité. Peut on imaginer que la fonction d'utilité collective ( Bergson/ Samuelson) puisse être utile; l'exemple du politique sera souvent considéré pour montrer en quoi les hommes politiques compensent en "marchandant" leurs votes ( Cf. supra Buchanan et Tullock infra...).Les tests de compensations ne sont que des extensions du principe d'unanimité parétiennne.
-Les prolongements de l'école de la tarification
S.C.Kolm montre dans la "valeur publique" qu'une externalité fréquente tient dans les effets d'encombrement; dans ce cas, la qualité du bien dépend du nombre d'usagers:Les encombrements concernent les routes, les trains, le téléphone, la TSF entre usagers similaires ou successifs. Ils peuvent être cycliques : pointes et creux dans l'utilisation des équipements.Il faut donc adapter la tarification en évitant soit l'encombrement soit l'exclusion: pour éviter l'exclusion, le tarif ne soit pas dépasser la disposition à payer pour une consommation donnée.Pour éviter l'encombrement, le tarif doit permettre de supporter les coûts marginaux correspondant aux tarifs de pointe. Mais le problème de la tarification apparaît surtout comme une façon de résoudre le dilemme service/bien publics; dilemme que traiterons dans le chapitre 2.