CHAPITRE IV- PAUVRETE ET JUSTICE .
Introduction: L'introduction de l'altruisme dans le raisonnement économique.
La prise en compte de la pauvreté et de la justice implique un minimum de considération vis à vis des autres. Cette considération pose des problèmes en économie. Elle signifie que l'on intégre les situations des autres dans sa préférence et dans sa fonction d'utilité. Cette intégration de l'autre est assimilée à l'atruisme et à une bienveillance ( extended sympathy). Cette valeur morale implicite ( "bien" veillance) pose des problèmes analytiques.
L'intégration de l'altruisme dans l' analyse économique individualiste, a conduit à de profondes remises en cause et à des théorèmes originaux. Ainsi les années 1970 voient les théorèmes du Rotten kid (Gary Becker, 1974) ou de l'équivalence Ricardienne (Robert Barro, 1974) avec des prolongements importants dans la calcul intergénérationnel ( Kotlikoff/ Summers, 1981; Gale/ Scholz, 1994) et plus généralement dans l'analyse de la richesse.
Une analyse plus fondamentale de l'altruisme "universaliste" ( Sen, 1970)ou"parfait" ( Rawls, 1971) a été effectuée dans le cadre des choix collectifs, depuis Harsanyi (1955) avec de nombreux prolongements ( Rawls, 1971; Sen, 1974).
Son utilisation explicite semble plutôt réservée à la théorie des jeux ( Axelrod) et à la sociobiologie (Becker, 1976). Le contexte historique du concept d'altruisme n'est pas étranger à cette réserve dans son utilisation. " Altruisme" " sociologie" ou encore " sociobiologie" sont des néologismes attachés au positivisme d' Auguste Comte; dans le contexte antiéconomiste de sa physique sociale. L'inconvénient de l'altruisme sociologique est qu'il est entâché de valeurs ( bien/mal, bon/mauvais, libre/totalitaire, juste/ injuste) qui le rendent peu compatible avec le raisonnement économique. Cet altruisme moral devrait être corrigé en revenant à la tradition philosophique.
L'altruisme, en philosophie économique, correspond à une "rationalité étendue", élargissant le calcul économique à la relation que l'individu apporte à son environnement social. Le terrain d'un individu à la fois "égoïste et éthique" avait été préparé par Harsanyi (1955) et sera ouvert à un individu dont les choix intrapersonnels peuvent être à rangs multiples ( Sen, 1974). La "rationalité économique étendue" correspond à un raffinement du calcul intrapersonnel et interindividuel. L'hypothèse d'altruisme accompagne implicitement cette poussée théorique. Si elle fait l'objet de débats particulièrement vifs en 1993 ( congrès de l'AEA), c'est qu'elle est replacée dans le cadre de la résurgence de l'évolutionnisme social et de la sociobiologie. De façon générale la littérature économique, de Stuart Mill (1861, pp. 136) et Sidgwick (1907) à Arrow (1963, pp. 152) ou encore Harsanyi (1977),Sen (1970), cite le principe universaliste de Kant ( Fondements de la Métaphysique des Moeurs, p. 103):
" Je dois toujours me conduire de telle sorte que je puisse aussi vouloir que ma maxime devienne une loi universelle"
Cet impératif catégorique implique un consensus sur les fins de la part d'individus rationnels. Ce consensus sera exprimé par un principe de Pareto-unanimité dans la théorie des choix collectifs et que tous les individus sans exclusion participent à cet utilitarisme social.
Ainsi les individus sont capables d'exprimer l'autonomie de leur volonté dans un contexte d' ignorance de leurs finalités personnelles (Cf. les hypothèses de Rawls et Harsanyi).L'obtention d'une procédure de justice parfaite implique "que l'individu ait la faculté de se prendre vraiment pour autrui", ce qui implique une rationalité étendue.
Comment obtenir cet universalisme suprême ?
Emettre un jugement moral de la part d'un individu implique qu'il ait la même probabilité d'occuper n'importe quelle position particulière et d'atteindre le niveau d'utilité qui lui est attaché. Avec une mesure cardinaliste à la Von Neuman/ Morgenstern, l'individu super- rationnel sera à même de calculer son utilité espérée comme moyenne de tous les niveaux d'utilité individuelle dans la société. Cette utilité moyenne pourra être considérée comme la fonction de bien être social.
Le bien être social (W) peut être assimilé à une quasi- loterie avec une probabilité 1/n d' être quiconque dans cet état.Wi (xi) sera l'utilité d'être la personne dans l'état x dans une échelle à la
Von Neuman- Morgenstern
" x W(x) = ![]()
![]() W i (x)
W i (x)
xÎ X
Cette dernière conception a l'intérêt de développer une certain neutralité de l'altruisme. L'altruisme peut en effet être bienveillant ou malveillant ( cf. l' ouvrage célèbre de Turnbull sur les Iks) : tout dépend de la configuration de l'institution altruiste; ce que nous avons vu précèdemment avec les "clubs" et que l'on voit plus généralement avec les institutions de charité ou actuellement avec les régies de chômeurs ( J. Ballet, 1994). Apparemment altruistes en prétendant gérer de nombreuses personnes en difficulté, elles peuvent s'avérer égoïstes sinon malveillantes en étant incapables d'assurer le suivi social ( la réinsertion) tout en empochant des subventions.
SECTION I - INSTABILITE DE LA PAUVRETE, INCERTITUDE SOCIALE
La pauvreté manifeste une situation de privation absolue ou relative qui n'est pas stable. Elle est une contrainte sur la dotation en biens et services d'un agent économique et donc sur son comportement. Or, par définition, un agent économique n'est pas passif, il réagit à cette contrainte en utilisant son environnement. Cette réaction s'effectue dans un environnement humain, par exemple une communauté , des générations, des groupes sociaux ou des classes. Les termes de cette relation entre l'agent économique et son environnement sont incertains. Ils dépendent de la nature de la contrainte, de la personnalité de l'agent, de sa perception par son environnement etc... Pour simplifier, si l'individu posséde ainsi un revenu inviduel que la statistique peut , malgré de grandes difficultés, approcher, il détient potentiellement un "revenu social " (Becker) qui correspond à ce qu'il peut obtenir de son environnement. S'il est difficile de connaitre l'issue précise du jeu qui crée un revenu social , il est certain que la situation de départ sera remise en cause. La gestion d'une politique sociale fondée sur le ciblage social n'en sera que plus difficile
- 11- Généralités
Pauvreté et misère sont des notions très générales. Le manque qu'elles impliquent peut se situer dans les différents domaines de la vie. On parle ainsi de pauvreté ou de misère à propos de la science (Cf.Popper, 1956), de la sexualité (Cf.W. Reich, 1930), de la politique, de la culture sinon des objets eux même.
La pauvreté en économie a trait à un manque ou un défaut dans les biens nécessaires. Ainsi définie, la pauvreté reproduit tous les conflits de méthode qui se rapportent aux objets économiques ( micro/macro, statique/dynamique, réel/monétaire etc...)
La pauvreté est analysèe par rapport au revenu ou par rapport à un panier de biens fondamentaux ( mesurant le niveau de vie) soit de façon absolue ( la satisfaction d'un individu par rapport aux biens), soit de façon relative ( la satisfaction d'un individu en biens estimée par rapport à d'autres individus). Elle signifie qu'un départage riches/pauvres est possible au moyen d'une ligne de pauvreté (la fameuse ligne Z). Quelle que soit la méthode d'écart par rapport à une norme, les termes de cet écart posent un problème de comparaison interpersonnelle de satisfactions.
La pauvreté pose de nombreux problèmes méthodologiques ayant trait à l'objet de ce manque, à l'expression de ce manque, et au sujet de ce manque.
-111- L'objet de ce manque
Ce manque peut être analysé à partir du niveau de vie (optique fonctionnelle), du bien- être (optique utilitariste), des droits (optique anthropologique).
- A) Le niveau de vie permet d'assurer un certain nombre de fonctions vitales : reproduction, production etc..
La plupart des études de pauvreté situent la pauvreté en termes de revenu, notamment dans les pays développés. Le revenu permet de connaitre le niveau de vie sans avoir à quantifier ses composantes et sans préjuger des possibilités des agents économiques et de leur propension à consommer.
Malheureusement dans les Pays en Voie de Développement, une telle approche est difficile car les statistiques sont peu fiables en matière de revenu du fait de l'autoconsommation, des transferts ou encore de la pluriactivité informelle.
D'où une approche du revenu par la dépense ( ce qui pose le problème de l'épargne informelle) et qui ne surmonte pas les problèmes précèdents. La solution semble alors se trouver dans une conception synthétique du standard de vie que l'on trouve actuellement aussi bien dans la "dimension sociale du développement" de la BIRD que dans le "développement humain" du PNUD.
Les débats entre les deux institutions soulignent les limites de cette approche: comment pondérer les biens au sein de l'indice synthétique ou encore comment normer un tel indice dans le cadre d'une comparaison internationale ?
- B) Le Bien Etre a trait au niveau de satisfaction des agents économiques. Il représente un parti pris sur le niveau d'utilité qu'ils éprouvent.
Une conception normative du standard de vie pose de nombreux problèmes éthiques. Est -on sur de "vouloir" le bonheur des pauvres en leur assurant le niveau de vie "normatif". On retrouve ici le problème des comparaisons interpersonnelles des niveaux d'utilité et de bien -être. Ceci pose le problème d'un "optimum" des pauvres tel que les agents concernés n'ont pas envie de changer de situation. Mais surtout, comment les agents peuvent ils exprimer leurs préférences et comment ressentent- ils leur bien être ?
A ce niveau, le problème tend à être interindividuel ? Comment s'insère la pauvreté dans un ensemble de stratégies interindividuelles ?
- C) - La prise en compte des Droits implique une analyse anthropologique de la place de chaque individu au sein de son environnement.
Dans tous les cas, la pauvreté est mesurèe par des flux effectifs. La pauvreté n'est-elle pas plutôt lièe à un stock de droits ? Dans cette conception tout individu fait partie d'une communauté structurant ses droits et obligations. La pauvreté sera représentèe par sa situation nette de droits et obligations .
A.Sen (1981) pose le problème des droits (entitlements) au niveau de la famine mais ne l'étend pas à la pauvreté. Or la famine n'est qu'un cas particulier de la pauvreté.La pauvreté dépend de la carte individuelle des droits et obligations de chaque individu . Il existe un pauvreté potentielle dans le fait de ne pas avoir de droits ou de subir un déséquilibre important entre les droits et les obligations. Des "générations critiques" font elles partie des nouveaux pauvres ?
Néanmoins, une conception étendue des droits fait apparaitre l'importance des droits et obligations dans un cadre communautaire et intergénérationnel. La pauvreté dépend alors de sa capacité à satisfaire sa demande de protection sociale dans un cadre communautaire donné. Cette conception n'est elle qu'une extension de la première en ajoutant au revenu individuel , le "revenu social" (Cf Becker, 1974)) ? Elle s'ajoute aussi à la deuxième en considérant non seulement la consommation effective de biens mais aussi les droits sur l'ensemble des biens necessaires au standard de vie. Il est donc normal qu'individu ne reste pas complétement passif face à une situation de pauvreté en aménageant sa carte des droits et obligations. Il peut encore réagir au niveau de son allocation de temps, en multipliant ses activités dans le cadre des contraintes de temps.
La pauvreté sera ainsi fonction de deux donnèes spécifiquement individuelles: les droits et obligations d'une part et l'allocation individuelle du temps d'autre part. Mais, ces donnèes sont elles mesurables ?
-2- L'expression de ce manque: comment mesurer ?
Ceci pose le problème des indices ( incidence, étendue) et de la ligne de pauvreté. Les sources statistiques invoquèes dans leur calcul sont souvent fragiles; en particulier dans les zones rurales où les donnèes sur le revenu ( saisi par la dépense, elle même estimèe par l'autoconsommation, sans prise en compte des transferts) sont peu fiables ; une inconnue de taille a trait au secteur non tructuré en milieu rural ( production, consommation, échanges).
Les indices de pauvreté et la ligne de pauvreté ( Cf Foster,Greer, Thorbecke, 1984) doivent être remaniés au moyen d'un coefficient de correction faisant intervenir la redistribution. Une pauvreté, nette des transferts privés, pourrait être esquissèe. L'étendue de la pauvreté pourrait alors recouvrir des populations critiques à partir des cartes individuelles de droits et obligations.
Encadré N°
Pauvretés et lignes de pauvreté: les indices composites
Comment différencier incidence, intensité, et inégalité des bas revenus ?
Incidence = nombre ou part de personnes se situant en dessous d'un seuil de bas revenus.
Intensité = intensité de la pauvreté mesurée par l'écart moyen des bas revenus.
Inégalité des bas revenus = Distribution des bas revenus au sein de la population à bas revenus.
L'indice de Sen combine ( somme pondérée) ces trois critères; si tous les revenus sont supérieurs au seuil de pauvreté, l'indice a la valeur minimum 0. Si tous les revenus se situent en dessous du seuil de pauvreté et si la distribution est parfaitement inégalitaire, l'indice a la valeur maximum 1.
On peut faire figurer sur un système d' axes, les transferts avant et après prise en compte des transferts nets, la diagonale indiquant l'absence de transferts.
Comment approcher une ligne de pauvreté ?
Une ligne de pauvreté permet de distinguer les "pauvres" des "non pauvres" à partir d'un critère normatif de revenu réel ( par exemple, 31 $ mensuels en PPA). Elle permet d'estimer la distribution des pauvres en decà de cette ligne, entre "plus pauvres des pauvres" et "plus riches des pauvres", en tenant compte éventuellement des sentiments altruistes (sympathie ou aversion) engendrés par cette distribution.
En calculant initialement une brèche de pauvreté normalisée: soit z la ligne de pauvreté, calculée en PPA, par exemple égale à 31,23 dollars mensuels.
Soit yi le revenu des pauvres, et le nombre des pauvres, S
, somme de 1 à q et n, la population totale et x le type d'altruisme vis à vis de la pauvreté, l'indice de Foster,Greer Throbecke est de FGT = 1/n S [(z - yi)/ z ] x
HI = 1/n S [ (z - yi)/ z]
Le plus classique est de Foster/ Greer/ Thorbecke ( ) , cet indicateur qui est sensible à la distribution entre les pauvres x exprime la préoccupation de l'étendue de la pauvreté; si x = 0, alors FGT devient analogue à HI. On peut assimiler x à une mesure de l'altruisme vis à vis des pauvres sinon à la redistribution charitable ou aux transferts.Si un transfert s'effectue en faveur des pauvres les plus proches de la ligne de pauvreté, il y a diminution de la pauvreté ( contrairement au précèdent).FGT permet de mettre en valeur le "linen shirt paradox" ( Adam Smith). Dans sa version moderne, il souligne que l'efficacité du dollar marginal d'aide sera évidente pour les plus "riches" des pauvres et nulle pour les plus "pauvres des pauvres".
On peut effectuer ce calcul par rapport à la ligne de pauvreté ou à la ligne d'indigence, dans ce dernier cas, on évalue le minimal vital. Les principaux dilemmes ont trait à la pauvreté absolue/ relative et à la méthode directe ou indirecte.
- Avec la pauvreté absolue, la situation de chaque individu est estimèe par rapport à une norme. Dans le cadre de la pauvreté relative la situation d' un individu est apprécièe par rapport à l'ensemble des individus relativement à des normes). La pauvreté absolue implique que l'on s'accorde sur les normes " absolues" que l'on peut appliquer en matière de niveau de vie: nutrition, santé, logement, éducation, équipement etc...
La pauvreté relative consiste à juger de la situation d'un individu ( ou d'un groupe) par rapport à un autre individu (ou d' un autre groupe). Le problème est de savoir où placer la ligne de pauvreté.
-A) La méthode d'observation peut être directe ( pesèe, mesure du revenu) ou indirecte ( interviews, analyse du revenu par la dépense/autoconsomation).
-La méthode directe a trait principalement à l'accès à la nourriture; elle exige une pesèe, permettant d 'évaluer les achats et aliments est necessaire afin de voir dans quelle mesure ceux çi et les plats qui résultent de leur transformation permettent de satisfaire les besoins nutritionnels fondamentaux. Ces derniers peuvent être évalués soit à partir d'une échelle d' équivalents adultes ( dite échelle d'Oxford ), soit calculés à partir des types d'activité et des budgets temps.
Ces trois étapes (pesèe, table de composition , calcul des besoins en fonction des budgets temps) sont rarement réunies dans un enquête. Cette méthode "lourde" a étè utilisèe dans l'enquête budget/consommation de 1979 sur la Côpte d'Ivoire(EBC, 1979), une des enquêtes les plus complètes menèes sur les conditions de vie des ménages dans le tiers monde. Pour le reste, on reste très les résultats très disparates selon les niveaux d'enquête, microenquêtes nutritionnelles, enquêtes nationale lourdes sur les budgets/consommation, enquêtes orales "standard" de la Banque Mondiale ou disponibilités alimentaires de la FAO
Ces estimations de revenu par les enquêtes orales posent cependant de graves problèmes d'estimation, aggravés par une division Nord/Sud du travail. Aux africains , la production des donnèes, aux experts des agences internationales le sérieux des analyses ! Cette division anormale du travail renforce les risques d'erreur dans la saisie , par manque de contrôle de la part des concepteurs (une variable sur trois est fausse,selon notre propre expérience) et les analyses non pertinentes, faute d'expérience sur le terrain de l'enquête. Ce type d'enquête, par interviews, surévalue les revenus urbains et sous estime les revenus agricoles; le revenu étant estimé par la dépense, faute d'informations suffisantes, il faut alors évaluer l'autoconsommation qui reste une donnèe majeure dans les régions rurales. Or celle çi est doublement sous évaluèe par le fait qu'elle ne fait pas l'objet de pesèe et qu'elle est valorisèe par le prix déclaré par l'enquêté. Ainsi l'auto- consommation agricole est évaluèe au prix bord-champ alors que les transferts de la campagne vers la ville sont estimés au prix de détail urbain .
L'autoconsommation urbaine résultant des transferts en produits agricoles est aussi négligèe. Les transferts ,définis de façon restreinte (comme envois monétaires dans le cadre des "ménages") sont sous évalués. Mais toutes les enquêtes montrent (cf.supra) que ces "retours" de la campagne vers la ville sont très faibles par rapport aux envois des ressortissants urbains vers leur communauté rurale d'origine.
Les deux méthodes , saisie directe des indicateurs nutritionnels et saisie indirecte par le revenu déclaré restent insatisfaisantes.
-Le processus de calcul des besoins nutritionnels en fonction des activités est complexe. L' observation des activités pose de grands problèmes dans la mesure où les calendriers traditionnels font que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. En zone rurale, il existe une alternance de jours , avec permission ou interdiction de certaines activités.
La méthode de saisie des revenus est d'autant plus indirecte que ceux çi sont estimés par la dépense, elle même dérivèe de l'autoconsommation...
Comment mesurer les redistributions ?
La situation de chaque individu doit être apprécièe par rapport à sa communauté; l'individualisme méthodologique implique que les critères habituels ( niveau de revenu et satisfaction des besoins fondamentaux) soient évalués au niveau de chaque individu. Sur le plan individuel, le critère le plus efficace semble être encore le taux de pression communautaire qui est donc aisément calculable à partir du revenu, des obligations directes et indirectes. Le taux de pression communautaire est un indicateur final de la situation de tout ressortissant et de ses difficultés; il reste cependant incomplet.
Il faut apprécier ce taux en essayant d'évaluer chaque carte individuelle de droits et d'obligations intergénérationnels (ROM); cette appréciation implique de connaitre les droits effectifs et d'apprécier les droits potentiels à partir de l'identification.
La forme la plus immédiate de l'altruisme est un réseau de responsabilité . Ce réseau peut être posé pour chaque personne par rapport à d'autres, plus jeunes ou plus vieilles. Les éléments de relation sont au moins des droits et des obligations, ne serait ce qu'en termes de respect de l'égale dignité de la personne humaine. Mais ces droits et ces obligations peuvent être d'intensité plus forte selon la société et les potentialités de recomposition de la personne concernée. Elle peut ainsi apprécier rationnellement, selon des modalités différentes, son interaction sociale et ses responsabilités. On peut formaliser cette "responsabilité sociale " ou "communauté" pour chaque individu par des points sur un système d'axes représentant en ordonnée la situation dans le temps des personnes concernées et en abcisse l'intensité des droits et obligations. Une telle carte des droits et obligations ( Rights and Obligations Map, désormais ROM ) est strictement personnelle et correspond intitialement à une phénoménologie de la responsabilité économique: la personne est plongée dans un univers de responsabilité en fonction de ses origines, de son statut familial, de son âge, de sa société, etc... On peut imaginer une ROM potentielle "équilibrée", au nom de la symétrie entre droits et obligations. Cette sociabilité se traduit par un réseau personnel de droits et obligations; cette sociabilité, immédiatement responsable est potentielle et n'a pas forcément d'incidence économique. La personne concernée peut activer ce réseau avec sa rationalité soit comme émetteur soit comme récepteur de transferts. Cette responsabilité est gérée par chaque personne en fonction de ses contraintes. Elle applique une rationalité hypothétique, de la fin sociale en fonction de ses moyens. Dès lors le réseau devient effectif et se traduit par des modifications dans les allocations individuelles en temps, en biens ou encore en monnaie. La mise en place d'un tel système n'implique pas l'équilibre: le remboursement peut se faire sur plusieurs générations ou ne jamais se faire; sinon sous des formes immatérielles ( affection, reconnaissance etc...). Ce système économique peut être ascendant ( des jeunes aux vieux) ou descendant ( des vieux aux jeunes) . Les déformations de chaque carte définissent la forme de l'altruisme au niveau de chaque personne. Ainsi la figure I , avec une forte déformation en sud- ouest caractérise un altruisme ascendant.
Figure 1- Carte de droits et obligations (ROM) avec forte relation ascendante.
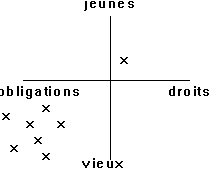
Les personnes peuvent-elles se contenter de gérer leur responsabilité ? Elles doivent rester coopératives. Compte tenu de ses droits et obligations, une personne peut décider à la suite de son raisonnement économique de couper avec son entourage, de se révolter contre la société; bref de réenvisager sa coopération sociale. A ce stade, la personne doit se demander quelles sont les sanctions sociales de son attitude, par exemple les risques d'exclusion et dans certaines sociétés de "courte maladie". Elle doit à ce stade être raisonnable.
-3- le sujet de la pauvreté: ménage, individu , communauté,
Une généralisation aux espaces, groupes et nations est elle possible ?
De qui s'agit il ?
Cette question est celle de l'unité statistique significative. La pauvreté peut s'apprécier au niveau de la commodité statistique, en particulier le ménage; le ménage est-il l'unité significative du point de vue de la pauvreté ? On sait que le revenu est redistribué de façon très différente en Afrique; en effet, chaque individu , en fonction de son statut socio- familial, a un réseau de redistribution qui lui est propre.
Cette question est posèe de façon instrumentale au niveau des échelles d'équivalence pour connaitre la situation individuelle au sein des ménages. En fait la question recouvre un phénomène plus fondamental ayant trait à l'envers caché des problématiques de la redistribution . Dans le cadre d'une approche interindividuelle , la pauvreté dépend des stratégies mises en place par chaque individu dans un contexte de rationnement généralisé.
Elle peut s'apprécier comme un un manque de droits. Dans ce cas, la situation individuelle des droits et des obligations est primordiale ainsi que la stratégie qui l'accompagne. Au plus les difficultés s'acumulent , au plus la demande de protection sociale est forte et au plus la carte individuelle des droits et des obligations devient complexe.
Il en est de même avec le temps; au plus les difficultés sont grandes, au plus l'individu doit réaménager ses contraintes de temps. Il peut substituer du temps aux biens dans le cadre des droits et des obligations (Mahieu, 1989) ; mais, il peut aussi jouer sur sa propre allocation de temps, au niveau des saisons, des jours , des heures. Sa situation de pauvreté le conduit souvent à aménager son allocation du temps afin de survivre et diversifier les risques; s'il le peut, il multipliera d'autant plus ses activités que sa situation est difficile.Cette dernière optique pose le problème d'une généralisation possible à des groupes sociaux ou des espaces géographiques de la pauvreté; par exemple à l'idèe qu'il puisse y avoir une démarcation entre urbain "riche" et "rural" pauvre, entre nations riches et nations pauvres.
- 12- La difficulté du ciblage social: dotations, allocation ciblée et allocation universelle.
La difficulté du ciblage social , inhérente à la dimension sociale du développement s'en trouve ainsi compliquée. La dimension sociale du développement repose principalement sur l'appréciation statistique de la pauvreté. Ainsi la dimension sociale de l'ajustement structurel a souvent été critiquèe comme étant une dimension "statistique", sans politique d'action.
En fait, les statisticiens connaissent des difficultés croissantes pour estimer les standards de vie des individus et spécialement le revenu. A une époque où les possibilités offertes par l'informatique en matière de contrôle et de traitement des données collectèes sont immenses et peu coûteuses, la méthode de collecte reste problématique, face aux biais anthropologiques. Les effets d'appellation ( qu'est ce qu' un ménage, un enfant, un pauvre?) , les effets de mémoire ( quelles sont les périodes significatives du temps ?) et enfin les effets d'adresse liés aux "questions retournées". L'obtention de données fiables sur le revenu
pose toutjours autant de problèmes, particulièrement dans les enquêtes orales: le revenu étant approximé par les dépenses, celles- ci étant assimilèes ,en zone rurale, à l'auto-consommation.
La situation s'aggrave encore quand on sait que le but des statistiques dans les pays en voie de développement est prioritairement de construire des indicateurs macroéconomiques : indices des prix, agrégats nationaux. De ce fait les unités d'enquête sont des ménages et des entreprises, non des individus.
Une construction macroéconomique ne peut que masquer les réactions individuelles aux calamités, en particulier à la pauvreté. Par nature, elle aboutit à des projections fatalistes. Or, les réactions individuelles aux contraintes ( pauvreté, famines, pandémies par ex.) sont responsables, rationnelles, raisonnables . L'agent économique réagit rationnellement aux contraintes macroéconomiques ou macrodémographiques et de ce fait remet en cause les tendances macro économiques. Cette rationalité est cependant adaptée à laspécificité de chaque société et, en définitive, est internalisée par chaque individu.
Ces réactions individuelles déstabilisent les projections macro économiques et créent des situations paradoxales , difficiles à gérer. La pauvreté telle qu'elle résulte de la distribution des biens ,dépend des stratégies interindividuelles ,dans le cadre de déterminations sociétales. La distribution des revenus est perturbée par des transferts ( effet T) et la pluriactivité ( P effet).
Ces deux effets relèvent de comportements volontaires et sont à réinterpréter dans le cadre de la politique de redistribution. Ordinairement, les optima possibles sont des situations d'équilibre entre n agents , (producteurs et consommateurs, pour deux produits) préférèes à toutes les autres. Ils se situent sur la ligne dite de contrat ou de conflit pour de multiples situations de répartition possibles.
L'optimum peut donc être établi dans une situation d'extrême inéquité ou de pauvreté relative. Il semble donc nécessaire de réfléchir sur une "politique" de redistribution optimale. Le débat a largement porté sur la taxation et ses effets suboptimaux et peut être réinterprété de la façon suivante, à la lumière des deux effets qui viennent d'être mis en valeur.
La dotation est un élément majeur de la survie ( Debreu, 1960). Si l'économie politique commence quelquefois par des "robinsonnades" ou par une scène de la création du type "Adam et Eve", la théorie économique moderne commence par l'analyse des situations de survie. Ce cas, très universel, permet de mieux comprendre comment la personne économique internalise des contraintes dans ses choix afin de se procurer le minimum vital. Survivre, c'est trouver par une stratégie donnée le mininum vital. Tout dépend de la dotation initiale. Il se peut qu'aucune stratégie ne permette de s'en sortir. Soit une marchandise, un lieu et deux dates dans la théorie de Debreu ( 1960) et revenons sur son hypothèse de de non survivance en nous aidant de la figure V-1.
Figure V-1, une marchandise, un lieu, deux dates.
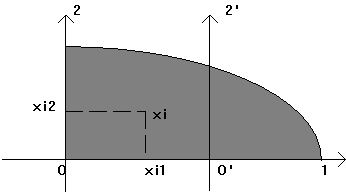
Considérons sur un système d'axe un input alimentaire qui ,au temps 1, doit permettre d'obtenir un même input alimentaire au temps 2. Ce même input au temps 2 peut être considéré comme une seconde marchandise. Une situation classique est celle où l'input de la première marchandise est inférieur ou égal au minimum [OO'] associé à un sous ensemble du quadrant fermé 1, O', 2'. Cette association ne forme pas en général un ensemble convexe. Il faut alors introduire l'hypothèse que le consommateur peut se débarasser librement des deux marchandises à l'intérieur de l'ensemble 1,0,2 qui ,lui, est convexe. Dans ce cas, le consommateur consomme xi1 de la première marchandise et dispose ( par libre substitution) de xi2 de la seconde marchandise mais n'en consommera effectivement rien.
Par son "choix" dans l'ensemble de consommation Xi, le consommateur détermine sa durée de vie..... Cette hypothèse forte permet de rétablir l'hypothèse de convexité sans laquelle une bonne partie de la microéconomie (l'idée d'un taux marginal de substitution par ex.) aura des difficultés à fonder ses démonstrations. Le choix entre deux dates est un taux d'actualisation subjectif. Dès que l'on passe à 2 dates t1 et t2 avec t1 > t2, on peut définir un taux d'intérêt qui permette de comprendre la différence de valeur entre t1 et t2. Ce taux d'actualisation prend en compte les caractéristiques de l' agent ( altruisme, bienveillance, aversion pour le risque, préférence pour le présent).
La dotation est un élèment majeur de la survie. Le temps permet d'aménager sa dotation (entitlements) ses droits en fonction du temps et des autres. On peut définir un ensemble de dotation ( entitlement map) (Sen, 1982) en fonction de l'alimentaire et du non alimentaire. L'aménagement des dotations individuelles entre ces deux composantes permet de surmonter les contraintes qui devraient aboutir à la non survivance. Soit une dotation telle que la définit Sen (1982) en alimentaire et non alimentaire; une telle dotation peut être aménagée en une dotation faite de revenu individuel et " social"; posons des lignes de pauvreté, l'individu condamné par manque de revenu individuel peut profiter d'un revenu social soit "ciblé" ( par l'Etat par ex.) soit universel ( cf le Revenu Minimum d'Insertion) lui permettant de sortir de la pauvreté. Un premier élargissement de la carte de Sen peut être réalisé en admettant que si l'homme concerné est dans un environnement social , il intégre d' autres hommes dans ses préférences, et donc peut bénéficier de droits sur cet environnement et en les activant afin d'obtenir des transferts. Tout dépend du rendement ( positif ou négatif) de cette intégration du social qui peut l'amener à être " égoïste simulant l'altruisme ( théorème du Rotten Kid;G. Becker, 1974) ou être altruiste simulant l'égoïsme ( égoïsme de précaution). Cette intégration du social implique de savoir gérer le temps et l'Autre, d'où la necessité de passer par des représentations de ces deux ressources par des cartes appropriées du temps et du tendre.
Ces stratégies optimales sur le temps et les biens peuvent être résumées à partir du graphe ci joint [figure V-2 ] : en considérant le revenu individuel ( formel, Yi), le revenu social ( de nature interindividuelle, informel ,Ys), le revenu tiré d'une pluriactivité ( de nature interindividuelle, informel, Yinf ) et enfin le revenu formel correspondant à un transfert étatique ( Yt). La carte des stratégies optimales qui en résulte est donc individuelle tout en étant fortement contrainte socialement .
Figure V- 2- Dotation de survie.
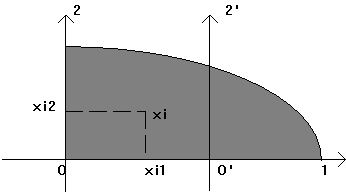
La contrainte sociale se manifeste au niveau des transferts ( par internalisation sur un équilibre Droits/ Obligations et donc l' allocation individuelle des ressources) ou encore au niveau de la pluriactivité ( impliquant un marché social) et des allocations de temps. Ces transferts et ces allocations de temps peuvent être représentés par des cartes ( de droits et obligations, d' allocations de temps) qui sont strictement individuelles; ce qui conduit à ajouter aux enquêtes classiques sur les ménages, des modules individuels dès que l'on aborde le social et le temps. Ces stratégies optimales se traduisent par une configuration donnée; celle ci implique dans tous les cas une dotation minimale correspondant à la dotation OE, en deçà de laquelle la survie n'est pas possible. Les déformations de la dotation de survie impliquent des modifications dans les relations interindividuelles. Ces altérités obéissent à des motifs hypothétiques, largement liés au mode de socialisation, et impliquent une recomposition permanente . Il importe donc de décomposer dans cette carte universelle, des stratégies possibles et de voir leurs implications. Les stratégies économiques présentées ici successivement ont trait aux transferts sociaux ( communautaires) et à la pluriactivité informelle (marchés segmentés), en esquissant leurs recompositions sur leurs milieux sociaux environnants. Une situation optimale est la situation ( équilibre réalisable) préférée à toute autre à un moment donné par un groupe d'agents économiques. Cette situation de pauvreté moyenne très forte peut être détestable du point de vue de l'observateur extérieur à ce groupe. Doit- il intervenir ?
Admettons encore le cas d'une situation à choisir par deux personnes qui s'accomodent d'une situation dite "en coin"; l'un a tout et l' autre n'a rien. Un obervateur bien attentionné tentera de les conduire vers une situation d'équilibre mieux partagée. Les situations économiques, ou équilibres réalisables entre plans d'action des personnes peuvent être diverses. On pense tout de suite à des situations qui ,vues de la part d'un tiers, sont insupportables et impliquent une compensation. Cette situation est très fréquente en économie publique et pose le problème des inégalités de revenu, de talent, de mérite dans ces situations déséquilibrées ( du point de vue de l'allocation de ressources), mais équilibrées du point de vue des préférences ( au sens de la stabilité de la préférence collective).
Un état d'optimum ( cf. Chapitre I) soulève le problème de l'ingérence; problème que pose bien le théorème de Lange- Lerner en abusant de l'équivalence équilibre général º optimum et de l' implication entre optimum décrété par l'"expert" et l'allocation de ressources. Des optima avec fort déséquilibre de l'allocation des ressources sont fréquents en économie, notamment en économie d'extrême pauvreté. Les préférences des agents peuvent s'exprimer par des actions, de type transferts privés ou auto organisation informelles. Autant ces transferts ( qui peuvent être démotivants) que l'informel ne sont pas efficaces du point de vue de la compétitivité internationale. Les transferts contraignent les actes économiques élémentaires et provoquent des déséquilibres en chaîne. Il en est de même des activités informelles dont la production et l'échange créent des contraintes en temps sur l'activité "tradable". Donc, la forme de la surface de survie peut être considérée comme tout à fait insatisfaisante avec, par exemple, l'absence de tout travail formel.
Tout le problème revient à savoir ce qui se passe dans un calcul interpersonnel. Les préférences sur les personnes jouent un rôle important. En effet, les transferts mais aussi l'activité informelle impliquent un réseau social et un système de réciprocité. Dans les tranferts, chacun émet un choix sur d'autres personnes: je préfère aider A plutôt que B, je puis reporter une obligation que j'ai vis à vis de B sur C etc..... La responsabilité vis à vis des autres exige sous contrainte de revenu et de temps, une priorité. Il en est de même pour l'activité informelle, je préfére acheter à tel vendeur ou faire réparer mon véhicule par tel artisan parcequ'il fait partie de mon réseau de privilégiés.
Le temps permet d'aménager sa dotation (entitlement), ses droits en fonction du temps et des autres. On peut définir un ensemble de dotations ( entitlements map) (Sen, 1981) en fonction de l'alimentaire et du non alimentaire. L'aménagement des dotations individuelles entre ces deux composantes permet de surmonter les contraintes qui devraient aboutir à la non survie. Soit une dotation telle que la définit Sen (1981) en alimentaire et non alimentaire; une telle dotation peut être aménagée en une dotation faite de revenu individuel et " social". Posons des lignes de pauvreté, la personne condamnée par manque de revenu individuel peut profiter d'un revenu social soit "ciblé" ( par l'Etat par ex.) soit universel (Cf le Revenu Minimum d'Insertion) lui permettant de sortir de la pauvreté. Un premier élargissement de la carte de Sen peut être réalisé en admettant que la personne concernée intègre d' autres personnes dans ses préférences, et donc peut bénéficier de droits sur cet environnement social. Tout dépend du rendement ( positif ou négatif) de cette intégration du social qui peut l'amener à être égoïste simulant l'altruisme ( théorème du Rotten Kid (G. Becker, 1974)) ou être altruiste simulant l'égoïsme ( égoïsme de précaution). Cette intégration du social implique de savoir gérer le temps et l'Autre, d'où la necessité de représenter ces deux ressources par des cartes appropriées du temps et du "tendre". Ces stratégies optimales sur le temps et les biens peuvent être résumées à partir du graphe ci joint [figure 2 ] : en considérant le revenu individuel ( formel, Yi), le revenu social ( de nature interindividuelle, informel ,Ys), le revenu tiré d'une pluriactivité ( de nature interindividuelle, informel, Yinf ) et enfin le revenu formel correspondant à un transfert étatique ( Yt). La carte des stratégies optimales qui en résulte est donc individuelle tout en étant fortement contrainte socialement .
Figure 2- Dotation de survie.
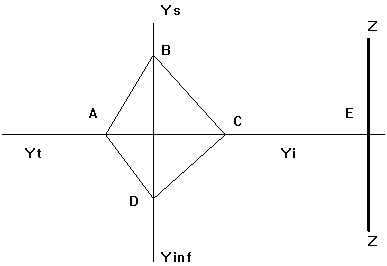
La contrainte sociale se manifeste au niveau des transferts ( par internalisation sur un équilibre Droits/ Obligations et donc l' allocation individuelle des ressources) ou encore au niveau de la pluriactivité ( impliquant un marché social) et des allocations de temps. Ces transferts et ces allocations de temps peuvent être représentés par des cartes ( de droits et obligations, d' allocations de temps) qui sont strictement individuelles; ce qui conduit à ajouter aux enquêtes classiques sur les ménages, des modules individuels dès que l'on aborde le social et le temps. Ces stratégies optimales se traduisent par une configuration donnée; celle ci implique dans tous les cas une dotation minimale correspondant à la dotation OE, en deçà de laquelle la survie n'est pas possible. Les déformations de la dotation de survie impliquent des modifications dans les relations interindividuelles. Ces altérités obéissent à des motifs hypothétiques, largement liés au mode de socialisation, et impliquent une recomposition permanente . Il importe donc de décomposer dans cette carte universelle, des stratégies possibles et de voir leurs implications. Les stratégies économiques présentées ici successivement ont trait aux transferts sociaux ( communautaires) et à la pluriactivité informelle (marchés segmentés), en esquissant leurs recompositions sur leurs milieux sociaux environnants. Une situation optimale est la situation ( équilibre réalisable) préférée à toute autre à un moment donné par un groupe d'agents économiques. Cette situation de pauvreté moyenne très forte peut être détestable du point de vue de l'observateur extérieur à ce groupe. Doit- il intervenir ?
Cette ingérence se heurte au fait que les termes de cette relation entre l'agent économique et son environnement sont incertains. Ils dépendent de la nature de la contrainte, de la personnalité de l'agent, de la façon dont il est perçu par son environnement, etc. Pour simplifier, si l'individu possède un revenu individuel que la statistique peut, malgré de grandes difficultés, approcher, il détient potentiellement un "revenu social" [Becker, 1974] qui correspond à ce qu'il peut obtenir de son environnement. S'il est difficile de connaître l'issue précise du jeu qui crée un revenu social, il est certain que la situation de départ sera remise en cause. La gestion d'une politique sociale fondée sur le ciblage social n'en sera que plus difficile. La difficulté du ciblage social, inhérente à la dimension sociale du développement s'en trouve ainsi augmentée. Une telle dimension repose principalement sur l'appréciation statistique de la pauvreté; d'où sa critique comme dimension "statistique", sans politique d'action. La situation s'aggrave encore quand on sait que le but des statistiques dans les pays en voie de développement est prioritairement de construire des indicateurs macroéconomiques : indices des prix, agrégats nationaux. De ce fait, les unités d'enquête sont des ménages et des entreprises, non des personnes. Une construction macroéconomique ne peut que masquer les réactions personnelles aux calamités, en particulier à la pauvreté. Par nature, elle aboutit à des projections fatalistes. Or, les réactions individuelles aux contraintes (pauvreté, famines, pandémies par ex.), par leur rationalité remettent en cause les tendances macroéconomiques. Cette rationalité est cependant adaptée à la spécificité de chaque société et, en définitive, est internalisée par chaque personne. Ces réactions personnelles déstabilisent les projections macroéconomiques et créent des situations paradoxales, difficiles à gérer.
Allocation ciblée
------------------
Le cadre de réflexion est celui d'un double revenu possible, fait du revenu individuel et du "revenu social", défini en référence à Becker [ 1974] comme le revenu tiré de l'environnement [figure V- 4].
FIGURE V-4
Figure 3- Revenus et lignes de pauvreté.
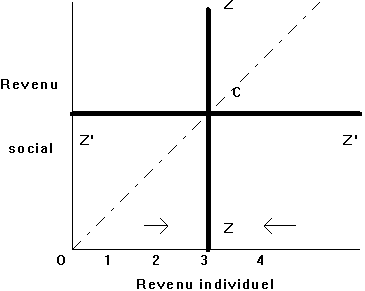
Les personnes possèdent des dotations en revenu individuel et en revenu social. Admettons qu'elles se classent selon leur revenu individuel de 0 à 4 et que la ligne de pauvreté ZZ passe en 3. Une telle ligne de pauvreté peut être tracée également pour le revenu social, soit Z'Z'. La diagonale OC indique les modalités de la redistribution possible. Par exemple le coût de la redistribution, telle que chaque pauvre devienne non pauvre, serait égal au triangle OCZ.
Une politique efficace ( au sens du maximum de résultat pour un minimum de coût) de lutte contre la pauvreté consistera à faire passer 2 sur la ligne de pauvreté. Si cette redistribution est effectuée par la taxation, celle-ci sera contrainte, définitive et sans contrepartie. Elle comprendra des coûts d'identification de la pauvreté qui risquent de transformer une dimension sociale en dimension "statistique" de la pauvreté. L' échec de la dimension sociale de la Banque Mondiale (fermée en 1992, après cinq années d 'existence coûteuse) montre, à la limite, qu'il aurait mieux valu transformer les crédits correspondants en allocation universelle. Une telle démarche ne soulagera, enfin, que les "plus riches des pauvres"..En effet, l'offre de développement peut être assimilée au dollar marginal d'aide. Un tel dollar ne sera efficace que pour les catégories les plus proches de la ligne de pauvreté. Mais si la redistribution s'effectue dans la classe moyenne, c'est-à- dire dans l'ensemble flou autour de la ligne de pauvreté, mieux vaut laisser jouer la classe moyenne elle-même.Le transfert volontaire, dans le cadre communautaire des droits et obligations corrige les effets de la taxation. En admettant que la personne 4 soit taxée, elle "prête" un transfert à 2 et acquiert un droit intergénérationnel sur 2. Si l'on intègre les stratégies différenciées des acteurs, des marchandages sont possibles. L'effet de transfert est ainsi d'autant mieux ciblé ["perfect targeting", Besley/ Kanbur, 1988] qu'il résulte de la volonté des acteurs. Ce type de redistribution peut être conçu comme "optimal", s'il respecte les préférences de chaque acteur; en ayant conscience que cette optimalité ne règle pas le problème des plus pauvres des pauvres. Aussi d'autres formes de stratégies optimales peuvent être mises en place, par exemple celles induites par les marchés liés à la pluriactivité informelle.
L'allocation universelle
- L'effet pluriactivité tend à assurer un "revenu universel"; tous les agents recoivent par l'élargissement du marché un revenu supplémentaire sans taxation. En admettant que la ligne de pauvreté corresponde à un niveau de survie, le nouveau revenu apporté par la pluriactivité permet de translater le revenu individuel au dessus de Z'Z'.
La redistribution qui correspond alors à la figure IV, est de type "universel". Plus globalement, l'allocation universelle peut être fournie soit par une redistribution d'un groupe de citoyens à d'autres ( riches----> pauvres) ou d'un ensemble de pays à d'autres ( Nord----> Sud). En fait des allocations ne sont pas universelles puisqu'elles proviennent d'une segmentation a priori de la population, elles ne sont pas optimales dans la mesure où elles résulteraient d'une politique de transferts et donc d'impôts négatifs.
Le thème du basic income, lancé par Thomas Paine il ya deux siècles, connaît un grand succès en Europe ( Van Parijs en Belgique, Bourguignon et Bresson en France). Dans tous les cas, le système est lourd à manier et normatif.
Dans des pays très pauvres, on observe souvent une réaction de l'ensemble de la population pur surmonter la contrainte de revenu, l'ensemble de la population contribuant à augmenter le revenu, par le marché résultant des activités informelles des individus.
FIGURE V-5, Allocation universelle
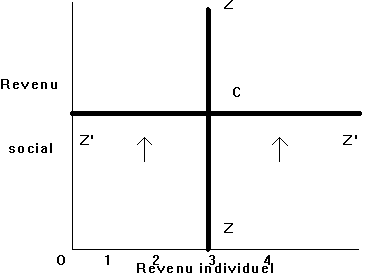
Elle ne résulte donc pas d'un développement décrété où la pauvreté dépend des paris macro- économiques des experts de l'Etat ou des agences internationales; encore moins de la création artificielle d'une "entreprise sociale" analogue aux entreprises de réinsertion des pays riches. Cette allocation est optimale si elle respecte les allocations individuelles de temps et donc un équilibre naturel entre activités formelles et informelles. Toute gestion artificielle, hors de ces normes, risque de mettre en péril cet équilibre social, notamment en favorisant une migration intrarurale dans des régions surpeuplées.
Les contraintes de pauvreté créent deux types de stratégies informelles: des transferts intra-communautaires, de la pluriactivité misérable. Les chocs externes sur ces édifices provoquent des recompositions qui échappent à la politique économique. Cette inefficacité de la politique économique , aussi bien pour les transferts intra-communautaires que pour les micro marchés, se traduit par une incapacité à maîtriser les recompositions et à en prévoir les effets: segmentations de la communauté, ethnocide cumulatif par effondrement de la régulation marchande. La pauvreté, telle qu'elle résulte de la distribution des biens, dépend des stratégies interindividuelles, dans le cadre de déterminations sociétales. La distribution des revenus est perturbée par des transferts (effet T) et la pluriactivité (effet P). Ces deux effets, une fois combinés, illustrent l'instabilité des situations de pauvreté autour des lignes ZZ et Z'Z'. Dans de nombreuses économies sous-développées, la réaction à la pauvreté combinera un effet transversal (effet T) et un effet longitudinal ( effet P) qui tous les deux permettent de compléter l'ensemble de la redistribution informelle. Cet ensemble ne désigne pas uniquement la production urbaine "non structurée" ou les "micro- entreprises " , mais l'ensemble des activités ( production, services, finance) et des transferts ( familiaux, communautaires) dont peut bénéficier une personne, compte tenu de son environnement social.
Ces deux effets relèvent de comportements volontaires et sont à réinterpréter dans le cadre de la redistribution optimale. Les cartes du "tendre" et du "temps" résultent du choix des personnes sous leurs contraintes, fussent elles exorbitantes. Ces deux effets illustrent la complexité des situations redistributives, en Afrique, comme ailleurs, dans un ensemble socio- économique généralement discontinu où des priorités et des seuils interviennent.
Les contraintes de pauvreté créent deux types de stratégies informelles: des transferts intra-communautaires, de la pluriactivité misérable. Les chocs externes sur ces édifices provoquent des recompositions qui échappent à la politique économique. Cette inefficacité de la politique économique , aussi bien pour les transferts intra-communautaires que pour les micro marchés, se traduit par une incapacité à maîtriser les recompositions et à en prévoir les effets: segmentations de la communauté, ethnocide cumulatif par effondrement de la régulation marchande. La pauvreté, telle qu'elle résulte de la distribution des biens, dépend des stratégies interindividuelles, dans le cadre de déterminations sociétales. La distribution des revenus est perturbée par des transferts (effet T) et la pluriactivité (effet P). Ces deux effets, une fois combinés, illustrent l'instabilité des situations de pauvreté autour des lignes ZZ et Z'Z'. Dans de nombreuses économies sous-développées, la réaction à la pauvreté combinera un effet transversal (effet T) et un effet longitudinal ( effet P) qui tous les deux permettent de compléter l'ensemble de la redistribution informelle. Cet ensemble ne désigne pas uniquement la production urbaine "non structurée" ou les "micro- entreprises " , mais l'ensemble des activités ( production, services, finance) et des transferts ( familiaux, communautaires) dont peut bénéficier une personne, compte tenu de son environnement social.
Ces deux effets relèvent de comportements volontaires et sont à réinterpréter dans le cadre de la redistribution optimale. Les cartes du "tendre" et du "temps" résultent du choix des personnes sous leurs contraintes, fussent elles exorbitantes. Ces deux effets illustrent la complexité des situations redistributives, en Afrique, comme ailleurs, dans un ensemble socio- économique généralement discontinu où des priorités et des seuils interviennent.
- Dans les deux cas, ces réactions ont des effets incertains.
Les transferts dépendent d'un système intergénérationnel de droits/ obligations et du statut que chaque individu y possède. Fondamentalement, le résultat de chaque transfert se perd dans l'incertain communautaire et ne permet pas de mesurer l'impact qu'il a sur le statut de l'ordonnateur auprès de sa communauté. La redistribution est d'autant plus efficace que chacun est mis dans un voile d'ignorance sur ses fins égoïstes.
La pluriactivité dépend de la contrainte de temps et surtout des possibilités du marché. Informelle, elle ne peut être ni précisément comptabilisée, ni mise en prospective. Elle est étroitement liée aux préférences des agents économiques et à l'existence d'optima de
pauvreté.
- La gestion de la pauvreté est problématique
Le pauvre, au début du jeu social, peut en fin de jeu devenir le "non pauvre" si son statut ( sa perception par la communauté) et/ou sa capacité à développer la pluriactivité lui permettent. De fait, la distribution des revenus est contrariée par le jeu social. Ainsi une politique discrétionnaire qui tenterait d'agir sur la ligne de pauvreté, risque de contrarier une demande volontaire de protection sociale et le marché qui lui est associé.
Une politique de lutte macroéconomique contre la pauvreté et le sous développement se heurte ainsi aux stratégies des agents face à leurs contraintes. Ces stratégies révèlent d'une certain façon la demande de développement des individus; demande jusqu'ici négligée par les offreurs de développement.
- SECTION II LES THEORIES DE LA JUSTICE
- 21 La "théorie de la justice" ( Rawls, 1971)
A l'intérieur de la pensée libérale, la théorie de la justice de Rawls (1971) est une tentative originale de rupture avec l'utilitarsime. Cette rupture sera contestée par Kenneth Arrow d'autant plus que cette théorie sera facilement intégrée dans la théorie des choix collectifs.
Il suffit d'ajouter aux règles de procédure de choix des impératifs d'équité, en particuler le leximin. La critique porte particulièrment sur le principe d'utilitarisme social que nous avons vu dans le chapitre précédent. Selon Sidgwick, dans une société d'utilitaristes éclairés, la satisfaction de n'importe quel individu doit être prise en compte. Mais n'importe quel individu même le plus déraisonnable peut ainsi détenir un pouvoir implicite de veto.
Mais s'il faut exclure, comment respecter la liberté ?
- 211- Le voile d'ignorance et la position originelle.
Le paradoxe des altruistes parfaits ( Rawls, pp. 218- 219).
Une société d'" altruistes parfaits " est celle où les individus ont des préférences sur les préférences des autres; soit des préférences de second ordre ou encore liées. Ainsi rien ne peut être décidé. S'il faut admettre que les agents ont des préférence qui portent sur des objets indépendants, celles ci peuvent être en conflit; il faut trouver un système de désintérêt mutuel.
Ce paradoxe est connu en économie dans l'altruisme généralisé comme celui de la "galerie des glaces " ( Blanchard - Fisher, 1989).
Afin d'empêcher toute vélléité utilitariste, un voile d'ignorance est posé sur la situation des individus et les fins particulières qu'ils peuvent attendre de leurs actions. Ainsi les individus ne pourront "utiliser les circonstances sociales et naturelles à leur avantage personnel". (Rawls, p. 168). Néanmoins, les partenaires ont une connaissance générale de la société humaine qui leur permet de réfléchir à une coopération sociale juste. Dans ce but, ils connaissent la théorie économique, les affaires politiques, l'organisation sociale et la psychologie humaine. Ainsi ils passeront un contrat unanime sur cette coopération tout en recherchant l'application d'un modèle de société avec des finalités ultimes.
Le principe d' Harsanyi ( cf. supra) ,ne saurait donc s'appliquer et laisse place à un stricte application du principe universel kantien.
"On peut alors considérer la position originelle comme une interprétation procédurale de la conception kantienne de l'autonomie et de l'impératif catégorique dans le cadre d'une théorie empirique" (Rawls, p. 293).
Ainsi, les partenaires arriveront aux deux principes de la justice.
212 Deux principes de la justice et deux règles de priorité lexicale
Les principes:
- Le premier principe a trait à la liberté auquel chacun a un droit égal à condition qu'il soit compatible avec le système de libertés pour tous. Les libertés de base peuvent être les libertés politiques, d'expression de réunion, de pensée et de conscience. Dans ce cadre libéral, les droits de la personne (intégrité) et de propriété sont protégés. Mais, cette protection n'a pas forcément trait à la liberté de posséder certaines formes de propriété et la liberté de contrat au sens du " laisser faire".
- Le second principe a trait aux inégalités sociales et économiques qui doivent être:
* au plus grand bénéfice des plus désavantagés dans la limite d'un juste principe d'épargne.
* attachées à des fonctions et des positions ouvertes à tous, conformément au principe de la jsute égalité des chances.
En d'autres termes, les inégalités sont arbitraires jusqu'à ce qu'elles contribuent raisonnablement à l'avantage de tous et sous réserve que les position set les fonctions auxquelles elles sont attachées où à partir desquelles elles puissent être atteintes, osient ouvertes à tous.
A ce principe est attachée la règle du maximin, i.e du "maximum minimorum", inspièré de la décision en univers incertain.
Soit à maximiser une fonction de gain (g) déterminée par une décision individuelle (d) et un contexte (c) tel que g= f( d,c).
Admettons trois décisions possibles et trois contextes possibles aboutissant aux gains et pertes suivants:
C1 C0 C3
D1 -7 +8 +12
D2 -8 +7 +14
D3 +5 +6 +8
D3, compte tenu du compte tenu du contexte (c) permet de gagner le plus (et à perdre le moins) possible.
- règles de priorité ou lexicographiques.
Un ordre de priorité est établi de telle sorte que chaque principe est entièrement satisfait avant la mise en oeuvre du suivant et ainsi de suite.
- La règle de priorité de la liberté fait que les libertés de base ne peuvent limitées qu'au nom de la liberté. Une réduction de la liberté n'est concevable que si elle renfocr le système des libertés partagé par tous.
- Une seconde règle établit la priorité de la justice sur l'efficacité et le bien être.
Cette justice est composite: elle repose sur l'égalité des chances et un principe de différence sociale. Rawls ( p. 341) montre comment cette compatibilité peut être établie:
- Une inégalité des chances doit améliorer les chances de ceux qui en ont le moins.
- Un taux d'épargne particulièrment élevé doit, au total, alléger la charge de ceux qui ont à le supporter.
L'inégalité sociale doit être au service de la justice sociale . De ce point de vue, Rawls approfondit les incidences philosophiques de la théorie de Keynes: l'inégalité dans la répartition de la richesse rend possible l'accumulation rapide du capital et l'amélioration plus ou moins durable du niveau de vie pour tous.
L'ordre lexicographique établi par Rawls subordonne l'utilitarisme (inhérent au principe d'efficacité et de maximisation des satisfactions) au principe de juste égalité des chances, lui même subordonné au principe de liberté. L'utilitarisme est- il effectivement subordonné ?
- 22- Prolongements et critiques
- 221- Critiques du système de Rawls
La théorie de la justice aura une grande influence dans la mesure où le principe lexicographique est un moyen habile de résoudre le dilemme (dit du "café du commerce") entre liberté et justice. Le principe lexicographique était déjà largement cité ( Georgescu Roegen, "La Science économique, ses problèmes et ses difficultés, Abreu in Econometrica). Mais son utilisation peu fréquente tant le principe de continuité est pratique. L'intégration du principe du leximin ( ordre lexicographique de redistribution du revenu minimum au revenu maximum, au contraire du leximax) sera immédiate , particulièrement dans la théorie des choix collectifs ( Arrow et surtout Sen, 1970). La critique libertarienne sera tout aussi rapide ( Nozick, 1971).
Kenneth Arrow (1973) remarque que la priorité lexicographique à la liberté n'exclut en rien que le choix collectif se fasse en maximisant la somme des utilités retirées des libertés individuelles et ainsi de suite pour toutes les autres options. L'ordre lexicographique n'est pas exclusif d'un calcul utilitariste individuel ( maximisant la satisfaction undividuelle sur des bases purement altruistes).
Beaucoup plus troublante est la confiance accordée par Rawls aux principes de la théorie des choix collectifs dans la situation originelle et sous le voile d'ignorance. La théorie du collective choice est en effet (Arrow, 1951) régie par deux principes premiers d'hédonisme et d'utilitarisme social avant les normes UPID.
La rationalité qui sous-tend les choix dans la position originelle est définie "comme capacité d'employer les moyens les plus efficaces pour atteindre les fins données" (Ralw, p. 40). En fait, il est question de "délibérations rationnelles" (p. 458),du bien comme rationalité (p.665), de choix d'être rationnels (p. 38).Ainsi la rationalité rawlsienne est mise au service de la justice: une maximisation des moyens au service de "fins ultimes" , le bien et la justice.
La critique la plus vive de la théorie de Rawls ( cf. Van Parijs, Qu'est ce qu'une société juste ?) viendra de Robert Nozick ( Anarchie, Etat et utopie) et de son paradoxe de la vedette sportive, en l'occurence le champion de basket, Wilt Chamberlain. La "juste" distribution des revenus sera violée par le fait que les fans de W.C paient très cher pour le voir ....au nom de leur liberté initiale; Il faudrait alors revoir le principe de liberté absolue pour éviter la mise en cause du principe d'équité. Des institutions collectives viendront interférer avec le principe originel de liberté. Il vaut donc mieux s'en tenir à une conception de l' Etat ultra- minimal (cf. l'Etat gendarme de M. Friedman), gardien de l'ordre.
Une autre critique viendra des "communautariens" (cf supra), en particulier l'idée que les choix initiaux viendraient d'individus "autonomes" alors même qu'il est nécessaire ( Mc Intyre) de rétablir une justice communautaire plutôt qu'une théorie libérale de la justice. D'où la réponse de Rawls dans "Justice et démocratie"1993. Le débat se déplace de l'économique autour de la Théorie de la Justice contre les libertariens ( mais aussi avec les économistes ( Arrow, Sen,..) au politique avec les communautariens. A la communauté des idées ( une sorte de communauté politique unifiée) s'oppose la démocratie avec pluralité des idées. L'intérêt serait de faire revenir à son tour ce débat politique sur l'économique en voyant mieux comment construire une " personne" dans le cadre économique qui permette de faire la synthèse des nombreuses constructions "dualistes". ( Harsanyi, Becker, Roemer, etc...)....
Le problème politique a trait au statut de l'Etat dans une société contractuelle.
Le statut de l'Etat et de la société politique différencie selon Catherine Audard dans son introduction l'opposition entre anglo- saxons et Européens. Ces derniers, essentiellement Français et Allemands, privilégieraient l'Etat au dessus des citoyens au nom du Bien être. L'Etat et les politiques ne sont que des citoyens au milieu des autres dans l'esprit anglo- saxon. Il existe potentiellement un utilitarisme communautaire qu'exprime bien la règle de l'utilitarisme social: la préférence sociale est impliquée par toutes les préférences individuelles.
Un changement de langage s'effectue: à la priorité du juste sur le bien, se juxtapose celle du raisonnable ( la capacité de s'abstraire de ses intérêts) sur le rationnel ( au sens de la théorie néo classique). On voit ainsi une nouvelle version de l' agent économique dual.
Le langage change au niveau de l'objet de l'anthropologie: une personne et non plus un individu ou agent. " Les membres de la société sont conçus non seulement comme des individus rationnels mais comme des personnes morales qui "peuvent coopérer en vue de l'avantage mutuel". La construction de cette personne s' inscrit explicitement dans un cadre kantien, notamment dans la conférence (chapitre 2): "Kantian constructivism in moral theory". Le constructivisme rejette l'existence de faits moraux indépendants et antérieurs et donc une hétéronomie a priori des règles.
-222- Prolongements.
- 2221- Généralisation des points de justice et envie.
La théorie de la justice de Rawls peut être intégrée dans l'ensemble des justices possibles au moyen d'un ensemble possible des utilités de deux types d' individus, U1 et U2, délimitée par TP. (cf. Buchanan, 1976 et Atkinson et Stiglitz, Lectures on public economics). Sur cette frontière, les différentes points possibles de la justice peuvent figurer:
E: Egalitarien , point de tangence entre PT et l'axe à 45°.
R: Rawlsien, plus grande amélioration du plus mal loti (U1).
N: Nozick, Etat ultraminimal.
B: Bentham
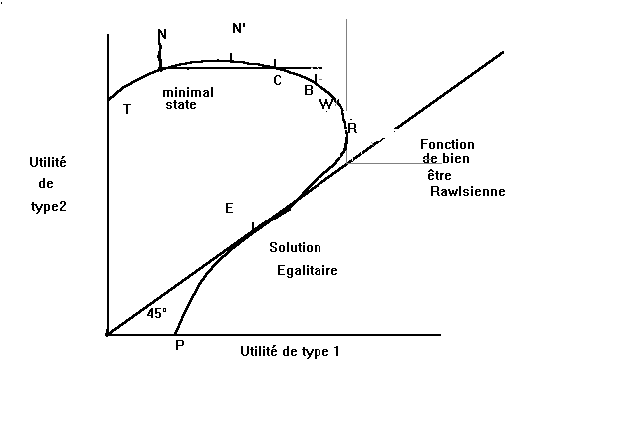
Ce type de figure souligne ainsi la capacité d'intégration de la théorie de Rawls.
L'envie invalide la justice et une longue tradition théorique ( Tinbergen, 1953; Foley, 1967, Kolm, 1972; Varian 1974) assimile l' absence d'envie à la justice. L'idée peut être émise que dans un monde d'envieux ( s'il n' y a pas de justice) des mesures soient prises afin soit d'égaliser le bien- être des individus soit leurs ressources. Une telle idée est rejetée par Nozick car l'égalité économique ne pourra supprimer l'envie.
L'idée la plus simple de l'envie est qu 'avec deux individus i et j et une dotation donnée
Pi xj xi
L'envie n'est pas forcément négative et malveillante. Elle peut avoir des conséquences multiples soit négatives visant à réduire la dotation de l'autre soit positives en suscitant l'émulation ( Schoeck, 1995).
Kolm ( 1972) définit l'envie partielle sur plusieurs biens de telle sorte qu' avec x et y par ex.
Pi ( xj, yi) ( xi, yj)
Cette analyse peut être prolongée en précisant les variables par exemple en distinguant les ressources externes, redistribuables (x), les ressources inaliénables (y) et (z) les paramètres personnels.
On peut définir ainsi une redistribution ( équité par diminution de l'envie) en jouant sur les ressources et/ou les aptitudes. On retrouve par exemple les débats sur l'éducation ( allocations ou aptitudes). On peut encore définir un programme dual ( Feldman et Kirman, 1974) tel que l'équité soit maximisée et l' envie minimisée. La justice, comme absence d'envie est à ce prix: établir un programme de redistribution sachant que nous ne sommes pas dans un état de nature ( sans justice distributive) mais connaissons un état du droit public ( Kant ,Métaphysique Des Moeurs,) dans lequel "la société est soumise à une justice distributive".
-2222- L'équivoque du communitarisme.
Ferdinand Tönnies (1887) était persuadé que l'ère de la société ( Gesellschaft) suivrait celle de la communauté ( Gemeinschaft). Or, face à la dissolution des rapports sociaux opérée par la modernité, le retour à la communauté est un thème récurrent de la sociologie aussi bien pour "réarmer moralement" les sociétés développées que pour lutter contre l'Etat dans les économies pauvres.
- 1 - La pensée communitarienne
Selon Etzioni Amitaï (1995), l'un de ses principaux animateurs, le mouvement communautarien est né d'une quinzaine de chercheurs en sciences sociale et philosophie, à Washington en 1990.Très US et assez politique, il est typique du "royaume du milieu" comme le résume le Washington Post( cité par Etzioni) entre libertariens ( absolutistes des droits de propriété) et autoritariens qui sont prêts à suspendre les doits constitutionnels pour combattre le Sida et la drogue. Un "agenda" normatif se propose à la fois de limiter le rôle de l'Etat ( aux grands dangers, à ce qui ne peut lui être substitué, au minimum d' intrusion possible et en évitant les effets externes négatifs. Les communautés seraient gouvernées par des "constitutions" qui tiendraient compte des problèmes de majorité /minorités et favoriseraient le "dialogue".
Le propos est toujours normatif; l'introduction est consacrée à " un nouvel ordre moral, social, public, sans puritanisme et oppression.' Le propos est très américanisant dans le style "nous croyons que"..."une résurgence morale est possible aux USA.." en faisant appel par exemple à un retour aux valeurs familiales. On se doute que ce message purificateur prétendant traiter "aux USA de la détérioration de la moralité privée et publique, du déclin de la famille, de la forte criminalité, ou encore de la corruption croissante au sein du gouvernement" sera écouté avec bienveillance. Il est donc question de rééquilibrer les droits avec de nouvelles responsabilités, équilibre que l'on trouve dans le système communautaire et donc " Be a communitarian: joint the movement" . L'ouvrage privilégie " the communitarian family", "the communitarian school"( "la seconde ligne de défense"), l'augmentation des responsabilités, le rétablissement de l'intérêt public. La plate-forme communautaire de Novembre 1991 part du constat des communautés d'appartenance, d'adhésion et du corps politique et de la nécessité de les activer afin de mieux protéger les droits individuels: les droits individuels sont protégés par les institutions de la société civile.
On retrouve chez Charles Taylor ( 1991), philosophe canadien, très marqué par les problèmes du Quebec, ce thème communitarien. Il évoque, jusqu'à l'obsession, le "malaise de la modernité", le fait d'être devenus des jouets de forces impersonnelles ( fétichisme des biens) , et donc la crise de la famille ( mobilité de la population, grandes villes, etc.. Les trois grandes sources du malaise sont l'individualisme, la primauté de la raison instrumentale ( maximum efficiency), les institutions et les structures des sociétés techno industrielles restreignent sévèrement nos choix. Il faut donc renforcer l'idée morale, une éthique , d'authenticité que l'on trouve chez le plus important philosophe à ce sujet qui est Rousseau et son " sentiment d'existence" et la liberté auto déterminée ( self- determining freedom) qui s'incarne dans le contrat social.On retrouve l'idée du dialogue (cf Etzioni) qui permet de faire et soutenir l'identité et la dénonciation d'une "société fragmentée dont les membres s'identifient de plus en plus difficilement avec leur société politique". Son ouvrage " Multiculturalisme, différence et démocratie" ( Taylor, 1997) traite d'abord du problème de la "reconnaissance" ( recognition) par exemple des femmes, des groupes minoritaires; Taylor fait alternativement référence à Hegel ( sur le thème de la reconnaissance, dans la phénoménologie de l'esprit) et à Kanty en voquant "la dignité qui consiste largement à être capable de déterminer soi même un vue de la bonne vie ( good life). Le libéralisme distinguerait les libertés fondamentales ( intouchables) et les privilèges et immunités (discutables).
-2- La politique communitarienne de la Banque Mondiale.
Ce programme communautaire typiquement nord- américain rejoint les "le communautarisme en économie ouverte" de la Banque Mondiale à travers ses fonds d'intervention; comme moyen terme entre l'Etat prévaricateur et les égoïsmes individuels. Le "développement communautaire" est un thème récurrent de la politique et des idéologies ( cf. Perroux, 1942).
La manifestation la plus intéressante (car source majeure d'inspiration actuellement pour les développeurs) a trait aux mutuelles et associations que recèlent les pays sous développées. Quoi de plus naturel que de faire adhérer à un projet, un "club"; ce dernier finance à son usage et en-dehors de toute intervention extérieure ses propres projets (au bénéfice exclusif de ses membres) ? Ces clubs sont particulièrement visibles dans les mutuelles ou associations de ressortissants d'un village, renforcés par les cadres urbains qui en Afrique de l'Ouest gèrent les projets socio- culturels .
Non seulement le Club de développement est la solution moyenne entre le tout Etat (service public comme tribut obligatoire sur tous les contribuables) et la privatisation forcenée ( bien public = bien financé privativement par les seuls utilisateurs) mais il favorise les petites réalisations: Small is beautiful. On comprend la précipitation des offreurs de développement vers ce produit récurrent. L'Etat "sous développé" ayant dévoilé sa rationalité dans sa recherche de rente, les clubs permettent de contourner le budget et plus généralement l'autorité publique. Ainsi est née la dimension culturelle de l'ajustement, le soutien à des associations d'intérêt général du Sud ( dits projets AGETIP ). Mais un club n'est pas forcément bienveillant, il peut être protecteur et invalidant....sinon totalitaire. Son inefficacité peut être redoublée par les types de projet qu'il met en oeuvre.....Les petits projets socioculturels contiennent de lourdes charges récurrentes et sont voués dans la plupart des cas à l'abandon. Enfin, l'ingérence de la Banque Mondiale dans des Fonds sociaux d'intervention ( exemple l'AGETIP) au dessus des souverainetés nationales pose un problème de droit. Jusqu'où le droit sur le développement est il contradictoire au droit au développement ?
Conclusio : le Ministère des EOP........
La priorité donnèe à l'éthique dans le rapport social comporte des conséquences importantes dans la conception du calcul économique. Il est question d'une priorité lexicographique (Rawls dans une optique macrosociétale) ou d'une priorité de l'autre dans la relation microsociale établie par chaque homme avec son prochain (Cf Lévinas). A ce stade, les exigences ethiques dépassent le simple rappel préalable à l'application du calcul économique; le problème devient celui de rapports éthiques préalables fondés sur la responsabilité vis à vis d'autrui. Ces rapports éthiques sont faits de normes ( obligation, interdiction, permission) qui déterminent nos actes économiques élèmentaires et font de notre calcul économique égoïste un élèment résiduel sinon utopique. Nos actes ont ainsi trait à autrui ( dans toute sa subjectivité, ce qui nous éloigne du totalisme socio historique), aux tiers ( dans la necessité de justice). Dans le temps nos actes se situent dans un réseau de droits et obligations dont l'orientation sera anthropologique; une application différencièe des lois morales universelles selon les sociétés.
L'intégration de l'éthique à l'économie est ainsi à ce prix: intégrer dans les concepts les plus intimes de la science économique (utilité, production, consommation, accumulation) les conséquences de l'intervention de l'autre ou plus généralement de la "communauté". Car la communauté implique, dans le temps, le déséquilibre dans un stock de droits et obligations: l'irresponsabilité de notre jeunesse et les responsabilités des générations critiques ,dites de l'âge mûr. Dans l'interaction sociale, l'individu internalise les normes, notamment sous la forme de cartes individuelles de Droits et Obligations. Ces cartes sont mises en action et donnent lieu à des transferts. Ceux ci sont particulièrement visibles dans certaines conditions et "communautés". Ces transferts, comme les formes d'altruisme en général, n'ont pas de valeur, ils peuvent apporter une aide solidaire mais aussi invalider l'édifice social. Ces transferts, notamment "intergénérationnels " et "inter vivos", posent des problèmes de mesure et d'intégration dans le calcul économique. Il en résulte des contraintes , des rationnements , et des inefficacités, sur le plan macroéconomique.
Dans les développements récents de la théorie normative, la responsabilité de la personne n'est pas immédiate. Elle se déduit des caractéristiques sinon du type ( Roemer, 1996) considéré, quel est la part du handicap ( positif ou négatif) et du mérite ( positif ou négatif) , donc du mélange de circonstances et de choix autonomes. D'une certain façon la question devient plus celle de la responsabilité de la société ( ou du gouvernement) dans sa taxation que celle des individus; d'autant plus que le Ministère concerné ( de '"equality of opportunities") détient dans le plus grand secret les types concernés ! Tout cela afin de maintenir de la liberté et de l'incitation ! La phénoménologie de la responsabilité développée ici a trait à la responsabilité donnée de l'un par rapport à l'autre, et aux intentions des protagonistes afin d'aménager leur situation. Cet aménagement des droits et obligations fonde une dynamique économique, en particulier dans le cadre de la survie.