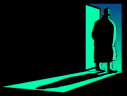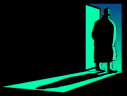
Conclusion
La place de l'homme dans la pensée économique, une anthropologie économique ?
.1. L’utilisation d’une problématique anthropologique en théorie économique
Du point de vue de la politique économique, il est plus simple de manier des identités comptables entre agrégats que d'introduire des variables de comportement. Le calcul économique est sérieusement compliqué par l'intégration de l'Autre, du temps et par conséquent de la monnaie. Une anthropologie économique est-elle nécessaire ?
L'économie a-anthropologique ?
La science économique s'intéresse à un homme
rationnel, fait d'entendement. Elle s'intéresse à l'homme autonome,
celui qui accède au-delà des sens aux impératifs catégoriques.
En effet l'anthropologie étudie la déformation par l'homme
en société (hétéronome) des règles universelles
; déformation liée aux impératifs hypothétiques,
aux moyens de satisfaire ses fins (universelles), à ses perversités.
Il est facile de dégager les parties de la théorie économique
où les hommes sont absents en tant qu'acteurs directs. Il en est ainsi
des parties de l'économie qui traitent des relations entre les marchandises.
Le plus a-anthropologique est le système de Sraffa (1970) qui traite
des productions de marchandises par des marchandises. Dans un système
de ce type, seules interviennent des relations techniques établies,
en fonction d'une mesure standard. De façon plus générale,
la macroéconomie s'éloigne le plus souvent de l'anthropologie
car elle s'appuie sur des variables globales et des agrégats, non sur
les personnes. Tel est le but de la comptabilité nationale en jouant
sur des comptes écrans et des soldes qui ne font pas apparaître
les hommes eux-mêmes, mais des secteurs institutionnels.
Les catégories, « entreprises, « ménages »,
« administrations publiques » sont hétérogènes
et le fait de leur prêter des hypothèses de comportement généralisé
pose de sérieux problèmes. Celles-ci sont inhérentes à
la théorie keynésienne, principale inspiratrice de cette méthode.
Ainsi les relations fondamentales ont trait à des quantités globales,
par exemple les équivalences entre le revenu global et soit la somme
de la consommation et de l’investissement, soit la somme de la consommation
et de l’épargne. Le risque d'erreur est d'autant plus grand que la prévision
s'appuie sur les comptes du passé et les tendances probables de
la macroéconomie. En effet, la variable comportementale est difficilement
prévisible, avec de telles catégories. Les lois psychologiques
fondamentales, notamment la supériorité de la propension à
épargner sur la propension à consommer, ou les comportements de
financement, font l'objet de controverses ( Kuznets, Nicolaï).
Dans ce cadre macroéconomique, les interactions et donc les réactions
des individus face à leurs contraintes ne sont pas prises en compte.
Dans cet ensemble rétroactif, les problèmes de redistribution
sont complexes et la globalité des instruments d'analyse ne les fera
pas apparaître. Un bon exemple de cette différence de conception
est le traitement de l'épargne en macroéconomie keynésienne
en tant que solde fatal entre le revenu agrégé et la consommation
agrégée. Une conception « individuelle » de l'épargne
peut au contraire faire apparaître ce sacrifice comme émanant de
précaution, d'assurance, de garantie à prendre dans un arbitrage
entre les perturbations intertemporelles et intergénérationnelles.
Autant les politiques globales de relance (dans les pays développés)
que celles d'ajustement/stabilisation (dans les pays en développement),
ont une efficacité économique très limitée et des
effets sociaux contestables. Leur efficacité est limitée
par la capacité des agents à réagir aux contraintes et
à anticiper les politiques, au nom de leur intérêt individuel
et d'autres considérations plus élargies (responsabilité)
à leur personnalité. Elles sont surtout aveugles et ne peuvent
prendre en compte l'intérêt des personnes. Or les personnes sont
présentes au niveau de l'émission des politiques, exprimant des
conflits d'intérêt, des altruismes simulés ; rien de tel
au niveau des individus soumis à de telles politiques. La macroéconomie
considère qu'elle fait a priori le bien des individus, elle décrète
leur bien-être, s'érige en service public de la masse.
L'homme, ce gêneur
L'idée du jardin secret ou des réactions
stratégiques des agents économiques, n'apparaît que très
tardivement. Si l'individu (l'agent économique) établit ses mœurs
économiques (consommation, production, épargne, transferts) en
fonction de son environnement, fatalement des normes morales jouent. Il en résulte
un réseau de contraintes morales en plus des contraintes purement matérielles.
Ces contraintes morales, en fonction du comportement de l'homme, peuvent devenir
matérielles (dons, transferts). Or ces externalités sont rarement
prises en compte dans la théorie économique ; le calcul sur les
contraintes morales est complexe, il dépend de l'information, des manipulations,
du statut socio-familial, etc.
L' éthique économique étudie les mœurs (ethos) des
hommes sous les contraintes de la nature et de la communauté des hommes.
Elle recherche donc à la fois une universalité humaine économique
(par exemple dans le don ou le marché) et son « altérité
» dans les comportements humains à des moments donnés et
en des lieux donnés. Elle étudie les comportements économiques
en privilégiant le rôle économique (maximisation sous contraintes
élargies au socio-éthique), mais ne peut se substituer à
une anthropologie générale, fondée sur la totalité
et l'histoire. Or l'économie est trop souvent standard et différentielle.
Standard n'est pas universel, il y manque les normes qui fondent l'universalité
du genre humain, sinon le standard ne s'applique qu’aux impératifs hypothétiques
et donc à l'altérité. Altérité n'est pas
différentiel au sens des premiers économistes visant, eux-mêmes,
à établir l' « échelle des créatures »
qui va des animaux à Dieu. Le « Je », grâce à
la raison, fonde l'altérité et la différence
fondamentale de l'homme avec toutes les choses. L'homme est en économie,
une partie indistincte d'entités globales (les unités économiques
de base : ménages, entreprises, institutions) et quelquefois un individu
en interaction sociale (Becker, 1974), mais que l'économie oblige à
reconnaître comme « hors norme ». Sans doute, s'il est
manipulé par la « main invisible » ou produit inconscient
des structures, il n'est qu’homo oeconomicus. Il est déterminé
mécaniquement par le marché ou le mode de production.
Mais l'homme est un gêneur. Il résiste à la politique économique
et plus encore l'invalide par sa capacité d'apprentissage,
ses anticipations et ses surréactions. Après les modes intellectuelles
du structuralisme et de l'introspection analytique, l'économisme
pourrait être triomphant s’il n'y avait les aléas posés
par l'homme aussi bien dans la société civile que dans la
société des besoins. L'échec des modèles structuralistes
et plus généralement des politiques macroéconomiques trouve
en grande partie sa source dans l'homme ; ce dernier est présent tout
autant dans les offreurs de politique économique que dans
les demandeurs. Il est présent avec son égoïsme naturel et
déforme en permanence les meilleures idées à son profit.
Il est présent aussi en tant qu'être social, élément
constitutif de sociétés qui élaborent
leurs particularismes et leurs résistances.
Si la macroéconomie peut difficilement prendre en compte l'homme, il
n'est pas sûr que la microéconomie soit automatiquement anthropologique.
On imagine facilement le risque d'une universalité transformée
en standardisation, de n'accorder d’intérêt qu'aux règles
(maximisation sous contraintes) ou normes universelles (optimum) hors
de toute altérité, et signification de terrain.
La microéconomie est-elle une anthropologie économique ?
La microéconomie recherche une vision standard du comportement
individuel ou du ménage, mais elle ne prend en compte que très
tardivement le comportement stratégique de l'agent. L'intérêt
de cette intégration massive par la théorie des
jeux est de montrer l’irréductibilité du comportement aux lois,
la difficulté à trouver des solutions uniques. L’analyse de l'interaction
des comportements individuels devient rapidement inextricable dès que
l'on sort du cadre ultra simplifié des présentations habituelles
en théorie des jeux.
Si l'anthropologie économique est l'étude de l'homme sous l'angle
économique, elle se confond avec la théorie économique
quand celle-ci est fondée sur l'homme. Le fait d'étudier les actes
économiques en accentuant un point de vue de façon idéal
typique, est un principe lui-même d'économie. L'anthropologie,
par son objet ambitieux (l'homme), représente un domaine immense que
le chercheur ne peut envisager que modestement, même s’il a conscience
de l'interconnexion des domaines étudiés. Le totalisme ne peut
être, sauf à maîtriser l'état et le mouvement, un
programme d'études (Sartre, la conclusion de la Critique de la raison
dialectique). De même les sciences sociales ne peuvent, selon Weber,
établir une cause ultime dans l’enchaînement des causalités
(Weber, 1992).
Ainsi l' anthropologie et l'éthique sont pragmatiques, sauf à
embrasser l'homme dans sa totalité, la société humaine
dans son infinité et toute sa complexité. Un point de vue est
fatalement privilégié. Il existe donc une anthropologie sous le
point de vue économique ; pragmatiquement celui-ci se réalise
par les économistes eux-mêmes dans leur communauté, avec
leurs instruments.
La microéconomie s'inscrit naturellement dans un cadre anthropologique
en étudiant l'économie au niveau des individus, de leurs préférences,
de leurs actes individuels, de leurs interactions (marché, plan, vote,
transferts, stratégies informelles). A condition qu'elle soit à
la fois un instrument universel (par exemple en envisageant les
situations « as if ») et de compréhension de l'altérité,
la microéconomie, dans le champ de l'économie permet de comprendre
par des idéal-types compréhensifs. Le niveau microéconomique
peut concerner les individus eux-mêmes ou les formes de leur interaction
(contrat, marché, plan) ou encore les lieux de celles-ci (ménages,
entreprises, communautés, etc.).
Elle a une nature compréhensive. En comparaison, la macroéconomie
est beaucoup plus proche de la politique économique
et donc de préoccupations normatives. Elle fournit la justification du
Léviathan. Cette positivité de la microéconomie en fait
un instrument critique de la macroéconomie. Le marché, l'optimum
et le bien-être peuvent être des instruments critiques redoutables,
la mauvaise conscience du macroéconomiste. Mais la microéconomie
a souvent été mal perçue ; ses utilisateurs ne la considèrent
que comme une méthode, applicable aussi bien à la recherche d'un
équilibre planifié que marchand. Elle présuppose
cependant une philosophie de la vie (la recherche du bonheur) ou une conception
de société : Arrow et Sen par exemple sont à la limite
de l'économie et de la philosophie. La formalisation de la microéconomie
est nécessaire ainsi que ses hypothèses extrêmes. L'abstraction
formalisatrice permet de synthétiser des situations et de typer des variations
possibles par rapport aux hypothèses extrêmes. Par exemple la concurrence
pure et parfaite permet de comprendre les imperfections de la concurrence. Typer
une situation d'optimum en coin (par ex. d'optimum de pauvreté) permet
de mieux situer les paradoxes de pauvreté. L'optimum individuel et la
compensation à toute externalité constituent la finalité
de tout raisonnement économique. La microéconomie considère
toute action ou toute situation du point de vue de ses conséquences sur
l'optimum du groupe considéré. L'anthropologie
économique traite non seulement de comportements, d'actions, mais systématise
les préfé-rences, les (res)sentiments, l'envie ou encore la frustration.
La microéconomie est-elle anthropologique ?
La microéconomie n'est pas forcément anthropologique.
Ainsi il ne suffit pas à la microéconomie de considérer
des unités élémentaires de l'analyse économique.
Il faut que ces unités soient humaines (et non uniquement individuelles)
et remplissent les qualités de l'anthropologie philosophique (universalité
et altérité). Le plus souvent, elle ne retient que l'aspect standard,
une universalité, sans s’enrichir dans la compréhension des altérités
; mais aussi, trahissant la règle de Hume, sa compréhension (positivité)
devient normative.
Des entités microéconomiques peuvent être constituées
sans les hommes : entreprises abstraites de tout compor-tement, organisations,
institutions ; très rapidement ces catégories appartiennent à
la macroéconomie par leurs hypothèses de comportement généralisé.
L'anthropologie économique serait pauvre si elle se réduisait
au calcul économique individuel par exemple de l'égalisation des
utilités marginales pondérées du consommateur face à
n biens possibles ou des conditions de son équilibre personnel optimal.
Ce cas de « robinsonnade » est exceptionnel. L’Autre intervient
très vite soit pour analyser les comparaisons intra personnelles de Robinson,
soit plus naturellement pour partager avec Robinson du temps, des biens, etc.
Dès lors, la microéconomie s'élargit considérablement
pour devenir une économie publique portant sur les modalités du
partage. Trop souvent les détracteurs de la « robinsonnade microéconomique
» n'ont pas conscience que l'essentiel de la microéconomie se trouve
dans sa composante sociale : la gigantesque nébuleuse de l'économie
publique et de l'économie sociale.
La microéconomie traite d'une « personnalité » complexe.
Le plus souvent, cette personne est dualiste, faite de contraintes sociales
et de choix libres. Lonsdale (1996) estime que cette « moral economy »
qui caractérise l'économie est « contradictoire »,
faite de contraintes et de stratégies de libre choix. La « personne
» pour Roemer est faite de « type social » et d'une liberté
qui à son coût : la responsabilité. Il en est de même
pour le consommateur de Becker qui, face à son environnement social,
« produit » des utilités. La personnalité économique
est ainsi complexe sur ce mode dual ; la question étant de savoir comment
modéliser cette dualité. D’un point de vue technique, il faut
imaginer un calcul du second ordre (ordinalité ou coordinalité
et une remise en cause des possibilités de passage de l'axiomatique des
préférences au calcul marginal (continuité ou priorité
lexicographique ?).
Ouvrir la microéconomie signifie y intégrer les contraintes d’autres domaines, par exemple, politiques, démogra- phiques, sexuelles. Ces contraintes interviennent sur une fonction de préférence dont les arguments peuvent être des choix de société, de principes, de personnes. Encore une fois l'angle individualiste n'a pour but que de mieux enrichir la contrainte sociale, de mieux comprendre son internalisation. Rien ne s’oppose à la construction d’une anthropologie microéconomique, sauf si elle ne retient que l'altérité, prenant le dessus sur toute tentative universelle ; confondue avec l'ethnologie, elle se disperserait en une collection de monographies. En fait il est difficile d’associer les deux points de vue de la microéconomie (universelle) et de l’anthropologie (relativiste).
.2. Comment associer l'anthropologie à l'économie ?
L'association de l'anthropologie à l'économie est contrariée soit par une ethnologie anti-économiciste, soit par une économie globalisante. Les premières tentatives explicites (Veblen) ou implicites (la praxéologie autrichienne) dans ce sens ont échoué. Une association difficile en économie
L'anthropologie philosophique est une considération peu courante en théorie économique. L’anthropologie économique a été appropriée le plus souvent par les ethnologues, en référence aux ethnies lointaines (Malinowski 1922, Herskovits 1952) ou à l’évolution des races européennes (Lapouge), afin de dénoncer la théorie économique. A l'inverse, l'approche des problèmes économiques, dans des contextes de crise, a été largement agrégative et planificatrice. Le « bouclage macro-économique » n'a que faire du point de vue anthropo-logique. L'anthropologie comme étude de l' « homme » semblait éloignée d'une microéconomie standard (celle des manuels de premier cycle) fondée sur des « agents » ou « individus » désincarnés, calculant isolément leur équilibre individuel avant de se rencontrer sur un marché puis sur tous les marchés. Cette référence caricaturale à l’homo oeconomicus passe sous silence les nombreuses microéconomies approfondies dites de l' « économie publique », traitant de l'interindividuel (Arrow, Sen), de l'interaction sociale (Becker, Barro) et de la personne (Rawls, Dworkin, Roemer).
Une école économique importante a développé simultanément la critique du « planisme » macro-économique et a dénoncé la réduction de la complexité de l'homme à une mécanique individuelle, notamment l'école autrichienne contemporaine avec Von Mises et Hayek. Ce dernier faisant référence explicitement à l’anthropologie culturelle du linguiste Sapir.
Plus généralement, la théorie économique de la société moderne, en particulier de la compétition industrielle, a été largement influencée par les théories sociobiologiques, en particulier Herbert Spencer. Déjà Marshall utilisait largement les thèmes du « struggle for life », thèmes repris dans la sociobiologie contemporaine de l' « altruism as fitness ». Auparavant, Marshall a fermé le débat sur la nécessaire intégration de l'altruisme et des valeurs morales (préface à la première édition des Principes) en affirmant définitivement le principe de continuité en économie. Aucune priorité (ou ordre lexicographique) ayant trait à des raisons morales, ne saurait être établie dans le calcul économique : il n'existe pas de cassure entre comporte-ments, de classes, normaux/anormaux, valeurs normales ou occasionnelles. L'axiome de continuité du calcul microéconomique a l'immense avantage pratique de permettre le passage entre une axiomatique des préférences et une analyse différentielle des utilités.
La prise en compte de la « nature » de l’homme s’effectue en théorie économique, en intégrant quelques hypothèses de morale (hédonisme, utilitarisme, bienveillance) et de rationalité. Mais le débat ne devient intéressant que sur le type de socialisation : interindividualité, interaction, coopération. Dès lors les lieux correspondants (ménage, entreprise, cité, marché, gouvernement) sont objets d’analyse plus que l'homme lui-même. Il est alors question du « ménage social » (Myrdal), de la « catallaxie » (Von Mises et Hayek), de l'intergénérationnel, bref d'une théorie de la condition humaine (Arendt, 1958), ou de l'action humaine (Von Mises, 1949).
L'anthropologie économique et la théorie économique : l’homme conditionné de l'interaction sociale
Saint Augustin pose, le premier selon H. Arendt, la question anthropologique en philosophie, en distinguant deux questions à propos de l'homme, « qui suis-je ? », et « que suis-je ? ». Questionner la nature humaine consiste à dégager notre nature de tous les objets qui nous entourent. Cette question anthropologique, « qui suis-je » se pose, selon Arendt, en face de Dieu. Si une partie de moi-même m'échappe, je ne puis la poser qu'en présence de Dieu. Cette question échappe donc à l'anthropologie économique et relève plutôt de la métaphysique. La question « que suis-je ? » a trait à la condition humaine, en particulier de l'homme dans son ménage social (Myrdal), et plus généralement de ses activités. Si Arendt distingue dans la « vita activa », le travail, l'oeuvre et l'action, Von Mises, de manière radicalement différente, replace les actions dans la catallaxie.
La condition de l'homme ou du ménage « social » conduit à un paradoxe apparent : au plus l’homme est déterminé, au plus il devient important de passer par son mode d'internalisation pour éclairer et comprendre le jeu individuel ; l'individualisme n'est alors qu'une méthode permettant de mieux comprendre les capacités de l'homme face à ses multiples contraintes sociales. Ce pouvoir sur les contraintes et cette capacité à accommoder les déterminismes, échappent le plus souvent à la technique. Afin de mieux connaître le comportement des hommes, les données statistiques peuvent désormais être saisies, contrôlées, apurées, traitées et analysées avec des procédés informatiques extraordinairement performants. Au lieu de plusieurs années, quelques heures suffisent dans la réalisation de ces opérations. Mais la base anthropologique de ces enquêtes est toujours aussi faible. Les effets anthropologiques les plus élémentaires rendent les questions peu pertinentes et les réponses inadaptées : effets d'appellation, de mémoire, équivocité des unités de temps et de lieu. Les questionnaires sont ainsi d'autant plus vagues que leurs traitements sont puissants. La chance pour l'homme d'échapper à la mise en cartes et en formules toutes faites est d'autant plus forte. Ainsi, selon E.Malinvaud (1991) « l'observation des modes de décision révèle que la difficulté d'informations pertinentes a plus d'importance que la difficulté de ce calcul »
Les lieux privilégiés de l'anthropologie économique
L'anthropologie économique pourrait se situer dans les lieux historiques privilégiés de l'expression économique humaine : le ménage, la société sous-développée.
Quelle est la pratique économique du ménage ? Gunnar Myrdal (1953) pose la question :
« Que signifie une économie sociale dont la fonction est le ménage social ? En premier lieu, cela implique ou suggère une analogie entre l'individu qui gère ses biens ou ceux de sa famille et sa société. Adam Smith et J.S. Mill ont effectué explicitement cette analogie ».
Mais, cette conception a été souvent battue en brèche par des philosophies de l'histoire. L'individu serait envahi par la modernité et son foyer (oikos) exposé à la face publique. Ainsi de nombreux travaux de l'après-guerre (Herbert Marcuse, Hannah Arendt) ont développé l’idée de l'homme écrasé par la société de production, de l'œuvre par le travail, sinon « obscène » de Baudrillard ; à l'image des télés ou talk shows où chacun (cf. l’affaire Clinton) vient exhiber son intimité. A cette prophétie de la modernité, assimilée à la socialisation du privé répond l'idée du « privé de plus en plus privé » (Simmel) ou encore l'idée que le privé a toujours été privé (Hayek, 1960 ; en référence à Sapir sur l'universalité de la propriété).
Mais, public ou secret, le ménage
n'est pas le seul lieu d'interaction sociale, pouvant intéresser l'anthropologie
économique. L'importance des calculs intergénérationnels
en situation de crise conduit à revenir aux familles élargies,
et à évoquer les dynasties. Il existe des lieux d'interaction
fonctionnels (entreprises, administrations, clubs sportifs, etc.) et des modes
de décision (marché, vote, plan). Il en est de ces lieux comme
des sociétés, ils peuvent être envisagés globalement
par leurs résultats agrégés et/ou comme autant de nœuds
de contrats et de conflits permettant de connaître la condition humaine.
Ainsi des stratégies de don/contre-don dans la relation entrepreneuriale
ou dans la politique (le « logrolling » par exemple) permettent
de mieux connaître la condition humaine. Des effets de miroir ou des complémentarités
peuvent être recherchés. Ainsi quand les économistes (Becker)
s'intéressent à l'enfant gâté, ils ont tout intérêt
à enrichir leurs hypothèses (tout en gardant leur méthode)
sur d'autres points de vue anthropologiques : recherches de renommée,
soif de puissance etc., afin de mieux connaître la nature du couple égoïsme/altruisme.
Le terrain d'excellence de l'anthropologie est d'autant plus la «
société primitive » que la connaissance de l'homme est assimilée
à l’ethnologie. Sans compter les rapports difficiles entre les
tendances de l'ethnologie et l'analyse économique (voir infra.), l'économie
considère plutôt depuis l'après-guerre non l'économie
primitive, mais des « économies en voie de développement
». Effectivement, pendant cette période, la «
caste inférieure » (Bardhan, 1993) des économistes
du développement, a fourni aux économistes, nombre d'outils anthropologiques
; tel le don/contre-don en économie du travail (Akerlof, Stiglitz, etc.)
provoquant une modification fondamentale de l'analyse du chômage. Mais,
réciproquement, l'économie du développement, ne constitue
plus l'« exception » anthropologique à la rationalité
économique, cette dernière pouvant être conçue comme
une simple adaptation aux contraintes ou comme une hyper rationalité
(par exemple, l'anticipation rationnelle par les planteurs de la période
de soudure). Il n'est plus pensable de considérer que les
« sous-développés», à la manière de
la « classe en soi » des prolétaires sont en deçà
de la rationalité ou du « seuil de conscience » et qu'il
appartient à une avant-garde d'experts ou de politiciens de leur apporter
une prise de conscience. De ce fait, la connaissance de l'homme sous l'angle
économique s'effectue dans toutes les sociétés sans que
le niveau de développement soit en cause. L'hypothèse de rationalité
minimale (universelle) ne suffit pas, les personnes ainsi considérées
ont une dimension éco-nomique qui les amène à coopérer
dans leur société, en vue de leur avantage mutuel.
.3. L'anthropologie économique face aux conflits de méthode
La question anthropologique ne peut être enfermée dans les conflits méthodologiques : inductivisme/déductivisme, holisme/individualisme, ou encore réalisme comparatif/ méthode hypothétique. Elle n’appartient pas non plus à une discipline particulière (médecine, psychologie, sociologie ou ethnologie). En économie, la question anthropologique (qu'est-ce que l'homme ?) est traitée de façon hypothétique par de nombreuses théories, princi-palement microéconomiques. Il en est de même pour l'éthique économique (Sen, Harsanyi) (que devient son comportement économique s'il est moral ?). Cette problématique reste très minoritaire et s'oppose aux théories économiques a-anthropologiques (macroéco-nomies matérielles, agrégatives, holistes, systémiques, etc.). On traitera donc de l'opposition historique entre l'anthropologie et l'économie, des termes contemporains de cette opposition, et enfin de ce qu'est pragmatiquement l'anthropologie économique, en particulier au sein des théories économiques de l'interindividuel et de l'interaction sociale.
Conséquences méthodologiques
Le point de vue anthropologique en économie traite des
mœurs de l'homme économique dans son universalité et son
altérité. Ce caractère associatif de l'anthropologie amène
à dissoudre un certain nombre de conflits de méthode, constitutifs
des sciences sociales : holisme/ individualisme, évolution historique/récurrence
ethno-centrique.
Tel est le vieux conflit entre holisme et individualisme. Le point
de vue anthropologique postule l'individu et son autonomie (dans l'universalité)
dans sa capacité à créer le social (même inconsciemment)
et à en adapter les contraintes. L'homme est le point de passage obligé
des normes, fussent-elles l'expression de contraintes sociales très fortes.
L'anthropologie étudie comment l'homme internalise les normes, l'individu
permettant d'analyser par son réseau sociétal (cf. infra les cartes
individuelles de droits et obligations), les normes sociales. L'anthropologie
n'oppose pas l'individu au social ; l'individualisme méthodologique consiste
à utiliser l'individu comme représentation des contraintes sociales.
L’universalité ne constitue pas un point de vue ethnocentrique, mais
la fatalité qui préside à une lecture récurrente
à partir des progrès de la raison. L'ethnocentrisme peut s'introduire
dans les internalisations et les déviations ; par exemple, on peut
estimer que les relations familiales sont de même nature en Afrique et
en Amérique du Nord. L’effet de miroir joue dans l 'espace, mais aussi
dans le temps. L'histoire nous apprend ainsi qu'il existe des universaux dans
le comportement économique passé et des modalités spécifiques
dans leur adaptation. Les modalités spécifiques d'échange
(Potlatch, Kula), de destruction (Bilabia), les facilités de certaines
zones d'abondance (M.Sahlins) permettent de mieux comprendre l'adaptation des
principes généraux de la maximisation sous contrainte. Le don,
la consommation ostentatoire, la destruction du surplus ont des finalités
politiques et culturelles que nous devons comprendre.
L'anthropologie étudie ainsi l'homme dans son universalité et
son altérité ; « économique », elle met en
relation ces caractéristiques avec la pragmatique économique,
les actes économiques quotidiens. Ces actes sont donc normatifs ; la
tâche des outils économiques, dans cette perspective, consiste
donc à mettre en valeur l'universalité et l'altérité.
Qu'est-ce que l'homme ? Statut de l'individualisme méthodologique
La question de l'homme économique est inévitable.
L'épouvantail de l'homo oeconomicus l'a reléguée
au rayon des abstractions dangereuses. Or cette question est première.
L'homme est capable de réfléchir et l'expression de ses préférences
en théorie économique fait appel à sa totalité.
Comment dénoncer à la fois le réductivisme économique
de l'homo oeconomicus et l’application élargie de l'économique
à tous les compartiments de la vie sociale ?
En sciences sociales, il est courant d'opposer (Birnbaum et Leca, 1986), le
social à l'individuel, le nominalisme (Tarde) au réalisme social
(Dürkheim). Le problème devient aisément un débat
sur la genèse du social, atomisme contre moléculaire, ou
de la réduction du tout aux éléments (cf. le débat
autour de la « Gelstat » théorie). Ce débat sur la
méthode d'appréhension du social a été systématisé
par Maurice Godelier dans Rationalité et irrationalité
en économie en opposant l'homo oeconomicus à la totalité
socio-historique comme point de départ de l'analyse de la société.
En économie, ce débat porte fondamentalement sur le no bridge
entre la micro et la macroéconomie, entre la problématique de
l'équilibre général (Walras) et celle de l'équilibre
global (Keynes). Un débat sur les fondements microéconomiques
de la macroéconomie a été introduit en 1965 (Clower, Leijhonhufvud),
sur la capacité à faire de Keynes un cas particulier de Walras.
Ce débat entre micro et macroéconomie, ou d'une certaine façon
entre structure et individu est dépassé par la dimension anthropologique.
Dans ce cadre, il n'est pas question de contester l'existence de l'Autre ou
encore les normes sociales qui s'ensuivent, mais d'affiner l'analyse en examinant
avec soin comment chacun, en fonction de l'Autre, internalise le
social, les droits et les obligations qui en résultent.
Il est donc nécessaire de saisir comment chaque
homme se représente le social sous une forme qui lui est propre, spécifique,
tout en étant traitée par une méthode universelle. Telle
est la méthode de représentation des normes qui est proposée
au chapitre V, en montrant des cas de configuration strictement individuelle
(personne ne peut avoir le même schéma d'allocation du temps, le
même réseau de sociabilité), etc.
Fondements microéconomiques des déséquilibres macroéconomiques
Dans le domaine de la compréhension économique, l'anthropologie économique est un point de vue particulier qui ne saurait se substituer à celui, par exemple, de la macroéconomie, particulièrement dans le domaine du développement. L’anthropologie permet de relativiser le point de vue universel en tenant compte des altérités.
L'anthropologie économique internalise les contraintes macroéconomiques au niveau des personnes et externalise les déformations individuelles au niveau d'une entité méso ou macroéconomique : marché, communauté, secteur, branche sinon agrégat. Néanmoins, cette interrelation a été évacuée sur la base d'un postulat de no bridge entre les deux domaines, d'une macroéconomie a-anthropologique ou encore d'une microéconomie standard. Les déséquilibres macroéconomiques sont posés le plus souvent « par hélicoptère », par exemple on fait l'hypothèse d'un « mark up » des entreprises. Or ils se trouvent dans les relations interpersonnelles elles-mêmes, relations esquivées au nom d'une prétendue « boite noire ». La condition humaine est au centre de l'analyse économique, question esquivée par la macroéconomie. En fait, derrière les agrégats, il est possible de rentrer dans la boîte noire des personnes et des relations interpersonnelles ; cette remontée dans la chaîne des causes aboutit à faire des hypothèses sur les contraintes personnelles et les déséquilibres originels.
Les institutions, les organisations, les communautés
et autres formes sociales sont des unités pertinentes d'observation des
agents économiques et de leur interaction. Ainsi le ménage, l'entreprise,
le gouvernement, ne sont pas seulement des unités « écrans
», dont on relève les performances sans interrogation sur leurs
modes d'obtention. Ils sont des lieux de contrat ou de conflit, de lutte ou
de coopération. Les circonstances et les processus économiques
au sein de ces institutions forment l'objet d'une anthropologie économique
particulièrement adaptée aux outils de la microéconomie
: analyse marginale, axiomatique des choix, théorie stratégique.
Une anthropologie économique qui prétendrait rejeter les outils
de la microéconomie, se priverait de la possibilité d'étudier
les principaux problèmes économiques ayant trait à l'homme,
notamment ses choix sous contrainte dans le contexte de sa personnalité.
A l'inverse quand la microéconomie refuse la personne pour la réduire
à un individu standard, elle évite la question anthropologique.
Sur des bases anthropologiques (Mauss, Geertz), de nombreux domaines de la réflexion économique ont été bouleversés par la prise en compte des relations interpersonnelles. Ainsi les relations de travail dans les entreprises depuis Akerlof (1970) sont analysées derrière un contrat informel comme des marchandages implicites de don/contre-don. De la même manière, derrière les gouvernements, les analyses économiques ont souligné des comportements analogues de « logrolling », « rent-seeking », et de corruption, des clientélismes et des paternalismes en tous genres. L'exemple le plus récent est celui des ménages et des stratégies interindividuelles menées par leurs membres face aux contraintes économiques, notamment le jeu sur les cartes du « tendre » (les transferts) et la carte du « temps » (les activités).
Dans tous les cas, les transferts entre vivants
(20 % du PIB aux Etats-Unis, plus de 100 % du revenu pour certains fonctionnaires
dans le Tiers-Monde) perturbent les agents économiques. Leur
environnement social les oblige à contraindre leurs actes économiques
les plus élémentaires: production, consommation, épargne,
investissement, etc. Ils doivent ainsi arbitrer entre les perturbations
« égoïstes » causées par le report temporel de
leurs jouissances et les perturbations « altruistes » occasionnées
aux obligés par leur jouissance immédiate, et trouver un taux
d'épargne d’équilibre individuel. Ce type de calcul dépend
de la force des relations de sociabilité et d’éléments
affectifs difficilement chiffrables. Ces éléments composent pour
chaque individu une carte individuelle de sociabilité, faite d’obligations
réciproques et sur lequel s'effectue un choix stratégique. Les
contraintes de revenu et de temps obligent à choisir, à dissimuler
ou à exagérer. Toute atteinte de l'équilibre individuel
par la politique économique ou autre événement exogène
est immédiatement intégrée par les individus qui réagissent.
Le sens de cette réaction peut être par exemple une préservation
« pied à pied » des transferts effectués à
certaines personnes de la carte de sociabilité. La quantification et
la compréhension de ces transferts, la plupart « informels »
reste un problème majeur. En moyenne 10 à 20 % de l'utilisation
du revenu échappent ainsi à la volonté du politique !
La carte du « tendre » n'est pas la seule possibilité stratégique,
la personnalité s'exerce dans un choix sur le temps. Les nombreuses découvertes
sur la production informelle (dans la plupart des cas, une pluriactivité),
aggravent les difficultés de la politique économique. Cette fois,
la production-consommation, un marché et des revenus échappent
à l’enregistrement statistique.
Cette réaction s'effectue sur la carte individuelle du temps. La marge
de liberté qui existe sur la carte individuelle du temps est importante
dans certaines situations, notamment en milieu rural et les économies
informelles représentent une part importante de l'économie nationale.
La carte du temps est particulièrement flexible dans un cadre informel et permet une remarquable réaction à toute contrainte, et notamment à la politique économique. Dans quelle mesure la réduction du temps de travail, par exemple dans le bâtiment, se traduira-t-elle par une augmentation du travail informel ? A l'inverse, si l'on considère que l'emploi du temps de tout homme est saturé, il est difficile de savoir quelle sera sa réaction à une contrainte supplémentaire sur son allocation de temps.
Transferts et pluriactivité se croisent
et peuvent se compléter. Face à ses contraintes économiques,
tout individu a cette marge de manœuvre, utiliser son entourage et/ou employer
le temps dont il dispose. Si l'Etat accorde des subventions importantes aux
citoyens, l'utilisation des autres stratégies (revenu formel, transferts
informels, pluriactivité) deviendra moins pressante. Ainsi, la
relation entre stratégies informelles (transferts, pluriactivité)
et stratégies formelles (revenu individuel formel, transferts étatiques)
délimite la dotation (les possibilités) qu'une personne utilise
face à ses contraintes. En considérant que cette dotation correspond
à un minimum vital donné, toute diminution d'une de ses composantes
(subvention étatique par exemple) se traduit, sauf disparition, par l'augmentation
des autres possibilités de revenu (transferts privés, revenu individuel,
pluriactivité informelle). Mais la forme de cette recomposition ne se
laisse pas prévoir mécaniquement au nom de la liberté relative
des personnes. L'édifice est d'autant plus fragile que la situation est
misérable.
Anthropologie et éthique économiques
Vers une définition de l’anthropologie économique
La nature de l'homme suscite de nombreuses discussions théoriques dans l’économie politique depuis le XVIIe siècle. Le mot anthropologie appartient au vocabulaire de l'anatomie et a pour objet, le corps humain. « C'est l'art que plusieurs appellent l'anthropologie » (Diderot, Encyclopédie, « Anatomie »). Cette anatomie humaine est caractéristique de l’œuvre de William Petty, par exemple de son Anatomie politique de l'Irlande (1672) ; fondateur de l'économie politique, il s'interroge sur l'échelle des créatures depuis les animaux jusqu’à Dieu, en passant par les Irlandais. L'anthropologie économique a trait crûment à la valeur de l'homme, à la rente capitalisée de son activité durant sa vie! Cette tradition de l'anatomie humaine, propre aux médecins spéculatifs, sera abandonnée dès les physiocrates au profit de l'ordre naturel et des catégories macroéconomiques. Rousseau, dont la philosophie sur l'ordre naturel diverge du conservatisme des physiocrates, énonce dans l' Essai sur l'origine des langues (Ch. VIII), une règle de méthode constitutive de l’anthropologie :
« Quand on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi ; mais pour étudier l'homme, il faut apprendre à porter sa vue au loin ; il faut d'abord observer les différences pour découvrir les propriétés. » La question anthropologique dans la théorie économique contemporaine
Dans la théorie économique contemporaine, ce pari joue sur les hypothèses de la microéconomie et sur l'insertion (tant risquée) de variables de comportement dans les modèles de la macroéconomie. Pari souvent perdu, car l'homme est indifférent, surréagit ou résiste aux politiques économiques. Le comportement économique est une source inépuisable de critique et de dépassement de la science économique, tant les hypothèses qu'elle peut formuler sur le comportement individuel, les situations interindividuelles, et les interactions sociales sont infinies.
Quand la théorie économique s'appuie sur les comportements de l'homme (résistances, anticipations, surréactions, etc.) afin de critiquer ses concepts et ses lois, elle manifeste alors toute sa dimension anthropologique et fonde une pensée « classique » . Elle pourrait inclure aussi bien la nouvelle microéconomie (Lancaster, Becker), la théorie normative du « social choice » (avec ses théorèmes d’impossibilité), la théorie positive du « public choice » (et ses paradoxes) ou encore s'incarner dans la longue liste des théorèmes d'inefficacité de Barro, Lucas et les autres.
Par définition, l’anthropologie économique
traite de la question « qu'est-ce que l'homme ? » du point de vue
de la théorie économique. La dimension anthropologique est
ancienne, se confondant avec les origines de la philosophie , le questionnement
économique est récent, à la mesure d'une discipline qui
n'a que deux siècles. Un de ses domaines privilégiés correspond
à la théorie du développement, non comme analyse comparative
et relativiste, mais comme recherche à travers les altérités,
d'un homme économique universel . Par le biais de la recherche microéconomique
et la compréhension du social en terme de rationalité économique,
le comportement économique est sous l'influence de l'individu et du social.
Ainsi la microéconomie prend sa dimension anthropo-logique quand elle
étudie l’autre homme dans son universalité et sa façon
propre d'appliquer les normes. De ce fait, l’anthropologie économique
recherche des universalités et les diverses altérations que chaque
personne leur apportera en fonction de son origine ethnique, linguistique, sa
communauté et le système de droits et obligations qui en découle,
tout en confrontant pragmatiquement cette question aux théories éco-nomiques.
La réhabilitation de l'homme passe par sa considération comme
personne et non plus comme individu. En quoi est-il différent de l'animal
? L'homme est autonome et exprime sa volonté. Il retrouve ainsi des règles
universelles qu'il fait siennes. Le problème de l'origine des règles
est alors évacué du débat pour se demander en quoi cet
édifice de règles est cohérent. Ce type d'approche caractérise
les premières problématiques de l'axiomatique des choix collectifs
(Arrow, Sen). Il trouve son prolongement dans une conception de la responsabilité
et plus généralement des théories économiques de
la personne. Néanmoins ce courant de pensée trouve difficilement
sa place entre les perspectives évolu-tionnaires et le courant hyper
libéral. D'autre part de nombreux courants de la théorie économique
développent cette complexité de l'homme et en même temps
sa rationalité substantielle.
Cette complexité tient par exemple dans la capacité de l'homme à réagir aux signaux, qu'il soit le paysan misérable face aux périodes de soudure ou le golden boy des places financières. Cette capacité se transforme en anticipations qui détruisent l'effet de surprise de la politique économique. La relation de pouvoir du politicien et des experts (les deux étant associés) par rapport à l'agent économique est contrariée par les capacités rationnelles d'agents qui ne sont plus des objets systématiquement obéissants. Dès lors la politique économique n'a plus l'efficacité escomptée sur les individus/supports d'agrégats. Il faut pour cela connaître les modes d'internalisation des signaux et des normes par les hommes. L'économie est alors phénoménologique.
Une autre façon d'envisager la complexité de l'homme tient dans un dédoublement de sa personne. Il est par exemple à la fois égoïste et altruiste, contraint et libre, raisonnable (épris de justice) et rationnel (à la recherche du « bien »). Il peut encore être une sorte d'agent voyageur, visitant successivement la communauté familiale, l’institution du travail, le marché concurrentiel. Le sens de la visite peut être déterminé par des règles, ou mieux une priorité morale. Néanmoins, cette priorité peut très bien ne pas être posée : l'homme peut considérer indifféremment les doses d’utilité tirées des biens (son camembert) et des personnes (sa grand-mère). Il peut encore être alternativement égoïste et altruiste à la façon de l'enfant « gâté-pourri », qui simule l'altruisme afin de maximiser ses gains égoïstes. En conséquence, la politique économique est floue. Elle croit par exemple frapper dans un pays en développement l'urbain riche, mais oublie que celui-ci supporte ses obligés ruraux. Elle oppose les rentiers dans une économie développée (le rapport Minc en France) aux chômeurs sans voir les solidarités intergénérationnelles.
La réflexion économique sur la condition
humaine n'établit pas le passage de l'homme de l'état de
nature à celui de la liberté. L'homme hétéronome,
en état de nature ou dans un ordre spontané, subit la liberté
; il n'a pas exercé sa libre volonté et recherché des lois
universelles. L'homme libre, exprimant sa volonté, ne subit pas la liberté
et ne la fait pas subir aux autres, sans avoir réfléchi à
ses conséquences du point de vue du souverain Bien.
Définition de l’anthropologie économique
Ainsi l'anthropologie économique sera définie comme une reconstruction hypothétique de la personne, dans le cadre de la théorie économique. Cette définition appelle de nombreux commentaires sur le fait que la personne repose sur l'anthropologie philosophique alors que cette prise en compte est limitée en économie par l'état de ses connaissances. Dit autrement (et de façon plus brutale), l'anthropologie économique est le sous-ensemble de l'anthropologie philosophique et de l'anthropologie des économistes.
Il est hors de question de prétendre à une personne totale et réelle. S'il est évident que la personne est un fait total, seuls les aspects pouvant rentrer dans le champ de la méthode et de la théorie économique seront pris en compte. La méthode économique est hypothétique, elle peut faire des hypothèses sur les actes substantiellement économiques (production, consommation, échange) et plus largement, compte tenu de sa méthode, sur les autres aspects (domestiques, politiques, culturels, ludiques, etc.) de la personne. Cette construction peut ainsi être très large mais elle ne prétendra pas à la totalité, encore moins à la réalité. Cette personne ainsi analysée est hypothétique (soumise à des hypothèses préalables) et ne saurait être réelle. De ce fait, la prospective est très limitée dans ce domaine et se heurte à un renouvellement permanent du comportement et donc des hypothèses. Mais cette complexité ne saurait être assimilée à un ordre spontané « réel ». Toute prétention à la totalité et à la dynamique d'une personne « réelle » serait extrêmement normative (l'ordre libéral par exemple) tant elle serait rapidement démentie par les faits. Si la personne est hypothétique, il existe de nombreux indices (anthropologiques) qui permettent au moins d'infirmer les théories. L’anthropologie économique a besoin d'enquêtes, de relevés, de recensements, mais aussi de collections de faits sur les hommes, leurs capacités et leurs opinions. Mais là encore l'induction (déduire des collections de faits des lois probabilisables) est un exercice périlleux qui ne saurait justifier un ordre ou une idéologie.
On réalise donc ici une analyse compréhensive, une « utopie économique » de la personne en développant un certain nombre d'hypothèses et outils de méthode propres à la science économique. Ce regard particulier sur la personne (partiel et hypothétique) diverge de toute conception réaliste ou prétendant à une « personne totale », dont la complexité réelle serait mise en évidence. Cet aspect partiel a pour but de montrer les libertés qui résultent des choix de la personne, bref un contexte personnaliste de liberté, lequel peut être envisagé avec toutes formes de société, même les plus exclusives, avec les contraintes les plus fortes sur la liberté politique ou économique. Cette hypothèse « libérale » n'a que faire d'un libéralisme qui imposerait une idéologie libérale. On peut néanmoins faire l'hypothèse d'une « personne » qui gère ses contraintes avec un espace de liberté. Les conséquences de cette liberté limitée (jouant sur l'environnement social) peuvent être par exemple les transferts (l’épargne n'étant qu'une « fuite » non contrôlée, résultante de l'intergénérationnel et de l'intertemporel, de l'égoïsme et de l'altruisme), et les activités parallèles ou pluriactivité, dont la plupart sont informelles et représentent une fuite hors de la production formelle. Cette liberté est capable de s’opposer et de déjouer les plans libéraux des experts.
Il est question d'un homme contemporain au nom du principe historique de récurrence : à l'aide des considé-rations anthropologiques de la philosophie et de la théorie économique, on traite ici d'une personne sous l'angle économique. Ces considérations sont renforcées par des effets de miroir d'une société à une autre, en particulier les altérités que l'on trouve dans les travaux de terrain. Cette conception de l'homme contemporain tente de rester « neutre » du point de vue de la philosophie de l'histoire. Il est hors de question de vouloir argumenter sur une amélioration ou une détérioration de la personne et de la société au cours du temps.
Anthropologie économique ou économie anthropologique ?
La question de l'homme est première en économie, aussi bien dans ses références antiques à l'oikos que dans le principe contemporain de l’optimum. L'argument essentiel tient cependant dans le fait que les règles de l'anthropologie économique sont données par la philosophie, en particulier la façon de considérer son objet, l'homme. La double référence à l'universalité et à l’altérité caractérise l'anthropologie économique. Elle implique au préalable un choix sur le type d'anthropologie. Une économie anthropologique ne fait qu'intégrer une dimension humaine à une question économique préalable. Par exemple, en quoi le déséquilibre macroéconomique pourrait trouver une compréhension complémentaire dans les comportements de « donnant/donnant » que l'on trouve initialement sur des marchés d'économies parallèles, sous-développées ; à l’inverse quelle priorité lexicographique d’ordre moral fonde, dans certains contextes, le désé-quilibre permanent entre donateurs et bénéficiaires. Réciproquement, une dimension anthropologique peut être reconstruite à partir de la microéconomie, en complétant le comportement d'un individu vis à vis des biens par la prise en compte des autres, en lui accordant la stature d'une personne responsable. Les concepts « desséchés » d' individu ou d' agent économique laisseraient ainsi la place à ceux d’homme ou de personne en admettant que la fonction d'utilité comporte non seulement des arguments matériels, mais aussi des arguments humains (les autres).
. A la recherche d'une éthique par l’anthropologie économique
L'éthique peut être conçue comme une recherche de la vie bonne (Aristote) ou comme une science de la morale (Kelsen). Elle implique le respect de la préférence de chacun pour la vie bonne. Les problèmes éthiques peuvent être posés dans un cadre axiomatique ou dans un cadre évolutionnaire : normes a priori ou a posteriori ?
Quelle priorité ?
Si l'éthique est prioritaire dans le rapport social, le calcul
économique se modifie profondément. Il est question d'une priorité
lexicographique (Rawls dans une optique macrosociétale) ou d'une priorité
de l'autre dans la relation micro sociale établie par chaque homme avec
son prochain (Levinas). A ce stade, les exigences éthiques dépassent
le simple rappel préalable à l'application du calcul écono-mique
; le problème devient celui de rapports éthiques préalables
fondés sur la responsabilité vis à vis d'autrui.
Ces rapports éthiques sont faits de normes (obligation, interdiction,
permission) qui déterminent nos actes économiques
élémentaires et font de notre calcul économique égoïste
un élément résiduel sinon utopique. Nos actes ont ainsi
trait à autrui (dans toute sa subjectivité, ce qui nous éloigne
du totalisme socio-historique), aux tiers (dans la nécessité de
justice). Dans le temps nos actes se situent dans un réseau de droits
et obligations, dont l'orientation est anthropologique ; une application diffé-renciée
des lois morales universelles selon les sociétés. L'intégration
de l'éthique à l'économie est ainsi à ce prix :
intégrer dans les concepts les plus intimes de la science économique
(utilité, production, consommation, accumu-lation) les conséquences
de l'intervention de l'Autre ou plus généralement de la «
communauté ».
La question anthropologique est aussi la question du droit de l'homme en tant
que demandeur de protection sociale à apprécier la politique économique
qui lui est offerte. Ce droit a trait à l’expression des préférences
et à la préservation des situations d'équilibre qu'il obtient,
compte tenu de ses caractéristiques. Ce droit est largement compromis,
soit parce que l'Etat détermine uni-latéralement une fonction
objectif de bien-être social, au nom du « service public
», soit parce qu'une tutelle internationale considère
qu'elle a un droit d'ingérence économique sur les pays en difficulté.
Ainsi, le problème de la reconnaissance de l'homme reste entier dans
la production de l'information et dans la politique économique. Cette
reconnaissance est celle d'un agent à part entière du développement
économique de la société. Il est « capable »
de s'exprimer, de réagir, de s'adapter aux contraintes et cette capacité
est universelle. La reconnaissance de l'universalité de l'individu est
loin d'être réglée par le fait de disposer d'une science
économique, capable de conventions théoriques abstraites. En effet,
il reste à admettre que la rationalité n'est pas réservée
à une élite et ne se répartit pas, à la manière
des premiers économistes ou de l' « économie animale »
de Buffon, sur une échelle de dignité décroissante
des créatures. Le domaine du développement
révèle le plus manifestement les traces de la
discrimination humaine. Le « sous-développé »
est réputé « incapable » de rationalité économique,
que ce soit pour le technocrate surévaluant ses propres outils,
ou pour le tiers-mondiste pour qui cette rationalité
est le propre de sociétés du Nord et ne saurait être
« plaquée » sur les sociétés du Sud.
L'anthropologie des normes ayant trait aux mœurs économiques
.
L'anthropologie économique a trait aux mœurs économiques de l'homme.
Ces mœurs procèdent de normes universelles (de l'homme autonome) et de
normes différentielles (de l'homme hétéronome, dans ses
passions et sa socialité). La science économique accumule, dans
sa diversité, les réponses à la question « qu'est-ce
que l'homme économique? » et fournit un certain nombre d'outils
puissants. Quand la science économique ne traite que d'un aspect, privilégiant
soit l'universalité, soit l'altérité, en les dissociant,
elle s'éloigne du point de vue anthropologique. Elle s'en éloigne
d'autant plus qu'elle nie l'homme en ne voyant que les relations matérielles,
entre marchandises par exemple, ou entre agrégats et variables globales.
L'anthropologie n'est pas nécessaire pour constituer une science
économique déductive. Elle est, par contre, indispensable à
l'induction et à la prévision des faits. Soit l'économie
politique est déductive et, dans ce cadre, l'homme n'est que présupposé
; dans le système de Sraffa ou l'axiomatique de Debreu, il n'est
pas question d'introduire des actions et des rétroactions. La logique
déductive est fatalement a-anthropologique et ceci ne peut lui être
reproché ; le but de cette analyse consiste à résoudre
des problèmes conventionnels, ayant trait notamment à la valeur.
Soit elle est inductive et dès lors, l'absence de point de vue anthropologique
pose des problèmes car cela signifie que des prévisions pourraient
être effectuées en l'absence de toute réaction humaine ;
on ne connaît que trop les problèmes inhérents aux hommes
: conflits militaires, politiques, sociaux. A priori la microéconomie
traite de l'individu ; elle traite de l'homme quand elle restitue le couple
universalité/altérité ; elle est donc là aussi non
seulement pour rechercher des régularités, mais aussi les effets
pervers (Boudon, Hirschman), les inanités, les mises en péril.
Le marché par simple assemblage d'une demande et d'une offre ne saurait
épuiser les possibilités d’ une microéconomie dont les
possibilités sont beaucoup plus vastes, tant le calcul économique
déborde la simple relation marchande.
L’anthropologie induit-elle le libéralisme ?
En de nombreux aspects, l'anthropologie appelle au libéralisme. Elle
peut invoquer la complexité de l'homme et l'imprévisibilité
de ses actions pour rejeter toute norme a priori. Peut-on alors en déduire
qu'il faut laisser l'homme en état de nature et ne juger qu'après
coup de la valeur morale de ses actes ?
La priorité à la liberté
ne saurait se confondre avec l'autonomie. Il existe un risque de liberté
« totalitaire » (les meilleurs idéaux sont en permanence
au service du fonds totalitaire de l'homme). Le détournement totalitaire
de la liberté serait que les conséquences de la liberté
première sur la privation d'autonomie des citoyens, soient encore plus
grandes que les conséquences de l'affirmation première de la morale,
fut-elle défendue par un Léviathan.
Le fait de se centrer sur le respect de l'homme n'appelle pas au
libéralisme absolu. L'homme est-il capable d’envisager les conséquences
de ses actes ? La liberté doit avoir un coût permettant de
probabiliser les conséquences de ses actes sur d'autres personnes directement
ou indirectement. La liberté, selon Stuart-Mill, concerne des personnes
mûres capables de prévoir les conséquences de leurs actes.
Or, même dans ce cas, les personnes ne sont pas à même d'envisager
les externalités de leurs actions. « Responsable, mais non coupable
» : comment réparer ensuite les erreurs du responsable qui laisse
passer des sévices irréparables ? Il n'existe aucune réparation
monétaire à un certain nombre de sévices. L'enfermement
ou l’exécution du responsable sont de piètres « compensations
» pour les sévices endurés par une victime innocente. Des
compensations sont impossibles pour des problèmes interindividuels, elles
n'ont pas de sens non plus pour les générations futures.
La réparation par marchandage d'une compensation dans une société
fortement juridique souffre en plus du problème de l'inégalité
de l’accès au droit. Le droit rentre dans un système économique
inégal. Dans de nombreux pays, le juge s'achète et s'il
ne s'achète pas, alors la capacité à l'influencer par le
louage des meilleurs avocats jouera un rôle déterminant. La liberté
ne peut justifier le marché. En effet il faudrait prouver que l'on peut
estimer les externalités négatives qu'il provoque non seulement
directement sur ses participants, mais indirectement soit dans la chaîne
des responsabilités, soit sur des générations futures.
La complexité de l'homme et des édifices
interindividuels ne saurait être l'argument pour une forme d'organisation
(le marché décrété par un parti politique ou un
gouvernement), dont les conséquences du fait de cette même complexité
sont incalculables et irréversibles.
Certes il existe des irréversibilités écologiques,
mais on oublie trop l'irréversibilité dans une organisation présente.
Pour paraphraser Adam Smith, mon intérêt dépend de l’égoïsme
de mon boucher, mais il est évident que, si la recherche du profit amène
à contaminer tous les acheteurs de viande par la maladie de Creutzfeld-Jakob,
le marché sanctionnera mon boucher par une chute de ses ventes. Mais
les morts des premiers moments ne reviendront pas et aucune compensation est
à même de réparer les torts encourus. Il n'existe aucune
réparation au crime fût-il économique. D'où des normes
et sanctions a priori qui permettent d'éviter l'irréparable. Il
existe ainsi de nombreuses situations où en forte asymétrie d'information,
le prix de la liberté, la responsabilité sur d'autres, ne sont
pas établis. La liberté doit alors être limitée en
conséquence par des règles prudentielles.
On devine tout le fatalisme du monde développé devant l'égocentrisme ethnique de nombreux pays sous-développés et l'idée que de l'ethnocide surgira forcément un ordre politique. Derrière l'anthropologie que nous avons définie, au-delà de l'économie, se cache le problème de l'équilibre entre l'universalité et l'altérité et de la forme (bienveillante ou malveillante) du résultat. L'universalité est-elle supérieure à une souveraineté? Le droit d'ingérence tente de répondre à ce problème. L'ingérence humanitaire y répond positivement et justifie les engagements contre l'inhumanité. Rien n'est moins sûr en économie. L'ingérence dans les choix les plus intimes des « sous-développés » est au contraire une atteinte à leur capacité universelle à réagir à leurs contraintes. Une souveraineté internationale se substitue à la capacité universelle à gérer ses contraintes.
L'anthropologie, considérée comme
le respect de l'homme dans son universalité et son altérité,
prend ainsi une valeur normative. Affirmant que la question « qu'est-ce
que l'homme ? » est prioritaire, elle contredirait son propre objet en
se déclarant anti-humaine. Les réactions anti-économistes
de nombre d'ethnologues les ont ainsi conduits à préférer
un discours structural ou global en économie, sinon une sociologie anti-économiciste.
Le discours économique, quand il porte sur
l'homme, participe à l'anthropologie et à l’éthique économiques.
Cette double dimension est très limitée quand elle s'en
tient aux seules relations (plans) d'un homme par rapport à des objets
matériels et à la convergence de leurs relations au moyen d'un
seul système de prix. Si les hommes émettent des préférences
sur d'autres hommes ou émettent des préférences sur des
biens à travers les préférences d'autres hommes, bref si
l'on pose la question de la relation à l'Autre, alors ils entrent dans
une relation complexe par rapport au monde vécu. L’homme acquiert
une person-nalité par sa capacité à s'identifier par rapport
aux autres, à être capable d'internaliser cette relation, d’être
capable d'intentions et d'actions ; parce que cette relation a trait à
d'autres, il peut envisager sa responsabilité par rapport aux autres
dans le cadre de ses contraintes. Cette responsabilité qui compose en
grande partie sa personnalité pose le problème de savoir comment
évaluer l’Autre. Est-il tellement complexe qu'il n’y ait rien à
en dire? L'anthropologie s'est heurtée à ce problème,
notamment en le traitant dans un cadre naturel (l'évolutionnisme) ou
encore politique (la théorie autrichienne). L'anthropologie économique
ne peut éviter cette difficulté ; l'économie est plus simple
quand elle est faite d'individus ou d'agents, elle est plus compliquée
dans le cas de personnes libres et responsables. L'usage de ces propriétés
(liberté et responsabilité) dans le calcul économique est
une des finalités majeures de l'éthique économique.