3- Les socialismes dits "utopiques" ou "vulgaires"
3- Les socialismes dits "utopiques" ou "vulgaires"
Le socialisme non marxiste est souvent qualifié d'utopique ou de vulgaire par rapport au "socialisme scientifique". Marx, dans le Manifeste, distingue le socialisme féodal (dont le socialisme sacré), le socialisme petit-bourgeois, le socialisme allemand dit "vrai", les socialismes "bourgeois" (Proudhon) et utopiques (St Simon, Fourier, Owen..).
Marx prophétise : le "libre épanouissement de chacun est la condition du libre épanouissement de tous" c equi fait inévitablement penser à la "liberté de choix" d' Amartya Sen (1999).
Ce socialisme recouvre de nombreuses tendances et il est éliminé de la plupart des manuels français, sauf celui d' Henri Denis. Le site de la New School célèbre par une excellente page les textes des différents courants : utopique, ricardien, St simonien, anarchiste, populiste, révolutionnaire, réformiste.... Le site Gallica de la BNF a exhumé de nombreux manuscrits de ces courants...de quoi faire des mémoires d'HPE !
Charles Gide a effectué une excellente présentation du socialisme(1) à la suite de laquelle on distingue:
Le socialisme néo- ricardien et coopératif (2)
Le socialisme français utopique (3)
Le socialisme révolutionnaire (4).
-1- Une présentation par Charles Gide (1847-1932)
in "Principes d'économie politique", 1931.
Les systèmes socialistes.
On a donné d'innombrables définitions du socialisme, mais aucune
n'a été retenue parce que ce mot de socialisme sert d'étiquette
aux écoles les plus disparates et même les plus antagonistes, en
sorte que quelle que soit la définition qu'on propose il y aura quelqu'une
de ces écoles qui protestera contre l'uniforme qu'on prétend lui
imposer. Tout ce qu'on peut dire c'est qu'elles sont toutes issues d'un sentiment
de révolte contre les injustices de l'ordre économique actuel,
et c'est pourquoi c'est dans le livre de la Répartition qu'il convient
de placer l'exposition de ces doctrines .
1° Le nom même de « socialisme » invite pourtant à croire qu'on pourrait le définir comme impliquant le sacrifice, ou du moins la subordination de l'intérêt individuel à l'intérêt social. Mais encore faudrait-il savoir ce qu'est l'intérêt social 1 Généralement, on entend par ce mot le bon ordre, c'est-à-dire le maintien de l'état de choses actuel, mais les socialistes s'irritent quand on oppose ce prétendu intérêt public aux revendications de la classe ouvrière et déclarent que cet intérêt public ne peut être autre que celui des travailleurs.
Il faudrait distinguer entre le socialisme autoritaire et le socialisme libertaire. Le premier implique une réglementation et une discipline, plus encore que l'ordre économique actuel, car après la Révolution accomplie il s'agira d'empêcher la vieille société de renaître, et pour cela la « dictature du prolétariat » sera indispensable, tout au moins temporairement et sans doute longtemps. Ce serait donc une erreur de voir dans le socialisme un élargissement de la démocratie. Le socialisme révolutionnaire ne redoute rien tant que de voir la minorité des militants paralysée par une foule inerte, qu'il serait obligé de remorquer. Il prendrait volontiers à son compte le mot d'ordre d'Ibsen : « les majorités n'ont jamais raison. C'est « le parti » seul qui doit gouverner. »
2° Souvent aussi on définit le socialisme comme l'absorption par l'État de toutes les activités privées. Mais cette définition, qui peut convenir à la social-démocratie, comme disent les Allemands, est repoussée par les socialistes marxistes. Ils protestent contre cette façon de présenter leur programme : ils déclarent que leur but n'est point d'étendre indéfiniment les fonctions de l'État mais de les supprimer progressivement – encore plus que ne le veut l'École ultra-libérale, car celle-ci s'arrête du moins à la limite de l'État-gendarme, tandis que cette dernière fonction est précisément une de celles que le socialisme goûte le moins. Socialisation ne veut donc pas dire « étatisation ». L'État, tel qu'il existe aujourd'hui le gouvernement, comme on l'appelle, représentant de la classe possédante ou bourgeoise, sera remplacé par un gouvernement purement économique, par un conseil d'administration qui ne sera que l'organe central des travailleurs organisés.
3° Peut-être pourrait-on mieux définir le socialisme comme l'abolition de la Propriété privée, puisque ce caractère semble commun à toutes les écoles. Et encore faut-il ici bien des réserves, car la propriété que les socialistes veulent abolir c'est seulement la propriété en tant que privilèges ; mais, au contraire, ils prétendent vouloir la réaliser pour tous, en tant qu'elle a pour objet le produit d'un travail personnel ; et même la libérer des servitudes qu'elle subit aujourd'hui entre les mains des petits propriétaires, telles que hypothèques, impôts, fermages. En d'autres termes, ils veulent conserver la propriété en tant que portant sur les objets de consommation, mais lui retirer ceux de ses attributs qu'on pourrait appeler agressifs en tant qu'ils permettent d'exploiter le travail d'autrui et d'en tirer profit.
4° Le vrai critérium du socialisme, tel qu'il résulte notamment de la théorie marxiste sur la plus-value (ci-après, Socialisme), c'est l'affirmation que la richesse des uns est prise sur le travail des autres. Or, si cette thèse est malheureusement fondée dans un grand nombre de cas, nous ne la croyons pas vraie dans l'ensemble. Je ne dirai pas, en sens inverse, que toute richesse est due au travail ou à l'initiative de son possesseur, tant s'en faut ! mais elle est due le plus souvent à des circonstances heureuses, à des conjonctures, dont il a su profiter (ci-dessus, p. 322).
C'est dans la première moitié du dernier siècle et en France que le socialisme a trouvé ses premiers chefs : Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Cabet, Pierre Leroux, Louis Blanc.
Ce socialisme n'était pas spécialement ouvrier.
Il ne faisait pas de distinctions de classes. Il cherchait un principe de justice
distributive autre que le jeu aveugle de la concurrence. Chaque école
a proposé le sien :
1° À chacun selon ses besoins, c'était le principe des communistes.
Mais au siècle dernier ce mot n'avait nullement le sens qu'il a aujourd'hui,
celui d'un socialisme ultra-rouge, le socialisme de Moscou. Les socialistes
dits communistes du XIXe siècle, Owen, Cabet, étaient tout à
fait débonnaires, et leur programme une idylle. Les petites colonies
dont ils traçaient les devis, ou qu'ils ont même réalisées,
étaient des Arcadies champêtres, des Petit-Trianons .
C'est bien à tort qu'on range généralement Fourier, célèbre par son phalanstère, parmi les communistes. En réalité, Fourier n'était communiste qu'en ce qui concerne la consommation et la production, nullement en ce qui concerne la répartition des biens. La vie commune dans le phalanstère n'était pour lui qu'un moyen d'organiser la production et la consommation dans des conditions plus économiques, mais n'avait nullement pour but d'établir l'égalité entre les hommes : elle devait laisser subsister au contraire. Fourier le déclare expressément non seulement les inégalités qui résultent du travail et du talent, mais encore celles qui résultent de l'inégalité des apports en capitaux. La répartition devait se faire ainsi : 5/12 pour le travail, 4/12 pour le capital, 3/12 pour le talent, ce qui n'a rien d'égalitaire et même ne diffère pas sensiblement de ce qu'est, en fait, la répartition actuelle. Il promet même aux sociétaires des dividendes fantastiques et d'opulents héritages. Il cherche la solution de la question sociale surtout dans le travail attrayant et prétend rendre le travail attrayant par une organisation compliquée de groupes et de séries. Dans ses énormes volumes le nombre d'idées géniales n'a d'égal que celui de ses extravagances .
2° À chacun selon sa capacité, c'était la devise fameuse de l'École de Saint-Simon. Socialiste, si l'on veut, mais d'un socialisme aristocratique et capitaliste, bien loin de proscrire les industriels, les grands patrons, les banquiers même, cette école leur conférait – sous le contrôle d'une Chambre de savants – le gouvernement de la société. Elle ne s'offusquait point de l'inégalité : seulement elle voulait remplacer l'inégalité artificielle par celle qui tient aux mérites individuels. Et c'est ce qu'elle exprimait par sa formule célèbre : « à chacun selon sa capacité, à chaque capacité selon ses œuvres. » La Révolution n'a pu aboutir, disait-elle, parce qu'en supprimant tous les privilèges politiques, fiscaux, civils, que conférait la naissance, elle en a oublié un, le plus exorbitant et le plus absurde de tous : la dévolution par l'héritage de la plus haute et la plus importante des fonctions, qui est le gouvernement économique de la société, l'administration de ses richesses, la gestion de ses entreprises.
L'abolition de l'hérédité était donc l'article essentiel de l'École de Saint-Simon. Cela paraît logique, car puisqu'elle avait pris pour devise : à chacun selon ses capacités, à chaque capacité selon ses œuvres – elle ne pouvait admettre, en tant qu'agent de répartition, l'hérédité, qui ne tient aucun compte des capacités. Pourtant si l'hérédité de famille a été la règle autrefois pour beaucoup de fonctions publiques, à commencer par la première de toutes, la royauté, c'est parce qu'on pouvait soutenir que l'hérédité du sang comporte la transmission de certaines qualités naturelles, et que d'ailleurs à l'hérédité physique s'ajoutent celle de l'exemple et de l'éducation. Mais c'est surtout en ce qui concerne l'hérédité testamentaire que la doctrine saint-simonienne paraît critiquable et même illogique, car ici ce n'est plus le hasard de la naissance, mais la désignation du père de famille qui institue l'héritier. Si donc toute propriété doit être considérée – c'est la thèse saint-simonienne – comme une fonction publique, ne peut-on pas en conclure que l'homme qui exerce cette fonction est assez bien qualifié pour désigner celui qui pourra l'exercer après lui – de même que chaque empereur de Rome désignait lui-même le futur César ? Il est vrai que ce précédent historique serait plutôt décourageant.
La difficulté c'est de trouver le moyen de mesurer les capacités ou même d'apprécier les œuvres de chacun. Nomination du gouvernement, examens ou concours, élection, cooptation, tous ces moyens se sont montrés à l'expérimentation si défectueux qu'on en vient, de découragement, à se demander si le tirage au sort, comme pour les membres des jurys criminels, ne vaudrait pas autant ! Et du reste, même en supposant qu'on pût trouver un critérium infaillible des talents, est-on bien sûr qu'un tel système, qui répartirait les fortunes selon les capacités, fût le plus conforme à la justice ? On peut très bien soutenir, au contraire, que la supériorité intellectuelle, pas plus que la supériorité physique, ne doit être un titre à la richesse. Elle constitue déjà par elle-même un privilège assez enviable et n'a pas besoin d'être aggravée encore par un nouveau privilège, à savoir le droit de revendiquer une plus forte part des biens matériels.
3° À chacun selon son travail, c'est le principe
de répartition de la plupart des écoles socialistes. Mais il faut
remarquer que ce principe comporte deux interprétations très différentes
selon que par le mot travail on entend la peine prise, l'effort exercé,
ou bien le résultat obtenu, l'œuvre accomplie.
Si l'on prend le mot travail dans le premier sens, celui de la peine prise,
de l'effort, nous n'avons aucun moyen de le mesurer, et moins encore si l'on
entend par là la bonne volonté. Et si l'on prend pour mesure,
comme l'enseignait Karl Max, le temps, le nombre d'heures on de minutes employées
au travail, avec un tel critérium on risque de donner une prime à
la paresse et à l'incapacité.
Si, au contraire, le principe à chacun selon son travail signifie : à chacun selon les résultats de son travail – tant mieux pour celui qui réussit, tant pis pour celui qui échoue – en ce cas, ce mode de répartition ne sera autre que celui qui régit l'économie actuelle et en consacrera toutes les injustices. Ce qui serait un progrès ce serait, au contraire, si l'on pouvait éliminer ou au moins atténuer ce qui la vicie dans le régime actuel, à savoir la part exagérée des chances – bonnes ou mauvaises – par quoi il faut entendre toutes les conjonctures sociales indépendantes de l'effort individuel. C'est bien à cela qu'on vise par maintes institutions : par exemple, les assurances dites sociales, et même par l'enseignement gratuit à tous les degrés.
------------------
L'école solidariste enseigne que la solidarité, qui n'était
qu'un fait brutal, doit devenir une règle de conduite, un devoir moral,
voire même une obligation juridique sanctionnée par la loi. Quelle
raison en donne-t-elle ? C’est que la solidarité, loi naturelle,
nous ayant montré clairement que chacun de nos actes se répercute
en bien ou en mal sur chacun de nos semblables, et réciproquement, notre
responsabilité et nos risques se trouvent énormément accrus.
S'il y a des misérables, nous devons les aider : – 1° parce
que nous sommes probablement en partie les auteurs de leur misère par
la façon dont nous avons dirigé nos entreprises, nos placements,
nos achats, ou par l'exemple que nous leur avons donné ; donc, étant
responsables, notre devoir est de les relever ; – 2° parce que nous
savons que nous ou nos enfants serons exposés à être les
victimes des misères d'autrui : leur maladie nous empoisonnera, leur
dépravation nous démoralisera. Donc, notre intérêt
bien compris est de les guérir.
Il faut donc, transformer la société des hommes en une sorte de
grande société de secours mutuels où la solidarité
naturelle, – rectifiée par la bonne volonté de chacun ou,
à son défaut, par la contrainte légale – réalisera
la justice ; où chacun sera appelé à prendre sa part du
fardeau commun et à recueillir sa part aussi du profit d'autrui. Et à
ceux qui craignent de diminuer par là l'individualité, l’énergie
qui compte d'abord sur soi, le self-help, il faut répondre que l’individualité
ne s'affirme et ne se développe pas, moins en aidant autrui qu'en s'aidant
soi-même.
-2- Socialisme Ricardien et réformistes
Ce courant propose une intervention progressivement plus importante de l'Etat dans l'économie.
Jean-Baptiste de Sismondi (1773-1842)
Publie:
Tableau de l'agriculture toscane, 1801. De la richesse commerciale , 1803.
Vol. I, Vol. II Histoire des republiques italiennes du moyen age, Vol. I,
Vol. II, 1809-18 De l'intérêt de la France à l'égard
de la traite des nègres, 1814 Examen de la Constitution françoise,1815.
Political Economy, 1815. Nouveaux principes d'économie politique,
ou de la Richesse dans ses rapports avec la population, 1819. Histoire des
français, 1821-44. Les colonies des anciens comparées à
celles des modernes, 1837 Etudes de sciences sociale, 1837 Études
sur l'économie politique, 1837 Précis de l'histoire des Français,
Vol. I, Vol. II, 1839 Fragments de son journal et correspondance, 1857
Dénonce le minimum vital et la mieux-value des capitalistes
Le fait de privilégier la valeur d'échange conduit le système capitaliste à des crises de sous-consommation
Ferdinand Lassalle (1825-1864)
A la pointe du mouvement ouvrier en Allemagne, il démontre dans "le système des droits acquis" que les changements dans l'esprit du peuple doivent conduire à des réformes, notamment en améliorant son expression politique. Mais la réforme sociale est limitée par la loi d'airain des salaires.
John Hobson (1858-1940)
Célèbre par sa théorie de la sous-consommation et préfigure Keynes par sa conception de l'épargne.
Publie :
The Physiology of Industry with A.F. Mummery, 1889. "The Law of the Three Rents", 1891, QJE The Evolution of Modern Capitalism, 1894. John Ruskin: Social Reformer. 1898. The Economics of Distribution, 1900 The Social Problem, 1901. Imperialism: A study, 1902. The Industrial System, 1909. The Crisis of Liberalism, 1909. "Marginal Productivity", 1910, Economic Review. Science of Wealth, 1912. Gold, Prices and Wages, 1913. Work and Wealth: A human valuation, 1914. The New Protectionism, 1916 Democracy After the War, 1917. Free Thought in the Social Sciences, 1926. Wealth and Life, 1929. L.T. Hobhouse, with M. Ginsberg, 1932. Veblen, 1936 Confessions of an Economic Heretic, 1938
Jean Baptiste GODIN et le familistère
Mutualité sociale et association du capital au travail (1880)
On ne peut laisser coexister la surproduction des industriels et agriculteurs avec la sous- consommation des miséreux , la solution se trouve dans la fraternité.
Robert Owen (1771-1858)
Le socialisme coopératif
Observations on the Effect of the Manufacturing System, 1815
"Evidence
on New Lanark", Parliamentary Papers, 1815
A New View of Society, 1816. (excerpts)
An Address to the Inhabitants of New Lanark, 1816
Two Memorials on Behalf of the Working Classes,
1818.
Report to the County of Lanark, 1821.
Lectures on an Entire New State of Society, 1830.
-3. Le socialisme français utopique.
Il est d'expression très populaire, violemment anti-religieux (Proudhon) ou mystique (Cabet) ; il élabore des utopies dont certaines auront une grande influence ( ex. A. Comte au Brésil ou Fourier aux Etats- Unis).
Charles Fourier (1772-1837)
Fils de notable à Besançon, marqué par des difficultés familiales,il est employé de commerce; puis il écrit ses premiers ouvrages à partir de1808 et fonde l'école sociétaire.
Le phalanstère et l'associationisme.
Théorie des quatre mouvements (1808)
Egarement
de la raison démontré par les ridicules des sciences incertaines
(1806?)
Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865)
D'origine très modeste, il obtient une pension de l'académie de Besançon et devient écrivain à Paris.Puis , après le succés de "qu'est-ce-que la propriété..." (1840), se lance en politique.Il critique le bonapartisme, puis s'y rallie. Célèbre par ses critiques de la religion, il a sur la femme des propositions très conservatrices et calcule qu'elle vaut 8/27 de l'homme....ce qui lui vaudra des écrits critiques de plusieurs femmes, en particulier Jenny d'Héricourt (1860) et Juliette La Messine (1858).
La Science Economique
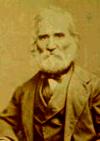
"Qui fait la soupe doit la manger" (1934)
"La richesse naît de l'intelligence et du travail, l'âme et la vie de l'humanité. Mais ces deux forces ne peuvent agir qu'à l'aide d'un élément passif, le sol, qu'elles mettent en oeuvre par leurs efforts combinés. Il semble donc que cet instrument indispensable devrait appartenir à tous les hommes. Il n'en est rien.
Des individus se sont emparés par ruse ou par violence de la terre commune, et, s'en déclarant les possesseurs, ils ont établi par des lois qu'elle serait à jamais leur été, et que ce droit de propriété deviendrait la base de la constitution sociale, c'est-à-dire qu'il primerait et au besoin pourrait absorber tous les droits humains, même celui de vivre, s'il avait le malheur de se trouver en conflit avec le privilège du petit nombre."
L'homme nouveau ou le messager du bonheur (1833)
Le catéchisme des industriels (1823)
Étienne Cabet (1788-1856)
Un néo millénarisme ? Propose la communauté
des biens dans la tradition chrétienne.
Révolution de 1830 et situation présente , 1833.
Voyage et aventures
de lord William Carisdall en Icarie, 1839 - Selections
Lettres sur la crise
actuelle, 1840.
La propagande communiste
ou Questions à discuter et à soutenir ou à écarter,
1842.
L'ouvrier : ses misères
actuelles, leur cause et leur remède, son futur bonheur dans la communauté,
moyens de l’établir,1844.
Réalisation de la communauté d’Icarie: nouvelles de Nauvoo
, 1849-50.
Le Vrai Christianisme
suivant Jésus-Christ, 1847.
Histoire populaire
de la Révolution française de 1789 à 1830, 1849-50. -
Selections
Colonie icarienne aux
Etats-Unis d'Amérique. Sa constitution, ses lois, sa situation matérielle
et morale aprés le premier semestre, 1855.
Pierre LEROUX 1797-1871
Pierre Leroux, introduit en France le mot " socialisme " comme antithèse de l’individualisme.Ouvrier typographe et conçoit les plans d’une machine à composer . Après la révolution de 1830, il se rallie au saint-simonisme dont il se sépare en novembre 1831. Imprimeur puis homme politique, il publie : De l’Humanité, De l’Egalité, Malthus et les économistes, Le carrosse de M. Aguado. Il est un critique très acerbe de Proudhon et mélange considérations de société et mythes religieux .
« Une Corporation ! Il y a bien des gens qui
se croient de savants politiques, et à qui ce mot de Corporation paraît
peu de chose ; eh bien ! ce mot, suivant moi, résume l'avenir ; il
porte, du moins, en lui l'avenir de la société ; car il contient
le germe de son organisation. Il ne s'agit pas, entendons-nous bien, de la
Corporation antique, cette corporation qui n'était qu'une caste, et
nous ne voulons plus de castes ! Non, plus de castes, mais l'organisation
!
J'applaudis comme vous à tout ce qui a été dit tout à
l'heure par notre Président, quand il a appelé la destruction
de toutes les castes en célébrant la réunion ici de nos
amis et compagnons venus de Bruxelles et de Londres. Nous sommes tous fils
d'Adam et de la même espèce ; toutes les religions toutes les
philosophies le proclament. L'Association universelle, c'est l'avenir. Mais
comment s'organisera cette grande Humanité ? J'ose dire que vous l'avez
pressenti en visant à organiser une Corporation. Ceux qui croiraient
ne faire qu'une chose de nulle conséquence, une chose sans valeur et
sans portée, en venant s'asseoir ici, comme s'il s'agissait simplement
de manger et d'entendre des chants, n'auraient rien compris à votre
institution. »
Jean-Joseph Louis Blanc, 1813-1882.
Historien et politique, il s'exile en Angleterre après les évènements
de 1848 et revient en 1870 pour se faire élire
député d'extrême gauche.
L'Organisation
du travail , 1839
Lettre sur la terreur,
Histoire de dix ans :
1830-1840, Vol I, Vol. II, Vol. III, Vol. IV, Vol. V, 1841
Histoire de la révolution
française, 12 vols, 1847-62
Le Droit au Travail,
1848.
Catéchisme des
socialistes, 1849
La révolution
de Février au Luxembourg, 1849
Lettres d'Angleterre,
Vol. I , Vol. II, 1863
L'État et la commune,
1866
Histoire de la révolution
de 1848, 1870
Histoire de la Constitution
du 25 février 1875, 1882
Quelques
vérités économiques, 1911
Paul Lafargue (1842-1911)
Gendre de Marx , surtout connu pour son pamphlet "Le droit à la paresse"(1883), a participé à l'Internationale des travailleurs et suscite la création d'un parti ouvrier en France et en Espagne. Il est arrêté à plusieurs reprises par la police française.Il publie plusieurs ouvrages, en particulier " la Religion du Capital" (1887).
Les philosophes antiques, rappelle Paul Lafargue , n’avaient que mépris pour le travail et le commerce ; pour Platon dans la République et Xénophon dans son Economique, ce sont des activités dégradantes qui empêchent le loisir et la sociabilité du citoyen. Le progrès et la machine selon Aristote doivent permettre de se passer des esclaves.
Le système capitaliste développe au contraire la dégénérescence intellectuelle par le travail : "Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis des siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes, les moralistes, ont sacro-sanctifié le travail. Hommes aveugles et bornés"
-4. le socialisme revolutionnaire
Mikhail Alexandrovich Bakounine, 1814-1876
Anarchiste, principal opposant à Marx au sein de la première
Internationale dont il sera exclu.
Federalism,
Socialism and Anti-Theologianism, 1867
The Knouto-Germanic
Empire and the Social Revolution,
God and the State,
1871
Marxism, Freedom, and
the State, 1872
"The Immorality of
the State"
"Stateless Socialism:
Anarchism"
"Founding of the Worker's
International"
"Recollections on Marx
and Engels"