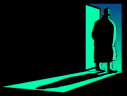Section 1- De Xénophon, l’économique
à la téléologie du BIEN (Aristote).
Si la conception "familiale" de l'économie est oubliée, l'éthique aristotélicienne du Bien est très majoritaire en économie. Elle est une pensée de l 'ordre qui s'oppose au communisme primitif que proposent Socrate et Platon.
1- Xénophon
L'Economique est un dialogue entre Socrate et Critobule, mais dont la plus grande partie traite des vertus de son épouse, Ischomaque. C’est un traité d’économie, analysant l’utilité et le profit, mais aussi un " traité de vie matrimoniale " (M. Foucault, l’usage des plaisirs). Au 4° siècle avant Jésus Christ, l’économie est clairement distinguée des autres sciences. Cette conception de l'économie, comme "affaire de famille" est reprise par Hannah Arendt ( Condition de l'homme moderne). Elle réapparaît avec les théorèmes de l'altruisme, définis par des relations ascendantes (Becker, 1971) ou descendantes (Barro, 1971). Le rôle de la famille (le privé) comme obstacle à la politique économique a été souvent négligé par la réflexion macro-économique.
L’économie : l’oikos
"J'entendis un jour Socrate parler en ces termes sur l'économie : "Dis-moi, Critobule, donne-t-on à l'économie le nom de science, comme à la médecine, à la métallurgie et à l'architecture? — Je le crois, Socrate. — On peut déterminer l'objet de ces sciences. Peut-on également déterminer celui de l'économie ?"
La gestion du patrimoine
" L'objet d'un bon économe, si je ne me trompe, est de bien gouverner sa maison. — Et la maison d'un autre, si on l'en chargeait, est-ce qu'il ne serait pas en état de la gouverner comme la sienne ? Un architecte peut aussi bien travailler pour un autre que pour lui : il doit en être de même de l'économe. — C'est mon avis, Socrate. — Un homme qui, versé dans la science économique, se trouverait sans biens, pourrait donc administrer la maison d'un autre, et recevoir un salaire comme en reçoit l'architecte qu'on emploie ? — Assurément, et même un salaire considérable….
Un calcul sur l’utilité des biens et sur les autres.
" Tu disais pourtant qu'on entend par maison tout ce que l'on a. — Sur ma foi, je voulais dire tout ce que l'on possède de bon : car ce qui est mauvais, pourrais-je l'appeler une possession ? — Si je ne me trompe, tu appelles bien ce qui est utile ? — Justement ; car ce qui est nuisible est plutôt un mal qu'un bien. —
Et les amis, si on a le talent de mettre à profit l'amitié, comment les appellerons-nous ? — Des biens, Socrate ; et ne sont-ils pas beaucoup plus dignes de ce nom que les bœufs, puisqu'ils nous servent plus encore que ces utiles animaux ? — Les ennemis, d'après ton propre raisonnement, sont donc aussi un bien pour qui sait les rendre utiles ? — Je le crois ainsi. — Il est donc d'un bon économe d'en user si sagement avec ses ennemis, qu'il sache en tirer parti ?
Le rôle de l’harmonie à la maison
"Pour moi, je pense qu'une bonne compagne est tout à fait de moitié avec le mari pour l'avantage commun. C'est l'homme le plus souvent qui, par son travail, fait venir le bien à la maison ; et la femme qui, presque toujours, se charge de l'employer aux dépenses nécessaires. L'emploi est-il bien fait, la maison prospère ; l'est-il mal, elle tombe en décadence."
Un point de vue agrarien.
"Ce que je te dis là, Critobule, c'est pour t'apprendre que même les plus heureux des mortels ne peuvent se passer de l'agriculture. En effet, les soins qu'on lui donne, en procurant des plaisirs purs, augmentent l'aisance, fortifient le corps, et mettent en état de remplir tous les devoirs de l'homme libre. D'abord, non contente de donner le nécessaire à celui qui la cultive, la terre fournit encore à ses plaisirs. Ces fleurs, qui ornent les autels et les statues des dieux, et qui font quelquefois la parure des hommes. "
Commerce international et profit
"S'il a besoin d'argent, ce n'est pas au hasard, ni au premier endroit qu'il les décharge : il n'apporte son blé, il ne le livre que dans les pays où il entend dire que cette denrée est montée au plus haut prix. C'est à peu près ainsi que ton père chérit l'agriculture. — Socrate, tu plaisantes. Pour moi, je pense qu'un homme qui vend ses maisons à mesure qu'il les bâtit, et qui ensuite en construit d'autres, n'en est pas moins un vrai amateur de bâtisse. — En vérité, Ischomaque, je pense, ainsi que toi, qu'on aime naturellement ce dont on tire profit."
Une synthèse…
"Critobule, nous avons établi que l'économie était une science, et nous l'avons défini la science de faire prospérer une maison. Par maison, nous entendions toutes nos possessions ensemble; par possessions, ce qui était utile à la vie de chacun; et le nom d'utile, nous ne le trouvions applicable qu'à tous les objets dont on savait tirer parti. Nous avons dit qu'il était impossible d'apprendre tous les arts, et nous avons jugé que les États ne devaient aucune considération aux arts qu'on appelle mécaniques, parce qu'ils dégradent à la fois le corps et l'esprit. On en aurait, disions-nous, une preuve convaincante, si, lors d'une invasion, l'on partageait les artisans et les laboureurs en deux classes, et qu'on demandât aux uns et aux autres s'il faut défendre les campagnes ou sortir des champs pour garder les murs. Nous étions persuadés que, dans cette supposition, les laboureurs opineraient pour la défense, tandis que les artisans seraient d'avis de ne point combattre, mais de rester, sans essuyer ni fatigue ni péril, dans l'état de repos auquel les accoutume leur éducation."
-2- Aristote : Le Bien est la finalité de l'économie pour les dominateurs (hommes libres).
Aristote nait en 384/3 à Stagire (ile ionienne, actuellement Stavros), fils de Nicomaque, médecin. Il part suivre des études à Athènes, à l'Académie où enseigne Platon. Il écrit de nombreux ouvrages dont il ne reste que quelques fragments. Il sera le précepteur d'Alexandre dit le Grand en Macédoine, avant de revenir à Athènes où il a de nombreux disciples. Il y subit une chasse au macédonien suite à une crise économique à Athènes en 324 et meurt en 322. Après sa mort, son œuvre se diffuse difficilement et sera combattue par les premiers pères de l'Eglise, avant d'être réhabilitée par Albert le Grand, puis par Thomas d'Aquin.
Les principales œuvres d'Aristote sont :
La Physique
La Métaphysique. Aristote est l'inventeur de cette discipline.
La Logique (Organon), qui contient les six livres suivants :
- De L'interprétation
- Des Catégories
- Analytiques Premiers
- Analytiques Seconds
- Topiques
- Réfutations sophistiques
La Politique
Ethique à Nicomaque
Rhétorique
S'il fallait se convaincre de l'importance de l'histoire, la référence à Aristote est permanente chez nombre d'économistes contemporain. Par exemple A. Sen fait référence au Bien qui justifie la programmation du développement par les économistes. Cette téléologie du Bien est l'argument suprême de l'économiste qui planifie le bien- être sans responsabilité. Le cadre de la cité est particulièrement autoritaire, fixant la hiérarchie naturelle. La théorie du Bien est inséparable d'une conception universelle de l'autorité des hommes libres sur leur maisonnée, en particulier sur leurs esclaves. Cette téléologie aristocratique du Bien est transposée au raisonnement économique moderne, elle implique fatalement l'esclavage. L'économie est une science de gestion des femmes des enfants et des esclaves !
Le Politique
Dans le Politique, Aristote revient sur l'économique , au départ l'administration de la maison, différente de la chrématistique, l'art d'acquérir la richesse. L'économique concerne d'abord la relation de maître à esclave, une relation universelle sinon naturelle que l'on retrouve avec les contrats précaires d'aujourd'hui ! L'économique est la science de la gestion des esclaves, la chrématistique l'art de les acquérir. Il existe des valeurs propres aux objets, soit des valeurs d'échange. Par exemple l'esclave dans la communauté (la cité) n'a qu'une valeur d'usage. L'échange par contre peut être facilité par la monnaie qui ne saurait être désirée pour elle-même. L'usure doit être condamnée ou la recherche de monopole.
Les hommes libres veulent l'excellence morale et la vertu. Les femmes sont soumises à une autorité politique, le mari comme chef d'Etat, les enfants aussi (le pouvoir du père est royal), l'esclave par nature. Ce dernier n'a besoin que de peu cette vertu, sinon d'un peu de raison que le Maître lui admonestera (p. 37).
La cité est la structure qui regroupe les familles, comment lui donner une constitution afin de préciser ce "tout structurant" ? Aristote réprouve la communauté, en particulier la communauté des femmes, telle que proposée par Socrate et Platon, ce qui ferait réduire la cité à la famille et la famille à l'individu et serait contradictoire au besoin de propriété. Aristote inaugure une longue tradition d'opposition au communisme des femmes et des biens. Il fait l'apologie de la propriété : il faut égaliser les désirs de fortune non les fortunes elles-mêmes, comme le propose Phaléas.
L’éthique à Nicomaque.
Toute action, économique par exemple, est en relation avec le Bien et le Bonheur. Elle n’est donc pas uniquement utile. L’utilité peut être en contradiction avec l’éthique, tout en étant conforme à la morale personnelle.
L’éthique est différente selon les domaines et les personnes. Aristote laisse une très grande liberté, même s’il présuppose une coordination par le souverain bien.
L’utilité correspond –elle à la recherche du bonheur ? Elle n’est pas suffisante. Une double préoccupation préside à la recherche du bonheur : il faut rechercher la fortune et la perfection par des moyens et des vertus particulières. Le bonheur additionne la vertu et les biens extérieurs, il ne peut se contenter de l’un ou de l’autre. Il faut donc tendre à une parfaite vertu et à être suffisamment pourvu des biens extérieurs.
Le politique doit posséder une certaine connaissance de ce qui a rapport à l’âme…... Aristote montre à quel point l’économique et la morale sont liées dans la recherche du bonheur. Les considérations économiques sont donc mêlées à la vertu et à l’altruisme; (le traducteur en fait un usage malheureux). Il suggère qu’un calcul économique soit possible sur la morale. Les économistes n’ont pas dit grand chose de la dimension morale de l’activité économique, car la morale impose des outils compliqués dans le calcul économique.
- 3- "La Grande Morale ".
"Le caractère éthique (ethos) tire son appellation de l’habitude(ethos). Il est appelé éthique à cause du fait qu’on prend des habitudes."
Il existe des vertus (contrairement au rationalisme exclusif de Platon) de la partie irrationnelle. Il existe des habitudes qui sont des vertus dans les actes économiques et qui nous font estimer les douleurs et les plaisirs. L’utilité n’est pas une vertu en soi. L’éthique peut donc être examinée sous son angle pragmatique.
L'homme libre, dans sa quête du Beau et du Bien, est fatalement égoïste et s'aime lui-même. Le juste se rapporte à autrui, "le juste par rapport à l'autrui, c'est l'égal." L'homme libre n'a pas à acquérir des biens et de se procurer de l'argent. C'est le rôle du financier.