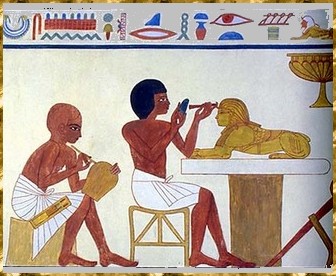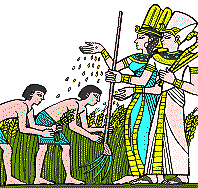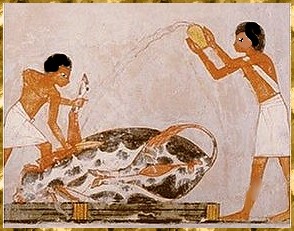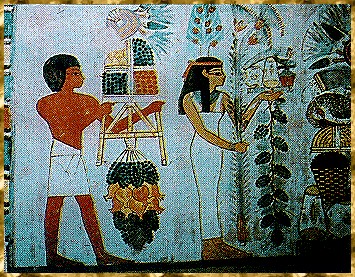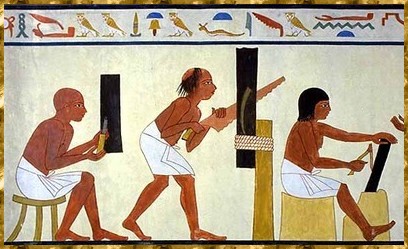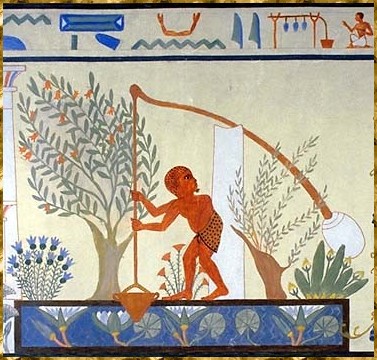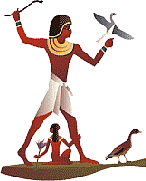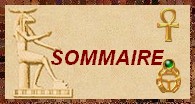|
|
 |
||||||||||||||||
| |
ARTISANS-OUVRIERS
De
l'argile, des pierres dures et tendres, de l'ivoire, de l'os, du bois, du
métal, les productions artisanales de l'Égypte ancienne marquent d'emblée
par leur qualité d'exécution. Dès
les hautes époques, céramiques, vases de pierre, statuettes d'argile et
d'ivoire, armes de silex et de métal reflètent l'existence d'un groupe
d'hommes, soustraits (en partie) aux travaux de subsistance, capables de
transmettre des codes, des règles et un savoir-faire. On en donnera pour
exemple les belles lames de silex à enlèvements en vagues, qui
constituent ce que l'on appelle communément les « couteaux prédynastiques
», et dont l'un des plus beaux exemplaires, avec manche d'ivoire orné,
est le couteau du Gebel el-Arak, conservé au musée du Louvre. L'élaboration
de ces lames de silex exceptionnelles, que l'on a pu récemment
reproduire, implique une telle complexité, demande un tel savoir-faire
que très peu d'ateliers durent en produire. Des ateliers, des maîtres,
des élèves. Seule une société fortement structurée, déjà hiérarchisée
pouvait soutenir l'existence de tels groupes, car les artisans de l'Egypte
n'étaient pas fondamentalement plus habiles que les autres, ils répondaient
à une demande, à des commandes d'aristocrates capables d'élaborer des règles,
de monopoliser les produits, d'acheminer les matières premières, de
s'attacher les services des meilleurs en leur art. Ce n'est pas un hasard
si les plus grandes oeuvres sont issues des ateliers royaux. L'émergence
puis l'essor pris par les artisans sont ainsi étroitement liés au
pouvoir. Parce qu'ils possédaient la faculté de modeler la matière,
parce qu'ils pouvaient élaborer les objets capables de refléter le
prestige et le rôle social de ceux qui les avaient commandés, les
artisans sont devenus indispensables aux hommes de pouvoir, puis hommes de
pouvoir eux-mêmes, comme le montrent, à l'époque pharaonique, les fières
inscriptions, gravées dans les tombeaux des maîtres d'oeuvre :
architectes, charpentiers, maçons, peintres-décorateurs...
Artisans ou artistes ; certains chercheurs ont souligné qu'il n'existait pas d'art égyptien dans l'acception que l'on donne aujourd'hui à ce mot, à savoir une catégorie d'objets développant ses propres motifs, ses formes et ses styles, distincte des pièces émanant de l'artisanat. Il n'y a point de mot égyptien pour désigner l'artiste, qui est englobé dans la catégorie plus générale des scribes - le scribe des contours pour le dessinateur - ou des artisans. Mais l'art ne constitue pas une donnée de base transculturelle, inhérente à la nature humaine. L'objet issu de la main de l'homme ne devient « oeuvre d'art » que par rapport et en fonction du contexte social de celui qui la définit comme telle. Ainsi, l'art est un phénomène social plus qu'individuel et nous regroupons souvent sous ce nom des objets qui ont été perçus et conçus à une époque et dans un lieu dans une tout autre acception. Si l'on se limite au sens restreint que l'Occident donne au mot « art », il n'existe ni en Égypte ni dans aucune société traditionnelle. Cependant, si l'appréciation des formes et modelés, des rythmes et des sons est affaire de personne et d'époque, la notion même d'excellence dans le travail est une qualité remarquée des Égyptiens dans la formule célèbre : « le meilleur en son art », ou « qui n'a pas son pareil », qui peut être attribuée à un artisan, un scribe, un médecin... Mais la maîtrise de la matière (le savoir-faire) est reconnue, établie et honorée, non parce qu'elle produit du beau, mais parce que celui-ci représente le groupe social qui le contrôle. Le clivage pourrait s'opérer à ce niveau : l'artisan produisant des biens de consommation (paniers, pots à cuire, outillage de base), le « spécialiste » étant producteur idéologique. Et la frontière entre les deux, d'inexistante à subtile au départ, s'est dessinée de plus en plus nette au fur et à mesure que prenait son envol une élite politique, qui légitimait et justifiait son pouvoir par la possession de ces objets symboliques.
Artisans Les paiements se faisaient en nature,
les rations allouées aux travailleurs manuels étant plus importantes que
celles des employés et des porteurs. Il était distribué du blé et de
l'orge assurant le pain et la bière de première nécessité, des légumes,
du poisson et du bois comme combustible. A certaines occasions, des
gratifications sous forme de sel, de vin, de boissons douces ou autres
denrées de luxe, complétaient les salaires. Chaque famille occupait une
maison de brique crue élevée sur des fondations en pierre. Les métiers,
carriers, maçons, plâtriers, dessinateurs, peintres, sculpteurs,
artisans sur cuivre, scribes se transmettaient héréditairement. La
plupart des mariages se faisaient à l'intérieur de la communauté. Les
habitants disposèrent d'assez de temps libre pour creuser et décorer
leurs propres tombeaux, du moins jusqu'au règne de Ramsès II. Leurs
descendants se contentèrent d'aménager ceux de leurs ancêtres qui
devinrent des caveaux familiaux.
Ces artisans disposaient d'un nombreux
personnel pour assurer les travaux domestiques : couper le bois,
puiser l'eau du Nil à près de cinq kilomètres et la rapporter à dos d'âne,
laver le linge, moudre le blé. Chaque quartier appointait son propre pêcheur
pour lui fournir chaque semaine du poisson frais. Les affaires du village
étaient gérées par un Conseil composé des hommes les plus âgés et de
leurs épouses aidés d'un scribe. Outre les questions courantes, ce
Conseil réglait les querelles et les différends sans conséquence ;
il infligeait parfois quelques peines. Les délits graves ressortissaient
de la justice du vizir.
Alors qu'il fut si souvent raconté que
les monuments égyptiens avaient été édifiés avec la sueur et le sang
d'esclaves sacrifiés, il est important de signaler les conditions de
travail. La journée était rythmée par quatre heures de labeur le matin
suivies d'un repas et d'une sieste. L'après-midi, à une heure variable,
le travail reprenait pour quatre autres heures. Il faut aussi signaler que
l'absentéisme était courant.
Agriculture Comme toutes les
civilisations anciennes, la civilisation égyptienne est agricole. Comme
le fellah d'aujourd'hui, l'Égyptien ancien est un paysan, fortement
attaché à une terre miraculeusement fertilisée par la crue annuelle. La
vie même du pays dépendait totalement des « respirations » du grand
fleuve qui le constitue et dont les débordements, de juillet à octobre,
permettaient à la végétation de croître au milieu du désert. De tout
temps et en tout point de la planète, les cycles de la nature, très vite
liés aux mouvements des astres, ont exercé sur les groupes humains une
fascination, située au fondement de toute pensée, de toute science. Mais
peut-être ici plus qu'ailleurs, dans cette étroite vallée, au carrefour
de l'Asie et de l'Afrique, le renouveau végétal, surgi du limon imbibé
du lent retrait des eaux, a marqué plus profondément la représentation
que les hommes se sont faite du monde et d'eux-mêmes. Le rôle central du
mythe d'Osiris, dieu de la végétation, de l'éternelle naissance, de
l'agriculture et du pouvoir royal, est là pour le prouver. Interférer
sur les forces naturelles, les détourner en quelque sorte à son profit,
ne peut être que l'oeuvre d'un dieu, et Osiris ouvrira aux hommes la voie
de la domestication et de la royauté. [...] La domestication des végétaux
et des animaux participe de la même mise en ordre que celle des êtres
humains, du même équilibre essentiel et précaire.
L'introduction
de l'agriculture en Égypte est relativement tardive, comparée aux régions
voisines du Proche-Orient. Les premières pratiques agricoles, dans cette
partie du monde, ont été décelées dès 9000 av. J.-C., en Syrie du
Nord, sur l'Euphrate, dans la zone d'origine des céréales sauvages : blé
amidonnier et orge. Elles se sont développées, avec l'élevage (bovins,
caprins, ovins, porcs), dans les nombreux villages agricoles qui se
constituent au cours des VIIIe et VIIe millénaires sur la totalité du
Levant et en Anatolie du Sud-Est, associant aux céréales des cultures
vivrières de plus en plus variées : pois, lentilles, fèves, vesces et
pois chiches pour les légumineuses, lin pour les textiles.
Pendant trois à quatre mois chaque année, les terres arables
d’Égypte étaient inondées par les eaux du Nil. Lorsque le fleuve
commençait à baisser, laissant alors une couche d’alluvions très
riches, le travail commençait. Il fallait labourer la terre deux fois
avec des bœufs pour la rendre plus meuble avant de semer puis la faire
damer par les animaux. Les Égyptiens cultivaient le blé, l’orge, le lin ainsi que des
fruits et légumes, tels que l’oignon, l’ail, les laitues, les pois,
les lentilles et les haricots. Elles étaient irriguées par l’eau
provenant de mini-réservoirs alimentés par le Nil grâce à des canaux
ainsi que par des chadoufs, c’est-à-dire de seaux équilibrés par des
contrepoids servant à transporter l’eau du fleuve dans une rigole aménagée
en bordure des champs.
Les paysans vivent en famille dans
leurs villages ou, dans le Delta, campent sous des tentes pour garder les
troupeaux qui pâturent. Un Conseil de village gère les affaires
courantes et l'administration centrale n'intervient qu'en deux occasions :
la perception des impôts et les problèmes créés par la crue ou des
conditions agricoles difficiles.
La première rencontre des cultivateurs
avec l'administration centrale était la venue des contrôleurs pour la
perception des impositions. Afin de déterminer les taxes dues, ils
arpentaient les champs, mesuraient les récoltes, dénombraient le bétail
et les volailles, inspectaient les vergers, les vignes et les palmeraies.
Aucune monnaie n'ayant eu cours avant l'occupation perse, les prélèvements
étaient effectués en nature. La moitié de toutes les productions était
ainsi destinée au trésor et bien souvent l'autre moitié assurait à
peine la subsistance familiale.
La richesse de l'Egypte reposait sur
son agriculture. De nombreux corps de métier, tisserands de laine ou de
lin, tanneurs, bouchers, brasseurs, vanniers dépendaient directement de
ses productions mais, bien que de manière plus lointaine, tout le reste
du pays était concerné. Lorsqu'un péril menaçait les récoltes, la
corvée réclamait un effort général. Chacun, quelle que soit sa
profession, était réquisitionné le temps nécessaire à surmonter les
difficultés. Les prêtres eux-mêmes n'étaient pas exemptés et les
hauts fonctionnaires se chargeaient de la surveillance et de
l'organisation du travail. Il s'agissait le plus souvent de maîtriser les
caprices du Nil et d'effectuer les travaux d'endiguement ou d'irrigation nécessités
par une crue trop forte ou trop basse.
Parfois il fallait nettoyer les terres
ou ramasser et engranger les moissons. Tous les Egyptiens recevaient des
pics, des houes, des paniers et se mêlaient aux paysans.
Les métiers artisanaux, comme la construction, le travail des métaux,
la menuiserie et l’orfèvrerie, jouaient un rôle important dans la
civilisation égyptienne. Les artisans spécialisés dans ces domaines vivaient dans des
villages qui leur étaient réservés et où ils jouissaient d’une vie
confortable et d’une bonne position sociale. Les artisans égyptiens travaillaient en collectivité, soit pour
des temples ou des palais, soit pour leurs communautés locales. Ils vivaient parfois dans des villages spécialement bâtis sur le
site de grands projets, comme la construction d’un tombeau ou d’un
palais. Plusieurs de ces villages d’artisans ont fait l’objet de
fouilles, dont Deir el-Medineh près de Thèbes, la demeure des artisans
qui ont bâti la Vallée des Rois. Ces artisans étaient tellement estimés que les meilleurs
d’entre eux avaient leurs propres tombes ornées de riches décorations.
À Deir el-Medineh, la qualité des peintures et du mobilier de la tombe
de Sennedjem témoigne de son talent. |
|
||||||||||||||||
 |
|
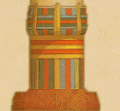 |
||||||||||||||||