|
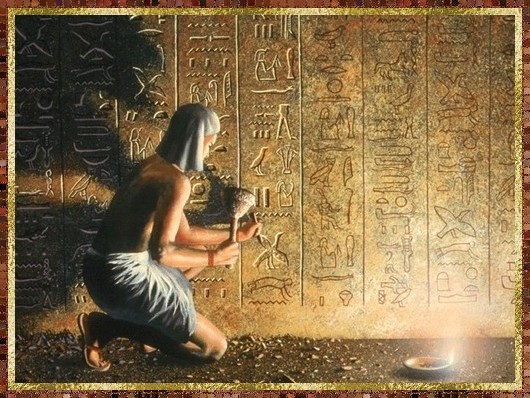
 HIEROGLYPHES
ET ROSETTE HIEROGLYPHES
ET ROSETTE 

Dans la vallée du Nil, chaque année les crues déposant leur limon
brouillaient toutes les marques de propriété entre les champs et
obligeaient à refaire un travail d’arpentage. Ce serait la raison de la
naissance de l’écriture dans la civilisation égyptienne…
Medouneter « paroles divines », c’est ainsi que les égyptiens
nommaient leur écriture, que les Grecs désignèrent sous le nom de
hierogluphikos littéralement « gravures sacrées ». L'écriture en Egypte
est au service d’un pouvoir où le religieux et le politique sont
indissociables ; elle est considérée comme un don des dieux et a
vocation à garantir l’ordre du monde.
Né peu après l’écriture mésopotamienne, le système hiéroglyphique
n’a subi aucune transformation notable au cours de ses quarante siècles
d’histoire, mais il a donné naissance à deux formes d’écriture plus
cursives mieux adaptées aux matières fragiles :
l’écriture hiératique aux signes simplifiés et non figuratifs qui
permet une copie rapide. C'est l'écriture de l'administration et des
transactions commerciales mais elle sert aussi à noter les textes
littéraires, scientifiques et religieux. Ecriture quotidienne de
l'Égypte pendant près de deux millénaires et demi, elle fut évincée
de son emploi profane par une autre cursive, le démotique, dès lors
son usage fut limité aux documents religieux. Sur papyrus ou sur
ostraca, tracée à l'encre noire ou rouge avec un pinceau fait d'une tige
de papyrus, ou plus tard avec une plume de roseau taillée en
biseau et dont la pointe était fendue. Introduite par
les grecs, elle finit par supplanter le pinceau
traditionnel.
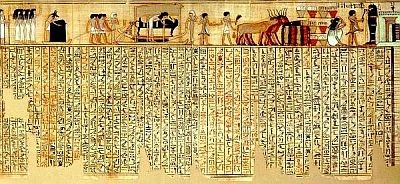
L’écriture démotique qui devient à partir du VIIe siècle avant
J.-C. l'écriture officielle. C'est la seule écriture égyptienne à
connaître une large utilisation dans la vie quotidienne (" démotique ",
du grec demotika, " écriture populaire "). Très cursive, riche en
ligatures et abréviations, elle a perdu, elle aussi, tout aspect
iconique.
Jusqu'en 1822 le mystère des hiéroglyphes fascinait
l'imagination. Durant quinze cents ans la connaissance de l'écriture
égyptienne s'était complètement perdue. Avant que Champollion ne perce
le secret de cette écriture sacrée les hiéroglyphes n'étaient que des
symboles mystérieux empreints de magie.
Le
système hiéroglyphique est complexe, il se fonde sur la combinaison de
trois catégories de signes: les phonogrammes, les idéogrammes et les
déterminatifs.
Les
éléments de notre écriture, les lettres, ne représentent qu'elles-mêmes.
Au contraire, les éléments de l'écriture égyptienne, les hiéroglyphes,
sont figuratifs, c'est-à-dire qu'ils représentent des êtres ou des
objets de l'univers pharaonique. Au demeurant, même un profane peut
identifier du premier coup d'œil, par exemple, un soleil, un oiseau ou
bien une barque. Les hiéroglyphes constituent donc des images.
traitées comme les autres images de l'art pictural égyptien, selon les
conventions propres à l'art égyptien: ainsi. le signe de l'homme assis
a-t-il la tête vue de profil, le torse de face, les jambes et les bras
de profil, etc...

Plus encore, il arrive que, dans une même scène, un objet soit
présent à la fois en tant que partie du tableau et en tant que signe
d'écriture.
Mais alors, qu'est-ce qui permet de distinguer le signe
d'écriture de la simple représentation, puisqu'il est image, lui aussi ?
Ce sont trois contraintes spécifiques.

Le
calibrage: les proportions respectives des hiéroglyphes ne correspondent
nullement aux proportions réelles des êtres et objets dont ils sont les
images.
La
densité de l'agencement : alors que les représentations se détachent au
milieu de larges blancs. les hiéroglyphes sont disposés de manière à
occuper le plus possible l'espace alloué. Ils y sont répartis en "
quadrats ", unités idéales divisant cet espace, et dont ils occupent le
quart, le tiers, la moitié ou la totalité. selon leur morphologie et
leur entourage. Il n'y a pas de séparation entre les mots et les
phrases.

L'orientation : dans une même ligne ou dans une même colonne, les
signes représentant des êtres animés et, plus généralement, les signes
dissymétriques sont tous orientés dans la même direction, qui est celle
du point de départ de la lecture. Cette lecture peut se faire de droite
à gauche ou de gauche à droite, horizontalement, et aussi verticalement
de haut en bas, chaque groupe se lisant de droite à gauche ou de gauche
à droite. Il y a donc quatre types majeurs d'agencement des
signes.


    
La
pierre de Rosette est un fragment de stèle en granite noir,
fréquemment assimilée à tort à du basalte, découverte dans le village de
Rachïd en juillet 1799 durant la campagne de Napoléon en Égypte. C'est
un jeune officier du génie, Pierre-François-Xavier Bouchard, qui
remarqua cette pierre noire de près d'un mètre de haut lors de travaux
de terrassement dans une ancienne forteresse turque. Lors de la
capitulation de 1801, les Anglais victorieux exigèrent la livraison des
monuments antiques, dont la pierre de Rosette. Mais dès 1800, une
reproduction du texte avait été envoyée en France pour y être
étudiée.
Les
inscriptions portées sur cette pierre se sont révélées être le même
texte reproduit selon trois systèmes d'écritures différentes: des
hiéroglyphes, du démotique et du grec. On crut, à ce moment-là, que le
mystère des hiéroglyphes allait être rapidement
percé.
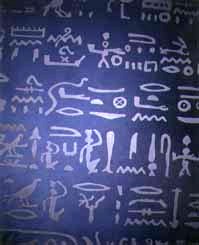
Ackerblad et Sylvestre de Sacy se lancèrent dans la première
tentative de déchiffrement, mais elle demeura vaine. Ce fut ensuite au
tour d'un savant anglais, Thomas Young, de se lancer dans un travail qui
sembla promis au succès. Hélas, Young ne connaissait pas le copte et peu
de textes anciens. Sur les signes hiéroglyphiques pour lesquels il
proposa une valeur, 5 seulement s'avéraient exacts, et il s'obstinait à
lire sur la pierre de Rosette Arsinoé, alors qu'y était mentionné, en
réalité, Autocrator. Si certains des signes présents dans les cartouches
étaient assez simples à trouver, ce fut parce qu'ils avaient été créés
pour rendre les voyelles des noms d'origine étrangère des derniers
souverains (Ptolémée, Cléopâtre, Alexandre).
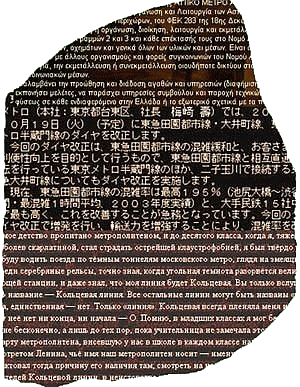
Jean-François Champollion, qui avait dix ans au moment de la
découverte de la pierre, se lança très jeune dans la bataille du
déchiffrement des hiéroglyphes. Il pressentit que la clé étaient la
connaissance des textes anciens et surtout du copte, langue parlée en
Egypte, et descendant de l'ancien égyptien. Un ami, l’architecte
Jean-Nicolas Huyot, avait envoyé des documents à Champollion le jeune.
Dans un cartouche, ce dernier repéra le signe solaire de Râ, un signe
qu'il savait être MS et 2 S : RâMSS, donc Ramsès, ce qui en même
temps veut dire Râ l’a mis au monde. Idem pour ThôtMS, Thoutmosis.Après
huit années de travail acharné, en 1822, il peut annoncer à la
communauté scientifique qu'il a percé le secret. Sa méthode était bonne,
puisqu'elle s'appliqua à la traduction d'autres textes
hiéroglyphiques.
Le
texte inscrit sur la pierre est un décret ptolémaïque de 196 av. J.-C.
La partie grecque de la pierre de Rosette commence ainsi: Le nouveau
roi, ayant reçu le royaume de son père... C'est un décret de Ptolémée V
Epiphane, décrivant des impôts qu'il abrogea (dont l'un est mesuré
en aroure et instituant l'ordre d'ériger des statues dans des
temples. La dernière phrase indique que ce décret devra être inscrit sur
une stèle de pierre dure dans l'écriture des mots des dieux
(hiéroglyphes), l'écriture populaire (démotique) et la langue
grecque.
La
pierre de Rosette mesure 114 cm de hauteur pour 72 cm de largeur et
environ 28 cm d'épaisseur, elle pèse 762 kgs.
Elle est exposée au British Museum à Londres, où elle est
conservée depuis 1802.
  

|