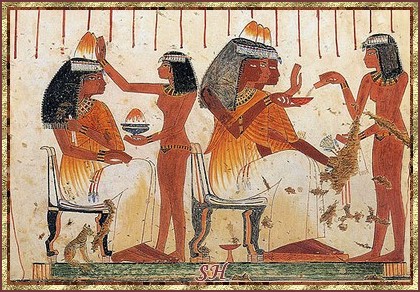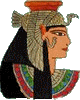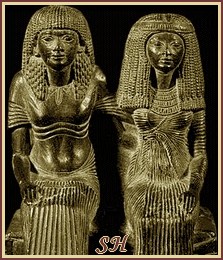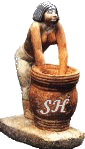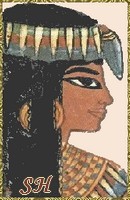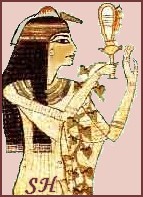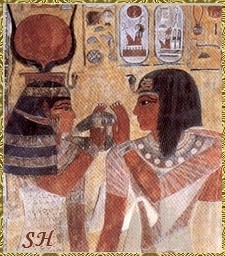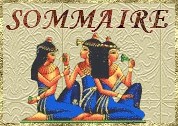|

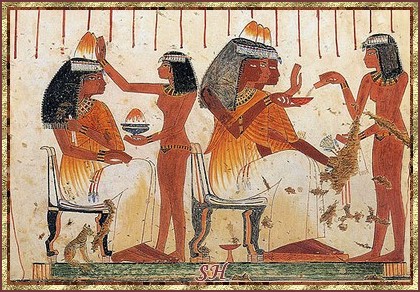
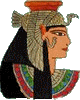
La femme de l'Egypte antique

L'importance
historique de l'ancienne civilisation égyptienne réside dans le
système des valeurs et des messages humanitaires qui a englobé tous
les aspects de vie et qui a formé, au fil de 7 mille ans, de
profondes racines. Parmi ces valeurs humanitaires les plus
importantes, figure la reconnaissance de l'importance du rôle de la
femme dans la société.
Cette valeur a été
pratiquement concrétisée en façonnant une position raffinée à la
femme égyptienne en tant que seul partenaire de l'homme dans sa vie
religieuse et profane conformément à la théorie de la création et de
la cosmogonie figurant parmi les principes religieux pharaoniques
qui prévoient l'égalité juridique complète et pour la 1ère
fois la liaison sacrée entre homme et femme à travers les contrats
de mariage éternels.
Cette position a
atteint le point de la vénération. C'est ainsi qu'existaient les
déesses à côté des dieux, telles la déesse de la sagesse qui avait
pris la forme de femme et la déesse Isis, symbole de la fidélité et
du dévouement.
La femme égyptienne
dans l'histoire pharaonique est également parvenue aux divers
domaines du travail, et a réussi à accéder au trône. Citons « Hotep », mère du roi Chéops ; « Khent », fille du
pharaon Mykérinos ; « Abah Hoteb », reine de Thèbes ; « Hatchepsout
», fille du pharaon Amon ; « Tiyi », mère de Akhnaton ...

La femme a de même exercé la magistrature, telle « Nepet »,
belle-mère du roi Pépi 1er de la 6ème
dynastie, et ce fait a été répété sous l'époque de la 26ème
dynastie.
La femme a également
travaillé dans le domaine de la médecine, telle « Psechet » qui a
porté le titre de grand médecin sous la 4ème dynastie.
Les femmes scribes ont accédé aux postes de (directrices, chef de
département des dépôts, observatrice des dépôts royaux, femme
d'affaires, prêtresse).
La femme égyptienne
menait une vie heureuse dans un pays où l'égalité entre les deux
sexes était un fait naturel. La civilisation pharaonique a également
promulgué les premières législations et lois gérant le rôle de la
femme, dont les plus importantes sont celles du mariage ou liaison
sacrée, qui déterminent les droits et les devoirs basés sur le
respect mutuel entre l'époux et l'épouse, la maîtresse de la maison
qui avait droit à l'héritage tout comme l'homme ; et en cas de
divorce sans raison, elle avait droit au tiers des biens de son
époux.
De même, l'ancien
égyptien s'attachait à ce que son épouse soit enterrée avec lui dans
le même cimetière. Partenaire dans la vie terrestre, elle le sera
après la résurrection.
Quant au droit à
l'enseignement, la femme égyptienne apprenait les sciences dès l'âge
de 4 ans, dans les écoles qui enseignaient les principes du calcul,
des mathématiques, de la géométrie et des sciences, en plus des
rudiments de la langue hiéroglyphique et de la langue hiératique
familière de la vie quotidienne.
Enfin, la fille
acquiert, tout à fait comme le garçon, le titre de « scribe
détentrice de l'encrier », et elle avait la possibilité de choisir
la spécialisation scientifique qu'elle voulait.

Parmi les dires du sage égyptien
concernant la nécessité de protéger la femme :
- « Il est sage d'aimer ta partenaire dans la vie et d'en prendre
soin, car elle prendra par la suite soin de ta maison ».
- « Tout au long de ta vie, prends soin d'elle, car elle est le don
des dieux qui ont répondu à tes prières et te l'ont octroyée..
Révérer le bienfait et satisfait les dieux ».
- « Ressens ses douleurs avant qu'elle n'en souffre ».
« Elle est la mère de tes enfants, si tu la rends heureuse et tu en
prends soin, elle fera de même avec eux. Elle est une consignation
dans tes mains et dans ton cœur, tu en es responsable devant Dieu le
plus Grand, puisque tu a juré dans son sanctuaire d'être pour elle
un frère, un père et un partenaire de vie ». Telle est la conviction
de l'ancien Egyptien.
Au cours de
l’histoire Égyptienne la condition des femmes a subi des changements
profonds. L’étude de cette condition dans la société pharaonique est
basée, principalement, sur des écrits masculins. L’ancienne
civilisation Égyptienne, fonctionnait sur le modèle patriarcal, où
le statut de la femme dépendait de son appartenance à une classe
sociale. La situation des Égyptiennes était bien meilleure que
celles des femmes dans les autres grandes civilisations antiques,
Rome, Grèce, Mésopotamie. Elle se dégradera d'ailleurs avec le poids
croissant de la culture hellénistique à la Basse Epoque.

La femme égyptienne dans la société
Les jeunes filles égyptiennes se marient en général vers l'âge de
douze treize ans. Le mariage d’amour devait aussi exister, mais
c’est le père qui choisissait le prétendant de sa fille, bien
souvent dans l'entourage immédiat. Il n'est pas rare que les
alliances matrimoniales soient contractées entre cousins, bien qu’il
soit difficile de définir les liens et degrés de parenté exacts. En
effet, le terme de "soeur", est aussi utilisé pour désigner
l'épouse. Il semble que le mariage entre frères et soeurs de sang ne
soit attesté qu'au sein de la famille royale. La monogamie semble de
règle, mais le chef de famille peu prendre des concubines et
légitimer les enfants qu'il a eus d'elles, si son épouse légitime ne
lui en a pas donnés. La polygamie n'est pas interdite, mais elle est
rare et semble être réservée aux puissants.
Une fois mariée, l'épouse devient " maîtresse de maison ", mention
qui précède désormais son nom. Elle règne sur la maisonnée qu’elle
doit gérer avec l'aide des servantes et des esclaves. Elle
accompagne son mari à la chasse, à la pêche, l'aide aux travaux des
champs, tisse, chante et danse. La maternité est une des fonctions
les plus importantes de la femme. Avoir des enfants est source de
considération sociale. L'éducation des filles comme des garçons est
confiée prioritairement à la mère durant les premières années.

La femme Égyptienne vit dans une société où les responsabilités
principales sont tenues, à tous les niveaux, par des hommes. Elle
n’est pas enfermée chez elle ou dans un harem, contrairement à la
femme grecque. Les représentations nous la montrent boulangère,
tisseuse, musicienne, danseuse, jardinière ou fermière. Bien que
spécifiquement féminines ces occupations lui font une place dans la
société où elle joue un rôle actif. Dans les classes supérieures, il
est possible que ces femmes aient reçu un certain niveau
d’instruction et que la pratique de l’écrit ne leur fut pas
inconnue, bien qu’aucune expression littéraire ou artistique
Égyptienne émanant d’auteurs féminins ne soit attestée. Elles ne
pouvaient accéder à la hiérarchie civile, mais à la Basse Époque les
femmes purent occuper de hautes fonctions sacerdotales au sein du
clergé d’Amon de Karnak.
La femme et le droit égyptien
Le Droit Égyptien indique clairement que la femme Égyptienne
détenait des droits égaux à celui de son père, de son frère ou de
son époux. Elle était propriétaire de ses biens propres et se voyait
reconnaître des acquits, un droit sur les biens acquis en commun
durant la période du mariage. Il lui était possible de mener seule
sa propre affaire, de participer à des transactions économiques,
d’hériter de propriétés, de posséder et de louer la terre et de
participer en tant que témoin ou partie, à des affaires judiciaires.
Elle peut aussi transmettre son patrimoine à la personne de son
choix.
La réalité est tout autre. Par sa position entre l’Asie et de
l’Afrique, l’Égypte subit l’influence de ces deux continents. Au
plan physique, la femme est ainsi perçue comme inférieure à l’homme.
Il est reconnu à l’homme marié d’avoir des relations sentimentales
avec d’autres femmes qu’elles soient veuves ou célibataires. La
femme mariée, au contraire, pour mieux assurer la société de la
paternité réelle des enfants nés ou à naître, se doit d’être fidèle.
Malheur à la femme adultère socialement réprouvée. Le viol, s’il est
perçu comme répréhensible, dans le cas d’une femme mariée, ne semble
pas poser a priori de problème éthique insurmontable.
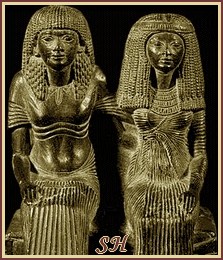
Représentation de la femme dans l’art
Le teint de la peau féminine est rendu par l’emploi de l’ocre jaune
tandis que l’épiderme masculin est traduit par l’ocre rouge. Il
s’agit là de conventions reflétant la nature des occupations de l’un
et de l’autre: la femme, à l’abri, veillant à la conduite de la
maison; l’homme exposé à l’ardeur des rayons de soleil. L’aspect
plus ou moins foncé de l’épiderme dénonce le statut plus ou moins
privilégié de l’individu. En sorte qu’un haut fonctionnaire de
l’Ancien Empire aura à cœur de se faire représenter avec une
carnation plus claire que ses sujets, contraints de vaquer à leurs
occupations au soleil.
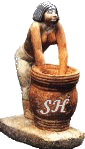
Dans la sculpture et le bas-relief l’homme et la femme sont souvent
représentés de taille ou d’échelle différente. Ce qui a été
considère comme la preuve d’une inégalité de statut entre les deux
sexes dans la société Égyptienne. Mais après une étude plus
approfondie de ces représentations on se rend compte que ses
constatations ne sont pas exactes. Un nombre important d’exemples
montre que la femme est représentée sur un pied d’égalité avec son
époux. La gestuelle des statues de couple laisse transparaître la
tendresse de l’épouse plus que sa soumission. Dans certains cas la
figuration de l’épouse et des enfants {la famille} sont avant tout
des représentations magiques du défunt. Les figurations de l’épouse
et des enfants forment des compléments permettant de mieux définir
la personnalité de l’homme élevé sur un piédestal.
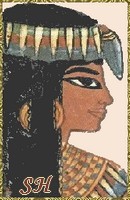
La femme dans la mythologie
Dans la cosmogonie le démiurge est généralement représenté sous un
aspect masculin, mais les diverses cosmogonies égyptiennes se
fondent sur la complémentarité des deux sexes. Certaines déesses
font exception à cette règle. A Saïs et Esna Neith est considérée à
comme à l'origine de la création, Methyer donne naissance au soleil,
Nekhbet qui est la divinité primordiale de sa ville de Nekheb.
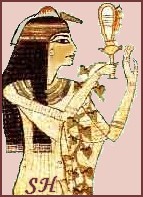
La notion de féminin se retrouve également dans les mythes et des
légendes religieuses. Nout, participe au périple quotidien du
soleil. A l'aube, elle met le soleil au monde pour l'avaler à
nouveau le soir. Rê poursuit alors son voyage à travers le corps
constellé d'étoiles de la déesse et renaît chaque matin. Hathor
participe au mythe de la destruction de l'Humanité. Maât, symbole de
la justice et de l'ordre cosmique qui assure la juste marche du
monde. Isis, la grande magicienne, don le rôle de mère et d'épouse
dévouée est primordial dans la légende osirienne.
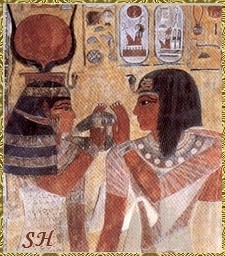

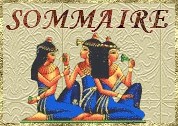
|