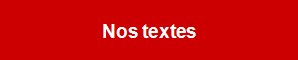JACQUES CHIRAC a
raison. L'ampleur du non au référendum du 29 mai s'explique,
en bonne partie, par un refus du « modèle anglo-saxon »,
perçu par les salariés français comme un univers de
concurrence impitoyable, où l'emploi se paye de salaires
très faibles, d'emplois précaires et d'une hyper-flexibilité
du travail. Le tout sur fond d'inégalités sociales acceptées
par les Britanniques, mais qui sembleraient insupportables
ici. Comme l'a relevé, au lendemain du scrutin français, la
Confédération européenne des syndicats (CES), qui avait
défendu le oui, « il ne semble pas que -le non français-
soit un rejet de l'Europe en général, mais un rejet de
l'Europe néolibérale ». « Le marché intérieur, précise la
CES, doit être associé à une dimension sociale forte,
prenant en compte les préoccupations des travailleurs et des
syndicats. »
Contrairement à une
idée répandue, les Français ne sont pas les seuls Européens
à exprimer des attentes sociales à l'égard de l'Europe. Mais
l'Hexagone a, sur cette question, une sensibilité à fleur de
peau, entretenue par de multiples facteurs.
L'un d'eux est qu'on
ne peut pas demander à un peuple qui a fait une révolution,
guillotiné son roi et pendu les aristocrates « à la lanterne
» d'avoir exactement la même conception des rapports sociaux
qu'une monarchie où l'une des deux Chambres du Parlement est
exclusivement composée de lords...
Deuxième facteur, plus
immédiat, et sans doute plus déterminant : la sociologie
française. Si l'on admet que le vote du 29 mai exprimait
souvent une angoisse, ou une colère sociale, l'ampleur de la
vague de protestation s'inscrit dans une réalité souvent
ignorée.
De nombreux hommes
politiques ou analystes n'ont jamais compris, ou admis, que
les résultats du recensement de l'Insee de 1999 avaient
enterré le rêve giscardien d'une France devenue une sorte de
gigantesque classe moyenne, avec, comme figure emblématique,
le cadre moderne et à l'aise, dans tous les sens du terme.
Le recensement
révélait au contraire que les employés et les ouvriers
représentent 56,9 % de la population active. Un « groupe
central » s'est bien constitué dans la société française,
mais pas celui qui était attendu dans les années 1970. Les
ouvriers ont reculé, mais pas disparu. Les employés, eux,
ont beaucoup augmenté. Et les réalités quotidiennes vécues
par ces deux catégories se sont rapprochées, par le bas.
Les chiffres de
l'Insee indiquaient, par exemple, que les salaires moyens
des deux catégories étaient très proches. Si l'on y ajoute
les petits paysans, la partie inférieure de ce qu'on appelle
les « catégories intermédiaires », les familles de ces
travailleurs occupés ou chômeurs, les retraités de ces
secteurs, il apparaît que toutes ces couches modestes
représentent une bonne part de l'électorat, alors que
l'ensemble des cadres et les « professions intellectuelles
supérieures » n'atteignent que 12,1 % de la population
active.
Le troisième facteur
qui a nourri le rejet du projet de Constitution est le
sentiment d' « insécurité sociale » qui caractérise ces
catégories. L'accroissement des inégalités, continu depuis
une vingtaine d'années, les touche de plein fouet, y compris
le risque de chômage, qui les menace plus que les cadres. Et
cette angoisse sociale déborde, aujourd'hui, pour gagner les
catégories moyennes. L'état d'esprit de nombreux Français «
ordinaires », en principe bien insérés dans la société, est
en effet de plus en plus marqué par un sentiment, non
seulement d'insécurité, mais aussi d'injustice.
Ce sentiment
d'insécurité est lié, bien sûr, au chômage, aux
délocalisations, y compris à l'intérieur de l'Europe
élargie, aux licenciements « boursiers » ou « financiers »,
provoqués non par les difficultés d'une entreprise mais par
la volonté d'augmenter sa rentabilité. Le sentiment
d'injustice et d'insatisfaction vient, lui, de la
comparaison entre les revenus moyens de la population, d'une
part, et les profits des grandes entreprises et les
rémunérations de leurs hauts dirigeants, d'autre part. De ce
point de vue, l'augmentation récente des bénéfices des
entreprises du CAC 40 de 64 % sur un an ou les conditions
financières du départ du PDG de Carrefour ont eu un effet
ravageur quand, dans le même temps, le Medef expliquait que
l'augmentation des salaires mettrait en péril l'économie et
jugeait le smic trop élevé.
Ces distorsions
spectaculaires illustrent et renforcent une double rupture.
Comme le résume Olivier Marchand, économiste de l'Insee, «
l'une des conditions de l'intégration dans l'économie
mondialisée est (...) d'opérer une déconnexion entre la
nation et son économie, entre la société et l'entreprise,
qui n'ont plus les mêmes intérêts » (Plein emploi,
l'improbable retour, « Folio actuel », 2002). Le capital,
plus que jamais nomade, s'investit dans un pays puis le
quitte, en fonction des espoirs de gain, souvent sans
considération pour les usines fermées et les travailleurs
abandonnés à leur sort. Dans sa forme extrême, c'est le
phénomène des « patrons-voyous ».
CONTEXTE DE DIVORCE
Cette première rupture
en a entraîné une seconde. Jusqu'aux années 1970, le pacte
social implicite de l'économie française - qui n'empêchait
évidemment pas les tensions et les revendications - reposait
sur la fameuse formule du chancelier social-démocrate
allemand Helmut Schmidt : les profits d'aujourd'hui font les
investissements de demain et les emplois d'après-demain. Or
ce principe est désormais rendu caduc par une mondialisation
fondée sur le modèle anglo-saxon du capitalisme, marqué par
la volonté de profit immédiat et maximum des actionnaires,
au détriment du modèle rhénan ; en fait un capitalisme «
raisonnable », stable, investi dans le moyen terme, avec un
ancrage territorial et la recherche de la paix sociale.
Résultat de ces deux
ruptures : une dégringolade de l'image des entreprises dans
l'opinion depuis vingt ans.
Du côté de l'Etat, la
lutte contre le chômage est certes une priorité affichée par
tous les gouvernements, et exprimée par le plan de cohésion
sociale de Jean-Louis Borloo dans les derniers mois du
gouvernement Raffarin. Mais, alors même que ces plans ne
parviennent pas à contrer le chômage de masse, les salariés
savent aussi qu'ils peuvent de moins en moins compter sur la
protection de l'Etat.
Les gouvernements
successifs leur ont fait comprendre que, dans une économie
privatisée et mondialisée, les pouvoirs publics ne peuvent
plus guère, et ne doivent plus, interférer dans la vie des
entreprises. Seuls des moyens indirects, mis en oeuvre par
les élus locaux ou l'Etat, peuvent tenter de peser sur les
décisions d'implantation ou de délocalisation.
Le référendum a eu
lieu dans ce contexte de divorce entre les salariés et
l'entreprise - bien différent de celui des années 1980,
quand les socialistes avaient réussi à valoriser l'image des
entreprises aux yeux de l'opinion - et d'incompréhension
croissante entre les citoyens et les pouvoirs publics.
Or, au fil du débat
sur le projet de traité constitutionnel, beaucoup
d'électeurs ont été confirmés dans l'idée qu'ils n'avaient
guère de protection à rechercher du côté d'une Europe où les
principes du néolibéralisme, inscrits dans la politique de
l'Union et consacrés par le projet de Constitution, sont
perçus comme une atteinte directe au fameux « modèle social
français ».
Après le premier
séisme de l'élection présidentielle de 2002, les sociologues
Stéphane Beaud et Michel Pialoux avaient expliqué dans les
colonnes du Monde que « la gauche a négligé le sentiment
d'insécurité né du chômage et de la précarité ». La même
critique pourrait aujourd'hui être adressée à l'ensemble des
partisans du oui.
Jean-Louis Andreani