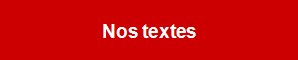|
Interview de Laurent FABIUS
L’Humanité
17 mai 2005
Question : Vous avez milité en faveur de
la ratification du traité de Maastricht, approuvé les traités
d’Amsterdam puis de Nice. Pourquoi vous opposer aujourd’hui au
projet de Constitution européenne ?
A l’époque, j’ai approuvé le Traité de
Maastricht parce qu’il contenait une avancée majeure : l’euro.
Malgré ses insuffisances actuelles - il reste encore trop
cher -, ce peut être un instrument de stabilité et de puissance
dans le concert mondial. La monnaie unique doit permettre à
l’Union européenne, donc à la France, de rééquilibrer le rapport
monétaire des forces avec les Etats-Unis. Elle doit nous aider à
affronter le choc du développement de la Chine. Mais Maastricht
ne représente pas la fin de l’Histoire ! C’était un premier pas
vers l’Europe de la croissance, de l’emploi et du social.
C’était d’ailleurs la vision de François Mitterrand. On est loin
du compte. La Banque centrale, arc-boutée sur la sacro-sainte
stabilité des prix et indépendante du pouvoir politique, ne se
donne pas les moyens de lutter contre le chômage et la
précarité. Il y a plus de 20 millions de chômeurs et voilà que
l’on nous propose de constitutionnaliser dans l’Europe à 25, 27
et bientôt 30, des politiques qui privilégient l’hyper-concurrence
au détriment de la production, des salaires, de la recherche, de
l’innovation. C’est l’une des raisons qui m’ont conduit à dire
« non ». Je suis pro-européen, partisan et artisan de l’Europe.
Mais je tire les leçons de l’expérience au gouvernement. C’est
le sens de mon vote : « non » pour une Europe plus sociale.
En quoi les perspectives ouvertes par ce
traité constitutionnel sont-elle porteuses, pour reprendre une
expression que vous avez utilisée, d’un « risque terrible de
décrochage social » ?
J’ai toujours conçu la construction
européenne comme un mouvement qui permettait, lentement mais
sûrement, une harmonisation économique et sociale vers le haut.
Quand on est de gauche et pro-européen, on est
internationaliste : on veut une Union qui rapproche les peuples
et les modèles sociaux. Avec le dernier élargissement, l’Europe
a changé de nature : les pays qui la composent désormais - et
qui ont pleine légitimité à le faire - sont très hétérogènes.
Les vieux schémas ne fonctionnent plus. Si la Constitution est
adoptée, chaque pays continuera, par exemple, de disposer d’un
droit de véto en matière fiscale. Quand les Etats membres
possédaient un niveau comparable de fiscalité, cette règle ne
posait pas problème. Mais aujourd’hui, chez certains nouveaux
entrants, la fiscalité sur les sociétés ne dépasse pas 10 %,
quand elle n’est pas tout bonnement de... 0%. Comment nier que
cela exercera une pression à la baisse sur notre propre impôt
sur les sociétés, à nous Français, Allemands ou Espagnols ?
S’ensuivra une chute des ressources publiques de l’Union,
préjudiciable à l’emploi, dommageable pour les services publics
et les territoires. Il en va de même dans le domaine social. Le
projet actuel de Constitution interdit à l’Union de procéder à
l’harmonisation sociale par le haut. Or, les différences sont
considérables entre les nouveaux membres et les anciens ; la
concurrence sera farouche. Salaires, protection sociale, droit
du travail, pensions - notre modèle social risque d’être tiré
vers le bas. Voilà pourquoi j’ai parlé de risque de décrochage
social.
Rien, juridiquement, ne s’oppose à une
renégociation. Jacques Delors lui-même en convient désormais.
Mais sur quelles bases politiques renégocier ?
La déclaration 30, annexée au Traité
constitutionnel, prévoit que si, en novembre 2006, des pays ont
refusé le traité, les chefs d’Etat se réunissent et réexaminent
la situation. En langage courant, cela veut dire qu’il y aura
une nouvelle discussion. Et la nouvelle Constitution ne doit
entrer en application qu’en 2009. Dans cette perspective, il est
très important que le « non » de la France soit un « non »
pro-européen et social. Car d’autres pays auront des positions
différentes des nôtres et la renégociation sera, comme toujours,
serrée. La France ne peut pas à elle seule imposer son point de
vue. Mais elle ne doit pas pour autant renoncer à ses exigences.
Avec un vote clair des Français en faveur d’un « non » de
changement, le France sera en position solide. La renégociation
devra porter, selon moi, sur trois points essentiels : écarter
la partie III sur les politiques concrètes, qui n’a rien à faire
dans une Constitution ; rendre le texte révisable ; lever les
restrictions permettant les coopérations renforcées,
c’est-à-dire permettre aux pays qui veulent aller plus loin et
plus vite ensemble, comme la France et l’Allemagne, de pouvoir
le faire. Ainsi revue, la Constitution ne sera pas parfaite,
mais au moins ne sera-t-elle pas verrouillée. Ce sera un pas
vers l’Europe sociale que nous souhaitons.
Martine Aubry vous accuse, à propos des
délocalisations, « d’attiser les peurs » et de « considérer les
pays étrangers comme nos ennemis »...
Je me suis donné une règle, à laquelle je ne
dérogerai pas : je ne rentre dans aucune polémique avec aucun
des responsables de gauche. Quant aux délocalisations, elles
existent, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe,
et ce n’est évidemment pas jouer sur les peurs de constater les
faits. Je suis élu d’une région, la Haute-Normandie, où les
délocalisations ne sont pas un fantasme hélas, mais déjà une
douloureuse réalité. « Le courage, disait Jaurès, c’est de
chercher la vérité et de la dire » : reconnaître l’ampleur du
phénomène des délocalisations, c’est dire la vérité. Y faire
face ne sera pas facile, mais c’est nécessaire. En ce qui
concerne les délocalisations en Europe même, l’urgence consiste
à aider beaucoup plus massivement les pays qui nous ont
rejoints. C’est notre intérêt commun. Cela suppose un budget
européen revu à la hausse - ce que précisément refuse Jacques
Chirac qui réclame, au contraire, sa réduction ! Autres
décisions indispensables : une fiscalité minimale, par exemple
pour l’impôt sur les sociétés, et un objectif de progression
sociale vers le haut. Or, comme je vous l’ai dit, ces deux
dernières mesures sont écartées par la Constitution (article
III-210). C’est grave. Cela veut dire que demain, si ce texte
entre en vigueur, nous serons démunis face au phénomène des
délocalisations.
Comment lutter contre les délocalisations
vers l’extérieur de l’Europe ?
Le développement des pays émergents est une
source de satisfaction pour tous ceux qui, comme moi, sont
préoccupés par le sous-développement. Mais pour qu’il se fasse
dans l’intérêt de tous, il doit être équilibré et régulé. Si on
ne se décide pas à discuter sérieusement au niveau mondial des
implications sociales, environnementales, énergétiques,
monétaires de la croissance de la Chine ou de l’Inde, celle-ci
sera source de déséquilibres planétaires. Pour un pays comme le
nôtre, il deviendra très difficile d’avoir une industrie forte.
Or il ne peut y avoir de croissance durable sans base
industrielle solide. Aujourd’hui, l’Europe ne possède pas les
moyens de réagir efficacement. Le cas du textile constitue une
bonne illustration. Les ministres multiplient les déclarations
d’intention. Mais au rythme où vont les choses, les entreprises
textiles de France auront déjà fermé quand on se décidera à
prendre des mesures ! Et je crains que le scénario ne se
reproduise pour le meuble voire, à terme, pour l’automobile. La
Constitution n’apporte pas de changement significatif dans ce
domaine.
Longtemps, beaucoup ont cru à un
« rééquilibrage automatique » et compté sur une augmentation
future rapide des salaires dans les pays émergents, sur notre
avance technologique et sur des coûts de transport dissuasifs.
Cette analyse rassurante est aujourd’hui dépassée. Le poids
démographique de pays comme la Chine et l’Inde exerce une
pression massive sur les salaires. Ils ont accompli des progrès
technologiques colossaux. La révolution de l’information lève
l’obstacle du coût des transports.
Nous devons donc concevoir un autre modèle de
régulation mondiale. Et c’est à l’Europe de le proposer, d’une
façon généreuse et solidaire. Dans le même temps, nous devons
permettre à nos propres industries d’évoluer, par la formation
et le développement technologique, pour offrir des emplois.
C’est pourquoi nous avons besoin d’une grande ambition
européenne pour l’industrie, la recherche et la technologie.
Passer à côté de ces questions, c’est occulter des problèmes
parmi les plus importants auxquels nous serons confrontés, ainsi
que nos enfants, dans les 20 ans qui viennent. Evitons de le
faire avec cette Constitution.
Votre expérience au gouvernement Jospin,
puis la réflexion sur l’échec de la gauche en 2002, ont-elles
contribué au cheminement qui vous conduit à défendre le non ?
Bien sûr. La défaite de Lionel Jospin est
aussi une défaite collective. J’en assume, comme d’autres, ma
part de responsabilité. Parmi les nombreuses causes de l’échec
du 21 avril 2002, il y a bien sûr la division de la gauche et
aussi le constat d’une prise de distance avec des millions
d’ouvriers, d’employés, d’enseignants, de retraités, de jeunes.
Depuis trois ans, j’en ai tiré des enseignements, notamment en
prônant une « opposition frontale » à la droite, c’est-à-dire à
la fois résolue et responsable. De même, j’observe qu’une large
partie du peuple de gauche se rassemble aujourd’hui sur le
« non ». Ce n’est pas un hasard et c’est un magnifique espoir.
Le rassemblement à gauche reste pour moi une nécessité absolue.
Une victoire du « oui »
compromettrait-elle la possibilité de mener, dans le futur, une
politique de gauche ?
Si on souhaite développer la recherche
scientifique, l’éducation, une politique des transports, les
services publics, il faut disposer des moyens financiers
nécessaires. Or, la Constitution ne permettra pas à l’Europe de
mener une politique budgétaire suffisante : l’unanimité est
requise et l’emprunt est interdit. Dans le même temps, le pacte
de stabilité gravé dans le marbre constitutionnel risque
d’empêcher les États membres de mener une politique de
croissance. Autrement dit, ce que l’on ne pourra pas faire au
niveau européen, on ne pourra plus le faire au niveau national.
Dans une telle Europe, une politique de gauche en faveur de
l’emploi et du progrès social serait très difficile. Les
libéraux, comme Nicolas Sarkozy, commencent d’ailleurs à sortir
du bois et à reconnaître publiquement que c’est la véritable
raison de leur soutien à cette Constitution. Pour l’UMP et le
MEDEF, l’Europe libérale passe par le « oui ». Et ils veulent se
servir de l’Europe libérale pour obliger à des orientations
régressives en France. Le choix est clairement entre l’Europe
sociale et l’Europe libérale. Pour préparer l’alternance de
demain, il faut commencer par voter « non » aujourd’hui |