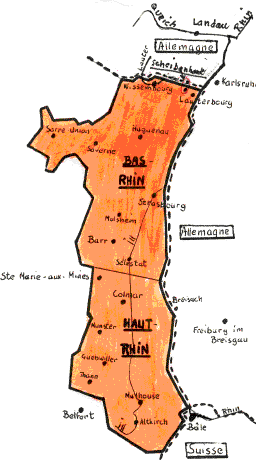| L'ALSACE, pays favorisé par la nature et prospère, a certes beaucoup de facettes, Mais sa personnalité est profondément marquée par sa géographie, son histoire, et sa spécificité linguistique et culturelle. | |||
I. sur la géographie: | |||
| |||
- la situation:
* l' Alsace est située à l'un des plus importants carrefours politiques et culturels de l'Europe.
* En effet, quels que fussent les aléas de l'histoire, l'Alsace a toujours été située au carrefour de deux grands univers culturels et linguistiques: l'univers français et l'univers allemand.
C'est la situation géographique qui a marqué le passé et orientera l'avenir de l'Alsace.
Mais l'Alsace ne doit son originalité non pas à
sa géographie, mais à son histoire.
- Une entité historique?
* Le nom "Elsass"/"Alsace"
- la 1ère forme a été latine: Alesacius, dont est dérivé la dénomination "Alsace".
- Plus tard apparaîtront les formes germaniques Alisagowe, Elisaza, Elsaza
- "Elsass" figure pour la première fois dans des documents remontant au VII° siècle.
Le terme est donc beaucoup plus ancien que ceux de "Deutschland" ou de "France".
L'Alsace
Bas-Rhin et Haut-Rhin
*Au VII° siècle, l'Alsace a été un duché: le Herzogtum Elsass (Eticho(n), le père de Ste Odile)
* Plus tard, elle deviendra un Herzogtum Elsass und Schwaben qui,
sous le règne des Hohenstaufen , aux XII° et XIII° siècles, a joué un rôle politique important en Europe occidentale. La fin de la dynastie des Hohenstaufen marquera également la fin d'une Alsace formant une entité politique.* L'une des conséquences des Traités de Westphalie en1648 a été l'intégration au XVII° siècle de l'Alsace dans le Royaume de France. Avec la création de la "Province d'Alsace", Louis XIV redonne ainsi à l'Alsace un semblant d'unité politique.
En 1871, la Prusse fera de l'Alsace et de la Lorraine annexées une Terre d'Empire : le Reichsland "Elsass-Lothringen" (la Terre d'Empire Alsace-Lorraine).En 1911, " l'Alsace-Lorraine" se voit octroyer une autonomie partielle. Trop peu et trop tard pour donner aux Alsaciens la conscience d'un Land autonome.
*Son identité historique, l'Alsace ne la doit pourtant pas à ce passé lointain,où pendant de brèves périodes, elle a formé une entité politique, mais à une évolution historique qui, pendant la longue période de confrontation entre l'Allemagne et la France pour l'hégémonie en Europe, a fait de l'Alsacien et, partant de l'Alsace, "un cas unique" , comme l'a fait remarquer Émile Baas dans son livre Situation de l'Alsace, (p.35 suiv.) .
- un "cas unique ", pourquoi?
* Non seulement l'histoire de l'Alsace ne recouvre pas entièrement l'histoire de la France ni évidemment celle de l'Allemagne, mais elle se distingue de celle de toutes les régions ou pays ayant également été occupés, voire annexés momentanément soit par la France soit par l'Allemagne au cours des guerres que ces deux pays se sont livrés.
* L'Alsace est aujourd'hui une région française et le sentiment national des Alsaciens est français. Mais jusqu'au XVII° siècle, l'Alsace était partie intégrante du Saint-Empire Romain de Nation Allemande (das Heilige Römische Reich Deutscher Nation), ce qui de par sa langue et sa culture - allemandes - n'avait absolument rien d'anormal.
* La Suisse et le Luxembourg ont également fait partie du Saint Empire Romain de Nation Allemande. Mais ces deux pays sont aujourd'hui des États indépendants.
Pas l'Alsace!
* D'autres régions françaises, comme la Bretagne et le Pays Basque, par exemple, ont également été intégrés dans le Royaume de France au cours des siècles, mais, depuis, ils sont toujours restés au sein de l'État français.
Pas l'Alsace!
* L'Alsace a été contrainte à quitter l'État français par deux fois pour être intégrée dans l'État allemand: en 1870: de jure - et en 1940: de facto
* Le Palatinat, même Hambourg, Brême, Coblence ont déjà été placés sous la souveraineté française et ont donc fait partie de l'État français. Le frère de Napoléon, Jérôme a même été Roi de Westphalie, mais aujourd'hui le Palatinat, Brême, Coblence et la Westphalie sont évidemment depuis longtemps de nouveau allemands.
Pas l'Alsace!
L'Alsace restera finalement française.
- Ce bref aperçu historique montre
que l'Alsace (avec la partie germanophone de la Lorraine) est le seul pays faisant autrefois partie de l'univers politique, linguistique et culturel allemand qui en a été définitivement séparée
+ non seulement sur le plan politique comme, par exemple, la Suisse et le Luxembourg
+ mais également sur le plan linguistique et culturel.
Et c'est là qu'est la différence fondamentale.
* Cette évolution a marqué profondément la psyché alsacienne. En effet, l'Alsace possède non seulement une histoire qui lui est propre, mais la perception qu'en ont les Alsaciens conscients d'eux-mêmes diffère de celle qu'en ont en général les autres Français et, bien sûr, les Allemands.
* A la vérité, consciemment ou non, les Alsaciens ont développé un sens de l'histoire qui leur est propre, même si en des moments particulièrement dramatiques, ils ont partagé leur histoire avec celle de l'Allemagne ou celle de la France tout entière.
* Mais ce n'est qu'avec leur propre histoire que les Alsaciens peuvent s'identifier pleinement.Et ce n'est que si l'on prend en compte toute l'histoire de l'Alsace que l'on peut comprendre la spécificité de son identité linguistique et culturelle.
III. sur la situation linguistique et culturelle:
| Le problème linguistique en Alsace était
toujours et est encore aujourd'hui fondamentalement un problème
culturel, étant bien entendu, qu'on ne peut jamais séparer
complètement la langue de la culture qu'elle véhicule et
que l'Alsace possède non pas une, mais deux langues et
... un dialecte. Pour comprendre d'une part, pourquoi le problème de l'identité linguistique et culturelle concerne tout le corps social alsacien et, d'autre part, pourquoi la question des langues revêt une telle importance, il faut réfléchir aux sources culturelles auxquelles l'Alsace puise sa substance depuis des siècles. |
*Les sources culturelles de l'Alsace sont au nombre de trois:
la source française, la source allemande et la source proprement alsacienne.
* la source française
1° Bien avant le 17° siècle, lorsque l'Alsace entra dans le giron français, une large fraction de la bourgeoisie alsacienne avait déjà eu accès à la culture de langue française.
* Gottfried von Straßburg (1157-1215) doit sa célébrité à son poème "Tristan und Isolde ". A Paris, où il a étudié, il a eu l'occasion de connaître le "Tristan" de Thomas de Bretagne. Et Johann Fischart (XVI°siècle) s'est inspiré du "Gargantua" de Rabelais pour écrire son célèbre ouvrage: "Die Geschichtsklitterung ".
* Pourquoi?
- Évidemment parce que, dans le monde de langue allemande de l'époque, l'Alsace était la région allemande la plus proche de la France,
- mais aussi parce que la culture de langue française jouissait alors d'un incomparable prestige dans toute l'Europe.
2° Mais jusqu'au 19° siècle, les Alsaciens, dans leur immense majorité, n'en bénéficièrent guère:
- ils n'avaient qu'une connaissance rudimentaire du français
- ils continuaient de vivre avec et dans leur dialecte et, ceux qui savaient écrire, utilisaient l'allemand.* Sans doute langue et culture sont-elles deux choses distinctes, mais c'est évidemment la langue française qui permet d'accéder à la source culturelle française.
* Cela a posé pendant longtemps de sérieux problèmes aux Alsaciens. C'est que, du jour au lendemain, on peut faire changer un peuple de nationalité, mais pas de langue!
* Il n'en rest pas moins que l'acquisition de la langue française et l'ouverture sur l'une des plus riches cultures du monde qui en a été la conséquence, ont constitué un enrichissement culturel considérable pour l'Alsace et les Alsaciens.
3° Aujourd'hui, le français occupe en Alsace une position tellement forte que quelques mots suffiront pour faire saisir le rôle qu'il joue dans la vie des Alsaciens.
- Le français n'est pas seulement "langue officielle", mais également "langue nationale".
- Depuis la Révolution, le principe de la politique linguistique française repose sur le slogan "une nation, une langue".
- Fondamentalement, la mise en oeuvre depuis 1982 du "programme pour la promotion des langues et des cultures régionales de France" et même les mesures qui ont été prises récemment n'y ont rien changé.
- Comme tous les citoyens français, l'Alsacien doit pouvoir
- communiquer avec tous ses compatriotes français, que ce soit en Alsace ou ailleurs
- participer, sans être freiné par l'obstacle de la langue, à la vie politique, sociale, économique, culturelle de la France tout entière.Il n'est donc pas étonnant que le français soit aujourd'hui en Alsace la langue largement dominante.
- A tel point d'ailleurs que chez la jeune génération d'Alsaciens, la question n'est plus de savoir
- si elle dispose des ressources linguistiques nécessaires pour pouvoir accéder aisément à la source française de la culture en Alsace
- mais si elle possède encore assez de ressources linguistiques pour pouvoir puiser à la source allemande de la culture en Alsace.
* la source allemande
1° Jusqu'au XVII° siècle, comme tous les pays de langue allemande, l'Alsace a fait partie de l'univers culturel allemand.
+ Elle a non seulement été un témoin privilégié de la vie culturelle allemande, mais encore y a participé de façon particulièrement significative.
* Si le XVI° siècle a été appelé le Grand Siècle Alsacien, ce n'est par mégalomanie, mais parce qu'une pléiade d'Alsaciens de marque ont été parmi les plus grands acteurs de la vie culturelle allemande.
* Que l'on songe à des hommes comme
* Geiler de Kaysersberg (1445-1510)
* Jakob Wimpfeling (1450-1528), le "Praeceptor Germaniae"
* Thomas Murner (1475-1537), son rival, avec son ouvrage "Germania Nova"
* Sebastian Brant (1458-1521) et son incomparable "Das Narrenschiff" (La Nef des Fous)
* Beatus Rhenanus (1485-1547), l'humaniste et ami d'Erasme de Rotterdam, [Beatus Rhenanus était un fils du boucher Antoine Bild, surnommé Rhinower, c.à.d. de Rhinau, mais né à Sélestat où sa famille s'était établie depuis longtemps, l'un de ses ancêtres avait d'ailleurs été bourgmestre de Sélestat]
* Johann Fischart (1546-1590), le grand poète et satirique strasbourgeois.* Il convient aussi de souligner le rôle considérable
- que l'Alsace [Johann Sturm et Jakob Sturm]
- et des Alsaciens [Martin Bucer/Butzer, de Sélestat (1491-1551) - Wolfgang Capito(n) /Köpfel, de Haguenau] ont joué dans le mouvement de la Réforme qui a été à la fois une révolution religieuse et une révolution culturelle.* C'est en Alsace, à Strasbourg,
- qu'a été imprimée la première Bible dans la langue de Luther, c'est-à-dire en allemand
- que la messe a été dite pour la première fois en allemand (en 1524), c'est-à-dire à peine deux ans après la traduction de la Bible par Martin Luther
- et qu'est paru le premier journal imprimé en allemand.
2° Pendant des siècles, le Rhin a été un axe culturel de tout premier ordre et ce n'est pas sans raison que l'on parle parfois de "culture rhénane" qui, soit dit en passant, lorsque déjà on en parle, doit désigner ce qu'elle représente et non pas être un euphémisme pour "culture de langue allemande".
- Certes, le traité de Westphalie en 1648 et puis la Capitulation de la ville de Strasbourg en 1681 ont constitué une profonde césure dans la vie culturelle de l'Alsace,
- mais pratiquement jusqu'au lendemain de la Deuxième guerre mondiale, il y a toujours eu des Alsaciens qui ont occupé une place importante dans la vie culturelle d'expression allemande.
* Pour comprendre la place que l'allemand
a occupé et doit pouvoir occuper dans la formation de la personnalité
alsacienne, il ne suffit pas de connaître l'histoire de l'Alsace,
il faut également avoir une vue d'ensemble sur l'histoire de la
langue allemande.
* C'est en effet cette histoire qui explique
- pourquoi les dialectes que l'on parle en Alsace sont différents de l'allemand oral courant (Umgangssprache) que l'on parle aujourd'hui outre-Rhin et ailleurs , malgré leur évidente parenté
- et pourquoi les dialectes, tout en se transformant, se sont maintenus si longtemps en Alsace (comme en Suisse, au Luxembourg)
- alors qu'en Allemagne (et aussi en Autriche), ils ne jouent plus le même rôle que chez nous.*L'histoire de l'allemand - l'histoire de toutes les langues - fournirait matière à plusieurs conférences.
Je ne rappellerai ici que ce qui est nécessaire pour comprendre la relation qui existe
- entre l'identité culturelle de l'Alsace
- et l'indispensable connaissance du Hochdeutsch, c.à.d. de l'allemand moderne.* Pour traduire la Bible en allemand, Martin Luther utilisa son dialecte de Thuringe, la langue des chancelleries et celle des marchands... c'est-à-dire le Hochdeutsch et non pas le Niederdeutsch.
*La conséquence, c'est que, progressivement, la langue de Luther - le Hochdeutsch - deviendra LA langue de tous les Allemands, c'est-à-dire des hommes de langue allemande.
C'est un événement capital.
*En effet , c'est grâce à Luther que le Hochdeutsch pénétrera dans l'Allemagne du Nord et affirmera ainsi sa suprématie sur le Niederdeutsch sans toutefois l'éliminer comme langue parlée, puisqu'on y parle toujours ce qu'on appelle aujourd'hui Plattdeutsch.
* Sans Luther, l'Allemagne aurait aujourd'hui sans doute deux langues:
- dans le nord: une langue dérivée du Niederdeutsch [bas-allemand] (= l'allemand de la "Basse-Allemagne"... et proche du néerlandais moderne)
- dans le sud: le Hochdeutsch [haut-allemand] (= l'allemand de la "Haute-Allemagne"), l'allemand tout court, comme on l'appelle aujourd'hui.
* C'est ce qui explique pourquoi
en Alsace et également en Suisse et au Luxembourg, c'est-à-dire dans des pays ou des régions qui ont été ou se sont séparés du monde culturel et politique allemand, peu de temps après que la langue de Luther a réussi à conquérir le monde allemand, les différences entre "l'allemand" et (ou) les dialecte(s) se sont creusées.

L'allemand à l'époque de Martin Luther
*A partir de ce moment, ces pays ou régions n'ont plus participé directement à l'évolution linguistique qui a eu lieu dans le reste du monde de langue allemande.
"Au moment où l'élite allemande allait progressivement se servir du haut-allemand - l'allemand - pour la communication écrite et orale, l'élite alsacienne allait progressivement se servir du français pour la communication écrite et orale. Et au moment où l'école et l'intensification des relations commerciales, sociales, politiques allaient favoriser outre-Rhin l'emploi du haut-allemand comme langue parlée, l'école et l'intensification des relations commerciales, sociales, politiques allaient favoriser en Alsace l'emploi du français comme langue parlée.
C'est cette évolution linguistique divergente de part et d'autre du Rhin, à partir du XVII° siècle, qui explique pourquoi, en Alsace, on ne se mit pas à parler haut-allemand comme dans la plupart des autres pays de langue allemande. A l'exception d'une fraction de l'élite intellectuelle et bourgeoise, les Alsaciens continuèrent de se servir exclusivement de leur dialecte dans la conversation courante. Le dialecte restait ainsi la langue des Alsaciens. Les Alsaciens se distinguaient ainsi et des autres Français et des Allemands.
Certes, ils apprenaient toujours le haut-allemand à l'école, et le haut-allemand demeura longtemps la langue écrite des Alsaciens. Cela n'empêcha pourtant pas le français de réussir sa percée et de s'imposer progressivement dans la vie publique. Là, la nécessité de savoir le haut-allemand diminuait au fur et à mesure que se répandait l'usage du français.
Dans une Alsace française, c'est le français et non pas le haut-allemand que les Alsaciens se devaient d'acquérir pour pouvoir communiquer avec leur nouvelle communauté. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Umgangssprache (le haut-allemand parlé) ne pouvait donc pas s'étendre à l'Alsace. Le français jouait en Alsace le rôle que le haut-allemand jouait outre-Rhin;. Dans l'aire linguistique allemande, les Alsaciens allaient occuper une place à part. Le dialecte - l'allemand alsacien - était dès lors confronté au français et non pas au haut-allemand. Son importance pour la préservation de l'identité alsacienne croissait d'autant.." (La crise d'identité, p.66/67)* Il n'en reste pas moins que l'allemand - le haut-allemand - est resté pendant longtemps la langue par excellence de la production littéraire en Alsace, comme d'ailleurs en Suisse alémanique et au Luxembourg.
* A titre d'exemples, je ne citerai que
- Gottlieb (Théophile) Conrad Pfeffel (1736-1809),
- Jean-Frédéric Oberlin (1740-1826),
- Albert Schweitzer (1875-1965)
- et René Schickele (1883-1940)
qui ont vécu respectivement aux XVIII°, XIX° et XX° siècles.+ Tous ces hommes savaient, bien entendu, le français,
mais c'est en allemand qu'ils écrivirent leurs principales oeuvres
littéraires, philosophiques ou religieux.
+ Ils étaient ou sont devenus des citoyens français,
mais ils n'ont jamais renié la source allemande de leur culture.
4° René Schickele n'a pas cessé de se
référer aux "deux traditions" de l'Alsace,
comme il disait: l'allemande et la française. "L'Alsace",
écrivit-il en 1904, donc à une époque où l'Alsace
était allemande, "est la floraison - le fruit - de deux traditions".
("die Blüte zweier Traditionen")
Et on sait avec quelle ardeur et quel talent il s'est engagé pour
la promotion en Alsace de "ein geistiges Elsässertum",
une "alsacianité de l'esprit".
* Certes, on se saurait affirmer que, aujourd'hui, la source allemande soit totalement tarie.
Nous avons toujours des écrivains et des poètes qui maintiennent cette "tradition".
Je ne citerai qu' André Weckmann, le plus connu de tous,
et le Professeur Adrien Finck, écrivain, poète et germaniste,
dont la réputation n'est plus à faire, même outre-Rhin.* Mais reconnaissons que la situation est des plus fragiles
et qu'il convient de s'attaquer franchement au problème de
l'inquiétant recul de l'allemand en Alsace - "un champ de ruines",
a dit Adrien Finck, si l'on songe à la production littéraire actuelle en langue allemande en Alsace.* Si donc l'allemand moderne (le "Hochdeutsch") doit avoir une place de choix
dans l'éducation linguistique et culturelle de la jeunesse alsacienne,+ ce n'est pas parce que l'allemand est "la langue du voisin"
- longtemps, c'est le français qui a été pour les Alsaciens "la langue du voisin" -
(cf. Les luttes linguistiques en Alsace..., chap.I, p.13/28)
+ mais parce que, depuis son origine, c'est une des langues de l'Alsace
et qu'elle fait ainsi partie de l'identité linguistique et culturelle de l'Alsace.
* la source proprement alsacienne
* C'est assez curieux: en général, c'est l'existence d'une source proprement alsacienne de notre culture qui est la plus discutée:
- il arrive qu'on la nie purement et simplement
- il arrive aussi que, sans la nier, on ne la considère que comme un simple dérivatif de la source culturelle allemande.* Et pourtant il existe bien en Alsace, depuis plusieurs décennies au moins, une source de la culture qui remonte évidemment au passé allemand de l'Alsace, mais qui, aujourd'hui, a des traits spécifiquement alsaciens.
* Son existence, elle la doit, bien sûr, à l'histoire, mais surtout au caractère du dialecte dit "alsacien", "l'alsacien", comme on dit aujourd'hui.
+ " l'alsacien"
* La chose la plus courante n'est pas toujours la mieux connue.
C'est vrai pour ce qui est couramment appelé "l'alsacien".
* "l'alsacien" n'est pas "langue".... mais dialecte!
* Du point de vue linguistique, le terme d'"alsacien" n'a aucun sens.
L'idée de séparer le dialecte parlé en Alsace de "l'allemand",
dont il n'est qu'une forme parmi d'autres, est née en France en 1870.* Encore en 1838, un homme comme Edouard Reuss pouvait écrire dans une revue (Erwinia)
"Wir reden deutsch" - Nous parlons allemand - et non pas "elsässisch" , ("alsacien")
sans que quelqu'un trouve à redire.* Si le terme d' "alsacien"s'est finalement imposé dans le débat alsacien,
c'est uniquement pour des raisons politiques. (cf. Les luttes linguistiques en Alsace... p.115/121)* Et l'on sait que lorsque le pouvoir politique et médiatique,
ce qui est presque toujours la même chose,
verse dans le nationalisme, réducteur et antidémocratique,
elle n'a que faire de la vérité linguistique... et historique.* Ce que nous appelons "alsacien" est en réalité DE l'allemand,
- DE l'allemand tel qu'on le parle - encore! - en Alsace.
"Elsasserditsch" - de l'allemand alsacien - disait-on autrefois
tout comme en Suisse alémanique, on parle le "Schwyzerdütsch",
c'est-à-dire de "l'allemand suisse" et non pas "schwyzerisch"!* Dans son livre, "Psychanalyse de l'Alsace", paru en 1951, Frédéric Hoffet faisait déjà remarquer qu' "il est aussi absurde de contester que l'on parle l'allemand à Strasbourg qu'il serait absurde d'affirmer que cette langue n'est point celle des habitants de Stuttgart, de Zurich ou de Fribourg-en-Brisgau."
* Toutes les langues modernes dites "nationales"
se sont formées à partir d'un ancien dialecte... qui a tout simplement "réussi"!"Réussi" quoi? ... à s'imposer aux autres dialectes du même système linguistique
et, partant, de la même aire linguistique,
grâce à l'appui du Pouvoir - quel qu'il fût! - qui, très souvent disposait d'une armée
et... d'une marine, comme le dira avec humour un linguiste canadien à propos de l'anglais!* Ces "autres dialectes" ne sont donc pas de simples variétés de "la langue"
devenue "nationale" et aujourd'hui commune à une même aire linguistique.
Celle-ci a tout simplement connu un développement différent de celui de ces "autres dialectes".* Pendant des siècles et des siècles, les hommes n'ont fait
que parler leur langue (... avec leur langue évidemment),
d'où les termes tels que "langue" en français, "Sprache", mais aussi "Zunge" en allemand,
"language", mais aussi "tongue" en anglais. qui tous se réfèrent à l'organe de la parole .* Aujourd'hui, la notion de "langue" ne se limite plus au seul parler,
mais inclut une forme écrite - progressivement codifiée - pour permettre la communication
au sens large du terme, avec tous les hommes de la même aire linguistique,
quels que soient le dialecte ou la forme orale courante que l'on parle ici ou là.++ Dans le monde de langue allemande,
la forme écrite et codifiée qui s'est imposée dans l'aire linguistique de l'allemand
est le Hochdeutsch, - l'allemand tout court -
que l'on parle par ailleurs le bavarois, le souabe, le Schwyzerdütsch, le Lëtzebuergesch
ou ... "l'alsacien"!* Cette forme écrite et codifiée, devenue partout "langue d'enseignement",
a favorisé l'usage d'une forme orale de l'allemand proche de la forme écrite,
appelée Umgangssprache."Le bavarois est bien de l'allemand,le piémontais est bien de l'italien, mais il y a une forme d'allemand, une forme d'italien qui n'est pas "dialecte", mais "langue". (André Martinet. Éléments de linguistique générale, p.155)
++ Ce qui est vrai pour le bavarois, l'est évidemment aussi pour "l'alsacien".
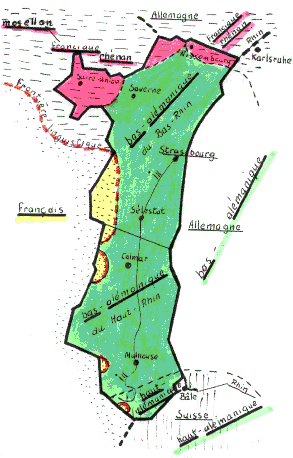
Les dialectes en Alsace
++ Répétons-le:
ce qu'on appelle "l'alsacien" n'est donc qu'une forme orale de l'allemand parmi d'autres.
Et la forme écrite codifiée correspondante est en Alsace, comme ailleurs
dans l'aire linguistique de l'allemand, le "Hochdeutsch" ou allemand moderne.Parler de "LANGUE régionale" en Alsace, n'a donc de sens que si l'on désigne à la fois
- le (s) dialecte (s), forme (s) orale (s) de l'allemand parlés (encore) par une majorité d'Alsaciens
- ET l'allemand moderne écrit, utilisé par les Alsaciens dialectophones
depuis que cette forme d'allemand est devenue
la "forme écrite unique et codifiée" dans le monde de langue allemande.
* "L'alsacien" n'est pas non plus une langue "régionale"
° d'abord parce que ce qu'on appelle "le dialecte alsacien", ce sont en réalité deux dialectes
- l'alémanique au sud de la Forêt de Haguenau
(Win (Wii) = vin, Zidung = journal - , Zischdi = mardi)
- et le francique (rhénan) au nord de cette Forêt (Wäin, Zäidung, Dienschdàà....),
chacun de ces deux dialectes comportant en outre toute une série de variantes .° ensuite parce que cet alémanique et ce francique sont parlés ailleurs que dans la "Région" Alsace.
C'est ainsi que- l'alémanique, par exemple, se parle également en Suisse, en Allemagne (Pays de Bade, Allgäu),
au Liechtenstein, en Autriche (Vorarlberg), donc dans cinq États différents
- et le francique (rhénan) au Pays de Bade, au Palatinat etc.° Il convient toutefois de faire remarquer que ce qu'on appelle le dialecte "alsacien"
- malgré toutes ses variantes - est ,
parmi les langues de l'Alsace, ce qui est le plus caractéristique pour l'Alsacien.
* Sa fonction identitaire est évidente.
* En effet
- c'est le français qui distingue les Alsaciens de l'immense majorité des Allemands,
des Autrichiens, des Suisses etc.
- c'est l'allemand qui distingue les Alsaciens de l'immense majorité des autres Français.
- mais c'est par leur dialecte que les Alsaciens se distinguent à la fois des uns et des autres.* Le dialecte est bien l'élément spécifique de l'identité - la personnalité - linguistique de l'Alsace.
* Quel que soit finalement son sort, pour l'Alsace et les Alsaciens,
le dialecte est et reste un facteur d'identification de tout premier ordre.
+ L'expression dialectale
* Sans doute la culture, c'est tout le "vécu" de l'homme. Elle ne se limite donc
ni à son expression littéraire ni à son expression artistique.* Mais même dans ce domaine,
on note une sensibilité, une démarche, une manière de voir et de dire
les choses spécifiques aux Alsaciens. Ce n'est pas aussi surprenant que cela.* En effet,
- être ballotté d'un État à l'autre, même plusieurs fois en un siècle,
- ne pouvant parfois ne plus compter que sur soi-même,
- se voir attaqué dans sa langue - son âme - et sa culture - son être -
par les uns et les autres, tout cela laisse des traces profondes dans la psychologie collective.L'expression culturelle et artistique en porte encore aujourd'hui la marque.
* Cela devient manifeste
- lorsque l'Alsacien est amené à s'exprimer dans son dialecte,
et que lorsqu'on compare ce qu'il dit et la manière dont il le dit
avec ce que disent et la manière dont le disent
ceux qui s'expriment également dans un dialecte alémanique (ou francique),
mais qui ne sont pas Alsaciens.* Ce qui m'a toujours frappé, notamment lors de "Dichterlesungen" (lectures publiques par
les poètes de leurs oeuvres) à Bregenz, Bâle, Lucerne et à Strasbourg notamment,
c'est que nos Mundartdichter - nos poètes d'expression dialectale -
n'ont qu'une chose en commun avec les poètes allemands, suisses
ou autrichiens d'expression alémanique:
l'utilisation du dialecte, de la Mundart, le dialecte alémanique en l'occurrence.* Mais ni la thématique de Nathan Katz ni celle de Sylvie Reff,
de Conrad Winter ou d'Adrien Finck, par exemple,
et encore moins celle d'André Weckmann ne se comprennent, si on ne tient pas compte
de la sensibilité proprement alsacienne - la manière alsacienne d'être -
et, surtout, la façon dont cette sensibilité alsacienne s'exprime chez nos meilleurs poètes alsaciens.* Je n'en donnerai qu'un exemple et ne citerai que
les derniers vers d'un poème d'André Weckmann intitulé: e schrej (un cri)
e schrej |
un cri |
| e schrej esch s letscht wås dr ewriblît vor åss de s schnüfe ufstecksch wann d die långs åm rhin ånnestrecksch un d vogese di met roschtigem läub züedecke e schrej |
il ne te restera qu'un cri lorsque avant ton dernier souffle tu te coucheras le long du Rhin et que les Vosges te recouvriront de feuilles mortes un cri |
* Si ce "schrej"- ce cri - d'André Weckmann a fait frémir
un auditoire de cinq nationalités différentes, comme ce fut la cas il y a quelques années
à Allschwil près de Bâle et à Bregenz, ce n'est pas seulement- parce que tous ces hommes et toutes ces femmes comprenaient et parlaient
le même dialecte alémanique, avec certes des variantes,
- mais surtout parce qu'ils sentaient qu' au travers de son "Elsasserditsch",
André Weckmann témoignait du drame humain
que vit celui qui, en continuant à s'exprimer en dialecte,
défend une partie essentielle de lui-même, une partie de son âme qu'on tente de lui ravir.
* Le fait est que les Alsaciens sont attachés à leur langue comme le sont tous les peuples."Aucun peuple n'abandonne sa langue s'il n'y est contraint."
(La crise d'identité, p.69)* Au fond, s'attaquer à une langue , pour quelque raison que ce soit,
est une tentative très raffinée d'exclusion de celui qui, par sa langue, est autre.* Ce drame n'est pas seulement un de ces problèmes de société
que l'on retrouve dans tous les grand pays industriels,
mais un problème qui interpelle l'homme dans ses rapports avec d'autres hommes.* Drame alsacien certes, mais aussi un drame humain
qui est vécu ailleurs qu'en Alsace, drame qui s'exprime le plus authentiquement en dialecte.* Et c'est là que nous nous confrontés avec le problème de l'existence du dialecte dit "alsacien".
* L'accès à toutes les sources culturelles de l'Alsace
a toujours posé à l'Alsacien de sérieux problèmes, mais ces sources
- constituent une richesse inappréciable qu'il convient de préserver et de développer,
- et ce sont elles qui donnent son originalité à la culture... "alsacienne".* Culture "alsacienne"?
Elle n'est rien d'autre que
la culture que l'Alsacien d'aujourd'hui peut et doit pouvoir acquérir
par la combinaison des éléments français, allemands et alsaciens qui, ensemble,
donnent à la culture vécue dans le milieu alsacien
sa marque spécifiquement alsacienne." (Le défi alsacien, p.151)
D'ailleurs , la question n'est pas du tout de savoir si l'Alsacien de cette fin du XX° siècle veut ou ne veut pas s'alimenter à une, deux ou trois sources culturelles, il n'en a tout simplement pas le choix s'il tient à assumer tout son passé, à vivre son présent en homme debout et à préparer à l'Alsace un avenir à la mesure de toutes ses potentialités culturelles. C'est une tâche certes immense, mais une tâche susceptible de rassembler toutes les forces vives de ce terroir autour d'un grand dessein alsacien tout en étant exemplaire pour la France tout entière. Car quelle autre région française peut apporter une telle contribution au devenir européen de la France? |