
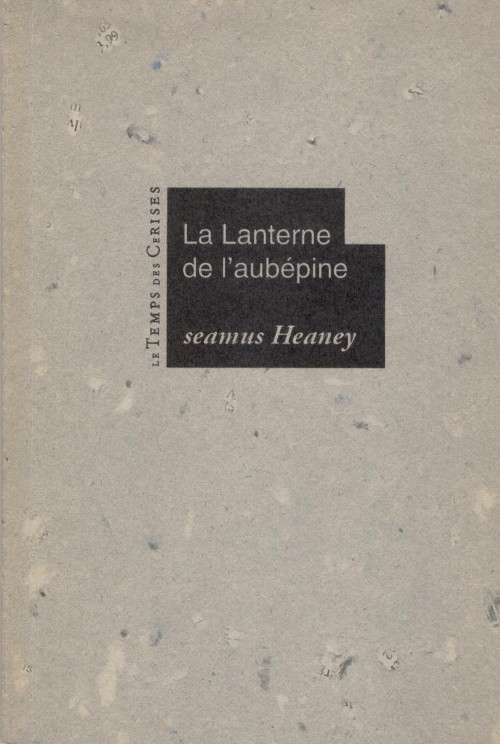
|
La matière d'Ulster(Préface à La lanterne de l'aubépine) |
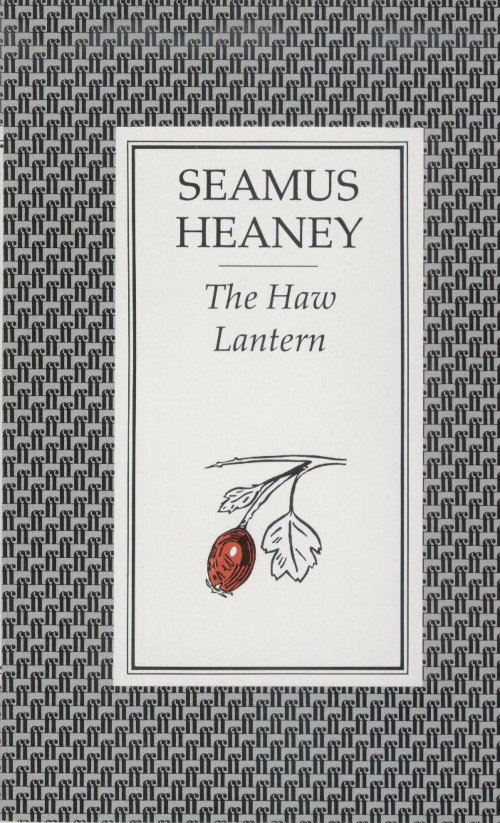
|

|
|||
|
|||
Notre poésie est une résine
Suintant du tronc qui la nourrit...
(Shakespeare, Timon d’Athènes)
Dans l’excellent numéro de la revue Digraphe consacrée à la poésie irlandaise contemporaine, Serge Fauchereau
introduisait ainsi en 1982 Seamus Heaney: “Pour le monde anglo-saxon et les milieux universitaires partout ailleurs,
Seamus Heaney est le poète irlandais – même les hôtesses de mon dernier vol Aer Lingus connaissaient son
nom...” J’ai envie de corriger et d’écrire : le poète de l’Ulster. Retrécissement du territoire qui ne signifie en rien
une contraction du champ de l’imaginaire et ne relègue pas Heaney au rang d’un poète provincial. L’universel prend
rarement racine dans un terreau abstrait mais veut une terre et une histoire d’où tirer sa substance. Seamus Heaney
lui-même exalte dans un recueil d’articles (Preoccupations, 1980) le “sens du lieu” et rappelle que ce qui fait
la vérité et la portée de la poésie de son aîné Patrick Kavanagh est son ancrage dans un paysage, une “paroisse”
précise.
Le lieu de Seamus Heaney c’est Mossbawn, près de Belfast, un lieu placé “entre les signes de l’influence anglaise et
l’appât de l’expérience originelle, entre le domaine et la tourbière”. Il y nait en 1939, l’aîné des neuf enfants d’une
famille de paysans catholiques. La présence à proximité de la ferme de cette terre interdite que constituait pour un
enfant le ‘bog’ marquera profondément l’esprit du poète. Le marais de tourbe aux trous d’eau sans fonds, à la maigre
végétation de mousse et de joncs, royaume de “créatures non répertoriées par les naturalistes”, hantera une grande
partie de son oeuvre. Le domaine est au contraire le pays de la communauté, “un pays de meules et de gerbes”, traversé
par les divisions religieuses. Les enfants chantent sur la route de l’école leur appartenance, dans des vers dont
l’innocence trouvera quelques années plus tard un double terrible:
“En haut de la longue échelle et au bas de la courte corde
Au diable le roi Guillaume et Dieu bénisse le Pape.”
Ou inversement.
Quelques livres moisissent sur une étagère hors de portée, derrière un rideau, les journaux déroulent notices
nécrologiques et avis de ventes aux enchères, les revues perpétuent les rites. La poésie, se souvient Heaney, c’est
alors les bandes dessinées, les chants de moquerie ou de ‘non-sense’ (”Un beau matin d’Octobre en Septembre de
Juillet dernier...”) et les récits d’aventure. Le premier frisson littéraire naîtra à l’occasion des leçons
d’histoire irlandaise, au cours desquels le jeune garçon découvre les mythes de l’ancienne civilisation celtique. Au
St-Columb’s College de Derry, où il est interne, il y a aussi les leçons de poésie anglaise, les vers de Byron et de
Keats reçues “à la façon des leçons de catéchisme”, formules rituelles sans relation avec l’expérience quotidienne,
chargées de vous protéger dans la vie adulte. C’est tout naturellement que plus tard, lorsqu’il décidera de consacrer
sa vie à la poésie, Seamus Heaney se retournera vers les paysages de son enfance et nourrira ses images du monde
primitif qu’il a connu, au centre desquelles le ‘bog’ déploie ses séductions.
Étudiant à Queen’s University à Belfast il commence à “bricoler des vers” et s’agrège à un groupe de jeunes
poètes rassemblés sous le magister de Philip Hobsbaum (fondateur en 1955 à Londres du “Groupe”), dont font aussi partie
entre autres Michael Longley et Derek Mahon. Ces poètes donneront à la poésie irlandaise une impulsion décisive et en
feront un des foyers de création les plus actifs de la poésie de langue anglaise de ces dernières années. Ses premiers
poèmes paraissent sous la signature d’Incertus (Incertain): “Je ne pouvais pas dire, bien sûr, que j’avais
trouvé une voix mais j’avais trouvé un jeu. Je savais que ce n’était qu’un jeu avec les mots et je n’ai pas même eu
l'audace d’y mettre mon nom”. Il subit alors l’influence de Gérard Manley Hopkins, dont les vers fortement accentués,
la musique tout en allitérations et en heurts de consonnes, font écho à l’accent de l’Ulster, énergique et anguleux.
Il découvre aussi la poésie anglo-saxonne, dont La lanterne de l'aubépine témoigne encore de l’attraction,
puisque le recueil comporte, outre la traduction d’un extrait de Beowulf, plusieurs allusions à ce chef
d’œuvre de la littérature pré-anglaise.
Le premier livre publié sous son nom, Death of a naturalist (Mort d’un naturaliste,1966), le révèle
d’emblée. Dans ce recueil, ainsi que dans le recueil suivant, Door into the Dark (Porte dans le noir,
1969), il manifeste sa fidélité aux paysages de Mossbawn, magnifiant les gestes de l’Irlande rurale et les rites de la
vie quotidienne dans des images simples, au lyrisme contenu, où la terre, la tourbe, l’eau, la boue, fournissent son
substrat à la poésie. Si “la plume est moins lourde que la pelle”, comme on le disait aux enfants pour les encourager
dans l’étude, le travail de la terre, la lame s’enfonçant dans les sillons, creusant des rigoles ou coupant la tourbe,
le seau jeté au fond du puits, et cette matière lourde de sens et de hasard, répondent au travail de l’écriture,
“creusant un puits dans la réalité”. Le parfait poète est alors pour Heaney un “sourcier” qui entre en communication
“avec ce qui gît caché” – et l’on se souvient que la terre est la mémoire de l’histoire, que cette terre d’Irlande est
le fruit de strates successives et que, creusant, on découvre sur chaque couche les restes des anciens campements. Le
rôle du poète est celui de “médiateur”, permettant à la communauté de retrouver et de tirer profit de ces ressources
enfouies.
Les évènements tragiques de 1969 posent aux écrivains d’Ulster la question de leur place dans la société déchirée que
révèle alors au grand jour l’enchaînement des violences. Ils conduisent certains à une intervention active dans l’arène
publique. La recherche d’une écriture et d’images épousant plus étroitement le champ de la réalité politique est aussi
celle de Seamus Heaney, mais s’il cherche à rendre l’intensité quasi-religieuse de la violence, dans sa brutalité et sa
complexité, c’est en restant fidèle à ce qui fait l’authenticité de la poésie : “La falsification des sentiments est un
péché contre l’imagination. La poésie est au-delà de la querelle avec nous-même, et la querelle avec les autres n’est
que rhétorique.”
Sa poésie embrassera désormais toute la matière d’Ulster, et plongera par le moyen du mythe, de la parabole, ou de la
manière la plus directe, dans cette terre divisée dont, à la manière d’Antée (dont il reprendra plus tard la figure
dans un poème de North), elle tire sa force. Deux lignées, deux histoires, deux cultures s’y côtoient et s’y
affrontent, de façon sourde ou violente suivant le temps, dans une même langue, celle du colonisateur. Le monde
“illettré” de Kathleen Ni Houlihan, celui de la Mère Irlande, dont le royaume subsiste à l’usurpation, le monde
d’Ossian qui se perpétue dans celui de Saint-Patrick: le pays des tourbières et des légendes, des dévotions frustes ou
cruelles, un monde naturel qui persiste enseveli sous la surface des choses – à l’image de ces restes des anciennes
civilisations que l’on retrouve après des siècles, conservés dans la tourbe, le beurre encore frais et les victimes
expiatoires souffrant toujours de leurs blessures. Et le monde du pouvoir impérial, celui de Cromwell, de Guillaume
d’Orange, d’Edouard Carlson, le monde réglé des colons, aux domaines tracés dans les décombres de ce qui fut le sens,
le monde sévère des pasteurs et des marchands, et le monde lettré des poètes qui lui répond et l’accompagne. La
tragédie de l’Irlande rejouée sur une scène plus étroite, un dernier champ clos où la truie dévore toujours ses petits.
Après plusieurs années d’enseignement dans des collèges de Belfast, puis à Queen’s University, Seamus Heaney s’établit
en 1972 à Glanmore, en République d’Irlande. Ce choix de passer la frontière fut en son temps considéré comme
emblématique. Il vit quelque temps de l’écriture puis, à partir de 1975, recommence à enseigner: d’abord à Dublin puis
à l’Université de Harvard aux Etats-Unis. Il publie dans cette période Wintering out (Endurer l’hiver/i>,
1972), North (Nord, 1975), Field Work (Fouilles, 1979), Station Island ( Ile de
pélerinage, 1984) . Il fait également paraître en 1983 une version d’un étonnant conte gaëlique remontant
probablement au début du millénaire, Sweeney Astray (Les errances de Sweeney). Il y retrouve la fraîcheur
de la langue des premiers poètes irlandais, celle du légendaire Ossian et celle des ermites chrétiens célébrant le
monde :
A Drum Cirb le cresson de la source
me tient lieu de souper à tierce ;
et ses sucs qui m’ont verdi le menton
sont pour toujours la marque de Sweeney
The Haw Lantern est publié en 1987 et reçoit la même année le prix Whitbread. Le recueil occupe une place
particulière dans l’oeuvre de Seamus Heaney. S’il témoigne de la tension entre mémoire individuelle et conscience
nationale, du conflit entre mythe et raison que l’on retrouve dans tous ses livres, la question nationale y est traitée
dans une veine souvent allégorique qui peut surprendre de la part d’un poète aussi concret.
Outre ses fonctions à Harvard, Seamus Heaney est depuis 1989 professeur de poésie à l’Université d’Oxford. Il est par
ailleurs directeur de la Field Day Theater Company, pour laquelle il a écrit en 1990 une version du Philoctete
de Sophocle, The cure at Troy (La guérison à Troie). Le thème du héros au pied blessé, abandonné sur une
île par ses compagnons et qui doit choisir entre sa douleur et une rédemption qui trahit son instinct et ses sentiments,
n’est-ce pas encore une fois le thème de l’Ulster ? Plus récemment a été publié Seeing Things (Visions,
1991).
La poésie de Seamus Heaney se prête parfois mal à la traduction, les difficultés liées à l’économie de la langue
anglaise étant ici accrues par un usage fréquent des doubles sens et des jeux d’échos, impossibles à rendre dans notre
langue. J’ai cherché à privilégier le sens et la concision. Robert Frost disait qu’un poème commence comme “un serrement
de gorge”. Seamus Heaney écrit de sa poésie qu’elle est liée de façon plus vitale et plus sensible “à l’activité dans
laquelle ‘le serrement de gorge’ trouve la pensée qu’à celle où la pensée trouve les mots”: “L’action cruciale est avant
les mots”. Puisse l’effort du traducteur toucher à travers d’autres mots la pensée et retrouver dans leur nudité
originelle les images d’où sont nés les poèmes.
Je voudrais enfin remercier Seamus Heaney pour les éclaircissements qu'il a bien voulu donner sur certains de ses
poèmes.
Gérard Cartier (1996)
|
Haut de page |