- CHAPITRE IV - Les pensées économiques
socio- historiques.
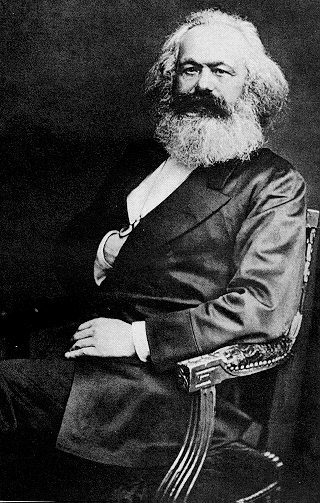

- CHAPITRE IV - Les pensées économiques
socio- historiques.
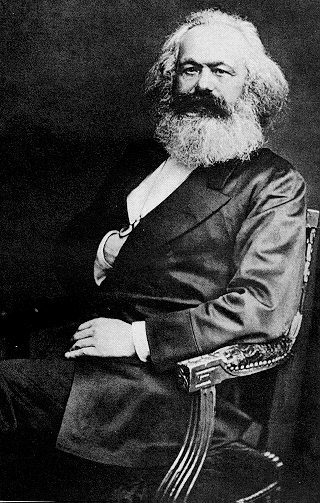

- II - Ecoles historiques allemandes, institutionnalistes et évolutionnistes
III
Les socialismes "utopiques" ou "vulgaires"
Existe-t-il une alternative aux systèmes
classiques de la production et néo classiques de l' échange ?
L'alternative la plus citée est de recourir à la sociologie et
à l'histoire. Le totalisme socio- historique est bien au 19° siècle,
l'alternative à la pensée néoclassique; les attaques redoublées
de Hayek et de Popper contre cette méthode " misérable", "néotribale"
ne s'y trompent pas. Les auteurs les plus cités au titre de ce troisième
Programme Recherche Scientifique sont Karl Marx, l'école historique allemande
et les auteurs institutionnalistes auxquels on adjoint quelquefois Schumpeter.
| Schumpeter résume en six points la démarche de l'école historique: La relativité contre les lois générales L'idée de l'unité de la vie sociale et de la relation inséparable entre ses éléments Le point de vue antirationaliste L' attitude évolutionnaire La recherche du concret et des causes concrètes hors de causes générales Le point de vue organique, l'organicisme social.
|
De façon générale, la démarche
socio- historique fait intervenir l'hétérogénéité
et le mouvement dans une dialectique des contraires. L'hétérogénéité
consiste par exemple à poser un système social total fait
de sous-systèmes ( économiques, domestiques, religieux, etc.),
relativement autonomes et pouvant être en contradiction. Le mouvement
vient des contradictions entre ces instances, par exemple de l 'opposition
entre le politique et l'économique. A un autre niveau,
ces instances sont composées de structures hiérarchisées
et complémentaires ( la relation capitalistes /salariés par ex.)
d'une part et de comportements. Ces derniers peuvent exprimer des passions ou
des instincts. Les "institutions", chez Veblen, étant un ensemble
d'habitudes de pensée et de comportement conventionnel.
La démarche socio- historique apporte des compléments précieux à la théorie économiques, mais pose des problèmes :
- Elle relativise les lois économiques dans le temps et dans l'espace, en « important » des notions issues d’autres disciplines.
- Elle ne peut prétendre à l’objectivité historique, elle est idéal-typique ( M. Weber)
- Elle ne peut traiter d’un certain nombre de problème analytiques par exemple d’ « existence » de la valeur, qui nécessite un cadre statique.
- Elle pose alors le problème de la « transformation » des données socio historiques en variables économiques (par exemple des valeurs en prix).
- La référence à l’histoire n’est pas neutre, elle peut être anthropocentrique sinon raciste ( cf. les articles de Veblen sur la race aryenne).
- Elle risque de devenir une philosophie de l’histoire avec des itinéraires obligatoires, cf. le schéma des 5 stades de Staline !
- Elle produit dans ce cadre des utopies, telles
les utopies du socialisme "vulgaire",
par exemple les phalanstères de Charles Fourier
(1772-1837).
12- Les principales composantes de sa pensée économique.
13- La pensée
socio- historique
Oeuvre.
Cette oeuvre est marquée par plusieurs ruptures dans l'itinéraire intellectuel (1844, 1857)
-1844: rupture philosophique avec l'hégélianisme: matérialisme historique (mh).
-1857: rupture économique ( avec application du matérialisme historique à l'économie): spécificité de la Plus- value.
L'oeuvre de Marx est très hétérogène : polémique (contre les socialistes, français, allemands, russes, contre Proudhon, Dürhing, Wagner) , pédagogique( envers les prolétaires de l'AIT, cf. Le Manifeste), théorique (le Capital). De nombreux auteurs ( Schumpeter, Mrs Robinson) ont distingué chez Marx, l'économiste, de l'historien, du philosophe, du sociologue....
Le Livre I du Capital (1867) est le seul ouvrage satisfaisant selon Marx , la méthode allant du général au particulier.
Principales oeuvres L'idéologie allemande ( avec F. Engels), 1845-1846. Misère de la philosophie, 1847. Le manifeste du parti communiste (avec F. Engels) , 1845. Introduction générale à la critique de l'économie politique, 1857. Grundrisse, 1857-1858. Le Capital, Livres I (1867), II, III, IV. Critique du programme de Gotha (1875) |
-La méthode historique marxienne
Elle est une méthode récurrente, illustrative et idéaltypique.
a) Une méthode historique récurrente :
Dans l' Introduction de 1857, Marx nous livre des précisions à propos de sa méthode, notamment sa méthode d'investigation historique: Dans sa conception il faut partir de " la société bourgeoise" , l'organisation historique de la production la plus développèe et la plus développèe qui soit". Les catégories qui permettent de comprendre sa structure et ses rapports de production permettent de comprendre "tous" les types de société disparus.." D'où l'analogie célèbre: " L'anatomie de l'homme est une clé pour l'anatomie du singe. Les virtualités qui annoncent dans les espèces inférieures une forme supérieure ne peuvent être comprises que lorsque le forme supérieure est déjà connue. "
Cette conception est-elle originale ? L'histoire a pour tache conventionelle de montrer comment le passé a produit, par étapes, le présent. Cette démarche ethnocentrique est classique, aussi bien chez historiens que les ethnologues.Marx relève cette objection , car sa conception de la société bourgeoise est critique....
"La précédente évolution historique repose, en général, sur le fait que la dernière formation sociale considère les formes passèes comme autant d'étapes vers elle-même,et qu'elle les conçoit toujours, d'un point de vue partial. En effet, elle est rarement capable( et seulement dans des conditions bien déterminèes), de faire sa propre critique".(Marx, ibid, p.260).
Il ne veut donc pas présenter la "succession des catégories économiques dans l'ordre de leur action historique" (ibid.p.262), mais dans un ordre de succession déterminé par la place qu'elles occupent dans l'ensemble de la société bourgeoise moderne. Au niveau de l'exposé, l'histoire a donc pour but d'étayer les hypothèses que Marx effectue à propos de la structuration capitaliste. Or, c'est précisément en 1857/1858, que Marx bouleverse son analyse du capitalisme. Il faut donc dissocier les textes historiques écrits avant, et après cette date.
b) Deux catégories de textes historiques doivent être distinguées : Il convient de distinguer a priori ceux qui précèdent, et ceux écrits après 1858 ; moment où Marx peut arriver à effectuer la démonstration du procès de l'exploitation du travailleur par le capitaliste en spécifiant la plus value. C'est à cette époque, qu'il annonce à Engels : "J'en arrive à quelques jolis développements. J'ai jeté par-dessus bord toute la doctrine du profit telle qu'elle a existé jusqu'à maintenant". (Lettre du 14 Janvier 1858 in Lettres sur le "Capital" - Editions Sociales, Paris 1964.)
Les textes écrits avant 1858, en dehors de leur but spécifique, (politique etc..) reprennent la nouvelle dialectique que Marx avance par la critique de la philosophie (notamment dans les thèses sur Feuerbach). Les textes écrits après cete date (notamment ceux inclus dans les Grundrisse et le Capital) s'attachent à éclairer la Genèse de l'appropriation et de l'exploitation caractéristiques du capitalisme.
c) L'essentiel de l'exposé historique aura pour but d'éclairer les deux découvertes de Marx :
"La loi de développement de l'histoire humaine et la loi spécifique du mouvement du mode de production capitaliste et de la société bourgeoise : la découverte de la plus value". (Engels F. - Discours sur la tombe de Marx - 17 Mars 1883)
Les éléments historiques avancés à propos des sociétés pré-capitalistes auront moins pour but de faire la théorie de celles-ci, que d'éclairer et appuyer ces deux découvertes.
d) Une méthode idéal-typique ?
- Qu'est-ce que l'idéal type selon M. Weber ?
C'est une construction intellectuelle obtenue "en accentuant unilatéralement un ou plusieurs points de vue et en enchaînant une multitude de phénomènes donnés isolément, diffus et discrets, que l'on trouve tantôt en grand nombre, tantôt en petit nombre, et par endroits pas du tout ". (M. Weber: "Essais sur la théorie de la Science", Paris, Plon, 1968, p.181).
Elle forme un "tableau de pensée homogène" (Ibid), étant donné que l'on aura ordonné ces phénomènes selon tel ou tel point de vue choisi unilatéralement.
En conséquence, ce tableau n'a pas d'existence réelle, "il est une utopie" (Ibid). "Le travail historique aura pour tâche de déterminer dans chaque cas particulier combien la réalité se rapproche ou s'écarte de ce tableau idéal.." (Ibid).
C'est à tort que J. Topolski oppose la démarche de Weber à celle de Marx en écrivant :
"Comme on le sait, on considère Weber comme représentant du traitement instrumentaliste de l'idéal-type ; par ailleurs, comme l'examen du capital le montre clairement, K. Marx appartenait à l'approche réaliste". (J. Topolski : "The model method in Economic History" - The Journal of European Economic History - n°3-Hiver 1972, p. 718).
Au contraire, Weber écrit :
"Toutes les lois et constructions de l'histoire spécifiquement marxistes ont évidemment (dans la mesure où elles sont théoriquement correctes un caractère idéal-typique".(M. Weber,ibid, t. p.200).
Weber souligne l'importance heuristique éminente, et même unique de ces idéal-types pour comparer la réalité.
Rosa Luxemburg définit le mode de production comme un idéal-type lorsqu'elle écrit :
"Le schéma marxien de l'accumulation n'est que l'expression théorique du moment précis où la domination capitaliste a atteint sa dernière limite, ou va l'atteindre, et en ce sens, il a le même caractère de fiction scientifique que le schéma de reproduction simple qui formule théoriquement le point de départ de la production capitaliste. L'analyse exacte de l'accumulation et de ses lois se trouve quelque part entre ces deux fictions". (Rosa Luxemburg:"L'accumulation du Capital" - Paris, Maspéro 1967, tome II, p. 90).
Les développements qui suivent confirment la définition de Weber et l'application qu'il en a faite aux séquences historiques Marxiennes. On verra comment les fragments historiques livrés au sein d'une séquence historique ou liste de séquences de l'évolution de l'humanité avant sa soumission au capital, seront accentués et ordonnés de façon à éclairer l'exposé des deux découvertes de Marx et de ses principes dérivés. Si ces fragments historiques, les séquences qui les contiennent, leurs délimitations chronologiques sont "fictives", cela vient du fait qu'elles sont isolées d'un tout historique et structuré, de la formation sociale pré-capitaliste correspondante, dont la théorie n'est pas faite. Que Marx ait pratiqué l'idéal-type Wébérien sans le savoir, n'a aucune valeur en soi ; ce qui est intéressant dans l'oeuvre méthodologique de Wéber, c'est qu'elle permet de mieux cerner le projet historique et ses limites ; en particulier, l'idéal-type wébérien permet de relativiser l'apport historique de Marx et de le ramener aux limites méthodologiques marxiennes.
12- Les principales composantes de sa pensée économique.
La pensée économique de Marx relativise les catégories économiques par des déterminants socio- historiques. Il s'agit notamment de justifier l' existence du "capitalisme de la grande industrie" par sa forme d'exploitation spécifique: le salariat associé à la plus- value. Ainsi les catégories et les lois économiques sont soumises à des principes socio- historiques préalables. De ce point de vue, l'oeuvre de Marx occupe une place exceptionnelle au sein de la pensée historique en économie. Rappelons les principaux concepts et "en gros " la synthèse macroéconomique. L'essentiel étant consacré à l'analyse historique en trois parties: enjeux (I), textes avant 1858 (II) et après 1858 (III), la méthode de relecture étant architecturale ( cf. l'introduction).
Les principaux concepts du Livre I sont:
- le capitalisme est une "immense accumulation de marchandises".
" La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises" ( Capital,I)
- la marchandise dont la valeur d'échange est un quantum de travail social. Il existe un fétichisme de la marchandise ( l'apparence de la valeur d'usage tend à se substituer à la relation entre les choses). De même la métamorphose de la marchandise en argent, risque de faire perdre le sens de ces rapports matériels.
"Une marchandise paraît au premier coup d'oeil quelque chose de trivial et qui se comprend de soi-même. Notre analyse a montré au contraire que c'est une chose très complexe, pleine de subtilités métaphysiques et d'arguties théologiques. En tant que valeur d'usage, il n’y a en elle rien de mystérieux, soit qu'elle satisfasse les besoins de l'homme par ses propriétés, soit que ses propriétés soient produites par le travail humain. Il est évident que l'activité de l'homme transforme les matières fournies par la nature d'une façon à les rendre utiles. La forme du bois, par exemple , est changée, si l'on en fait une table. Néanmoins la table reste bois, une chose ordinaire et qui tombe sous les sens. Mais dès qu'elle se présente comme marchandise, c'est une toute autre affaire. À la fois saisissable et insaisissable, il ne lui suffit pas de poser ses pieds sur le sol ; elle se dresse, pour ainsi dire, sur sa tête de bois en face des autres marchandises et se livre à des caprices plus bizarres que si elle se mettait à danser.
Le caractère mystique de la marchandise ne provient donc pas de sa valeur d'usage. Il ne provient pas davantage des caractères qui déterminent la valeur. D'abord, en effet, si variés que puissent être les travaux utiles ou les activités productives, c'est une vérité physiologique qu'ils sont avant tout des fonctions de l'organisme humain, et que toute fonction pareille, quels que soient son contenu et sa forme, est essentiellement une dépense du cerveau, des nerfs, des muscles, des organes, des sens, etc. de l'homme. En second lieu, pour ce qui sert à déterminer la quantité de valeur, c'est à dire la durée de cette dépense ou la quantité de travail, on ne saurait nier que cette quantité de travail se distingue visiblement de sa qualité. Dans tous les états sociaux le temps qu'il faut pour produire les moyens de consommation a dû intéresser l'homme, quoique inégalement, suivant les divers degrés de civilisation . Enfin dès que les hommes travaillent d'une manière quelconque les uns pour les autres, leur travail acquiert aussi une forme sociale.
D'où provient donc le caractère énigmatique du produit du travail, dès qu'il revêt la forme d'une marchandise ? Evidemment de cette forme elle-même.
Le caractère d'égalité des travaux humains acquiert la forme de valeur des produits du travail ; la mesure des travaux individuels par leur durée acquiert la forme de la grandeur de valeur des produits du travail ; enfin les rapports des producteurs, dans lesquels s'affirment les caractères sociaux de leurs travaux, acquièrent la forme d'un rapport social des produits du travail. Voilà pourquoi des produits se convertissent en marchandises, c'est-à-dire en choses qui tombent et ne tombent pas sous le sens, ou choses sociales. C'est ainsi que l'impression lumineuse d'un objet sur le nerf optique ne se présente pas comme une excitation subjective du nerf lui- même, mais comme la forme sensible de quelque chose qui existe en-dehors de l'oeil. Il faut ajouter que dans l'acte de la vision la lumière est réellement projetée d'un objet extérieur sur un autre objet, l'oeil ; c'est un rapport physique entre des choses physiques. Mais la forme valeur et le rapport de valeur des produits du travail n'ont absolument rien à faire avec leur nature physique. C'est seulement un rapport social déterminé des hommes entre eux qui revêt ici pour eux la forme fantastique d'un rapport des choses entre elles. Pour trouver une analogie à ce phénomène, il faut la chercher dans la région nuageuse du monde religieux. Là les produits du cerveau humain ont l'aspect d'êtres indépendants, doués de corps particuliers, en communication avec les hommes et entre eux. Il en est de même des produits de la main de l'homme dans le monde marchand. C’est ce que l'on peut nommer le fétichisme attaché aux produits du travail, dès qu'ils se présentent comme des marchandises, fétichisme inséparable de ce mode de production.
En général, des objets d'utilité ne deviennent des marchandises que parce qu'ils sont les produits de travaux privés ; exécutés indépendamment les uns des autres. L'ensemble de ces travaux privés forme le travail social. Comme les producteurs n'entrent socialement en contact que par l'échange de leurs produits, ce n'est que dans les limites de cet échange que s'affirment les caractères sociaux de leurs travaux privés. Ou bien les travaux privés ne se manifestent en réalité comme divisions du travail social que par les rapports que l'échange établit entre les produits du travail et indirectement entre les producteurs. Il en résulte que pour ces derniers les rapports de leurs travaux privés apparaissent ce qu'ils sont, c’est-à- dire non des rapports sociaux immédiats des personnes dans leurs travaux même, mais bien plutôt des rapports sociaux entre les choses.
C'est seulement dans leur échange que les produits du travail acquièrent comme valeurs une existence sociale identique et uniforme, distincte de leur existence matérielle et multiforme comme objets d'utilité. Cette scission du produit du travail en objet utile et en objet de valeur, s'élargit dans la pratique dès que l'échange a acquis assez d'étendue et d'importance pour que des objets utiles soient produits en vue de l'échange, de sorte que le caractère de valeur de ces objets est déjà pris en considération dans leur production même. À partir de ce moment, les travaux privés des producteurs acquièrent en fait un double caractère social. D'un côté ils doivent être travail utile, satisfaire des besoins sociaux et s'affirmer ainsi comme parties intégrantes du travail général, d'un système de division sociale du travail qui se forme spontanément ; de l'autre côté ils ne satisfont les besoins divers des producteurs eux-mêmes, que parce que chaque espèce de travail privé utile est échangeable avec toutes les autres espèces de travail privé utile, c’est-à-dire est réputé leur égal. L'égalité de travaux qui diffèrent toto coelo les uns des autres ne peut consister que dans une abstraction de leur inégalité réelle, que dans la réduction à leur caractère commun de dépense de force humaine, de travail humain en général, et c'est l'échange seul qui opère cette réduction en mettant en présence les uns des autres sur un pied d'égalité les produits des travaux les plus divers. "
- la force de travail comme marchandise. Ce n'est pas donc l'homme qui est exploité,..mais la force de travail. L'exploitation est un rapport matériel.
- le produit du travail est supérieur au "minimum vital", nécessaire à la reproduction de la force de travail.
-la plus value absolue revient à augmenter le produit du travail ; la plus value relative, plus subtile, consiste à dévaloriser le minimum vital, d'où l'importance du mode de production en agriculture.
- la composition organique du capital (p. 751) analyse la part des "avances " ( cf. l'emprunt aux classiques) en travail (capital variable, V) et en capital (capital constant, C). On en déduira des lois structurelles ( augmentation de C/V et disparition de la race ouvrière) sous hypothèse de comportement de maximisation du profit par les capitalistes.
- D'où vient le capitalisme ? ... de la "séparation "du travailleur de ses moyens de production et de sa dépendance vis à vis du marché au cours du processus " d'accumulation primitive". Le capitalisme est donc historiquement une double négation ( de son environnement et de sa propre structure par élimination de la concurrence).
Synthèse macroéconomique:
-I- Le marché du travail
Il s 'inscrit dans l'accumulation primitive et se caractérise par un déséquilibre (le chomage) qui se reporte sur le marché des biens et services.
-II- Le marché des biens et services.
Deux élèments fondamentaux:
- le modèle bisectoriel: les schémas de la reproduction
- la baisse tendancielle du taux de profit(cf supra).
Les schémas de la reproduction
De l'économie stationnaire ( reproduction simple) à la croissance ( reproduction élargie) en économie fermée. L'oubli des marchés extérieurs dans le cadre de rapports de force. Les théories de l'impérialisme compléteront plus tard ( Rosa- Luxemburg, Hilferding, Kautsky, Lénine...) cet édifice.
Soient deux secteurs: moyens de production et biens de consommation. Avec l'offre ( O), le capital constant (C), le capital variable (V) et la plus- value (PL).
O1 = C1 + V1 + PL1
O2 = C2 + V2 + PL2
D1 = C1 + C2 + a ( PL1 + PL2)
D2 = V1 + V2 + (1- a ) ( PL1 + PL2)
l'équilibre global de référence doit être tel que:
O1 = D1 ---> O1 + O2 = D1 + D2 O2 = D2
HYP- 1
Si O1 < D1, en fait: I<S
alors O2 > D2 et donc la production est supérieure à la consommation.
En fait, la surproduction de marchandises entraine le rationnement de l'entrepreneur capitaliste et la sous-consommation.
- la baisse tendancielle du taux de profit(cf supra).
Soit r = PL/ C + V
avec la composition organique du capital a = C/V
Ainsi le taux de profit ( Pl/ C + V) peut connaître une tendance à la baisse relativement au taux d'exploitation ( PL/V) et à la composition organique du capital a = C/V .
-III- La monnaie-
Il est fortement question chez Marx d'illusion monétaire, surtout dans la forme de la valeur. La monnaie n'aurait qu'une utilité indirecte ? Mais la monnaie joue un rôle fondamental dans le processus de constitution et de dissolution des formes précapitalistes.
Elle permet la circulation des marchandises dans le cycle A M M' A'
Elle est un élèment fondamental de la crise: s'il existe des décalages dans l'achat/vente des marchandises, cela posera des pbs au moment de la reconversion de l'argent en capital productif. (ex. les matières premières augmentent).L'analyse marxiste des crises et de la monnaie a été prolongèe par l'analyse contemporaine de la suraccumulation /dévalorisation.
Une pensée historique préexiste à la pensée économique. L 'interrogation de la périodisation de Marx a pour but de saisir dans quelle mesure par son éventuelle unicité, elle autorise à une sociologie des connaissances et donc à une socio- histoire économique. Schéma unique d'évolution de l'humanité ou séquences- types illustrant des objets historiques multiples ?
13- La pensée socio- historique
- 131- Enjeux et méthode
Les enjeux
L'existence ou non d'un schéma unilinéaire d'évolution de la société humaine est un des problèmes majeurs que pose l'interprétation de l'oeuvre (*) de Marx ; et prend plusieurs dimensions :
- une dimension philosophique. De même que Marx pratique le raisonnement économique tout en condamnant l'économie politique, aurait-il utilisé le passeport universel d'une théorie générale historico-philosophique" (Marx K, "Lettre à Mikhailovski", Novembre 1877, La Pléiade, II, V, p. 1552.) tout en rejetant l'aliénation philosophique ?
- une dimension ethnocentrique. Si, selon la méthode historique de Marx (note 1), un tel schéma est conçu de façon récurrente à partir de la société bourgeoise occidentale, que deviennent les sociétés non européennes ? Sont-elles assimilables à la société antique ou à la société féodale de l'histoire européenne ou doit-on les rejeter dans l'exotisme des sociétés dites "primitives" ou "asiatiques" ?
- une dimension politique. Si l'évolution de la société humaine par différents stades de développement est successive et fatale, le passage du capitalisme au socialisme est un passage obligé, quelles que soient les luttes socio-politiques ; de ce fait, la question de la transition au socialisme est prématurée pour toutes les sociétés n'ayant pas encore atteint le niveau de développement de la société bourgeoise moderne..
- une dimension épistémologique. Un tel schéma, dans le cadre du principe du matérialisme historique détermine la connaissance. Celle-ci serait donc d'ordre socio-historique ; les catégories de la pensée étant déterminées, en dernière analyse, par l'histoire de l'économique, de la lutte des hommes pour leur survie.
- une dimension méthodologique. L'existence d'une analyse socio-historique "objective" implique que l'on puisse analyser l'état et le mouvement des structures ; cette référence ultime peut-elle constituer un projet ? Si dans la différence entre le sujet et l'objet, elle ne peut exister, (note 2) l'histoire n'est plus que la construction artificielle de l'historien. Ainsi l'histoire de Marx, loin d'être objective, ne serait plus qu'une pluralité de séquences historiques artificielles, conçue différemment en fonction de l'idée à démontrer ; autant de séquences qui, illustrant la méthode de Max Weber, sont des "séquences types".
- une dimension économique. A l'heure où les théories économiques du développement sont en crise, telles les théories des industries industrialisantes (Cf. l'échec du modèle Algérien) ou les théories de la troisième voie (entre le capitalisme et le socialisme), il est tentant de considérer le développement, dans le cadre de la domination internationale du capitalisme, comme développement des échanges marchands et des rapports salariaux capitalistes. Dès lors, la théorie historique de Marx, conçue non plus comme théorie générale de l'histoire mais comme théorie de la genèse du capitalisme (centrée sur le développement du marché et du salariat dans l'espace précapitaliste Anglais du XVIè au XIXè siècle), semble pouvoir s'appliquer idéalement aux économies en voie de développement effectif du capitalisme. Est-il possible d'utiliser la théorie historique de Marx comme théorie critique de développement après avoir utilisé sa critique de l'économie bourgeoise pour bouillir les marmites de l'avenir ?... sans retomber dans la philosophie de d'histoire.
La méthode
"Nous ne connaissons qu'une seule science, la science de l'histoire. L'histoire peut être considérée sous deux aspects : l'histoire de la nature et l'histoire des hommes. Toutefois, ces aspects sont inséparables ; tant qu'existent des hommes, histoire de la nature et histoire des hommes se conditionnent réciproquement" (K.Marx, F Engels : Passage biffé du manuscrit de "L'idéologie Allemande". Editions Sociales, édition bilingue. Paris, 1972, P.55)/
Matérialisme historique et périodisations
L'histoire est à la base de l'élaboration du principe que Marx voulait général et explicatif du développement de l'histoire humaine : le principe du matérialisme historique. Selon ce principe, les faits déterminent les idées au cours de périodes historiques, contradictoires, successives et spécifiques ; la démonstration de ce principe dans le champ de l'histoire nécessite la recherche de périodisations.
Mais périodiser par rapport à quel objet d'étude ? Les périodes et les transitions peuvent être construites de multiples façons à partir du magma historique..
La principale application de ce principe philosophique s'effectue dans l'oeuvre de Marx au sein de l'Economique et se cristallise sur un problème : celui de l'originalité historique du système capitaliste, de sa "différence historique" par rapport aux systèmes qui le précèdent. Mais, comment peut-on affirmer l'originalité, la "différence historique" du capitalisme sans avoir effectué la théorie des autres systèmes ? Dans cette perspective, l'oeuvre de Marx abonde en références historiques différentielles ; celles-ci sont rarement classées et le plus souvent incidentes, à l'exeption d'une demi- douzaine de schémas d'évolution de la société humaine. Ces schémas mettent en jeu différents stades d'évolution, le nombre et la nature de ces stades variant d'un schéma à l'autre.Ces schémas deviendront célèbres, après la mort de Marx, en venant à l'appui de nouvelles "théories marxistes" telles que :
- La théorie de la marche forcée de l'humanité par certains stades obligatoires dont le nombre variera en fonction de la reconnaissance ou non d'un stade spécifique d'évolution (dit d'"esclavagisme généralisé") des sociétés non européennes. La version la plus populaire celle des cinq stades (communiste primitif, esclavagiste, féodal, capitaliste, socialiste) naîtra d'une mauvaise interprétation des textes "pédagogiques" de Staline, tels "Matérialisme" dialectique et matérialisme historique" (1936) et "Brève histoire du parti communiste bolchevik" (1938).
- La théorie marxiste du "Féodalisme sans rivages" qui permettrait de caractériser, à l'aide du concept du servage, comme l'écrit Hobsbawm "aussi bien les émirats du Nord du Niger que la France de 1788, les tendances visibles de la société aztèque à la veille de la conquête Espagnole et la Russie tsariste du 19è siècle" (E.Hobsbawm, 1965)
- La théorie "architecturale" de la stricte dominance de l'infrastructure sur la superstructure ; le couple forces productives /rapports sociaux (le "mode de production") déterminant et permettant de caractériser toutes les sociétés humaines.
- La théorie selon laquelle toute l'histoire serait explicable par la lutte des classes (en ne regardant pas au-delà des premières lignes du "Manifeste..").
Ces différentes "théories" ont été établies à partir de simples illustrations venant à l'appui, dans l'oeuvre de Marx, de certains développements du matérialisme historique ; notamment ceux visant établir la "différence historique" du capitalisme.Aussi leur existence est contestable, var l'analyse historique de Marx, limitèe, inachevèe , ne contient pas de schéma unique de l'évolution humaine. Ce simple constat, tiré de la relecture dans cet exposé, n'est pas suffisant. Le fatalisme historique contenu dans ces théories réintroduit une philosophie de l' histoire que Marx a tenté de rejeter tout au long de son oeuvre. Ainsi, une analyse plus approfondie, au delà du simple survol des textes doit montrer en quoi ce fatalisme historique s'oppose au projet intellectuel de Marx. L'analyse historique de Marx est inachevèe, limitèe par les priorités de ce projet intellectuel: la critique de la philosophie et la critique de l'économie politique. A cette double critique sont subordonnées les différentes remarques historiques de Marx; et ce qui en résulte: une nouvelle analyse fondèe sur le matérialisme historique de l'exploitation capitaliste.Elle est inachevèe au sens où, après la mise à nu de la Plus Value, Marx ne livre sous forme achevèe que la genèse du capitalisme.En aucun cas, elle ne contient un schéma unique de l'évolution humaine.En effectuant une relecture des passages historiques de Marx, on trouve souvent des références à des "stades" passés et quelquefois, des listes de formes de propriété ou l'exploitation, de modes de production antérieurs au capitalisme. Mais ces références sont subordonnèes à un exposé donné; par exemple, à un exposé dialectique de la division du travail (Idéologie allemande), de la lutte des classes (Manifeste...), de l'expropriation (Grundrisse), de la plus value (Capital), etc...
L'oeuvre historique de Marx contient ainsi plusieurs évocations de stades historiques différents, appréhendés de façon différente (ne serait-ce que sur le plan chronologique), mais en aucun cas un schéma unique de l'évolution de l'humanité.Certes, il est toujours possible de déduire un tel schéma à partir de ces élèments; mais en dehors des spéculation inévitables dans ce genre de travail, une telle démarche serait contradictoire avec les caractéristiques de la méthode de Marx.
Nous examinerons successivement les périodisations et séquence-types Marxiennes produites, avant et après 1858 :
- Avant 1858 :
L'Idéologie Allemande mérite un traitement particulier en tant que première expression de la nouvelle dialectique de Marx. Ensuite, deux types de texte sont examinés : ceux à caractère polémique dirigés contre Proudhon (et indirectement, conte la philosophie Allemande), ceux à caractère populaire ("Le Manifeste", les "conférences sur Travail salarié et Capital".)
- Après 1858 :
Rappelons qu'en aucun cas un tel choix ne représente un parti-pris dans le faux débat (suscité par Althusser ; repris exagérement par ses premiers critiques). sur la "coupure" et surtout sur le moment de celle-ci dans l'oeuvre de Marx.Ce que nous savons, c'est qu'à partir de ce moment, Marx arrive à une nouvelle théorie du présent qui peut l'amener à une nouvelle conception du passé.Cette nouvelle histoire sera-t-elle écrite ? La réponse à cette question est recherchée successivement dans la préface à la critique.., les Grundrisse, le Capital. Une dissociation est effectuée entre les textes antérieurs à 1867 publiés (Livre I et non publiés (Grundrisse), et les textes postérieurs à cette date, plus particulièrement, les manuscrits qu'Engels publiera comme Livre II et III du Capital.
132 - Périodisations et séquences types marxiennes avant 1858.
L'histoire joue un rôle limité dans
des textes à vocation polémique (contre l'Idéologie Allemande
puis contre Proudhon) , pédagogiques ( les Conférences ) et politiques
(le Manifeste).
1 - L'"IDEOLOGIE ALLEMANDE"
1°) LA PLACE DE L'IDEOLOGIE ALLEMANDE DANS L'OEUVRE DE
MARX
En général, on donne à ce manuscrit, écrit en 1845/1846 à Bruxelles par Marx et Engels une place importante : il contient l'expression d'un nouveau principe philosophique et l'illustration de celui-ci à travers une vision globale de l'histoire de l'humanité.Ayant effectué leur "examen de conscience philosophique", Marx et Engels se mettent à critiquer les critiques allemands de Hegel de la gauche Hégélienne) ou le "vrai socialisme" de Karl Grun et du Dr Kuhlman. Mais, par là même, Marx critique avec Engels, son propre terrain de critique, la problèmatique Feurbachienne, dans laquelle il se situait dans des articles comme "La question Juive" ou la "critique de la Philosophie de l'Etat de Hegel".
Marx et Engels critiquent une critique Feurbachienne restée sur le terrain de Hegel: "dans la mesure où il est matérialiste, Feuerbach ne fait jamais intervenir l'histoire, et dans la mesure où il fait entrer l'histoire en ligne de compte, il n'est pas matérialiste.Chez lui, histoire et matérialisme sont complétement séparés" ; ("l'Idéologie allemande", op cit p. 47). Ils lui substitue une critique radicalement différente, dont la différence est apparue dans la recherche historique . Au tribunal des faits, il n'est plus possible de soutenir que les luttes sociales proviennent des oppositions d'idées et de principes au sein de l'idée absolue.La base des antagonismes de l'histoire, est le "développement du processus réel de la production, et cela en partant de la production matérielle de la vie immédiate" (ibid, p. 37). et la "conscience ne peut jamais être autre chose que l'Etre conscient et l'Etre des hommes est leur processus de vie réel", ce que Marx résume dans cette petite phrase devenue célèbre :
"Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience".
Ce principe constitue la base épistémologique que Marx utilisera désormais tout au long de son oeuvre, d'où l'importance de ce manuscrit non publié. J. Domarchi va jusqu'à écrire qu'il contient "toutes les thèses que Marx ne cessera par la suite de prendre, et, là, comme ailleurs, on ne peut que noter la remarquable continuité de sa pensée" (J.Domarchi : "Marx et l'Histoire" - "L'Herne", Paris, 1973, p. 195)
Faut-il voir dans ce texte une "coupure épistémologique qui marque la mutation d'une problématique pré-scientifique en une problématique scientifique" ? (L. Althusser : "Pour Marx" Maspéro, Paris 1966).On sait que pour Althusser cette coupure concerne conjointement deux disciplines théoriques distinctes : en fondant la théorie de l'histoire (le matérialiste historique), Marx a dans un seul et même mouvement, rompu avec sa conscience philosophique idéologique antérieure et fondé une nouvelle philosophie (le matérialisem dialectique).
Reprenant le concept de coupure épistémologique, Maurice Godelier reconnait qu'il y a une "coupure au moins double, d'ordre philosophique et épistémologique général en 1846/ 1847". Mais cette étape, selon lui, n'est pas la seule décisive en ce qui concerne l'économie politique. L'analyse radicalement nouvelle que Marx effectue du rapport capital/ travail, du mécanisme même de la formation de la plus-value et de profit en 1858, implique que l'on situe à cette date, une autre coupure épistémologique, cette fois, dans le domaine spécifique de l'économie politique. (Godelier M. : Préface aux textes "sur les sociétés pré-capitalistes" - op cit. p. 27).
Le moment n'est pas venu de reprendre les termes de la controverse suscitée par l'affirmation d'Althusser. Dans le manuscrit de l'Idéologie Allemande, ce qui est fondamental, c'est l'expression d'un nouveau principe ; celui du "matérialisme historique". Cependant, il ne faut pas exagérer la portée de "l'Idéologie Allemande" que Marx et Engels n'ont pas semblé pressés de faire paraître. Marx et Engels n'y opposent pas une recette historique à le recette philosophique. Ils avancent quelques abstractions, étayées par des exemples historiques.
Si "la philosophie cesse d'avoir un milieu où elle existe de façon autonome, "on pourra tout au plus mettre à sa place une synthèse des résultats les plus généraux qu'il est possible d'abstraire de l'étude du développement historique des hommes". (K.Marx, F. Engels : Idéologie Allemande - op cit. , p. 75).
Marx et Engels réitèrent les conseils de prudence à propos de ces résultats abstraits, tirés de l'histoire réelle. Ces abstractions :
-"prises en soi, détachées de l'histoire réelle n'ont absolument aucune valeur".
-".. peuvent tout au plus servir à classer plus aisément la matière historique, à indiquer la succession de ses stratifications particulières".
-"ne donnent en aucune façon, comme la philosophie, une recette, un schéma selon lequel on peut accomoder les époques historiques". (Ibid).
Par contre, beaucoup plus importantes sont les trois pages où sont inscrites les onze thèses sur Feuerbach que L. Goldman considère comme " la première formulation brillante, concise, et à ce niveau de concision définitive du matérialisme dialectique". (L. Goldman : "Marxisme et Sciences Humaines", Idées" - N.R.F. - 1970).
Engels écrira à la suite de sa critique du manuscrit de 1845/1846 :
" J'ai retrouvé par contre, dans un vieux cahier de Marx, les onze thèses sur Feuerbach publilièes en appendice. Ce sont de simples notes jetèes rapidement sur le papier, pour être élaborèes par la suite, nullement destinèes à l'impression, mais d'une valeur inappréciab, comme le premier document où soit déposé le germe génial de la nouvelle conception du monde. "
L'essentiel de l'Idéologie Allemande réside dans une polémique entamèe contre les néo-hégéliens, polémique souvent fastidieuse pour le lecteur contemporain.
Ce manuscrit de 600 pages in octavo, Marx (1857)avoue l'avoir abandonné de bonne grâce" à la critique rongeuse des souris". Engels , en 1888,à une époque où l'édition du manuscrit ne posait plus de problèmes, n'accorde qu'un intérêt mineur à ce texte:
"Avant d'envoyer ces lignes à l'impression, j'ai ressorti et regardé encore une fois le vieux manuscrit de 1845-1846. Le chapitre sur Feuerbach n' est pas terminé. La partie rédigèe consiste en un exposé de la conception matérialiste de l'histoire, qui prouve seulement combien nos connaissances d'alors en histoire économique étaient encore incomplètes. La critique de la doctrine même de Feuerbach y faisant défaut, je ne pouvais l'utiliser dmans mon but actuel."
Les exemples historiques ne seront là qu'à titre d'illustration des abstractions:
"Nous allons ici expliquer par des exmples historiques quelques unes de ces abstractions dont nous nous servirons vivi à vis de l'idéologie"
Malheureusement, les exemples historiques épars de l'Idéologie Allemande seront érigés en théorie dans le cadre général de la transformation des abstractions provisoires de l'Idéologie Allemande en "Théorie du matérialisme historique" Plus particulièrement, la matière historique non classèe du texte servira à constituer une théorie de l'évolution humaine en stades ou séquences-types donnèes.
-2°- LES SEQUENCES TYPES DE L'IDEOLOGIE ALLEMANDE.
L '"Idéologie Allemande" contient-elle le premier exposé du schéma marxiste de l'évolution de l' Humanité ? Résumant l'Idéologie Allemande, M.Godelier écrit :" tel est le premier schéma de l'évolution de l'histoire que décrivent Marx et Engels"ou encore Jacques Milhau (1972) commente ainsi le travail de Marx et Engels:
"Leur examen du développement dialectique des forces productives et des rapports sociaux schématise l'enchainement des régimes successifs : propriété tribale, système antique, système féodal, et société bourgeoise."
Ces deux jugements ne sont pas faux au sens où il est possible de déduire du texte un schéma d'évolution . Il n'y a pas cependant dans l'Idéologie Allemande de schéma unique et résume de l'évolution de l'humanité.Un premier schéma expose trois séquences-types correspondant à un rapport donné entre division du travail et structure sociale/ forces productives/ formes de propriété. Elles correspondent aux formes de propriété tribale, communale et d'Etat de l'Antiquité, féodale.
Un deuxième schéma insiste beaucoup plus sur la formation de la Grande Industrie à travers les formes de propriété privèe depuis le moyen âge et distingue trois séquences-types:
-1°)- Du XI° siècle au milieu du XVII° sicècle : formation du commerce et de la manufacture dans le cadre de l'opposition villes/campagnes.
-2° )- Du milieu du XVII° à la fin du XVIII° siècle: suprématie du commerce et de la navigation, formation d'un marché mondial, relatif pour l'Angleterre, et de la libre concurrence interne; rôle subordonné de la manufacture.
-3°)- A partir de la fin du XVIII° siécle: suprématie de la Grande Industrie. A la fin de la première partie, l'Idéologie Allemande, dans le cadre des rapports entre l'Etat et la propriété, évoque une séquence historique de la propriété: "propriété foncière, féodale, mobilière, corporative, de la capital de manufacture"; avant d'imaginer une possible appropriation de la totalité des instruments de production par les prolétaires eux-mêmes.En aucun cas, il n'y a de schéma "grandiose" , évoquant de façon synthétique le passage de l'humanité par ces différents stades; les stades "pré-capitalistes" ne sont pas d'ailleurs analysés pour eux même que ce soit dans la première ou la deuxième esquisse.
a) première esquisse
Trois formes de propriété définissent trois époques de l'histoire europèenne: tribale, antique, féodale:
- la production tribale: la production y est rudimentaire (chasse, pêche, élevage du bétail, à la rigueur agriculture); la division du travail dépend de l'extension de la famille qui fonde la structure sociale. L'esclavage latent, ne va pas se développer que peu à peu.
- la propriété antique, propriété communale et propriété d'Etat: plusieurs tribus sont réunies par contrat ou par conquête dans une seule ville; l'esclavage subsiste, mais "les citoyens n'ont toute puissance que sur leurs esclaves qui travaillent dans leur communauté, ce qui les lie déjà à la forme de propriété communale. Celle-ci sera menacèe par le développement de la propriété mobilière et immobilière, l'opposition de la ville à la campagne et au sein de la ville entre le commerce et l'industrie. A ce stade, Marx réfute la conception machiavélique de l'histoire à propos des motifs qui ne sont pas le goût de la violence, du pillage etc.. mais qui sont en dernier ressort économiques.Si la guerre, chez le peuple barbare conquérant, est une forme normale de relation, cela vient du fait que l'
"accroissement de la population crèe de façon plus impérieuse le besoin de nouveaux moyens de production, étant donné le mode de production traditionnel et rudimentaire qui es le seul possible."(ibid)
Dès à présent, l'analyse de ces deux périodes appelle quelques remarques: les caractéristiques "reelles" de ces périodes restent vagues. Par exemple, la propriété tribale
".... correspond à ce stade rudimentaire de la production où un peuple se nourrit de la chasse et de la pêche, de l'élevage du bétail ou à la rigueur de l'agriculture."(ibid)
Sur ce point, on voit que l'analyse est imprécise; plus encore, Marx suggère que l'économie pastorale nomade précède l'agriculture, idèe communément acceptèe à l'époque; mais qui n'est plus soutenable actuellement. Nous rencontrons ici une des "parties mortes" des développements historiques de Marx et Engels, selon M.Godelier (préface aux textes sur les sociétés précapitalistes). Ainsi,dans une phase préagricole, le chien, la chèvre, le renne, le mouton sont domesmtiqués; puis , dans une phase agricole (entre 6000 et 4000 avant J.C.), les "voleurs de récolte" (vache, buffle,etc..). animaux. Ce n'est qu'ultérieurement qu'apparait la domestication des animaux de transport et de travail (cheval, chameau ,etc..) et que des économies pastorales purement nomades sont possibles. Toujours à titre d'exemple, les mouvements historiques que Marx énonce à propos de l'antiquité restent inexpliqèes; on ne sait pas pourquoi se développe une propriété mobilière puis immobilière; comment se crèe une opposition entre la ville et la campagne; on ne voit pas du tout d'ailleurs les raisons du passage de la propriété tribale , de la réunion de plusieurs tribus en une seule ville par contrat et par conquête et dans laquelle l'esclagage subsiste.
-L'analyse du procès de transition de l'antiquité à la société féodale n'est pas plus prècise. Elle se borne à constater que la propriété féodale ou par ordres provient à la fois de la décadence de l'Empire et des institutions conquérantes.Marx et Engels relèvent:
"les derniers siècles de l'empire romain en décadence et la conquête des barbares eux même anéantirent une masse de forces productives".
Cet anéantissement provoque, selon eux, le déclin de l'agriculture, la décadence de l'industrie, la mise en veilleuse du commerce et la diminution de la population; ne suggérent-ils pas une régression en décrivant ainsi cette période ? De sévères controverses s'expriment à ce propos, par exemple dans le débat collectif "sur le féodalisme". Cette forme de propriété est remarquable par la situation démographique qui lui correspond: sur une vaste superficie est éparpillèe une faible population; situation inverse à celle de l'antiquité qui fera surgir le moyen âge des zones rurales. Comme dans les deux précèdentes formes de propriété, la propriété féodale repose sur une communauté, cette fois celle de seigneurs féodaux; communauté qui a pour but l'exploitation de la classe directement productive, les serfs. Mais ,ici encore, les remarques historiques se succèdent sans développement, ni justification. A propos de la structure féodale de la propriété foncière, Marx et Engels notent sa spécificité" parceque les conditions de la production étaient différentes"; mais cette différence n'est pas approfondie sans discussion du modus operandi propre à l'agriculture féodale. Avec le développemnt de du féodalisme croit l'opposition entre les villes et les campagnes; Marx et Engels insistent sur le fait que les villes prospères seront autant de refuges pour les serfs qui s'évadaient en masse de la campagne. Ce surplus de population et le besoin de marchés couverts concourrent à l'apparition du maitre dans les villes face aux compagnons, apprentis et journaliers.
Toutes ces remarques restent vagues. Il n'est pas possible de savoir d'où proviennent ces villes, comment elles ont pu se maintenir hors ou émerger du chaos. Les causes de la fuite des serfs et du surplus de la population dans les villes restent inexpliquèes, de même que leurs facteurs de prospérité. L'exposé se poursuit toujours aussi général, montrant comment la propriété principale de la féodalité est hétérogène; faite de propriété foncière à structure féodale et de propriété corporative. La division du travail y reste très peu développèe, contrairement à la division en ordres. Une dernière remarque pour rappeler que l'extension du territoire oblige la noblesse à avoir partout un monarque à sa tête et d'un seul coup l'exposé s'arrête. Aucune indication n'est donnèe sur les contradictions internes de la société féodale, son mode d'évolution vers le capitalisme. Marx et Engels énoncent immédiatement la loi du matérialisme historique. L'illustration préalable que constitue cette esquisse brève et imprécise de l'évolution historique, leur semble suffisante.
"Le fait est le suivant; des individus déterminés qui ont une activité productive selon un mode déterminé, entrent dans des rapports sociaux et politiques déterminés.."(ibid).
b) DEUXIEME ESQUISSE.
Celle- ci distingue trois périodes de la propriété privèe depuis le moyen âge.
-La première période marque le début des manufactures dont l'apparition est llièe à plusieurs facteurs: la division du travail entre les villes, une concentration poussèe de la population et du capital, le développement du commerce,etc..; facteurs qui, par là même, entrainent une décomposition de la féodalité. L'extension du commerce et de la manufacture accélère la substitution de rapports d'argent entre les travailleurs et employeurs aux anciens rapports patriarcaux, entraine le déclin des corporations où se concentre la petite bourgeoisie. Celle- ci perd son pouvoir politique au profit des commerçants et des manufacturiers.
-La deuxième période s'ouvre au milieu du XVII° siècle, par les lois sur la navigation et les monopoles coloniaux. Le commerce et la navigation se développent plus rapidement que la manufacture " qui joue un rôle secondaire" mais ces activités se concentrent en Angleterre qui bénéficie d'un marché mondial; face aux besoins de celui-çi, le mode de production manufacturier ne peut suffire et sera remplacé à la fin du XVIII° siècle par la grande industrie.
"Cette demande qui débordait les forces productives fut la force motrice qui suscita la troisième période de la propriété privèe depuis le moyen âge en créant la grande industrie."(ibid,p.67)
Ce système industriel moderne se répandra hors de l'Angleterre du fait de la concurrence. Son avénement est lié aux facteurs suivants:
-La création d'un marché mondial; l'importance du marché mondial relatif de l'Angleterre et donc la croissance rapide de la demande de produits anglais qui ont modifié radicalement les forces productives et les rapports sociaux.
-la dissolution de " tous les rapports naturels pour en faire des rapports d'argent";
-"la victoire de la ville commercante sur la campagne", la fin de l'artisanat;
-la formation d'une classe qui s'est reéllement débarassèe du monde ancien et qui s'oppose à lui en même temps.
Il est particulièrement difficile de comprendre ce qui fait la spécificité du capitalisme de la grande industrie: à lui seul, le "marché mondial" n'est pas un facteur suffisant; quand diverses phases de l'histoire se sont crèes des marchés mondiaux, il n'y a pas eu pour autant création de la grande industrie. La définition de la manufacture est inexistante, sa généralité d'application étonnante. Marx met sur le même pied la petite exploitation de tissage du XIV°/ XV° siècle et la manufacture du XVIII° siécle, confondant petite production parcellaire et production associèe. Il apparait surtout, dans la deuxième esquisse, que Marx ne cherche pas à donner un compte-rendu exact de l'évolution de l'humanité. La dynamique interne des diférentes sociétés n'est qu'à peine esquissèe, le passage d'une étape à l'autre le plus souvent inexpliqué. L'histoire ,ici, est au service de l'exposition et de la justification du matérialisme historique et des développements correspondants, servant à préciser des relations entre catégories en cours d'élaboration( forces productives, relation sociales, aliénation réelle, classes...) Marx cherche en priorité , dans cette deuxième esquisse, une séquence idéale, ne retenant que les éléments directement liés à l'histoire de la bourgeoisie, et par là même, à l'histoire du prolétariat; d'où l'insistance, dans cette esquisse, sur le devenir de la propriété privèe. Mais, n'ayant pas encore élaboré sa théorie explicative du mouvement propre à la société capitaliste, Marx ne peut encore en faire la genèse; cela explique l'imprécision des autres séquences types développèes avant 1858.
Le temps n'est pas encore à l'analyse récurrente, et aucun cas il ne faut voir dans les schémas de l'Idéologie Allemande, une nouvelle" philosophie de l'histoire". A cet égard, ce texte marque le début des mises en garde de Marx et Engels vis à vis de toute interprétation en ce sens:
"[A la place de la philosophie indépendante..], on pourra tout au plus mettre une synthèse des résultats les plus généraux qu'il est possible d'abstraire de l'étude du développement historique des hommes."
Ces résultats ont une valeur illustrative et classificatoire. Les auteurs développent alors une de leurs plus célèbres mises en garde contre la philosophie de l'histoire.
" Ces abstractions, prises en soi, détachèes de l'histoire réelle, n'ont absolument aucune valeur. Elles peuvent tout au plus servir à classer plus aisément la matière historique, à indiquer la succession de ses stratifications particuliières. Mais, elles ne donnent en aucun façon comme la philosophie, une recette , un schéma selon lequel on peut accomoder les époques historiques . La difficulté commence ceulement au contraire, lorsqu'on se met à étudier et à classer ce matériel.."
2- LES AUTRES SEQUENCES TYPES ELABOREES AVANT 1858.
L'idéologie Allemande n'ayant pu être éditèe, la première expression publique du "matérialisme historique" sera la lettre à Annenkov, rédigèe en Décembre 1846. Nous distinguerons cette version des deux autres versions "populaires", livrèes postérieurement par l'intermédiaire du "Manifeste" et des conférences sur "Travail salarié et capital".
1- La Lettre à Annenkov et la "Misère de la philosophie".
Cette lettre est rédigèe en "mauvais français" du propre aveu de Marx, parceque son objet est de critiquer un auteur français, Proudhon.Elle est une première impression que livre Marx après sa lecture (en deux jours ! ) de la "Philosophie de la misère". C'est une sévère critique effectuèe, pour partie en termes académiques, à un Proudhon autodidacte qui applique grossièrement à l'économie politique la méthode de Hegel. Marx ne lui pardonne pas de jouer sur les deux tabeaux, celui de la philosphie allemande, et celui de l'économie politique; immédiatement, il rédige sa "Misère de la philosophie", publièe en Juin 1847. L'occasion est trop belle. Marx critique, à partir de la faible synthèse de Proudhon, la philophie allemande. Sa critique est centrèe sur le caractère historique des catégories économiques. Pour ce faire, elle s'appuie sur l' illustration historique et donne lieu à un exposé de la conception matérialiste del'histoire. Pour illustrer comment "les formes économiques sous lesquelles les hommes produisent, consomment, échangent, son transitoires et historiques", par la contradiction qui s'établit entre forces productives et relations sociales, Marx prend l'exemple des révolutions anglaises du XVIIè siècles.
" Aussi y eut-il deux coups de tonnerre, la révolution de 1640 et celle de 1688. Toutes les anciennes formes économiques, les realtions sociales qui leur correspondaient, l'Etat politique qui était l'expression officielle de l'ancienne société civile furent brisées en Angleterre." (Marx, Lettre à Annenkov,LP,Ip.1438).
Cette révolution totale qu'il reprend mot à mot dans "Misère de la philosophie amène une nouvelle phase de l'histoire, le "règime manufacturier".Marx y revient à propos de la division du travail après avoir cité le "règime des castes" et le "règime des corporations":
"Et la division du travail du régime manufacturier qui commence au milieu du XVIIè sicècle et finit dans la dernière partie du XVIIIè siècle en Angleterre, n'est-elle pas aussi totalement distincte de la division du travail de la grande industrie et de l'industrie moderne ?"(ibid).
A ce mode de division du travail correspondent des instruments spécifiques :
" Par exemple, du milieu de XVIIè siècle , jusqu'au milieu du XVIII° siècle, les homme sne faisaient pas tout avec la main. Ils possédaient des instruments, et des instruments très compliqués comme les métiers, les navires, les leviers,etc.."(ibid)
Ces premières observation sont reprises dans "Misère de la philosophie" afin d'étayer la spécificité de la division du travail: "Sous le règime patriarcal, sous le régime des castes, sous le régime féodal et corporatif, il y avait division du travail dans la société toute entière, selon des règles fixes."( Misère de la Philosophie,L.P.,I,p.101)
Elles sont associées à celles qui étaient déjà esquissèes dans l'Idéologie Allemande à propos de des forces productives, des rapports sociaux, de la division du travail. Le déterminisme historique devient très fort avec cette relation célèbre de la mécanique forces productives /rapports sociaux:
"Le moulin à vapeur vous donnera la société avec le suzerain; le moulin à vapeur, la société avec le capitaliste industriel". (ibid)
L'accent est mis, en réaction au réformisme de Proudhon, sur les classes, classes "en elles mêmes" et classes "en elles mêmes".
"De tous les instruments de production, le plus grand pouvoir productif, c'est la classe révolutionnaire, elle même" (ibid).
Le rôle des classes sera plus important encore dans les séquences types développèes dans les versions populaires du matérialisme historique.
-II- LE MANIFESTE COMMUNISTE ET LES CONFERENCES SUR "TRAVAIL SALARIE ET CAPITAL" .
Jusqu'à présent, les séquences-types avancèes par Marx et Engels, ont tenu un rôle limité : venir à l'appui et illustrer le matérialisme historique, argumenter la critique adressèe à la "conception philosophique allemande" de l'histoire et à la méthode "économico- métaphysique" de Proudhon. Dans le "Manifeste" et dans ses conférences de 1847, une contrainte pédagogique s'impose à la compréhension historique: proposer au prolétariat un programme théorique et pratique qui soit clair.Marx commente ainsi, au début de Décembre 1847, ses conférences sur "Travail Salarié et Capital":
"Notre présentation sera aussi simple et populaire que possible. Nous ne poserons même pas , en principe, les notions les plus élèmentaires de l'économie politique".
Les "Conférences..." tentent d'illustrer de façon très générale les modes de production; le "Manifeste" met l'accent sur la dialectique de classes en évoquant les séquences les plus typiques à cet égard : antique, féodale et bourgeoise.
Certaines idèes forces de la dynamique historique marxienne reviennent dans le "Manifeste":
-le rôle moteur de la formation des marchés et des besoins correspondants.
-l' idèe d'une évolution progressive, économique et politique de la bourgeoisie, dès le développement des premières villes.
-plus particulièrement, le mode de production corporatif et féodal ne cède pas directement la place au mode de production de la grande industrie; il est remplacé par la manufacture et les "petits industriels".
Une fois de plus, Marx ne cherche pas à faire une histoire "exacte". Il cherche avant tout à dégager le schéma idéal permettant de d'éclairer le développement de la bourgeoisie en tant que classe , et du mode de production manufacturier , puis de la grande industrie.
Premier bilan
Il semble difficile de déduire des remarques historiques d'avant 1858, un schéma "marxiste" d'évolution de l'humanité. Ces remarques étayent la critique de de la philosophie allemande et de Proudhon, illustrent la nouvelle conception matérialiste de l'histoire et,enfin, éclairent le programme du prolétariat.
Les limites sont donc très étroites:
-au delà du schéma des trois âges, il n'y a pas de schéma unique nouveau.
-les "séquences-types" précapitalistes, citèes ici ou là, ne sont pas étudiées pour elle même.
-la transition d'une séquence à l'autre est à peine esquissèe.
-Marx cherche surtout à dégager la ligne typique d'évolution de l'humanité vers le capitalisme..........mais la spécificité du mode de production capitaliste n'est pas dégagèe.
Si l'exposé analytique de l'économie bourgeoise précède celui de sa génèse et, plus encore, conditionne l'analyse des économies précapitalistes, Marx et Engels, dans ces textes d'avant 1858, ne sont pas encore en mesure de fournir une analyse originale des économies précapitalistes. N'ayant pas encore percé le mystère de la formation de la plus-value et du profit en économie capitaliste, il ne peuvent de façon récurrente éclairer la spécificité du système féodal et des autres systèmes précapitalistes.
-133- Périodisations et séquences types marxiennes après 1858.
Deux évènements marquent cette période :
- la prise de conscience par Marx, dans le cadre de sa collaboration au New York Daily Tribune (commencèe en 1851), de l'existence en Inde d'une forme spécifique de la propriété foncière.
-l'élaboration d'une nouvelle théorie du profit, fondèe sur la "séparation radicale du travailleur des moyens de production" et l'appropriation sans échange de son travail, par le propriétaire du capital.
Ils conduisent Marx à revoir sa conception de l'évolution des sociétés et à perfectionner sa méthode historique. Cette "révision" sera consacrèe dans les textes correspondant aux "Grundrisse der politischen oekonomie" (rédigés en 1857/1858, non publiés ) et dans la "Contribution à la critique de l'économie politique" (parue en 1859). Dans les textes postérieurs, et notamment le Capital, la périodisation de l'histoire ne contiendra pas de nouveauté essentielle.
1- DE LA PREFACE DE " LA CRITIQUE DE L'ECONOMIE POLITIQUE" AUX GRUNDRISSE :
-I) La "Préface.." Dans la préface à la critique de l'économie politique, Marx continue à exposer le mécanisme général de tout changement social. Ici encore, il n'y a pas d'analyse de périodes historiques spécifiques ou de relations de production particulières pouvant les définir. Cette préface reprend les conclusions de l'Idéologie Allemande. Elle contient surtout le fameux aveu de rupture de Marx vis à vis de sa conscience historique d'autrefois.Le seul exposé traitant des formations historiques tient dans cette liste inexpliquèe des formations et des périodes historiques.
"Réduits à leurs grandes lignes, les modes de production asiatique, antique féodal et bourgeois moderne apparaissent comme des époques progressives de la formation économiquede la société" (Critique de l'Economie Politique, L.P.,p.272, passim).
La formule est ambigüe. Elle semble contenir une conception mécanique de l'histoire.Néanmoins, elle renferme un élèment nouveau, le mode production asiatique. Marx l'introduit, à la suite d'une série de travaux qu'il effectue avec Engels sur la question indienne et dont les résultats sont consignés dans leur correspondance et publiés dans les articles du New York Daily Tribune ( réedités en France par les éditions sociales sous le titre "Textes sur le colonialisme"). La question indienne a trait au type de domination coloniale que l'Angleterre prétend pratiquer. Pour prélever l'impôt foncier, encore faut-il connaitre le régime de la propriété privèe ou plus exactement qui est le propriétaire: est-ce l'aristocratie locale, équivalent de la noblesse foncière europèenne ou les communautés villageoises ? Marx opte pour la thèse d'une propriété du sol divisèe entre le souverain, propriétaire ultime et la communauté villageoise, simple usufruitière. Par là même, il refuse l'idèe d'une propriété privèe de type europèen en Inde. Ce refus implique que l'histoire ne puisse plus être enfermèe dans un schéma unilinéaire d'évolution: s'il y a des époques progressives de la formation économique de la société, elles ne sont plus forcément sur la même ligne d'évolution.
Curieusement, ces cerniers développements ne sont pas pour autant repris dans la "Critique de l'économie politique" où une liste de quatre stades appuie une reformulation de la conception matérialiste de l'histoire et des outils correspondants.Ils ne réapparaissent que dans le texte longtemps resté inédit des "Formes de production antérieure à la production capitaliste" qui, sur ce sujet, est le plus riche dans l'oeuvre de Marx.
LES GRUNDRISSE.. ET LA NOUVELLE ORIENTATION HISTORIQUE. _____________________________________________________
Marx, dans sa correspondance avec Lassalle, caractérise cet ensemble de textes comme étant à la fois" le fruit de quinze annèes de recherche, c'est à dire des meilleures de ma vie" et des "monographies écrites à des périodes trsè différentes pour sa propre clarification et non pour la publication". Ce texte développe l'idèe d'un schéma multilinéaire où l'histoire est telle que de multiples formes de communautés primitves peuvent évoluer de façon diverse vers des formes distinctes d'Etat et de sociétés de classes. On y trouve sept formes différentes d'appropriation du sol correspondant chacune à un mode de production donné: communauté primitive, mode de production asiatique, antique, esclavagiste, germanique, féodal, capitaliste. Certaines de ces formes ont un caractère géographique plus prononcé: mode de production germain, slave, asiatique. D'autres se caractérisent beaucoup plus par la forme que revêt l'exploitation: mode de production esclavagiste, féodal, servile.
Cependant, les sept formes d'appropriation du sol recensèes dans le texte sont traitèes de façon inégale. Plus particulièrement le féodalisme est négligé; rien ou presque ne traite de ses contradictions internes. Il n'y a pas non plus de discussion du servage. Par ailleurs, si le rôle de la cité dans la transition du féodalisme au capitalisme est souligné, le rôle de l'agriculture féodale dans ce procès est passé sous silence. Bref, on ne trouve pas plus dans le texte des "Formen.."que dans les autres textes , une analyse des dynamiques internes des systèmes précapitalsites à moins qu'ils n'expliquent les préconditions du capitalisme. Ainsi, si les développements intitiaux sont consacrés à la commune tribale, au despotisme oriental, à l'antiquité et à la propriété germanique( le féodalisme est à peine cité), ces passages ne constituent pas des analyses historiques. Tout en étant plus précis que les textes précédents, ils ont le même objet: étayer l'exposé du mécanisme général de tout changement social, exposé dont la forme est, cette fois, beaucoup plus rigoureuse que celle des premiers développements de l'"Idéologie allemande".
Désormais, l'histoire est au service d'une nouvelle démarche: comprendre le passage d'uen forme de propriété à une autre; processus dont le résultat est la séparation et l'opposition du travail par rapport au capital.Ce processus est double, à la fois d'expropriation ,créant le travailleur "libre" et aussi de transformation de sa propriété en fonds libre.
"Voici ce qui nous importe, ici, avant tout: le processus de dissolution qui transforme une masse d'individus, un peuple etc..en salariés virtuellement libres (individus que seule leur indigence oblige à travailler et à vendre leur travail) présuppose non pas la disparition, mais le changement des anciennes ressources et conditions de propriété: passant en tant que fonds libres dans d'autres mains, ou même restant en partie dans les mêmes mains, leur mode d'existence s'étant transformé."
(Marx, Formen..L.P.,II,pp.345-346)
Ce double processus , à lui seul , n'est pas suffisant; il faut ici qu'il y ait intervention du capital. Quelle a été sa genèse? Il doit y avoir eu création d'une fortune monétaire: cette création s'est faite lors de la "préhistoire "de l'économie bourgeoise. "L'usure, le commerce, la vie urbaine et la fiscalité , qui s'y développent parallèlement , y ont joué le rôle principal. L'épargne des fermiers, des paysans , etc..y a contribué , bien qu'à un moindre degré." (ibid) Grace au commerce, l'argent peut acheter les conditions objectives de travail et le travail vivant des travailleurs libres. Marx rappelle immédiatement une priorité fondamentale pour la suite de ses observations historiques: seul le processus de dissolution , lui même, peut conférer à l'argent la faculté de se transformer en capital.
Marx répétera cette négation et cette affirmation :
-A son origine, le capital n'a pas créé et accumulé les conditions objectives du travail: "Rien de plus inepte..absurde..".
-La richesse monétaire doit trouver devant elle , tous prêts, les travailleurs "libres", dépouillés de leur habileté, leurs instruments, matériaux, subsistances,etc.. pour pouvoir devenir ensuite capital.Ainsi le capital ne peut devenir prédominant que si l'expropriation s'est faite à grande échelle. A la limite, le processus d'accumulation monétaire est secondaire. Il s'est produit dans la Rome antique, Bizance, mais sans aboutir au capital. Le phénomène premier reste la séparation radicale du producteur d'avec les moyens de production. En d'autres termes, l'expropriation précède l'appropriation du surtravail et donc le capital.
L'histoire marxienne révéle ainsi sa base d'analyse récurrente: l'exploitation capitaliste dont les termes constitutifs sont le salariat et l'échange inégalitaire entre le travail et le capital. Si des séquences types sont produites, ce sera pour illustrer le phénomène d'expropriation menant au salariat. En quoi le "Capital" confirme t'il cette méthode ?
-- 2- LE CAPITAL.
__________________
Nous distinguerons "l'ensemble artistique" du Livre I du Capital, publié du vivant de Marx , des élèments des Livres II et III rassemblés et publiés par Engels.
-1- Le Livre I et l'"accumulation primitive".
Marx analyse dans les sept premières sections, le"mode de production capitaliste et les rapports de production et d'échange qui lui correspondent". Si ces sections contiennent de nombreux rappels historiques (Cf.les passages sur la manufacture et la coopération), nous traiterons plus spécialement de la 8° section, consacrèe à l' accumulation primitive. Cette section historique du capital tranche avec le style de la majorité de l'ouvrage. Marx, lui même, propoera à son éditeur Kugelman de la faire lire à son épouse , dans la mesure où elle fait partie des "sections lisibles" pour un début.
Les principes définis dans les "Grundrisse" sont à nouveau présents mais, sous une forme plus rigoureuse. Ainsi, pour sortir du "cercle vicieux"( plus-value/ production capitaliste/accumulation capitaliste),Marx écrit au début qu'il faut " admettre une accumulation primitive" (previous accumulation,dit A.Smith), antérieure à l'accumulation capitaliste et servant de point de départ à la production capitaliste, au lieu de venir d'elle." Il termine à nouveau par cette même idèe:
"Le mode de production et d'accumulation capitaliste et partant la propriété privèe capitaliste présuppose l'anéantissement de la propriété privèe fondèe sur le travail personnel; sa base, c'est l'expropriation du travailleur." (Le Capital,section VIII,L.P.,I,p.1167).
L'histoire n'a plus qu'un but limité et précis : étudier la genèse du trvailleur libre. A ce présupposé sont consacrés cinq chapitres. Un seul traite de la "Genése du capitaliste industriel"; les autres présupposés ayant trait au capital commercial et usuraire, sont cités pour mémoire. L' ensemble systèmatique ,embrassant à la fois le régime colonial, le crédit public, la finance moderne et le système protectioniste" est brièvement décrit. Limitèe par son objet, cette section est limitèe géographiquement à la ligne idéale de son mouvement: l'évolution de l'expropriation( particulièrement paysanne) en Angleterre qui joue ici le rôle de modèle pour (et seulement) les autres pays de l'Europe occidentale. Précèdemment, Marx faisait remonter l'origine du capitalisme au XI° siècle. Dans cette section, chronologiquement, l'évolution étudièe part du XVI° siècle; Marx concentre donc son attention sur une étape limitèe du devenir du capitalisme.Nous n'avons donc plus de "panorama" historique sur l'évolution de l'humanité"; mais, des précisions seront elles donnèes sur les questions posèes précèdemment ?
Il n'y a pratiquement rien sur le mode de production féodal, les problème du servage et de l'agriculture médiévale. Marx relève que "le servage avait disparu de fait vers la fin du XIV° siècle" et que le "le trait le plus caractéristique de la production féodale dans tous les pays de l'Europe occidentale, c'est le partage du sol entre le plus grand nombre possible d'hommes liges"(ibid p.1171 et 1172) Voilà tout sur le mode de production féodal! Sa dynamique interne reste inconnue. En conséquence, ilest difficile de constituer une théorie de la transition du féodalisme au capitalisme à partir du Livre I. Dans la mesure où Marx dispose d'une théorie du capitalisme mais d'aucune théorie du féodalisme, on peut avoir au mieux une théorie abstraite de la genèse du capitalisme mais en aucun cas de théorie de la transition. Cette dernière nécessite la connaissance et la possibilité de différencier deux complexes sociaux à dominante.
A propos de la transition, plus qu'une solution, il faut y voir un problème: le mode de production capitaliste est - il directement négation du mode de production féodal ?
* S'il est , au départ, fondé sur la négation de "la propriété privèe fondèe sur le travail personnel", cela ne suppose-t'il pas que l'exploitation du sol soit libérèe du servage ?
* Si ce départ est au XVI° siècle et si le servage disparait au XV° siècle, n'y at'il pas un no man's land de l'histoire, du XIV° au XVIII° siècle ?
*Du XIV° siècle au XVI° siècle, quel est le rôle des yeomen et de la paysannerie émancipèe, évoqués par Marx ? Peut-on parler à ce propos d'un mode de production des "yeomen" ou des "petits producteurs immédiats, propriétaires de leurs moyens de production" (que Marx cite dans le "chapitre inédit" du Capital).
*Si la manufacture joue un rôle "secondaire" jusqu'à l'avènement du capitalisme industriel, Marx (Livre I, section IV, LP, I, p.875) peut il évoquer une "période manufacturière" ,courant du XVI° siècle jusqu'au dernier tiers du XVIII° siècle ? *Si la manufacture est le mode de production capitaliste dominé, quel est , sachant que le commerce ne peut être cité à ce titre, le mode de production dominant ?
Si ces questions ne sont pas résolues,ce n'est pas faute de connaissances. Depuis, les Grundrisse et la mise à nu du salariat, Marx s'en tient à une genèse résumèe du capitalisme, en traçant la ligne idéale de l'expropriation. Ainsi, s'il retient quelques séquences types délimitèes chronologiquement, c'est au nom de cette ligne idéale quels que soient les complexes sociaux correspondants.
Cette périodisation donne les repères suivants:
-I- XIV° siècle :
Dissolution du servage, "âge d'or du travail en train de s'émanciper".
"Dès que le servage eut donc disparu, et qu'au XV° siècle la prospérité des villes prit un grand essor, le peuple anglais atteignit l'état d'aisance éloquemment dépeint par le chancelier Fortescue...mais cete richesse du peuple excluait la richese capitaliste"(ibid.p.1172).
-II- A partir du dernier tiers du XV° siècle et au début du XVI° siècle.
* Passage de l'âge d'or à l'âge de fer, licenciement des suites seigneuriales, Réforme, début des enclosures etc...
* Début de la Manufacture.
-III- Dernier tiers du XVII°siécle.
* "Suprématie commerciale de l'Angleterre" qui combine les différentes méthodes d'accumulation primitive dans uen extension de la manufacture; mais celle çi ne s'empare de l'industrie nationale que d'une manière fragmentaire, sporadique." (ibid.p.1209).
-IV- Dernier tiers du XVIII° siècle: avènement de la grande industrie.
"C'est la grande industrie seule qui, au moyen des machines, fonde l'exploitation agricole capitaliste sur une base permanente qui fait radicalement exproprier l'immense majorité de la population rurale, et consomme la séparation de l'agriculture d'avec l'industrie domestique des campagnes, en en extirpant les racines, le filage et le tissage" ( ibid. p.1210)
Cette seule phrase montre à quel point Marx a besoin d'une base à la genèse du mode production capitaliste. Mais, l'analyse de cette base et du complexe de relations sociale sort du cadre de son ouvrage.Marx, dans une lettre à Lassalle du 22 Novembre 1858, projetait d'écrire, outre sa critique du système capitaliste (cf. Le Capital) et de l'économie politique bourgeoise ( cf. "La Critique..), au delà des notes recueillies dans les "Théories sur la plus value", une ébauche historique des rapports ou des catégories économiques.
Celle-ci n'ayant pas été écrite, trouve-t'on des élèments dans les notes recueillies par Engels, formant les Livres II et III du Capital ?
II- LIVRES II et III du CAPITAL.
A partir de 1867, Marx reprend ses lectures historiques qui portent notamment :
* sur des séquences donnèes de l'histoire : l'histoire antique (fin 1879), l'histoire de l'Egypte et de ses origines (fin 1882), quelques semaines avant sa mort, l'histoire du moyen âge occidental.
*sur la périodisation: Marx rédige, en 1881, une énorme chronologie allant de 90 avant J.C à 1470.
Deux problèmes l'intéressent particulièrement :
-L'histoire des communautés rurales. En particulier les communautés rurales germaniques et surtout Russe. Il relit Von Maurer en 1868, apprend le russe. Il lit de nombreux ouvrages, en particulier celui de Kovaleski ("la propriété commune"),et prend part à la controverse sur le développement de la propriété commune en Russie.
- le problème des origines de la société; surtout depuis la lecture qu'il effectue entre décembre 1880 et mars 1881 de Morgan "Ancient society". Dans cet ouvrage, selon Engels (Préface à la quatrième édition de l'Origine de la famille , de la propriété privèe et de l'Etat) :
" La gens romaine et grecque trouve pour la première fois son explication complète dans celle des sauvages, en particulier des indiens d'Amérique, ce qui donne une base solide à l'histoire primitive."
Malheureusement, les conséquences de ces lectures seront très limitèes et tiennent dans une réaffirmation des principes élaborés jusque là. Le Livre II traitant essentiellement de la circulation et de la rotation du capital, ne comporte que très peu de remarques historiques. Par contre, le livre III est beaucoup plus riche à cet égard. Il comporte plusieurs chapitres historiques à propos des formes (marchandes, usuraires, agraires) du capital. Traitant de ces présupposés, Marx ne remettra pas en cause l'orientation , les hypothèses et la périodisation esquissèes dans le Livre I.
A)- L' HISTOIRE DU CAPITAL MARCHAND.
Le capital marchand, rappelle Marx, constitue la forme la plus ancienne du capital:
"Nous ne nous occuperons, ici, que du capital commercial, car comme nous l'avons déjà vu, il est avec le grand commerce qu'il suppose, l'unique condition du développement du commerce, de l'argent, et du capital." (Le Capital, Livre III, L.P.,II ,p.1093).
La phrase peut prêter à contresens; le présupposé du capitalisme est-il , dès lors, le capital commercial ? Marx rappelle l'importance du développement de cette forme de capital qui tend à orienter de plus en plus l'éconoie vers la production de valeurs d'échange et à transformer les produits en marchandises. Néanmoins, cette condition est necessaire, mais non suffisante; le phénomène reste l'expropriation. On voit ici le pas franchi entre ce texte et l'Idéologie Allemande. Dans ce dernier texte, l'accent était mis sur le marché mondial, mais rien ne permettait de savoir en quoi ce phénomène (qui s'était déjà produit antérieurement) avait débouché sur le capitalisme. Ce texte est aussi un des rares passages où Marx se fait plus précis sur la transition. Ainsi, il cite les modes de production suivants: communauté primitive, petite agriculture indépendante, petit bourgeois, capitaliste. Il fait intervenir aussi dans le testele "communauté rurale hindoue, placèe sous le régime de la propriété commune". Marx y précise le stade intermédiaire où la "fortune marchande est la forme dominante du capital"(ibid.p.1096). Dans ce cas, "le processus de circulation est devenu indépendant des producteurs qui en sont le point de départ et d'aboutissement, et lorsqu'ils sont eux même indépendants de ce processus"(ibidem).
A nouveau, il revient sur cette période "manufacturière" qu'il évoque depuis l'Idéologie Allemande, où "le commerce domine l'industrie".
A la limite, rien de nouveau. Mais, à la fin du chapitre, il spécifie les voies de transition du mode de production féodal au mode de production capitaliste et le rôle du mode de production parcellaire. Ce dernier est apparu lors de la décomposition de la féodalité, exprimant une dépendance plus ou moins forte des producteurs ; sans que cela change la domination du mode de production associé au développement du commerce. Seul le mode de production capitaliste, où "l'industriel devient commerçant, et produit directement pour le commerce de gros", peut renverser cette dominance. Dans cette analyse de la "voie révolutionnaire", Marx arrive cette fois à coordonner les rôles respecifs de la production parcellaire, du commerce et de la manufacture.
-B) L'USURE PRE-CAPITALISTE .
Marx consacre à l'usure précapitaliste, un chapitre dont l'orientation est, sur le fonds, similaire au chapitre sur l'histoire du capital marchand. Ce chapitre insiste, à nouveau, sur le rôle de la production parcellaire: "Forme caractéristique portant intérêt, le capital usuraire correspond à la prédominance de la petite production des paysans cultivant eux mêmes et des petits maitres artisans." (ibid.p.1267)
En aucun cas, l'usure peut modifier radicalement le processus de production:
"Là où les moyens de production sont dispersés, l'usure centralise la richesse monétaire. Elle ne change pas le mode de production mais, tel un parasite, elle y adhère et le rend misérable" (ibid,p.1269)
Marx revient sans arrêt sur l'expropriation:
"Dans l'économie capitaliste, l'usure ne peut plus séparer le producteur de ses conditions de production, car la séparation est désormais accomplie". (ibidem)
L'impossibilité de l'usure à jouer un rôle "révolutionnaire" et son rôle parasite, Marx l'illustre en citant des "formes asiatiques", l'antiquité (plus spécialement la dernière période de la République à Rome où le niveau de la manufacture était très bas), le féodalisme. Le passage décisif du capital usuraire au capital portant intérêt est déterminé par les banques, jusqu'à ce dernier soit subordonné au mode de production capitaliste.
L'au delà du capitalisme est même évoqué:
"Il n'est pas douteux que le système du crédit servira de puissant levier dans la période de transition du mode de production capitaliste au mode de production associé"; (ibid.p.1281)
En définitive, les formes usuraires et commerciales du capital telles qu'elles sont théorisèes dans le Livre III du Capital, ne font que compléter le schéma de l'accumulation primitive du Livre I du Capital.
"L'usure et le commerce exploitent un mode de production donné, il ne le crèent pas, ils lui demeurent exptérieurs".(ibid.p.1269). Par rapport à la méthode historique de 1857, l'accumulation primitive reste une genèse abstraite qui se suffit à elle même.
-C) L'ETUDE DE LA "GENESE DE LA RENTE FONCIERE CAPITALISTE".
Dès le début de la VI° section du livre III sur la transformation du surprofit en rente foncière , Marx avertit le lecteur qu'il renonce à y présenter l'histoire de la propriété foncière:
"L'analyse de la propriété foncière, dans ses diverses formes historiques, sort du cadre de cet ouvrage". (ibid.p.1285)
Très vite, Marx rappelle la ligne directrice: "Dans le chapitre sur l'accumulation primitive (Livre I,ch.XXIV), nous avons vu que ce mode de production suppose, d'une part la séparation des producteurs immédiats d'avec la condition qui en faisait un simple accessoire du sol (comme sujet corvéable, serf, esclave, etc..) et d'autre part, la dépossession de la masse du peuple de tout fonds de terre."(ibid.p.1288).
Marx, après avoir dissocié surtravail et rente foncière, évoque la difficulté consistant "à découvrir la source de l'excédent de plus-value que le capital agricole paie au propriétaire foncier sous forme de rente après que les plus-values des différents capitaux aient été ramenèes au profit moyen".(ibid.p.1391) Cette rente, excédent sur le profit moyen, n'existe que dans une société où le mode production capitaliste est dominant, où le capital "a soumis désormais le travail agricole à son règne et à se productivité" (ibid.p.1410) Aussi Marx essaye de spécifier historiquement la rente moderne par rapport aux autres formes de rente: rente en travail, rente en nature, rente pécuniaire. Les deux premières formes de rente sont les produits de modes d'exploitation pré-capitalistes donnés dans des sociétés de type asiatique,antique, esclavagiste, féodale. Détruisant les anciennes formes de rente, la rente pécuniaire est "l'ultime forme" de rente foncière. Marx précise, comme pour le commerce, les voies de transition crèes par la monétarisation de la rente:
" Le développement de la rente pécuniaire ne peut conduire progressivement qu'à la libre propriété paysanne ou la rente particulière à l'économie capitaliste : le rente payèe par le fermier capitaliste"(ibid.p.1408)
-La première voie est en fait un cul de sac; la libre propriété paysanne est contradictoire au développement du capitalisme. Sa négation est fatale. La petite production parcellaire est condamnèe à terme par sa médiocrité:
"Par sa nature même, la propriété parcellaire exclut l'accroissement de la productivité sociale du travail, le développement du travail associé, la concentration sociale des capitaux, l'élevage à grande échelle et l'applcation progressive de la science à la culture. L'usure et les impôts la ruinent fatalement partout". (ibid.p.1417)
Cependant Marx hésite dans l'interprétation de ce phénomène; sa spécificité historique n'est pas claire. Dans plusieurs passages de son oeuvre,Marx type ce mode de production, associant petite culture et métier indépendant, comme
"la base économique des communautés anciennes à leur meilleure époque, après que la propriété orientale originellement indivise se fut dissoute, et avant que l'esclavage se fut emparé sérieusement de la rpoduction". (Le Capital,Livre I,section IV,L.P. p.874)
Dans le chapitre inédit du Capital, Marx décrit la propriété parcellaire comme la "forme normale de propriété" dans l'antiquité classique, comme la "base économique de la société" chez les peuples modernes; elle est une des formes issues de la décomposition de la propriété féodale à l'exemple de la yeomanry en Angleterre, des paysanneries en Suède, France et Allemagne occidentale. Elle peut se maintenir , en partie, à côté de l'exploitation capitaliste. Dans ce cas, le paysan/artisan est à la fois capitaliste et salarié.Si Marx reconnait la production parcellaire comme mode de production, il hésite à en faire une séquence intermédiaire entre le féodalisme et le capitalisme . Le capitalisme repose sur l'abolition du mode de production féodal mais aussi sur l'abolition du "mode de production fondé sur la propriété privèe du producteur immédiat sur les conditions de production" (notes éparses du chapitre inédit du Capital).
Pourquoi cette hésitation ?
* D'une part parceque le statut du producteur immédiat est ambigu: il se paie son salaire, se prend sa plus-value, et tire un profit quand il ne se verse pas, en plus (en tant que propriétaire foncier) une rente.
* D'autre part, la petite propriété immémdiate a été sur le plan économique, un argument majeur de l'économie politique, de la philosophie du droit,etc.. pour justifier les bienfaits de la propriété capitaliste.
Ce mode de production qui a réellement existé , à des phases historiques différents, constitue un "rêve séculaire des travailleurs" (Latouche,1973), "l'utopie ambigüe du mode de production féodal" (Latouche,ibid.), "l'âge d'or" (Thornton,1846). Tout en le qualifiant de "richesse du peuple", Marx multiplie les mises en garde contre les confusions entre la thésaurisation typique de ce mode production et l'accumulation capitaliste elle même; particulièrement dans le chapitre inédit du Capital:
"Discussions oiseuses et ergotage,..il est donc faux, ridicule, mensonger, imposteur..d'assimiler accumulation capitaliste et l'épargne et la thésaurisation des petits producteurs immédiats".
Néanmoins , la vraie raison de cette reserve est à rechercher, une fois de plus dans le projet théorique marxien : dans sa genèse idéale du capitalisme, Marx traite de l'expropriation des petits possesseurs de terre, non de l'appropriation qu'ils ont pu réaliser. Que se passe-t'il, en définitive, lorsqu'il y a confrontation de la petite paysannerie indépendante et du capitalisme ? Une fraction de celle-çi peut se maintenir; mais, peu à peu, le petit propriétaire devient soit petit capitaliste, soit travailleur salarié.
"Voilà où tend la société dans laquelle prédomine le mode de production capitaliste" (Marx, Matériaux pour l'économie,L.P.,II,p.403).
- La deuxième voie crèe par la monétarisation de la rente correspond au développement du fermage et celle-çi est beaucoup plus "révolutionnaire". Elle est spécifiquement capitaliste. L'extension du fermage a deux origines:
*internes : dans ce cas, ce sont des paysans eux-mêmes, qui, tout en étant astreints au paiement de la rente en nature,ont réussi à exploiter des journaliers pour leur propre compte et deviennent des "fermiers bourgeois".
*externes :parmi ceux qui ont accumulé du capital à la ville, certains viennent l'investir à la campagne et deviennent des "fermiers capitalistes". Ce phénomène se déroule après monétarisation de la rente et seulement dans des pays qui dominent déjà le marché mondial.
Un fait est troublant: l'importance donnèe au marché. Celui-çi déclenche l'affermage qui révolutionne, ensuite, les rapports de production. La monétarisation de la rente et l'apparition du fermier capitaliste ne peuvent se produire que si le marché mondial du commerce et de la manufacture est développé
" à un niveau suffisamment élevé". Puis, dès que le fermier capitaliste commence à d'interposer entre le propriétaire foncier et l'agriculteur exploitant, tous les rapports qui s'étaient constitués au sein de l'ancien mode de production se dissolvent." (Le Capital,Livre III,L.P.,II,p.1409).
Mais peut-on dire qu'il y avait marché mondial à l'époque Tudor ? Si cette époque a connu une "classe de fermiers capitalistes très riches pour l' époque" (Le Capital, Livre I,L.P.I,p.1204), les relations sociales ont-elles été dissoutes ? Marx semble buter sur l'obstacle des origines du capitalisme agricole.. la critique du Livre III doit cependant être nuancèe:
-les 5°,6°, 7° sections du Livre III restent particulièrement inachevèes.
- si l'on en croit Engels, Marx devait remanier la VI° section sur la rente foncière à la lumière de l'analyse qu'il avait effectuèe de l'exploitation des producteurs agricoles en Russie. Celle- ci
"devait prendre dans la section sur la rente foncière, la place que l'Angleterre avait occupèe au Livre I, pour le travail salarié industriel". (Engels, préface au Livre III du Capital, L.P.,II,p.1585).
- Dans le manuscrit sur "la genèse de la rente foncière capitaliste", Marx renvoie à un chapitre sur l'histoire de la rente foncière qui ne sera jamais écrit. Un projet similaire est évoqué dans les "Théories sur la plus-value":
"Il faudrait développer:
-1) la transition de la propriété féodale à la rente foncière, commerciale, réglèe par la production capitaliste, ouencore le passage de cette propriété féodale à la libre propriété paysanne.
-2) La genèse de la rente foncière dans les pays comme les Etats-Unis, où le sol n'a pas , à l'origine, fait l'objet d'une appropriation et où le mode de production bourgeois prédomine d'emblèe, du moins formellement.
-3) Les formes asiatiques, encore existantes de la propriété foncière." (Marx, Théories sur la Plus Value)
Sur le premier point, Engels avait demandé des éclaircissements à Marx dans une lettre du 9 avril 1858.
III - AUTRES ECRITS A PARTIR DE 1867 : DEUX REAFFIRMATIONS CAPITALES
______________________________________________________________________
Marx, à la fin de sa vie, continue à porter un intérêt majeur aux problèmes des origines de l'humanité, à certaines des étapes concrètes de son développement et de sa périodisation. Faute de temps, il n'en résultera pas la fameuse histoire des rapports ou des catégories économiques projetèe en 1858. De même, il ne pourra remanier, comme il en avait eu l'intention (Engles, préface au Livre III), la section sur la rente foncière du Livre III, à la lumière de l'exemple russe. A la lumière de cet exemple, Marx met en garde contre toute interprétation abusive du projet historique du Livre I.Deux écrits sont éclairant à cet égard : la lettre à Mikhaïlovski (novembre 1877) et celle adressèe à Véra Zassoulitch (Mars 1881).Elles réaffirment:
A) les limites de la ligne de développement esquissèe dans le Livre I:
-elle est réduite au
"mouvement qui, faisant divorcer les producteurs de leurs moyens de production, convertit les premiers en salariés (prolétaires dans le sens moderne du mot) et les détenteurs des derniers en capitalistes". (Lettre à Mikhaïlovski).
- "La fatalité historique de ce mouvement est donc expréssement restreinte aux pays de l'Europe occidentale" (Lettre à Véra..).
En tant que passage d'une forme de propriété privèe en une autre forme de propriété privèe, elle ne s'applique qu'à ces pays. Elle ne peut s'appliquer à la Russie où il y aurait à transformer la propriété commune en propriété privèe.
B) En aucun cas, il n'existe une "soi-disant théorie" de la "necessité historique pour tous les pays du monde de passer par toutes les phases de la production capitaliste". (Lette à Vera..). Marx propose une "esquisse de la genèse du capitalisme", mais nullement une "théorie historico-philosophique de la marche générale, fatalement imposèe à tous les peuples..." (Lettre à Mikhaïlovski). La critique de l'histoire marxienne ne peut donc aller au delà du cadre méthodologique qui en a déterminé sa réalisation et ses limites. Ces limites sont ainsi résumèes par Engels sans l'Anti-Dühring;
" L'économie politique en tant que science des conditions et des formes dans lesquelles les diverses sociétés ont produit et échangé et dans lesquelles ,en conséquence, les produits se sont chaque fois répartis, l'économie politique, avec cette extension reste pourtant à créer. Ce que nous possédons de science économique jusqu'ici se limite presqu'exclusivement à la genèse et au développement du mode de production capitaliste."
Conclusions : LES LIMITES DE L'ANALYSE HISTORIQUE DE MARX.
A) Limites générales: il n'existe pas de schéma d'évolution normatif chez Marx.
Marx ne propose pas de recette "historique" face à la recette philophique allemande. En critiquant celle-çi, il aboutit à une nouvelle dialectique qui suggère un nouveau projet historique; mais ne peut le réaliser, faute d'une nouvelle conception du présent. Avec celle-ci, en 1857/1858, Marx nous livre sous forme définitive la genèse du salariat qu'il conçoit comme genèse résumèe et idéale de la naissance et de l'avènement du capitalisme.
- Elle est une genèse résumèe aux phénomènes constitutifs du salariat; phénomènes positifs isolés, extraits des formation sociales pré-capitalistes dont les traits constitutifs sont à peine esquissés.
-Elle est une genèse idéale, sinon idéal typique, réduite à la genèse particulière du capitalisme anglais conçu comme le modèle pour l'Europe occidentale.ce qui ne veut signifier que des genèses similaires doivent se produire ailleurs.
Jusqu'à l'avènement du capitalisme, cette histoire est donc limitèe à des élèments arbitrairement choisis et isolés dans un cadre chronologique et géographique limité. En dehors de cette genèse, les autres listes de sociétés, de modes de production pré-capitalistes ne font qu'esquisser un mouvement dialectique particulier. En aucun cas, elles ne donnent une périodisation définitive de l'histoire de l'humanité, ni de théorie des périodes pré-capitalistes. De telles périodisations seraient en contradiction avec les principes épistémologiques de l' Introduction de 1857. Sans doute, a-t'-on trop souvent confondu, comme le suggère R.Aron, périodisation concrète et typologie des modes de production.
-a) le cadre de la genèse du salariat.
------------------------------------
L' "accumulation primitive" ne prétendait que : "tracer la voie par laquelle dans l'Europe occidental, l'ordre économique capitaliste est sorti des entrailles de l'ordre économique féodal". (Lettre à Mikhaïlovski).
Cette voie est permise grace à un processus d'expropriation donné; mais, qui est exproprié ? Si le mode de production capitaliste est négation de la propriété privèe fondèe sur le travail personnel, il faut faire appel à une exploitation du sol libérèe du servage. Donc, il ne peut être directement négation du système féodal. La négation du système féodal est nécessaire à l'apparition de ce qui est la véritable base, le "négatif" de la propriété privèe capitaliste: "la petite propriété privèe des producteurs libres" que Marx évoque partiellement.
Mais quelle est la place relative de ce mode; comment se maintient-il ?
Nous ne pouvons le savoir. Marx isole les élèments déterminants dans l'accès au présent sans faire l'analyse de la place relative de ces élèments dans la formation sociale correspondante. L'accumulation primitive n'est qu'une genèse idéal typique du salariat, un tableau "utopique" de la salarisation .Cette genèse ne peut être à elle seule, la théorie de la transition d'une formation sociale à une autre; ce qui necessite la double connaissance de la formation passèe et de la formation future. Dans le cadre de cette genèse, les facteurs explicatifs, les phénomènes caractéristiques de l'avènement du capitalsime sont-ils clairement établis ?
-b) Les facteurs déterminant l'évolution des besoins sociaux et du marché.
Pourquoi avoir exproprié les paysans libres et les avoir remplacé par des fermiers ? A priori pour obtenir une force de travail et des moyens de production libres; cela créant automatiquement le marché intérieur necessaire au développement de la manufacture. Cette réponse appelle une autre question: pourquoi était-il nécessaire de libérer cette force de travail et ces moyens de production ? Sans doute des profits étaient possibles..mais ceux-çi supposent l'existence d' un marché; donc, le marché crèe l 'expropriation qui crèe le marché.. Cette redondance est particulièrement nette au niveau de la rente pécuniaire. La monétarisation de la rente n'est possible que si, prélablement, le marché mondial s'est développé "à un niveau suffisamment élevé". A ce moment, le fermier est en droit d'apparaitre et avec lui la dissolution des anciens rapport sociaux..
Nous retrouvons l'aporie précèdente: le marché crèe le fermier qui crèe l'expropriation qui, à son tour, développe le marché. Ce dernier, est ainsi, depuis l'Idéologie allemande la condition préalable de l'expropriation. Le marché a-t'il été créé par l'activité manufacturière? Mais, pour qu'il y ait manufacture, il faut qu'il y ait "une multitude d'ouvriers fonctionnant en même temps sous le commandement du même capital, dans le même espace; ou si l'on veut, sur le même champ de travail, en vue de produire le même genre de marchandise...." (Le Capital, I,XIII,L.P.,I,p.859). Pour qu'il y ait production capitaliste, Marx rappelle qu'elle "demande pour l'écoulement de ses produits, un marché étendu". (ibid.) Si le marché est la condition nécessaire au processus, nous ne connaissons pas l'origine de ce marché "étendu", à un niveau suffisamment élevé. Cela pose le problème de la validité de l'explication endogène de l'évolution et de la dissolution du système féodal et donc de l'apparition du capitalisme.
La solution est elle contenue dans cette phrase célèbre ?
"La force est l'accoucheuse de toute vieille société en travail. La force est un agent économique." (Le Capital, I,L.P.,I,p.1213).
Cette fameuse phrase signifie- t'elle que la causalité historique est superstructurelle chez Marx, comme le laissent entendre J.Y.Calvez (1956) et B.Baechler (1971) ? Aucunement, la force n'est qu'un moyen indispensable du changement social, elle n'est qu'un levier pour abréger la transition entre l' ancienne et la nouvelle formation sociale. La réponse se trouve alors dans le système social (l'infra et la super- structure) de l'époque; mais quel est celui là ?
c) Le problème des rapports sociaux.
Certains lecteurs estiment que Marx a résolu ce problème à travers la déclaration historique du "Manifeste":
"L'histoire de toute société, jusqu'à nos jours, est l'histoire de la lutte des classes"
Mais, rien n'est moins sûr. Marx, lui-même, affirme à plusieurs reprises que la société de classe est spécifique au capitalisme. Dès l'Idéologie Allemande( E.S.p.203), il relativise ce concept:
" La différence entre l'individu personnel opposé à l'individu en sa qualité de membre d'une classe, la contingence des conditions d'existence pour l'individu n'apparaissent qu'avec la classe elle-même, un produit de la bourgeoisie."
Cette apparente contradiction marque une hésitation constante sur le problème de l'existence ou non de classes pré-capitalistes.Certes, l'exploitation capitaliste simplifie le rapport de classes; mais, dès lors une rétroprojection de cette vue simplifièe risque d'être périlleuse. Prenons l'exemple du XVII° siècle Anglais, les notions de classe et d'ordre sont imbriquèes avec une très grande variété des situations de dépendance, compliquèe par la présence d'une masse de travailleurs indépendants? La division villes/campagnes est peu perceptible: la propriété terrienne a souvent une origine commerciale et l'activité commerciale repose sur une base territoriale. Dans le Trade de l'époque, travail manuel et travail intellectuel sont largement confondus.
Les modes de production , articulant rapports, besoins sociaux et forces productives, de même que les "décalages" entre instances, sont , dans l'oeuvre de Marx autant de moyens de classement de la matière historique afin d'illustrer un principe causal général : la dialectique matérialiste historique. Dans la matérialité des faits et leur interaction avec les idèes, Marx ne donne pas de recette permettant de connaitre la cause ultime du changement social, au sein d'un schéma fatal de l'histoire.
L'oeuvre de Marx, au nom du matérialisme historique, recèle une pluralité de constructions historiques, de séquences types. Elle reste ,malgré un siécle d'interprétations philosophico- historiques, la base de multiples variations historiques possibles. Illustrant le relativisme de Max Weber:
"Le nombre et la nature des causes qui ont déterminé un évènement singulier quelconque sont toujours infinis". (Essais sur la théorie de la science)
****
note 1: Marx K., "Introduction générale à la critique de l'économie politique", 1857. La Pléiade, I, p. 231. Cette introduction, avec la postface de la seconde édition Allemande du Capital (1873), expose la méthode historique de Marx dont l'application effective se trouve dans la structure du Livre I du Capital.