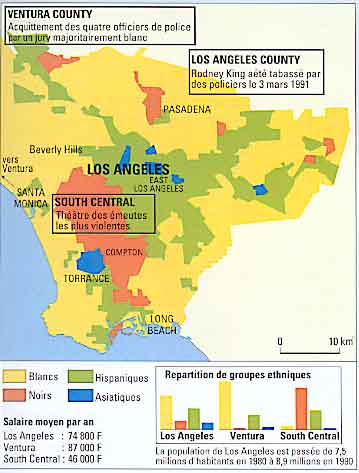Los Angeles, ville du futur
Le seul tissu de la ville est celui des autoroutes, spectacle inouï
de ces milliers de voitures circulant à une vitesse égale,
dans les deux sens, ne revenant de nulle part, n'allant nulle part: immense
acte collectif, rouler sans cesse, sans agressivité. Il n'y a pas
de verticalité à Los Angeles, il n'y a pas de collecti-vité,
pas de centre ni de monuments: un espace fantastique, une succession de
toutes les fonctions éparses, puissance de la pure étendue
celle qu'on retrouve dans les déserts.
D'après Jean Baudrillard,
Amérique,Grasset, 1986.
Il suffit d'évoquer l'âge d'or du cinéma hollywoodien
des années 30 et les livres de Scott Fitzgerald et de Nathanael West
pour retrouver un Los Angeles mythique. La conclusion du roman satirique
de West, The Day of the Locust, comporte une scène mémorable:
dans Broadway, une des principales artères de Downtown Los Angeles,
devant un des grands cinémas de la ville, des milliers de fans attendent
l'arrivée des vedettes à l'occasion d'une première.
L'immense foule, débordée, devient menaçante; des bagarres
éclatent, des spectateurs perdent pied, des badauds meurent piétinés.
West, en imaginant cette tragédie dérisoire et parfaitement
évitable, avait pour but de stigmatiser l'hystérie collective
suscitée par le star system hollywoodien; mais aujourd'hui, nous
en retenons surtout le fait qu'à cette époque, des centaines
de milliers d'Angelinos fréquentaient Downtown LA, toutes ethnies
confondues, alors qu'aujourd'hui, selon Robert Harris, titulaire de la chaire
d'architecture à USC (University of Southern California) « rares
sont les Angelinos qui savent même qu'il existe un centre-ville, un
Downtown LA ».
Ceux qui le savent y vont peu, et pour cause : Broadway, comme Main Street
et Hollywood Avenue, ses deux rues parallèles, fait aujourd'hui partie
d'un ghetto mexicain (« Chicano ») à l'abandon. On y parle
exclusivement espagnol. Les grands magasins- que fréquentaient les
stars sont fermés depuis longtemps; les cinémas à mille
cinq cents places où se déroulaient les premières sont
ou fermés, ou détruits, ou devenus lieux de réunion
de précheurs de sectes diverses (les rares cinémas qui survivent
ne montrent que des films X espagnols). A quelques centaines de mètres
de là se trouve San Pedro Street et son Skid Row avoisinant,
et le centre de contrôle des pauvres (Poverty Containment' Center
(1)) géré par l'archevêché autour duquel
gravitent environ 20 000 sans-abri et inemployables de toutes sortes - drogués,
alcooliques, malade mentaux ou simplement clochards avec leurs inévitable
caddies de supermarché, soit une bonne proportion de 75 000 sans-abri
recensés par le comté de Los Angeles. On se croirait dans
quelque bas-fond d'une grande ville africaine en proie à une crise
profonde, mais sans la moindre trace de cette gaieté, de cet amour
de la vie, de cette volonté de surmonter les épreuves les
plus dures qui caractérisent les taudis africains.
Bizarrement, à un kilomètre à peine de ce downtown
dont les habitants n'ont, pour la plupart, aucun espoir d'en sortir, se
dresse un vaste quartier d'affaires, neuf et pimpant, luxueusement aménagé,
avec gratte-ciel dernier cri, restaurants, magasins et hôtels de luxe.
Cette rénovation d'une petite portion de Downtown LA, due largement
à des capitaux japonais, est clairement visible du Skid Row:
on pourrait y accéder, à pied, en quelques minutes à
peine. Mais il s'agit de deux mondes à part, d'un phénomène
dont Guskind s'est sans doute inspiré pour son article dans le
National journal.
Car l'accès à ce quartier d'affaires rénové
est en fait difficile, tout au moins pour ceux qui n'ont aucune raison valable
de s'y trouver : escaliers mécaniques et couloirs piétonniers
extérieurs réservés, parkings à carte et immeubles
sévèrement gardés protègent cette zone urbaine
de l'invasion toute théorique d'habitants du Skid Row pourtant
tout proche; les contraintes sont, bien sûr, pour la plupart invisibles,
l'interdiction toute relative: taxis et voitures y ont libre accès,
l'exclusion est indirecte, économique (le parking coûte relativement
cher). Mais les architectes responsables de ce nouvel ensemble) la Financial
City of Los Angeles dont l'importance financière est à peu
près égale à celle de la Cité de Londres, reconnaissent
que les questions de sécurité y ont été prioritaires.
Les techniques employées ont d'ailleurs fait leurs preuves: en avril
1992, au moment des émeutes provoquées par l'acquittement
des policiers accusés d'avoir tabassé Rodney King, la Cité
financière - malgré son aspect presque provocateur pour les
habitants si proches du Skid Row, du Poverty Containment Center de la ville
et de MacArthur Park (2) - n'a subi aucun dégât. Le déclenchement
de divers systèmes de sécurité l'ayant transformé
en forteresse inaccessible dès le début de l'émeute,
les habitants de la zone de Los Angeles, contournant cette partie fortifiée
de Downtown LA, ont déferlé dans les rues plus lointaines,
dans les quartiers à population majoritairement coréenne ou
de moyenne bourgeoisie, et ce sont ces quartiers-là, pillés
et incendiés, qui ont le plus souffert.
Autre « centre » du « comté de Los Angeles »
exceptionnellement protégé : le complexe commercial City-Walk,
prolongement des studios Universal à l'autre bout de la ville, un
ensemble de rues piétonnières (restaurants, magasins, cinémas)
au slogan publicitaire particulièrement évocateur: «
Urban Thrills Without The Ills » (littéralement, « Frissons
urbains sans effets pernicieux »). Là encore, l'exclusion est
indirecte mais efficace : parkings obligatoires et relativement chers (il
n'y a pas de transports en commun et, pour y accéder à pied,
il faut compter quinze minutes de marche le long d'un chemin en forte pente),
gardes armés en évidence, installations clairement conçues
pour une clientèle aisée, y compris les nombreux touristes
attirés par Los Angeles mais peu enclins à s'aventurer dans
la vraie ville.
Son inventeur, l'architecte John Jerde, dit l'avoir conçu en tant
que vision platonique d'un Los Angeles idéal, laissant libre cours
à son imagination pour ériger « la ville que Los Angeles
n'a jamais eue ». Spécialiste en shopping malls dans le monde
entier, responsable du premier concept (finalement refusé bien que
de qualité supérieure) d'Euro-Disneyland, jerde a réalisé,
avec CityWalk, un microcosme de Los Angeles, mais un microcosme totalement
aseptisé, donc acceptable pour les touristes les plus craintifs.
C'est la notion de Disneyland, appliquée cette fois non à
un ensemble de loisirs inspiré des créatures mythiques inventées
par Disney, mais à la cité de Los Angeles elle-même.
On y retrouve des évocations discrètes du vieux Los Angeles
disparu, des rappels passés et présents de l'architecture
« typique » de Santa Monica, de Venice, de Sunset Boulevard et
même de Broadway, mais sans surprises, sans voitures, sans faune humaine,
sans le moindre désordre (caractéristique de toute vraie ville)
- bref, City-Walk est à Los Angeles ce que Disneyland est à
l'Amérique réelle. Mike Davis, professeur de théorie
urbaine à Son inventeur, l'architecte John Jerde, dit l'avoir conçu
en tant que vision platonique d'un Los Angeles idéal, laissant libre
cours à son imagination pour ériger « la ville que Los
Angeles n'a jamais eue ». Spécialiste en shopping malls dans
le monde entier, responsable du premier concept (finalement refusé
bien que de qualité supérieure) d'Euro-Disneyland, jerde a
réalisé, avec CityWalk, un microcosme de Los Angeles, mais
un microcosme totalement aseptisé, donc acceptable pour les touristes
les plus craintifs.
C'est la notion de Disneyland, appliquée cette fois non à
un ensemble de loisirs inspiré des créatures mythiques inventées
par Disney, mais à la cité de Los Angeles elle-même.
On y retrouve des évocations discrètes du vieux Los Angeles
disparu, des rappels passés et présents de l'architecture
« typique » de Santa Monica, de Venice, de Sunset Boulevard et
même de Broadway, mais sans surprises, sans voitures, sans faune humaine,
sans le moindre désordre (caractéristique de toute vraie ville)
- bref, City-Walk est à Los Angeles ce que Disneyland est à
l'Amérique réelle. Mike Davis, professeur de théorie
urbaine à la South California Institute of Architecture, note d'ailleurs
avec ironie qu'« au début du siècle, là où
se dresse aujourd'hui le parc de Disneyland, il y avait des orangeraies
que les gens venaient contempler. Aujourd'hui, Disneyland nous donne une
vision de ce paysage qui n'existe plus parce que détruit par Disneland
qui s'y est substitué et y occupe maintenant ce même terrain
». L'analogie vaut pour CityWalk, copie conforme miniaturisée
et aseptisée d'une ville idéale qui n'a jamais vraiment existé,
sauf dans l'imagination de son créateur.
Les critiques reprochent à Jerde d'avoir délibérément
exclu de CityWalk tout ce qui pourrait nuire au commerce - les pauvres,
les clochards, tous ceux qui ne peuvent pas se permettre de faire leur shopping
dans des boutiques luxueuses - bref, d'avoir exclu de cette « cité
» factice tout ce qui fait le charme et l'imprévu d'une cité
authentique - et c'est un fait qu'il se dégage de cette succession
de magasins et de restaurants terriblement kitsch un relent de Dysneyland,
mais aussi un côté "boutiques hors taxes" factice
et ennuyeux.
(...)
CityWalk en fait, n'est qu'une des nombreuses manifestations d'un boom
immobilier d'un genre analogue, mais beaucoup plus répandu: la construction
de banlieues, voire de petites villes, entièrement murées
et hermétiquement closes, véritables villes bunkers comprenant
écoles privées, magasins mais aussi clubs sportifs, dentistes,
médecins et même terrains de golf - le but, pour les acquéreurs
de propriétés à l'intérieur de ces enceintes
discrètement fortifiées, étant d'évoluer au
sein d'un monde en parfaite sécurité. Alors que de tels ensembles
étaientjadis relativement rares (Malibu Beach, La Brea Park) et destinés
surtout à des milliardaires, ce phénomène se généralise
aujourd'hui à travers l'ensemble des États-Unis.
A l'entrée de ces enclaves, qu'elles soient en Californie, dans les
lointaines banlieues de Detroit ou dans le New jersey, aucune voiture étrangère
ne peut pénétrer au-delà d'une barrière et d'un
poste de garde sans que le visiteur décline son identité et
le but de sa visite. Les étrangers ne pouvant fournir d'explications
suffisantes se voient impitoyablement refoulés. Des patrouilles armées
(également privées) assurent une sécurité interne
constante.
On y voit les prémices d'un style de vie nouveau, d'où la
cité proprement dite serait exclue, ou réduite à un
lieu de passage, à des heures de bureau vécues à l'intérieur
d'une enceinte spécialement aménagée (Renaissance Center
à Detroit, Financial City à Los Angeles) - lieu qu'on quittera
le plus rapidement possible en fin de journée pour retrouver son
propre bunker dans un cadre rural, auprès de gens de son propre milieu.
Les ressortissants privilégiés des bunkervilles et des zones
urbaines fortifiées éviteront ainsi, la vie durant, tout contact
étranger, tout côtoiement d'une foule par définition
menaçante. Il n'y aura aucune surprise désagréable,
aucun imprévu possible, et on se félicitera de son style de
vie en lisant régulièrement, dans la presse, les comptes rendus
des faits divers sanglants se déroulant ailleurs, dans les downtowns
à l'abandon...
Mais le prix à payer est lourd, les inconvénients majeurs.
Pour Mike Davis, adversaire acharné de ces bunkervilles, ces villes-Frankenstein
où tout est subordonné au profit - la seule préoccupation
de ses occupants étant de maintenir, par tous les moyens, la valeur
immobilière de leurs investissements - sont des villes mortes, totalement
stériles et artificielles.
Y vivre entraîne des conséquences psychologiques inattendues:
la mentalité des résidents de ces bunkervilles se différencie
très vite de celle des citadins. On peut la résumer ainsi:
« Notre responsabilité s'arrête ici, derrière nos
murs fortifiés. La cité et ses problèmes, c'est-à-dire
les problèmes de l'ensemble de la société américaine,
ne sont plus les nôtres. Nous ne sommes plus concernés. »
La sécurité totale, mais en fin de compte factice, de ce genre
d'existence (car le monde extérieur continue d'être, qu'on
le veuille ou non) rendra les résidents des bunkervilles de moins
en moins aptes à surmonter des crises de toutes sortes: il en résultera
une perte de sang-froid, un sentiment de panique suscité par le moindre
imprévu, et une peur obsessionnelle de l'étranger, considéré
comme « colporteur de la violence ».
Tout cela conduit Charles Murray, socilologue très écouté
et ancien conseiller (pour les questions sociales) successivement de Nixon,
Reagan et Bush, donc peu suspect de gauchisme, à adresser une mise
en garde sévère à ses compatriotes. L'Amérique,
écrit-il dans "Losing Ground" (3) en choisissant
ainsi de se fractionner en petits groupes sociaux entièrement cloisonnés,
est en train de se balkaniser sans s'en rendre compte: «Nous sommes
en train de nous transformer en une véritable société
de castes, avec cloisonnement social rigide entre les riches et les autres...
J'essaye d'imaginer ce qui se passera quand les 10 ou 20 % de la population
auront suffisamment de revenus pour faire à leur tour ce que la minuscule
fraction richissime du pays a toujours pu faire, c'est-à-dire ignorer
les contraintes des institutions sociales qu'ils estiment leur être
défavorables. Ceux qui se disent de gauche protestent depuis des
années que les riches ont un pouvoir démesuré. je leur
dis qu'ils n'ont encore rien vu. »
Sa conclusion : le jour viendra où « les villes seront perçues
comme des endroits condamnés ou, au mieux, l'équivalent de
ces réserves indiennes, vis-à-vis desquelles les nouvelles
castes dirigeantes (demeurant dans des bunkervilles) déclineront
toute responsabilité ».
1. Containment implique aussi la notion de refoulement
2. Lieu à haut risque et domaine privilégié des gangs,
où la police ne
s'aventure que rarement.
3. Basic Books, New York 1984