|
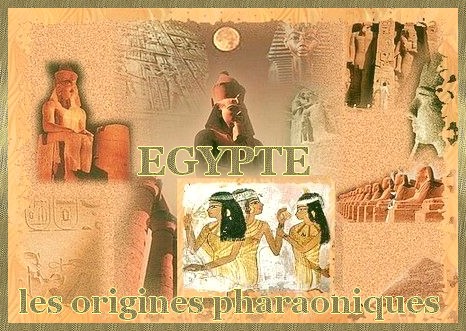
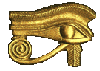 LES ORIGINES DE
L'EGYPTE LES ORIGINES DE
L'EGYPTE 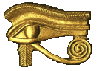
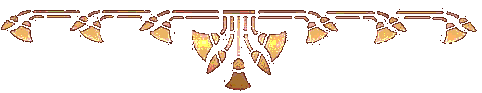
Quand
se met en place la civilisation pharaonique, telle qu’elle
nous apparaît à travers textes et monuments grandioses,
l’Égypte a déjà un long passé. Car si l’histoire des
premiers Pharaons remonte au début du IIIe millénaire, les
racines de leur histoire plongent dans un passé bien plus
lointain, dans une préhistoire qui s’est jouée au gré
des variations climatiques de la dernière période du
Quaternaire, l’Holocène, de 10 000 avant notre ère à
nos jours. En effet, s’il est un lieu où les
modifications environnementales ont tenu un rôle clé dans
l’aventure humaine, c’est bien en cet endroit, à ces époques
lointaines où les caprices des cieux ont entraîné les
hommes à des défis toujours plus grands. Après s’être
concentrées sur la vallée du Nil, où l’existence
d’une préhistoire a été démontrée dès la fin du XIXe
siècle par l’archéologue britannique Flinders Petrie,
les recherches se sont déplacées ces vingt-cinq dernières
années vers les déserts, révélant un étonnant va et
vient de groupes pastoraux, entre 10 000 avant notre ère et
le début de l’aridification définitive, vers 4 000
avant notre ère. On a très peu d’informations sur ce qui
se passe à cette époque dans la vallée du Nil, sans doute
en raison du comportement du fleuve qui, alternativement, a
creusé et exhaussé sa vallée, détruisant ou
ensevelissant les sites.
La
scène s’éclaire courant Ve millénaire, avec
l’apparition, au Fayoum et dans le delta du Nil, des
premiers sites pleinement néolithiques. Au Fayoum et à Mérimdé
Beni-Salâme, puis à El-Omari, l’homme est devenu éleveur
et cultive les céréales. Hormis le bœuf, dont la
domestication au Sahara dès le VIIIe millénaire ne doit
pas être exclue, toutes ces espèces sont d’origine
orientale : chèvres, moutons, porcs, orge, blé et lin
trouvent leur biotope originel dans cette zone levantine, où
ils ont été domestiqués à une époque plus ancienne. La
préhistoire égyptienne, dans ses aspects les plus
lointains, reflète donc cette double appartenance à la
fois africaine et orientale. Elle est à l’image du
fleuve, qui prend ses sources au cœur de l’Afrique, se déploie
sur plus de 6600 km, traverse un désert parmi les plus
arides du monde, pour se jeter enfin, bras ouverts, dans la
Méditerranée, une mer peu fréquentée jusqu’au IIème
millénaire avant notre ère. Vers l’est, au contraire,
l’isthme de Suez et les côtes syro-palestiniennes
constituent très tôt les grandes pénétrantes vers le
monde oriental, c’est la voie de passage obligée pour un
Égyptien qui fuit la vallée, comme le montreront plus tard
les aventures de Sinouhé.
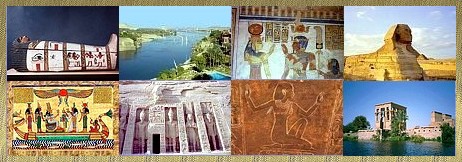
C’est
au tournant du IVe millénaire, vers 4200 avant notre ère,
que se mettent en place les premiers éléments d’une
aventure humaine qui se conclura, un millénaire plus tard,
par l’apparition du plus ancien État de la planète.
A
l’extrémité nord de la Haute-Égypte, entre les villes
modernes d’Assiout et de Tahta, un ensemble homogène se
dessine à travers une succession de nécropoles qui s’échelonnent
au pied du massif calcaire, sur la rive orientale du Nil, au
long d'une trentaine de kilomètres. Il s’agit de la
culture de Badari. Inhumés sur le côté, en position
recroquevillée, dite « fœtale », la tête généralement
orientée au sud, les individus reposent dans de simples
fosses, souvent enveloppés ou recouverts de nattes. Le matériel
qui les accompagne révèle une société complexe et inégalitaire,
capable de produire des biens de luxe. À côté des
belles poteries rouges à bord noir et surface ondulée, on
note des objets en ivoire de très grande qualité :
figurines généralement féminines, cuillers, peignes, épingles
de cheveux. Les palettes à fard, réalisées dans une belle
pierre vert-noir appelée « grauwacke », et dont les
gîtes se trouvent dans le wadi Hammamat, font leur
apparition sous des formes simples de losanges plus ou moins
allongés. Le peu qu’on connaisse des habitats atteste un
mode de subsistance mixte, où, à côté des espèces
domestiques, l’économie de ponction – chasse, pêche,
cueillette – joue encore un rôle important. Les
relations avec leurs voisins de Basse-Égypte sont attestées
à travers certains groupes d’outillage lithique – les
pointes de flèches à base concave – et peut-être
dans la technique particulière de polir les poteries. Ces
populations connaissaient bien les déserts et particulièrement
le désert oriental, entre Nil et mer Rouge, qu’elles
traversaient en quête de coquillages marins et dont elles
surent très vite exploiter les richesses pétrographiques
– grauwacke, stéatite, malachite. Avec la culture
badarienne, on assiste à l’amorce d’un processus qui
ira en s’accélérant.
Vers
3800 avant notre ère, l’aire occupée par les populations
badariennes s’étend vers le sud, constituant alors la
première culture de Nagada, du nom du grand cimetière
fouillé par Petrie, à quelques kilomètres au nord de la
ville moderne de Louxor. Peu à peu, l’agriculture, et
tout particulièrement l’agriculture céréalière, va être
amenée à jouer un rôle clé dans les processus de hiérarchisation
sociale, dont l’évolution des pratiques funéraires est
le plus frappant reflet. Dans cet univers, tous les morts ne
sont pas traités de façon égale. Le phénomène inégalitaire
se traduit par l’accumulation d’objets dans certaines
tombes et par le soin apporté à la confection de certains
d’entre eux. Les belles poteries polies rouges s’ornent
à présent – au moins certaines d’entre elles – de
dessins peints en blanc : simples motifs géométriques, décors
végétaux ou animaux riverains – crocodiles, poissons,
hippopotames – au corps strié de chevrons. Quand la
figure humaine apparaît, ce qui est très rare, elle
traduit déjà des relations fortes de pouvoir entre les
hommes : des personnages au chef paré de plumes, les bras
levés en signe de victoire, dominent des sujets plus
petits, enchaînés et aux bras entravés, c’est l’image du guerrier victorieux.
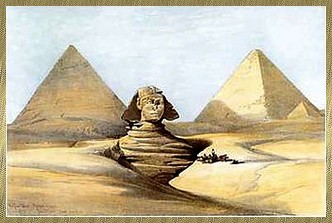
À
la même époque, et jusque vers 3500, se développe en
Basse-Égypte, une culture de pasteurs-agriculteurs, comme
en témoignent les restes abondants de faune domestique et
les kilos de graines de céréales retrouvées dans les
silos du site de Maadi, localité actuelle de la banlieue du
Caire. À l’inverse de ce qui se passe en Haute-Égypte,
le monde funéraire a ici un faible impact. Les morts sont
inhumés dans de simples fosses avec très peu
d’offrandes, souvent sans offrande. Ce qui caractérise
l’ensemble culturel de Basse-Égypte, ce sont ses
relations privilégiées avec le Proche-Orient voisin. De
Palestine viennent les céramiques à pied, à col, à
anses, à décor en mamelons, les grands racloirs de silex,
les lames de silex de type dit « cananéen », la
résine et dans cette perspective, le cuivre qui se
substituera plus vite qu’ailleurs et dans de plus grandes
proportions aux autres matières premières. Les
importations de Haute-Égypte, en revanche, sont plus
modestes : têtes de massue discoïdes, vases de pierre,
palettes rhomboïdales et quelques poteries rouges à bord
noir. Mais, sous la pression de la turbulente élite des
princes nagadiens, à présent trop à l’étroit dans leur
berceau, dans ces cinq cents kilomètres de vallée
qui séparent Assiout d’Éléphantine, les communautés
agro-pastorales de Basse-Égypte vont disparaître, absorbées
plus ou moins radicalement par le groupe dominant. Ces
modalités d’acculturation sont aujourd’hui très discutées.
Plutôt qu’une guerre de conquête pure et dure, on conçoit
des formes d’assimilation plus variées : alliances,
mariages, sans exclure les coups de force, notamment avec
certains groupes rebelles du Delta, comme en témoigneront
les documents de la fin de la période – les palettes ornées.
Cette
expansion nagadienne ne se limitera pas au nord du pays,
mais trouvera son symétrique au sud, en se déployant
jusqu’aux marges de la seconde cataracte, en Nubie, là où
se développeront des communautés particulières de Nubiens
« égyptianisés », le fameux Groupe A. Cette période
d’expansion correspond à la seconde phase de la culture
nagadienne. L’accentuation considérable du processus de
hiérarchisation est visible dans les nécropoles par une
tendance marquée à l’accumulation des biens de
consommation et de prestige. L’élite affirme alors sa
différence par la possession d’objets luxueux. C’est
l’époque des grands couteaux, dont la confection exprime
un des sommets mondiaux de la taille du silex, des bijoux en
cuivre et en or, des ivoires travaillés, des pierres précieuses
parfois venues de très loin, comme le lapis lazuli
originaire d’Afghanistan, des palettes à fard zoomorphes
et des belles poteries à fond blanc, décorées de motifs
peints à l’ocre : spirales, vaguelettes, lignes ondulées,
mais également des scènes complexes dominées par le thème
de la navigation. L’axe du Nil n’est pas seulement la
voie de communication par excellence, celle qui relie le
Delta au cœur africain, c’est aussi le lien symbolique
qui unit deux mondes symétriques : celui des vivants et
celui des morts. La tombe des Grands de Nagada, en ces temps
d’expansion et de domination, reflète peu à peu la
maison des vivants : elle s’édifie, se complexifie,
alliant l’utilisation de la brique crue à la
multiplication des chambres et des magasins.
Progressivement, durant la phase finale du Prédynastique,
phase Nagada III, elle redessinera pour l’éternité
l’image des palais royaux, entourés de murs à redans et
de tombes subsidiaires destinées à l’entourage du roi.
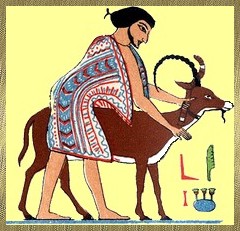
C’est
cette dernière phase du Nagadien, entre 3300 et 2900, qui
voit l’apparition du processus de codification, un des
caractères des sociétés étatiques. Plusieurs artefacts
disparaissent, comme la poterie décorée, les beaux
couteaux de silex, d’autres évoluent, comme les palettes
à fard devenues supports d’iconographie, tandis que des
formes nouvelles commencent à voir le jour, comme certains
vases que l’on retrouvera tout au long de l’Ancien
Empire. Mais la grande nouveauté de Nagada III, c’est le
début de l’écriture.
Dans la tombe U-j d’Abydos, des poteries portaient peints
à l’ocre rouge des animaux associés à des motifs végétaux,
interprétés comme les premiers signes de l’écriture hiéroglyphique,
et lus comme la désignation du domaine (le végétal) de
rois (les animaux) qui auraient régné durant une « dynastie
0 », soit entre 3300 et 3100 avant notre ère. Dès cette
époque, un signe rectangulaire typique, appelé serekh,
considéré comme la représentation d’une façade de
palais, apparaît incisé sur la panse des poteries, parfois
surmonté d’un faucon et à l’intérieur duquel prendra
place, sous la Première Dynastie, le nom du Pharaon. Ainsi
l’écriture apparaît-elle en relation avec la gestion des
échanges commerciaux, la volonté de garantir l’intégrité
et la qualité du produit, volonté émanant d’une élite
de plus en plus puissante, qui, très rapidement, saura
reconnaître ce « pouvoir » de l’écrit
et se l’attribuera en se désignant : avant tout énoncé
plus complexe, le mot renvoie au nom royal.
La
palette de Narmer, découverte à Hiérakonpolis et conservée
au musée du Caire, synthétise admirablement cette époque
charnière, quand la préhistoire vient buter aux premières
marches de l’histoire. Réalisée en grauwacke, sur un
support traditionnel, celui de la palette à fard attestée
dès le Badarien, elle porte en relief une iconographie
magnifiquement structurée, dominée par la double tête de
la déesse vache Bat, à visage humain, encadrant le nom du
roi dans son serekh. Au verso, le roi figuré avec la
couronne blanche de Haute-Égypte assomme de sa massue
piriforme un prisonnier agenouillé. Les signes hiéroglyphiques
informent qu’il s’agit d’un homme (symbole probable
d’une population) du Delta. Dans la partie basse, des
ennemis dénudés et morts expriment la défaite. Au recto,
le godet, dessiné par l’entrelas du cou de deux monstres
tenus en laisse, notifie que le rôle premier de l’objet
n’a pas été oublié, qu’il s’agit bien d’une
palette à fard et non d’un simple et innocent support
pour une iconographie de caractère royale. Le roi, porté
sur le registre du haut, coiffe cette fois la couronne rouge
de Basse-Égypte. Il avance, précédé de son scribe et de
ses porte-étendards, vers la « Grande porte d’Horus, le
harponneur », désignation de la ville de Bouto, à
l’extrémité du Delta. Deux rangées d’ennemis allongés,
la tête coupée placée entre les jambes, expriment
l’ampleur de la défaite. C’est dans l’achèvement du
processus d’unification des deux terres que se situe ce
document, principe de dualité consubstanciel à la royauté
égyptienne. L’image s’est fixée en un stéréotype
appelé à traverser trois millénaires : celle du roi
massacreur. Tandis qu’au plan social, l’ascension
vertigineuse de l’élite se traduit par la monumentalité
des tombeaux et l’accumulation du mobilier funéraire,
elle s’exprime ici par une sorte d’exaltation de la
violence, violence totalement dominée par l’institution
monarchique, qui, loin de traduire simplement des événements,
sublime la force et la puissance, exprime une idéologie
dont se générera l’image du Pharaon à travers les siècles
à venir.
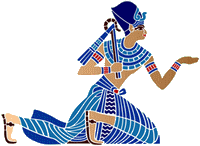
Aux
origines de l'Égypte : Du Néolithique à l'émergence
de l'Etat




Page2
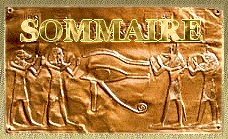
|