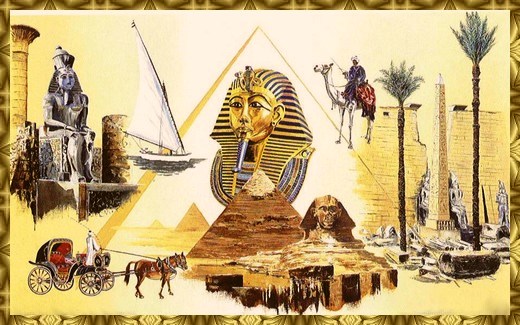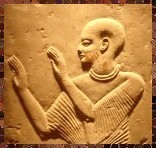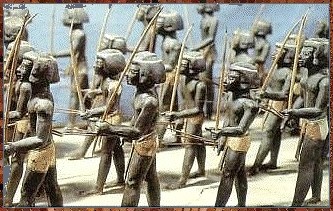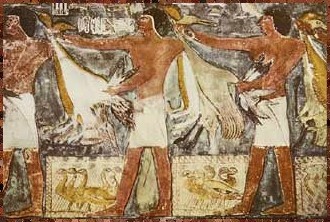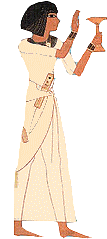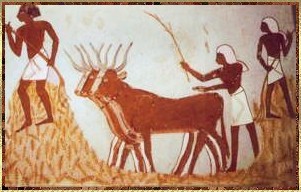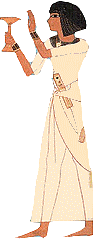|
SOCIETE
EGYPTIENNE
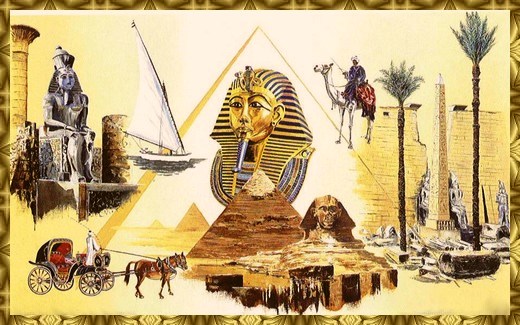
ADMINISTRATION ET VIZIRAT
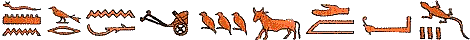
L’administration égyptienne parait très complexe dès son
origine.
Le système administratif de cette dernière est lié au cadre
géographique, tenant compte de la division Haute et Basse
Egypte.
Cette
administration est liée à la notion de nomes (provinces). Le « haut »
responsable de celle-ci est le Vizir. Il est à l’Egypte ancienne, ce
qu’est le ministre aux temps modernes. Il cumule les fonctions de ministre
de la justice, contrôle l’appareil bureaucratique. Son pouvoir s’exerce
sur les jugements, la chancellerie, la police, le fisc, les contributions,
les transports fluviaux.
Il a sous sa
responsabilité des « ministères » ; le Trésor, le double-grenier,
l’agriculture, les archives royales, la justice. Il est aussi chancelier
de la Haute et la Basse Egypte, et le plus souvent juge et intendant des
travaux royaux. Le siège de l’administration est le palais, en relation
directe avec le roi et sa cour. Son rôle premier est d’entretenir
l’approvisionnement en nourriture pour le Palais, et de maintenir le culte
au travers de travaux d’architecture funéraire. L’administration gère
toutes les ressources et richesses du pays. Chaque vizir a des scribes, un
trésorier, un surintendant des troupeaux, des « maires » de villes, des
chefs de villages et toute une cohorte de petits officiels sous ses
ordres. Toutes ces nominations étaient en général le privilège du
vizir.
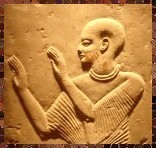
L’administration
est divisée en 42 nomes à partir de la 5ème dynastie. Les « nomarques »,
fonctionnaires royaux assimilés à des gouverneurs, étaient sous l’autorité
du roi. Ces derniers exerçaient des fonctions dans l’administration
religieuse et les services divins pour pharaon. Tous les fonctionnaires
sont entretenus par l’Etat ; ils reçoivent régulièrement de la nourriture,
vêtements, les ustensiles quotidiens, ou mieux, une terre, avec le
personnel agricole. Les plus qualifiés ou plus ambitieux cumulent les
fonctions et leurs bénéfices. A voir les catalogues entiers de charges qui
pèsent sur les épaules de certain, il était peu probable qu’ils puissent y
faire face sans l’aide de suppléants. De façon générale les fonctionnaires
ont leur poste de père en fils. Il y a toute une hiérarchie de postes
:
directeur, directeur-adjoint, sous-directeur, directeur des scribes,
directeur des greniers, directeur des ressources humaines… Tout un
sous-système qui tend à rendre ce type d’administration à être l’un des
plus complexe de l’histoire.

SOCIETE
EGYPTIENNE
Puissance militaire
Une puissance militaire croissante
sous l’Ancien Empire, l’Egypte ne dispose pas d’une armée permanente.
Chaque nome possède une milice autonome et les grands domaines agricoles
ont leur propre police interne. Peu nombreuses, les forces du roi sont
constituées par les gardes du palais, les corps expéditionnaires chargés
de surveiller les routes du désert et la police des chantiers. En cas de
guerre, la royauté rassemble une armée provisoire constituée de miliciens
et d’auxiliaires nubiens et libyens. Dès cette époque, l’Egypte étend sa
domination sur la Nubie riche en or, ivoire et bétail et exploite
les mines de cuivre et de turquoise du Sinaï Au Moyen Empire, les milices
semblent se constituer en de véritables armées de conscrits recrutés par
des scribes. Lors des campagnes militaires, le roi les rassemble sous ses
ordres. La royauté entretient cependant des troupes militaires permanentes
sur les frontières du pays au sein de forteresses défensives. L’Égypte
poursuit son extension vers le sud où le roi Sésostris III annexe la Basse
Nubie. La politique impérialiste de l’Egypte prend une toute autre ampleur
au Nouvel Empire et a pour conséquence la création d’une armée de métier
permanente et bien organisée. L’Égypte se constitue un vaste empire du
pays de Koush (la Haute Nubie), qu’elle dote d’un vice-roi, à l’Euphrate
où les principautés vassales sont assujetties à un lourd
tribut.
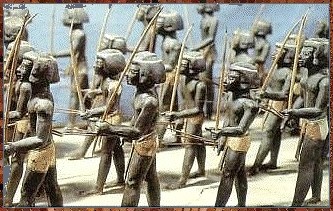
L’apogée de l’armée
Très performante, l’armée du Nouvel
Empire possède une puissante cavalerie de chars qui forme l’élite
militaire, ainsi que de nombreux archers. Le roi est le chef suprême des
forces militaires. Il dirige en personne les troupes lors des grands
affrontements. Il est secondé par un « grand général », chef des armées,
et par des lieutenants, chefs de régions militaires.
Le recrutement des
soldats, leur formation et leur entretien, sont de la responsabilité du
vizir. Ils sont rémunérés en or et en butin, et reçoivent des esclaves et
des terres qu’ils peuvent léguer à leurs fils si ces derniers intègrent
l’armée. Cette politique de rétribution amène la formation d’une véritable
aristocratie militaire qui ne tarde pas à porter plusieurs généraux au
pouvoir (Horemheb, Ramsès Ier). Sous Ramsès II l’armée est composée
de quatre corps placés sous la protection d’un dieu : Amon, Rê, Ptah ou
Seth. Elle intègre de nombreux mercenaires asiatiques, nubiens et
libyens.
Au début du premier millénaire, les troupes mercenaires
prennent de plus en plus d’importance. L’un de leurs chefs libyens accède
au pouvoir et fonde la XXIIe dynastie. À la Basse Époque, le statut de
soldat est devenu héréditaire et les rémunérations se font par des
donations de terres et de nourriture. Les mercenaires sont principalement
des Grecs.
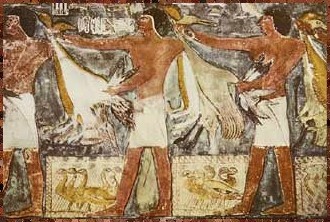
Le pouvoir du clergé
Sous l’Ancien Empire, les
temples, dédiés à des divinités ou au culte funéraire du roi, ne possèdent
pas de clergé permanent. Les offices et les rites sont accomplis par des
fonctionnaires dont la charge est provisoire. Les cultes nécessitent des
offrandes quotidiennes de nourriture qui proviennent de domaines agricoles
rattachés aux temples par donation royale.
À la fin de l’Ancien Empire,
le roi concède des chartes d’immunité qui exemptent d’impôts et de corvées
les domaines agricoles des différents temples. Il se développe ainsi toute
une économie articulée autour des cultes funéraires et divins et qui a
pour conséquence la formation d’un clergé permanent dont l’importance ne
cesse de croître au cours du Moyen Empire. Au Nouvel Empire, les temples
et leurs domaines sont dirigés par un collège de prêtres et par un bureau
de scribes placés sous la direction d’un premier prophète. Le clergé
d’Amon ne tarde pas à surpasser en puissance les autres clergés grâce aux
nombreuses donations des rois de la XVIIIe dynastie qui favorisent leur
dieu tutélaire.

Cette
puissance devient une véritable menace pour la royauté. La crise éclate
sous Akhenaton. Le clergé qui ose s’opposer ouvertement à la réforme
religieuse du roi subit de nombreuses persécutions. Il retrouve toute sa
puissance sous les ramessides où la charge de premier prophète d’Amon
devient héréditaire. À la mort de Ramsès XI, profitant de
l’affaiblissement du pouvoir royal, le clergé amonien prend le pouvoir et
instaure une véritable théocratie sur Thèbes et la Haute Égypte (- 1080 à
- 950). À la Basse Époque, les différents clergés possèdent la majorité
des terres de l’Égypte.
Un peuple d'artisans ouvriers et
d'agriculteurs
Durant l’Ancien Empire, les artisans ouvriers sont des
fonctionnaires du roi. Ils travaillent essentiellement sur les grands
chantiers de construction des temples ou des pyramides ou dans les
ateliers du palais, encadrés par des contremaîtres et des scribes
pointilleux. L’éclatement de l’administration centralisée à la fin de
l’Ancien Empire permet aux artisans de travailler à leur compte ou à celui
des temples ou des notables. Ils sont regroupés en corporations dont les
chefs sont de hauts fonctionnaires de l’administration chargés de défendre
leurs intérêts. Les plus connus sont, au Nouvel Empire, les travailleurs
de la Tombe chargés de la construction des hypogées royaux dans la vallée
des Rois à Thèbes. Ils forment une véritable caste qui pratique le droit
de grève. Tous ces travailleurs de l’ombre donnent à la civilisation
égyptienne ses plus belles oeuvres d’art tant dans la joaillerie que dans
la sculpture ou la peinture. Le statut des paysans de l’Ancien Empire
s’apparente à celui des serfs du Moyen Âge. Ils sont attachés à leur
terre, astreints aux corvées royales et lourdement imposés par
l’administration. Ils sont surveillés par des scribes royaux ou par des
contremaîtres, que l’on voit armés de gourdins dans les scènes agraires
des parois des tombes. Avec la multiplication des chartes d’immunité des
temples et l’émancipation des nomarques provinciaux, les paysans
deviennent plus autonomes et sont affranchis dès la fin de l’Ancien
Empire. Au cours du Moyen Empire et du Nouvel Empire, les paysans
s’apparentent à des métayers. Les domaines royaux, religieux ou privés
sont divisés en plusieurs lots dûment répertoriés dans un registre
cadastral qui précise pour chacun d’eux le taux d’imposition. Chaque lot
est confié à un chef de famille, à charge pour lui de payer l’impôt et de
s’acquitter des corvées obligatoires. Le paysan peut transmettre sa
parcelle à sa femme ou à ses enfants. Ce statut n’évoluera guère par la
suite.
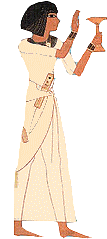
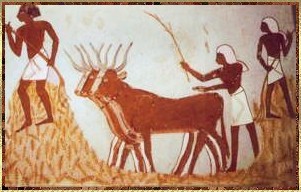 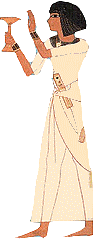
Page
2

|