 |
 |
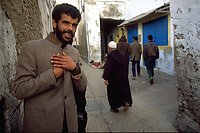 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Vols Maroc
Tanger était à l’origine un village de pêcheurs implanté autour du phare. Dès 1976 , cette cité a commue le chef-lieu de la province. Celle-ci a bénéficié du programme «Al Aouda» et «Al Wahda» du gouvernement du Maroc (Maroc). L’effort de l’Etat en faveur de cette province est orienté également vers la réalisation des villages de pêcheurs. D’autre part, dès 1976, une unité de dessalement d’eau de mer y a été installée et des recherches ont conduit à la découverte d’eaux souterraines dans les environs de la ville. Cette cité possède un atout : la corniche. Ceve stratégique destinée aux investissements touristiques est une zone touristique non affectée couvrant une superficie de 80 ha. Elle est couverte par le plan d’aménagement de la ville de Boujdour. Elle est retenue comme étant une réserve foncière destinée à recevoir les activités touristiques et d’animation , dgement des vols aeriens vers le Maroc sectoriel initié est déjà lancé pour cette corniche. Ainsi la zone pourra accueillir une zone hôtelière, les résidences secondaires, la restauration et l’animation le long de la corniche et une zone immeubles. Boujdour est la province des belles plages par excellence. Des plages féeriques et pittoresques sauvages et vierges qui s’étendent sur des centaines de kilomètres le long du littoral, émergeant parfois entre des chaînes longues de falaises et parfois s’exposant en tapis de sable doré sur 6, 20 ou 30 km pour chaque plage. La plage de Awziwalt est l’un de ses lieux inédits. Elle est située à une vingtaine de kilomètres au sud de Boujdour, desservie par la route nationale n° 1. Le site (Maroc) en question est une immense plage vierg aménagements adéquats. Le site d’Awziwalt offre une immense plage avec une infinie étendue atlantique avec une profondeur considérable. Cet atout pourrait être exploité dans le cadre de la réalisation de projets touristiques de grande envergure. D’autre part, La province de Boujdour combine plusieurs reliefs. En effet, on y trouve le sable, les dunene hauteur qui peut atteindre des dizaines de mètres abritant plusieurs sources d’eau saumâtre ou sulfureuse venant des hauteurs pour couler dans l’océan Atlantique. L’une des plus belles régions de la province de Boujdour est la commune de Gueltat - Zemmour avec ses plaines et son relief accidenté avec des dépressions géologiques, ses oasis et ses sources d’eau douce. Le site se trouve au sein de la province, ce qui lui confère une beauté exceptionnelle différente des sites littoraux de cette région. Parmi les sites historiques de la province, le phare de Boujdour construit par les Portugais au 18e siècle et qui annonce la ville à plusieurs kilomètres avant d’y arriver. La ville de Boujdour se caractérise aussi par la longueur de ses artères principales et ses grandes avenues et bon d’un port de pêche et de plaisance. Le terrain désertique de la province offre d’énormes possibilités de sports de voitures, de motos et de rallyes aériens. Le terrain saharien de la province offre également d’énormes richesses en espèces animales. La faus, chèvres et dromadaires. Le dromadaire constitue un signe de prestige et de richesse. Sa viande est la plus consommée localement et sa graisse sert à soigner certaines maladies respiratoires. Cet animal est un don prestigieux du mari à la mariée. C’est également un moyen de transport utile pour atteindre certains coins inaccessibles. Les dromadaires de Boujdour participent également aux courses de chameaux locales, régionales, nationales et internationales. Pour sa part, le patrimoine végétal dans la province est riche et adapté. Il est constitué de plantes pastorales pour les animaux herbivores et plantes médicinales. D’autres trois secteurs principaux : le travail du cuir des vols en avion vers le Maroc, celui des métaux principalement l’argent et celui du bois. Le deuxième domaine qui illustre le savoir-faire dans la province à l’instar des autres provinces du Sud, la fabrication des bijoux, armes, cadenas et clés. S’ajoute à cela la confection des tentes sahariennes qui sont faites de poils de c tente reflète le statut social du propriétaire, son rang économique et son importance politique au sein du groupe. La province connaît également des moussems et des festivités. Tel le moussem de Lamsid à la commune de Lamsid à mi-chemin entre Laâyoune et Boujdour. Le village balnéaire de Moulay Bouselham se trouve à 70 km au nord de la ville de Kénitra et à 35 km au sud de celle de Larache. Il fait partie du territoire de la province de Kénitra (cercle de Lalla Mimouna). Situé à mi-chemin entre Tanger et Rabat, le village est tourné, d'un côté vers l'Atlantique, et de l'autre vers la Lagune de Merja Zerga et des vols de Royal air Maroc. Moulay Bousselham porte le nom de son Saint enterré entre la côte et la lagune, et sur la tombe duquel, des milliers de marocains viennent se recueillir chaque été, le temps d'un celle-ci et les saints enterrés à sa proximité. Ce qui est conforté par des légendes locales. Hassan Dalil, accompagnateur touristique, raconte que « Moulay Bousselham était venu de l'Egypte avant de se fixer aux abords de la Merja Zerga. Il est mort lors de la bataille de Oued El Makhazine en 1578 (Bataille des trois rois)». n avion avec des vols bon marché et l'on compte aujourd'hui pas moins de sept dispersés dans le village. Outre le mausolée de Moulay Bousselham, le village contient les marabouts de Sidi Abdeljalil Tayar, Sidi Abdeljalil Laglaoui, Sidi Abdellah, Sidi Ahmed Chahed, Lalla Mannana et Sidi Larbi Ayachi. « Chaque saint se spécialise dans le diagnostic d'une maladie ou dans le dénouement d'un problème de société », expliquent les indigènes qui ne sont pas tous originaires du village. La plupart des résidences sont secondaires, qui appartiennent aux Marocains résidant à l'étranger ou aux quelques familles étrangères, souvent non habitées, fermées et bien gardées. Hassan Errabah, résidant au village, dévoile que « de 4000 personnes qui vivent dans le cercle de Lalla Mimouna, plus des deux tiers ne sont pas originaires de Moulay Bousselham . Seulement une vingtaine de vols quotidiens vers le Maroc de maisons appartiennent aux indigènes qui détiennent des petits commerces». a Zerga qui dépend, à la fois, des communes de Moulay Bouselham et de Sidi Mohamed Lahmer. Il s'agit d'un véritable parc naturel où l'on peut notamment observer des colonies de hérons et des flamants roses. Juste après l'agriculture, la pêche représente l'une des principales activités exeonstruction. Ces activités sont souvent combinées à d'autres secondaires comme l'élevage, l'artisanat, le commerce, l'accompagnement des touristes, etc. Seulement, le village et les douars environnants souffrent d'un manque criard d'infrastructures de base, d'espaces socio-éducatifs et d'espaces verts. « L'urbanisation a été faite d'une façon anarchique sans prendre en compte que le site de la Merja Zerga est une réserve biologique et sans prendre en considération l'aspect esthétique et paysager de la zone », nous confie Ali Aghnaj, coordinateur national du programme WWF (le Bureau mondial pour la nature). L'habitat informel est important mais recouvre des situations juridiques très variées. Laveaux quartiers informels répondent assez rapidement des équipements collectifs : eau, électricité, voirie, écoles … «Dans certains quartiers de Moulay Bousselham, l'eau usée émanant des douches et des fosses septiques de certaines habitations stagne sur des rues non bitumées, pourrissant ainjoute l'eau de vaisselle versée ici et là par les femmes. Autant de situations insalubres que les autorités locales essayent en vain de combattre », nous renseigne un fonctionnaire de la Commune qui a voulu garder l'anonymat. Livrée à elle-même, la cité est devenue un véritable dépôt d'ordures constitués en gros de déchets agricoles. Parce que les habitants jettent ces ordures au milieu d'un vaste champ de sacs en plastique, des décharges sauvages ont élu domicile à l'entrée du village et dans les forêts d'Eucalyptus. La population locale de cette zone humide compte plus de 16.000 habitants dont un millier occupent le centre urbain de Moulay Bousselham. Le reste est réparti sur les 17 douars localisés dans le pourtoir de la lagune. Le douar le plus célèbre n'est autre que Douar Dlalha, très connu pour ces fameuses pastèques cultivées localement. Ces douars sont alimentés en eau potable par bornes fontaines de la Commune rurale. Les eaux des canaux de drainage ne sont pas consommables. Aux dires des habitants, elles provoquent des intoxications, voire la mort des animaux qui viennent s'abreuver. Le risque de contamination des nappes phréatiques n'est pas utopique. « Pour déféquer, ils se cachent, au loin, à l'ombre des murs parce que les baraques ne sont souvent dotées que de fosses septiques provisoires. Celles-ci reçoivent les eaux usées découlant de lavabos et de toilettes de ue les bidonvillois se mettent en famille à l'œuvre pour les vider en profondeur et jeter les déchets liquides puisés dans des terrains vagues. Et, pour ne pas indisposer les voisins, l'évacuation se fait à une heure très tardive de la nuit », décrit un jeune homme avec un regard fougueux. En l'absence d'un réseau d'assainissement, les déchets solides et liquides sont directement jetés dans la Merja zerga ou dans l'océan at collectif. « En remplaçant ces fosses septiques par l'égout, on réduit considérablement les risques de pollution des nappes phréatiques mais on risque aussi de polluer davantage les eaux de surface ! », nous éclaire Tahar, un employé du service d'assainissement de la Commune. « Au fait, toau et d'une manière irrégulière sur des grandes étendues de terres agricoles riches », commente un habitant. Dans certaines baraques, des habitants ont transformé une de leurs pièces en petites épiceries sans porte, dotées uniquement de petites fenêtres permettant juste aux vendeurs de remettre ise demandée. Volubilis est une ville antique romaine située sur les bords de Oued Khoumane, rivière de la banlieue de Meknès (Maroc), non loin de la ville sainte de Moulay Idris Zerhoun où repose Idrîs Ier. Le nom de Volubilis du site serait dû à l'abondance de la plante. Le nom berbère de la ville est Walili, Oualili, ou Walila (arabe :[walila]) qui désigne la fleur de liseron. La ville vivait du commerce de l'huile d'olive. On retrouve dans les ruines de nombreux pressoirs à huile. Les vestiges les plus anciens datent du IIIe siècle avant J.C.). En 42 avant J.-C., l'empire romain annexe le royaume de Maurétanie Tingitane (de Tanger), après l'assassinat par l'empereur Caligula du roi maurétanien Ptolémée. Volubilis devint la capitale régionale de l'administration romaine, avec le statut de maire. Cela lui valut la construction d'un certain nombre de monuments publics : t de Caracalla, en 212), date de 277. Vers 285 les fonctionnaires romains quittèrent la région pour se replier sur Tanger. Le retrait des Romains se traduisit aussi par des changement de mode de vie. L'aqueduc n'était plus correctement entretenu et la ville se déplaça : les habitants abandonnèrent les parties hautes pour se rapprocher de la rivière. En 681, Maghreb. Les Abbassides installèrent une garnison à Volubilis. En 789, Idrîs Ier un descendant de Hasan et de `Aî , le gendre du Prophète, s'enfuit pour échapper aux persécutions abbassides. Il s'installa à Volubilis, (re)devenue Walila. Avec la fondation de Fès par Idrîs II (808), Volubilis perd encore de son importance. En 818, Volubilis accueille des Andalous chassés de Cordoue. Ceux-ci s'installent en bordure de la rivière. La ville romaine sert de carrière pour les matériaux de construction. Les guides locaux racontent que le site n'a été complètement abandonné qu'après le séisme de 1755 à Lisbonne. Les vestiges les plus spectaculaires sont les très nombreuses mosaïques ornant le sol des riches demeures. Leur conservation pose toutefois problème : auparavant protégées, elles sont désormais exposée la moitié du site. Quelques maisons permettent de bien percevoir le plan de ces grandes demeures romaines avec leur atrium et impluvium. On a retrouvé deux établissements de bain : l'un d'époque romaine avec son hypocauste, l'autre hammam de le site est classé patrimoine universel par l'UNESCO.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |