Notes et commentaires
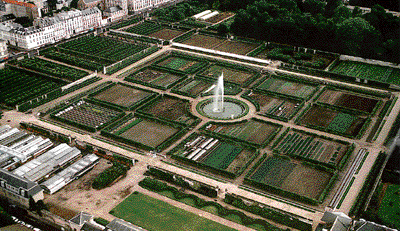
Notes et commentaires
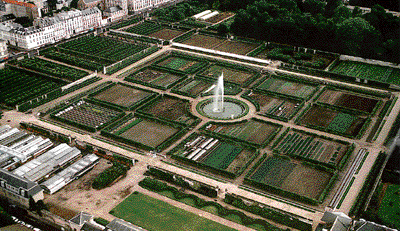
Cette rubrique a pour but de rendre le
cours interactif; si vous êtes un fan de Ricardo, Walras,Hayek
, Marx ou autre, votre avis est bienvenu !
Adam Smith ( notes de D. Chevassus-au- Louis
Adam Smith ( notes d' E. Woerli)
Léon Walras ( notes de Y. Rousseau)
Léon Walras ( commentaires de S. Barillot)
Utilité cardinale versus utilité ordinale :la notion de " pur nombre " a-t-elle un sens pratique en économie ? (S.Barillot)
Deux économistes polonais : M.KALECKI et O. LANGE (Bogumila Straczek)
Les principales critiques adressées à la théorie dominante (Samir ZEMMOUR)
Question d’un étudiant : dans sa dynamique grandiose,
David Ricardo a t-il utilisé la théorie de la productivité
marginale ?
Wicksteed (1914) a répondu sur ce point, rappelle Sraffa (1970). On ne doit pas se laisser abuser par l’emploi du mot « marginal » pour l’utilisation de la dernière dose de terre.
Dans la théorie ricardienne de la rente, la place occupée par chaque dose de terre est déjà déterminée par sa productivité, indépendamment du nombre de doses déjà utilisées.
Dans la théorie marginaliste, la productivité
de chaque facteur est déterminée par la place qu’elle occupe,
en fonction du nombre de dose déjà utilisées. Le facteur
est homogène
Source: Benetti C. (1974), Valeur et répartition, PUG/Maspéro
Commentaire de Damien Chevassus-au-Louis ( Maîtrise 1999/ 2000)
J' ai fini de lire le Livre 1 de La Richesse des nations ce week-end. ..Bien que les premières lignes de son ouvrage soient consacrées à la Division du travail dans les manufactures et à l' opulence qui en découle, Adam Smith n' en reste pas moins agrarien. Il consacre un long chapitre à la rente. Si les fermiers sont décrits comme paresseux dans le chapitre 1 (p 76) car il n' y a pas de division du travail; Adam Smith loue leur travail dans le chapitre 10: " Tout homme qui, par relation d' affaires ou par curiosité, a un peu vécu avec les dernières classes du peuple de la campagne et de la ville, connaît très bien la supériorité des unes sur les autres. " (p 204). La conclusion du Livre 1 est, on ne peut plus claire: la société est divisée en trois classes les propriétaires fonciers, les ouvriers et les capitalistes. " l' intérêt de la première de ces trois grandes classes est étroitement liée l' intérêt général de la société (p334). L' intérêt de la seconde l' est également, mais: " il (l'ouvrier) est incapable, ou de connaître l' intérêt général, ou d'en sentir la liaison avec le sien propre.>> (p335) Par contre, l' intérêt de la troisième ne correspond pas à l' intérêt général de la société. Toute proposition de loi qui viendrait de cette classe doit donc être reçue " avec la plus grande défiance>>. " Cette proposition vient d' une classe de gens dont l' intérêt ne saurait jamais être exactement le même que l' intérêt de la société qui ont, en général, intérêt à tromper le public et même à le surcharger et qui, en conséquence, ont déjà fait l' un et l' autre en beaucoup d' occasions. " (p >336)
Commentaire de Damien Chevassus-au-Louis ( Maîtrise 1999/ 2000)
Jacques Duboin (1878-1976)
Ouvrages disponibles :
"Le Socialisme distributif", Jacques Duboin, présentation et choix de textes par Jean-Paul Lambert, préface d'Alain Caillé, éd. L' Harmattan
Kou l'ahuri ou la misère dans l'abondance ! Jacques Duboin
"La Grande Relève", revue disponible à la Maison de la Presse de St Quentin
Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/grande.releve/
Biographie:
Jacques Duboin est né le 17 septembre 1878 dans une famille de magistrats. Il fut banquier. Elu député de Haute Savoie en 1921, il fut l' auteur d' un discours sur la modernisation de l'armée française, que l'Histoire attribua injustement au général De Gaulle. Lors de la crise de 29, il fut partisan initialement d'une taxation des machines et du progrès technique, de la réduction du temps de travail et de l'union des économies européennes pour revenir au plein emploi. (Nous faisons fausse route 1932) Par la suite il prit conscience de <<la grande relève de l' homme par la machine>> C' est la fin du travail! Il fonde alors une économie dans laquelle les hommes se partagent équitablement l'abondance des ressources. Il crée un mouvement, remplit des salles avant et après la guerre…et <<le silence l'engloutit>> pour cause de Trente Glorieuses. Mais la crise actuelle rend toute son actualité au constat et aux solutions proposées par la réflexion de Jacques Duboin.
Les grands principes de l'économie distributive :
Le constat: la valeur d'une marchandise dépend de sa rareté. Le progrès technique a réussi à la vaincre : les machines permettent de créer toujours plus de biens avec moins de travail. Mais seule la demande solvable est satisfaite; par conséquent la pénurie est entretenue (destruction de marchandises dans les années 30, système de flux tendus de nos jours) pour maintenir les cours.
Alternative: tout citoyen reçoit un revenu qui ne dépend plus de son travail, mais du volume des richesses produites par l'économie. La monnaie n'assure plus qu'une fonction d'intermédiaire dans les échanges. La quantité de monnaie en circulation dépend de la quantité de biens disponibles. Il n' y a donc pas d'inflation. Chaque citoyen doit participer à la production du pays, mais le temps de travail est sensiblement abaissé. Le progrès technique permet aux hommes de satisfaire leurs besoins tout en travaillant moins. Alors que la rareté pousse à l'égoïsme, l'abondance rendra les hommes altruistes.
ADAM SMITH (1723 - 1790) notes d' Elsa WOERLI ,Maîtrise de Sciences Economiques , Université de Versailles .
BIOGRAPHIE
Fils d'un contrôleur des douanes, il hérite d'une charge en douane (alors qu'il est libéral !) Il aura la chance d'aller à l'université de Glasgow et il passera ensuite à Oxford. Il fait de la philosophie et de l'éthique puis il commence à enseigner à Glasgow. Grâce à son enseignement en Ecosse, il fréquente les grands philosophes de la bienveillance (notion de sympathie étendue).
Smith fera un cours sur l'économie et l'éthique et il trouve un lien entre les deux. Il s'intéresse également à la formation du langage . Il publie en 1759 " la Théorie des Sentiments Moraux " qui est l'approfondissement de son cours d'éthique. Ce livre obtient un succès gigantesque. Pourtant dès qu'il obtient ce succès, il démissionne de l'université en 1764. Il devient précepteur du jeune Duc de Buccleuch et il l'accompagne dans le " Grand Tour " pendant 2 ans dans toute l'Europe. Smith rencontre les Physiocrates à Paris et à Versailles ou il a accès aux grands salons parisiens dans lesquels il rencontre Quesnay et Turgot. Ensuite il revient à Londres d'où il rédige " la Richesse des Nations " (publiée en 1776) . De plus il continue à être philosophe car il hérite de la philosophie de D.HUME. Les héritiers de Smith vont brûler tous ses papiers et ses publications car c'est ce qu'il souhaitaitait… on utilise donc les notes de cours de ses étudiants !
- LA THEORIE DES SENTIMENTS MORAUX (idées philosophiques)
2 idées contemporaines :
1. Idée de l'anthropologie de l'économie : c'est une réflexion sur le sujet de l'économie. Qui est le sujet de l'activité économique ? Sujet bienveillant, sujet purement matériel, sujet moral,… Qui sommes nous ? Les agents économiques sont des êtres schizophrènes qui sont partagés entre l'égoïsme et l'altruisme (cf. Kolm).Ma perturbation égoïste est maximum quand je recule ma consommation dans le temps ? diagramme du taux d'intérêt subjectif. La relation entre l'anthropologie et l'économie chez Smith a fait l'objet de longues discussions. Est-ce que la TSM ne va pas inaugurer une fracture entre l'anthropologie et l'économie ? La théorie de Smith est fondée non pas sur l'altruisme (? moderne) mais sur la sympathie et la bienveillance. La sympathie chez Smith c'est de se soucier des autres (mon utilité peut augmenter avec votre utilité = bienveillance / elle peut baisser et c'est alors la malveillance). Mais est ce que je peux donner un fondement rationnel à la bienveillance ? Y a t-il un calcul économique derrière la bienveillance = est ce que je peux mettre de l'utilité derrière cette notion ? Hobbs se posait déjà la même question sur la malveillance. Smith généralise les propositions des philosophes écossais et il est moins optimiste que ses prédécesseurs sur la nature humaine. On parle ainsi de bienveillance limitée.
2. La sympathie est un principe d'intérêt pour ce qui arrive aux autres. Elle est neutre a priori chez Smith. C'est la faculté de partager des passions, des sentiments qui peuvent être positifs ou négatifs : il se peut que ma sympathie étendue soit neutre (ex : je ne suis pas concerné par la mort de milliers de chinois), par contre moi peux avoir de la bienveillance en fonction de la proximité ? je me tracasse de celui qui souffre près de moi. Je peux passer de la bienveillance vis-à-vis de votre douleur et me sentir concerné, mais je peux également passer de la bienveillance au dégoût, et donc à la malveillance. L'idéal pour Smith c'est la sympathie réciproque, mais souvent la sympathie n'est pas équilibrée. La sympathie peut se transformer en envie. Elle concerne plus souvent les douleurs des autres que leurs joies. L'important est de se demander cette sympathie n'est pas contradictoire à nous même (cf. la théorie du self-love). Il est des domaines ou le " self-love " l'emporte sur la bienveillance. En économie, il faudra parfois blâmer le fait de préférer la bienveillance à la malveillance ? il n'y a pas de contradiction : il y a des activités ou l'on est bienveillant et d'autres ou l'on est égoïste. La RDN prolonge la TSM dans le domaine de l'économie. Mais est ce une théorie purement psychologique ? Pour K.ARROW il y a des préférences de second ordre chez Smith : la préférence de second ordre veut dire que je préfère pour vous(" je préfère que vous préfèriez… ") .Pour ARROW le problème que pose Smith est insurmontable et donc il travaille sur des préférences de premier ordre, c'est à dire sur la co-ordinalité.
Chez Smith il y a l'idée de spectre de l'altruisme. Si on fait un calcul altruiste, ce calcul devra intégrer des jugements de valeur et des règles morales. Smith : dans quelle mesure peut-on faire intervenir la morale ? En quoi y a t-il des sentiments moraux dans un calcul utilitaire ?
- LA RICHESSE DES NATIONS (idées économiques)
Pour nous le premier livre est le plus important (il y en a 3 en tout) et surtout le premier chapitre. Le premier concept est celui de la division du travail. Smith part d'un faux problème : la richesse pour lui c'est la somme des choses nécessaires, commodes et agréables à la vie. La richesse c'est la somme des valeurs d'usage. Mais comment augmenter la richesse ? La réponse est dans le premier livre.
Quelles sont les causes de la richesse ? Dans les sociétés primitives, c'est la nature de la population qui est importante ? anthropologie de la malveillance. La division du travail fait que le plus pauvre des pauvres va pouvoir s'en sortir. L'opulence naît de la division du travail.
-La division du travail : c'est le passage de l'activité artisanale à la manufacture puis à la grande industrie. Smith différentie la manufacture hétérogène et la manufacture homogène (ici le travail devient complètement social). Le principe premier chez Smith c'est la socialisation et pour lui l'indicateur de développement c'est la division du travail. La division du travail est fondée sur l'intérêt réciproque ? nous avons tous intérêt à la division du travail. Hélas la division du travail ne peut être étendue comme on le veut car elle est limitée par le marché et les marchés sont eux même limités essentiellement par les moyens de transport. Dès qu'il y a division du travail et marché, il faut de la monnaie et la facilité monétaire peut aussi limiter l'échange et dons la division du travail. Le principe qui nous pousse ici est l'égoïsme : " donnez moi ce dont j'ai besoin et vous aurez de moi ce dont vous avez besoin vous-même " Mais qu'est ce que l'on attend de la division du travail et de l'extension du marché ? *l'accumulation du capital (la division du capital- >accumulation du capital->augmentation de la division du travail & élargissement du marché) C'est la conception de l'accumulation primitive. Le capitalisme dépend avant tout de la division du travail.
*La différence entre travail productif & travail improductif : avec la division du travail, l'écart entre les deux augmente. Le travail productif est celui qui permet la reproduction du fond de capital. L'agriculture joue un rôle important pour la reproduction, mais la manufacture peut aussi accroître le capital. Pour Smith il y a une bonté de la nature qui est particulière. Quand on augmente le nombre de travailleur, on augmente l'écart entre travail productif et travail improductif. Le travail improductif est ce qui ne sert qu'à donner un revenu (salaire, profit, rente) mais ne reconstitue pas le fond.
*La division du travail va poser un problème : elle est animée par l'intérêt personnel et donc il faut trouver un mécanisme régulateur = la main invisible. La main invisible c'est le libre échange chez Smith. Cette notion sera surtout théorisée par Hayek avec un processus inintentionnel de l'ordre social.
Considérons thème " valeur/répartition/prix " On est dans une société de division du travail ? est ce que l'on peut trouver quelque chose de commun, est ce que l'on peut se mettre d'accord sur une valeur, sur un prix ? Nous connaissons des prix de marché = prix paradoxaux qui varient et on ne comprend pas ces variations. Pour Smith on a des mécanismes d'offre et de demande qui sont plus compliqués qu'il n'y paraît. J'ai un prix de marché qui gravite autour d'un prix naturel?je dois essayer de connaître ces lois de gravitation. De même l'or et l'argent sont des monnaies qui gravitent autour d'un prix naturel. Pour Smith, pour connaître la valeur en échange on a le problème de la gravitation. Donc il se pose la question de savoir si on va réellement connaître la valeur en échange. C'est le premier à se poser la question et on ne sait toujours pas y répondre.
VALEUR- >REPARTITION ->PRIX (abstrait) (concret) capital ?courbe d'offre ?prix
La séquence valeur /répartition /prix est truffée d'évidences fausses. On ne peut partir isolément de la répartition pour connaître le prix : c'est une erreur car il existe le principe de récurrence à l'infini. Erreur fondamentale : le capital est hétérogène (pour tous sauf pour Samuelson) c'est à dire qu'il a des composants divers. Or on ne peut connaître la productivité marginale du capital sans connaître la valeur du capital. On va donc chercher des prix courants du capital. Mais comment déterminer cette séquence sans la prendre à l'envers ? -
problème de circularité du développement
La solution que donne Smith est très particulière : ce n'est pas tellement à partir des profits, des salaires, de la rente que l'on trouve le prix. On cherche plutôt la valeur en échange = quantité d'une marchandise que l'on peut acheter. Le fondement de la valeur c'est la quantité de travail que l'on peut acheter, c'est la quantité de travail que l'on peut commander. Pour commander du travail il faut commander la valeur du travail c'est à dire le salaire. La valeur du salaire c'est le minimum physiologique c'est à dire un panier de biens. Pourtant ce minimum physiologique n'est pas constant (Smith : paradoxe de la chemise de lin ? ce n'est pas le plus pauvre des pauvres mais le plus riche des pauvres car il a des bottes de cuir et une chemise de lin) Il faudrait un vrai critère de pauvreté pour calculer le minimum physiologique ? la théorie du travail commandée n'est pas bonne ! En 1960 on trouve la solution : Sraffa trouve une quantité de travail commandée correspondant à des situations extrêmes (taux de profit maximum & taux de salaire minimum). La valeur est en général quelque chose d'abstrait. Le problème c'est que l'on doit passer d'un problème très abstrait à un problème concret = les prix. ? problème de la transformation. Est-ce que je peux passer de la valeur en échange au prix concret qui est d'évaluer notre prix respectif ? Il existe aussi le problème de la troncature. Pourtant il existe une erreur dans cette critique qui s'appuie sur : - la récurrence à l'infinie -la tautologie
On sait depuis 1870 que la tautologie c'est ce qui donne la valeur même au raisonnement. On ne s'en sortira pas si on ne change pas la logique/ on ne peut mesurer le même que par le même (la valeur par la valeur).
-La théorie de l'état et de l'avantage absolu Smith : " Théorie de l'Etat Gendarme " Ce n'est pas une théorie de l'état omniprésent : l'état est là pour protéger la liberté individuelle des citoyens. Pour Smith on doit connaître en économie comment faire fonctionner l'état. L'état doit faire respecter les libertés mais aussi la protéger. Théorie de l'avantage absolu : il est important d'avoir un état capable de défendre la compétitivité de l'économie. C'est donc un libre échange réfléchi et raisonné. Il faut bien savoir comment faire fonctionner l'état : à la base de l'état il y a l'impôt. Smith montre qu'il faut connaître les règles de l'impôt. Bon état ? bonne protection ? avantage absolu ? libre échange
L'impôt dépend de 4 règles fondamentales : 1. Règle de l'équité : l'impôt doit être égal 2. Règle de la certitude : l'impôt doit être certain (voté un an avant) 3. Règle de la commodité : on ne peut payer en nature, il vaut mieux avoir un impôt tel que la T.V.A. 4. Règle de l'économie : l'impôt doit rapporter plus qu'il ne coute. Ce sont des règles très modernes. Mais c'est un auteur proche de la physiocratie = auteur très traditionnel. En fait Smith critique les physiocrates et dénonce leurs erreurs et c'est pour mieux les recopier ! En effet sa conception de la richesse reste fondamentale. Erreurs : - Smith reste prisonnier du naturalisme de son époque : l'agriculture plus que les autres activités permet la reproduction - Pour Smith la rente est première et ensuite on redistribue les salaires et les profits ? l'histoire du développement est une histoire qui voit la rente baisser en faveur des profits et des salaires. Ricardo que ces idées sont complètement fausses : la rente est un revenu résiduel donc avec le développement des sociétés la rente augmente et le profit baisse. - Influence de la liberté des échanges sur la baisse du prix des marchandises. Le libre échange ? la baisse des prix des biens non agricoles ? la hausse des prix agricoles : pour Smith le libre échange favorisera l'agriculture grâce à une hausse relative des prix agricoles par rapport aux prix non agricoles. Il y a un risque d'augmentation du prix du minimum physiologique = accroissement du revenu (contradiction)
WALRAS (1834-1910), notes de Yolande Rousseau, étudiante en Maîtrise de Sciences Economiques, Université de Versailles.
Fondateur du socialisme libéral ,il se prononce pour l'impôt unique dans l'agriculture.
Walras est rejeté en France sur 2 terrains : 1. Economiste : Utilisation des mathématiques et des techniques marginales 2. Auteur socialiste
Né à Evreux, son père Auguste Walras est lui aussi professeur d'économie. Léon Walras deviendra critique d'art avant de postuler sans succès à des postes d'enseignant en économie dans les universités de Paris. Il devra enseigner à Lausanne à partir de 1870.
A la fin du 19ème siècle, il y a un conflit en France entre la pensée libérale (des universités) , un mouvement socialiste (des écoles d'ingénieurs) et le courant solidariste.
Walras sépare son oeuvre en 3 parties :
* Les éléments d'économie pure ou théorie de la richesse sociale (1874) Au départ, il s'appelait "Théorie de l'échange". Cet ouvrage part de l'économie réelle (qu'est-ce-que l'échange réellement ?) puis il se pose la question de l'épargne et de la monnaie.
* Il voudra publier des études d'économie sociale de façon séparée
* Il publiera également des études d'économie politique appliquée : Théorie de la production et de la richesse sociale.
Walras est donc un auteur de la séparation : Economie pure, sociale, appliquée. Mais c'est une erreur de croire que Walras voulait éclater la pensée dans ces 3 éléments. C'était juste une question de présentation.
a. Conception de la société
Walras pense qu'il y a 2 niveaux :
* Division du travail : Niveau de l'homme physiologique
* Personnalité morale de l'homme
Au départ, l'homme est un homme physiologique puis c'est une personne morale. L'homme est différent de l'animal du fait de sa sensibilité, sa volonté etc. L'important c'est la propriété, l'impôt et la perfection sociale. Etre socialiste c'est vouloir la perfection sociale mais ça n'empêche pas d'être libéral !
Dans cette pensée sociale de Walras, il y a l'idée que la personne se réalise dans l'échange. Par le laisser faire, laisser passer, l'homme pourra se réaliser dans l'échange.
Justice commutative : Celle qui préside aux échanges (statue de la déesse de la justice tenant une balance). Egalité des chances au départ.
Justice distributive : Celle qui préside aux concours (statue de la déesse de la justice avec une couronne). La société économique ne doit pas être une économie avec des handicaps. Walras est contre une justice distributive. Pourquoi prendre de l'argent à certains pour en donner à d'autres ?
La société doit être une société de justice commutative. Il faut revoir la position de l'homme par rapport à l'Etat. C'est l'Etat qui peut assurer la justice commutative. La terre, les biens naturels doivent être propriété de l'Etat. Il faut donc établir un moyen (dépenses de l'Etat et remboursement de la dette de l'Etat) pour que la terre et les ressources naturelles soient propriété de l'Etat. Tout le monde devrait être à égalité devant les ressources naturelles.
On peut faire une comparaison entre A.Walras et M.Weber. En effet, Walras parle sans arrêt de type idéal.
b. Théorie de l'échange et de la production dans l'économie politique pure
L'homme n'est pas seulement libre, ce qui fonde sa liberté c'est sa responsabilité. Walras veut poser un type idéal de CPP. Ensuite il posera le problème de l'oligopole et de la concurrence imparfaite. Le problème fondamental en économie est l'étude de la valeur dans les rapports d'échange (liées à la notion de prix relatifs). Walras n'étudie pas la valeur d'usage mais la valeur d'échange : Combinaison de l'utilité et de la rareté. Utilité du dernier besoin satisfait. Si on accepte cette notion, le point de départ de la pensée économique est l'égalisation des utilités marginales pondérées au prix des facteurs. Les rapports d'échange (prix) sont déterminés par la relation: Pa/Pb = Mb/Ma
Il faut désormais passer à l'étude de la production. La société d'échange ne pose pas de problème, c'est la société de production qui pose problème. A cette époque, on en est à la loi des 3 facteurs de JB Say (très mauvaise loi) : Chacun est rémunéré en fonction de ses utilités. Qu'y-a-t-il derrière les services producteurs de JB Say ? Comment exprimer le prix de chaque produit en prix de revient par rapport aux services producteurs ? Il faut arriver à résoudre le système de production (comme pour Ricardo).
On utilise un système de production pour trouver un système cohérent de prix relatifs = Synthèse de la théorie de l'échange et de la théorie de la production. Grâce à cette synthèse, Walras va aboutir à la théorie de l'équilibre général.
Peut-on trouver un équilibre général ?
On cherche des prix et des quantités. Existe-t-il un système de prix qui coordonne les comportements des agents économiques ?
Cadre du raisonnement :
* Principe de dichotomie : On travaille en économie réelle en terme de prix relatifs où une marchandise servira de numéraire (prix du blé = 1 = numéraire). Le principe de dichotomie est fondamental dans la théorie néo-classique.
* Système centralisé : Commissaire priseur (crieur) Les échanges en économie se font comme à la Bourse avec un processus de tâtonnement avec un crieur. Tant qu'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'échange. Avant on n'échange que des bons provisoires. Le système de Walras est un gigantesque système de troc. Tous les biens sont liquides et immédiatement échangeables.
Objectifs du raisonnement de l'équilibre général :
Recherche des quantités échangées et des prix d'équilibre compte tenu que les agents économiques obtiendront le maximum de satisfaction. Les prix sont des signaux (véhiculent l'information).
Méthode de l'équilibre général :
Pour chaque marché on pose 2 égalités :
* Quantité échangée = Quantité demandée *
Quantité échangée = Quantité offerte
Walras raisonne au départ sur 2 marchés : * Marché des biens de consommation * Marché des services producteurs
Pour chacun de ces marché, on a les 2 égalités, on cherche alors les quantités échangées avec des prix donnés. On cherche un système d'échange de 2m+2n équations et inconnues. On va établir une marchandise numéraire. On aura donc un système de 2m+2n-1 inconnues avec 2m+2n équations. Le système peut être déterminé. On peut compliquer le système en intégrant des paramètres : Fonction de préférence associée au marché et des coefficient de fabrication. Les fonctions de préférences et les coefficients de fabrication sont fixes. On peut lui adjoindre un 3ème marché : Le marché des capitaux neufs (on raisonne en terme de revenus nets). L'offre et la demande de capitaux neufs dépendent de l'épargne. Ca rajoute donc 2 équations et 2 inconnues.
2 variables posent problème :
* Il faudrait connaître le montant de l'épargne
* Introduction du taux de revenu net : différence entre le prix du service producteur et le montant des primes exprimées en proportion du prix du capital.
Il veut créer un 3ème marché sans introduire la monnaie. Revenu net = Revenu différentiel
Le problème de Walras est double et il ne peut pas y répondre :
* Existence de l'équilibre général (Debreu) * Stabilité de cet équilibre Ces 2 questions vont créer 2 écoles
Le problème de Walras : Il ne suffit pas d'avoir autant d'équations que d'inconnues et un certain degré de liberté. Sur le plan mathématique, il peut y avoir plusieurs points d'équilibre et on peut avoir des prix négatifs. Or ce n'était pas prévu par Walras. Il ne voit pas que son système peut très bien ne pas avoir de solution unique. Debreu résoudra ce problème de l'existence de l'équilibre général.
Walras fait l'hypothèse que l'équilibre général assure le maximum de satisfaction. Or l'équilibre général n'est pas forcément un optimum. C'est Pareto qui en parlera.
Commentaires de Sébastien Barillot, allocataire, thèse en cours au DEA DESTIN
Je viens de lire quelques lignes des Etudes d'Economie Sociale. Je trouve cette ouvrage d'une grande modernité, notamment lorsqu'il tente de reconcilier l'homoeconomicus et la personne morale agissant en société, avec l'idée que l'individu fonde le rapport social tout en étant concerné par des relations d'interdépendance. L'image du soldat et de l'armée est très éloquante (p.136). De plus, Walras fait clairement appel aux concepts "d'association" et "d'assurance" (p.187) comme l'expression d'un échange volontaire et d'une réciprocité (idée pour une future intro). Walras n'est-il pas, dans une certaine mesure, l'un des fondateurs de l'économie publique moderne, alors que ses contemporains s'acharnaient sur des problèmes de tarification? J'en veux pour preuve l'ensemble de la sixième leçon qui présente de curieuses analogies avec les propos de Rawls (p.134): "Et un problème de justice, consistant à dire quand est-ce ce que les hommes doivent profiter individuellement, et quand est-ce qu'ils doivent profiter en commun ou collectivement, des efforts faits en vue de l'accomplissement de leur destinée, et se résolvant par l'attribution à la jouissance individuelle de la position personnelle et particulière que l'individu s'est donnée, et à la jouissance collective ou commune des conditions sociales générales que l'Etat a faites". La différence vient peut-être du fait que chez Rawls, la position originelle est indépendante de la volonté de l'individu.
Utilité cardinale versus utilité ordinale :
la notion de " pur nombre " a-t-elle un sens pratique en économie ?
Notes de Sébastien BARILLOT, Allocataire de Recherche.
Pauvres étudiants que nous
sommes !Dès nos premiers contacts avec la science économique,
nous nous voyons déjà confrontés à des débats
théoriques qui freinent notre compréhension. La controverse,
certes ancienne mais non résolue, sur la " mesurabilité "
de l’utilité individuelle par l’intermédiaire d’une fonction
mathématique associant un nombre à la satisfaction retirée
de l’acte de consommation, en est un exemple flagrant. Les premiers penseurs
du calcul marginaliste (Menger, Walras, Jevons), et avant eux J. Bentham,
avaient développé une théorie " cardinale " de l’utilité
au sens où cette dernière devait être quantifiable
et pouvoir exprimer une relation linéaire précise entre les
satisfactions retirées de deux paniers de biens différents.
On cherchait alors à attribuer un " pur nombre " à ce qui
reste une interprétation subjective d’un phénomène
psychologique. Il aura fallu attendre le début du 20ème
siècle avec V. Pareto pour réfléchir sur la nécessité
d’une telle démarche. Les conceptions dites " modernes " des choix
du consommateur, dont la théorie des préférences révélée
constitue une variante, simplifie le problème en tentant, sinon
d’expurger la valeur (utilité) du raisonnement, tout au moins d’en
limiter l’importance à une appréciation relative des préférences
de l’agent économique. L’approche ordinale consiste donc en la classification
des paniers de biens deux à deux en fonction de l’intensité
de " bien-être " qu’ils procurent respectivement. Dès lors,
tout le monde semble d’accord pour enterrer la hache de guerre et se retrancher
du côté de l’ordinalité et manipuler des relations
de " préordre ". Néanmoins, un bémol est apportée
à cette apparente unité par les travaux de J. Von Neumann
et O. Morgenstern sur l’introduction de l’incertitude et la notion d’"
utilité espérée ".
Ainsi, afin de mieux s’approprier les termes de cette discussion, nous pouvons citer quelques remarques extraites, pour la plupart, de manuels de microéconomie. On s’aperçoit que, si certains désirent rester prudents, d’autres n’hésitent pas à prendre clairement position.
Alors, laissons la parole aux auteurs !
De la mesure cardinale de l’utilité…
Maddala G.S., Miller E. [1989], Microeconomics : Theory
and Applications, McGraw-Hill, p. 91.
" Economists who believed in cardinal utility can be divided into two groups. Those who believed in cardinal and additive utility and cardinal but not additive utility.
Nineteenth-century economits such as Jevons, Walras, and Marshall (1842-1924) belonged to the first group. They considered utility to be not only measurable but also additive, that is, if an orange gives 5 " utils " of utility and an apple gives 6 " utils " of utility then the utility of both an orange and an apple is 5 + 6 = 11 " utils ".
Economists such as Edgeworth (1845-1926) and Irving fisher (1867-1947) belonged to the second group. They argued that utility is measurable but not additive, that it depends simultaneously on all the amounts of the different goods consumed ".
Malinvaud E. [1982], Leçons de Théorie
Microéconomique, Dunod, p. 38-39.
" Vous pouvez cependant estimer, après réflexion, qu’il existe pour chaque consommateur une satisfaction ou une utilité qui ne soit pas seulement une notion ordinale, mais qui ait un véritable sens cardinal, ou, pour reprendre le langage de M. Allais, qu’il existe une " satisfaction absolue ". en d’autres termes, vous penseriez que, parmi toutes les fonctions S qui conduisent au même système de préférences, il en existe une qui a un sens plus profond et qui mesure, mieux que les autres, la véritable utilité que le consommateur retire des divers complexes de consommation ".
[…]
" C’est au fond suivant que vous croyez ou non à la signification des comparaisons entre gains d’utilité que vous acceptez ou non le concept de satisfaction absolue ".
[…]
" Comme vous le voyez, la distinction entre satisfaction
absolue et satisfaction relative rappelle la distinction faite en physique
entre grandeurs mesurables et grandeurs simplement repérables ".
Blaug M. [1986], La pensée économique, origine et développement, Economica, p. 389-390.
(sur l’hypothèse de séparabilité)
" […] tant que l’utilité d’un bien est entièrement
indépendante de celle des autres biens, il est en principe possible
de construire une échelle cardinale de l’utilité ".
… à une classification
ordinale des préférences.
Maddala G.S., Miller E. [1989], Microeconomics : Theory
and Applications, McGraw-Hill, p. 91-92.
" The Italian economist, Vilfredo Pareto (1848-1923),
laid the foundations for the modern theory of utility. It is assumed that
the consumer need not be able to assign numbers that represent utility,
but can rank commodities in order of preference ".
Deaton A., Muellbaueur J. [1980], Economics and consumer behavior, Cambridge University Press, p. 28-29.
" […], if v(q) is a utility function representing an ordering, and f() is an arbitrary monotonic increasing function, then f[v(Q1)] ³ f[v(Q2)] if and only if v(Q1) ³ v(Q2). The fact that v(Q) and f[v(Q)] are, in their ordering of bundles, identical utility functions is often stated as " the utility function is only defined up to a monotone increasing transformation. This is exactly the same as saying that v(Q) is an ordinal, as opposed to cardinal, utility function. Its only purpose is to order bundles q ; the actual values it takes are not in themselves meaningful in modeling choices ".
[…]
" This does not mean that utility functions defined in
a cardinal way have no part to play in welfare economics, […], but only
that, for the theory of choice, utilitarian considerations are superfluous
".
Picard P. [1992], Eléments de microéconomie,
Montchrestien, p. 31.
" […] ce qui est important dans la fonction d’utilité ce n’est pas de quantifier la satisfaction mais plus simplement de représenter les préférences du consommateur entre les différents vecteurs de consommation, c’est à dire d’ordonner ces vecteurs ".
[…]
" Le point de départ de la théorie ordinale
de l’utilité est une représentation des préférences
du consommateur qui est une simple classification. Ceci conduit à
utiliser la notion mathématique de préordre ".
Allais M. [1994], Traité d’Economie Pure,
Editions Clément Juglar, p. 158-159.
" En réalité, si un homme peut savoir que le troisième verre de vin lui procure moins de satisfaction que le second, il ne peut déterminer de façon précise quelle quantité de vin il doit boire après le second verre pour avoir un accroissement de satisfaction égal à celui que lui a procuré ce second verre de vin. Il en résulte que la possibilité d’une mesure absolue de la satisfaction ne peut être considérée que comme une hypothèse.
Ainsi et alors que l’existence pratique des surfaces d’indifférence
doit être considérée comme une certitude celle d’une
échelle absolue de la satisfaction reste problématique, dans
l’état actuel des choses tout au moins ".
Varian H.R. [1996], Introduction à la microéconomie,
DeBoeck Université, 1997, p. 67.
" Mais même si nous trouvions une façon convaincante
d’attribuer des niveaux d’utilité, à quoi cela servirait-il
dans l’étude des comportements de choix ? Pour déterminer
quel panier est choisi, nous avons uniquement besoin de savoir lequel est
préféré, lequel à l’utilité la plus
élevée. Connaître la grandeur de l’écart n’apporte
rien à l’étude des choix. Puisqu’une conception cardinale
de l’utilité n’est pas nécessaire pour étudier les
comportements de choix et que, de toute façon, il n’existe pas de
critère convaincant pour attribuer des niveaux d’utilité
cardinale, nous nous limiterons à une conception purement ordinale
de l’utilité. "
Gould J.P., Ferguson C.E. [1982], Théorie Microéconomique,
Economica, p. 21.
" Tout ce que l’on attend de la fonction d’utilité
est qu’elle reflète les mêmes classements que ceux que le
consommateur donne à différents ensembles de biens. […] En
bref, tout ce que l’on demande à la fonction d’utilité, c’est
de fournir une mesure ordinale de l’utilité procurée par
les ensembles de biens et non une mesure cardinale ".
Kreps D.M. [1990], A Course in Microeconomic Theory,
Harvester Wheatsheaf, p. 32.
" The point is that the units in a utility scale, or even
the size of relative differences, have no particular meaning. We can’t,
in looking at a change from x to y, say that the consumer is better off
by amount U(y)-U(x) or by anything like this. At this point (it will be
differente when we get to uncertainty […], the utility function is introduced
as an analytical convenience. It has no paticular cardinal significance
".
Un retour sur la mesure cardinale
avec l’hypothèse de choix incertains.
Kreps D.M. [1990], A Course in Microeconomic Theory,
Harvester Wheatsheaf, p. 77.
" Continuing on this general point, recall that we said in the previous chapter that there is no cardinal significance in utility différences. That is, if U(x)-U(x’’) = 2(U(x’)-U(x’’)) > 0, this doesn’t mean anything like x is twice better than x’’ than is x’. it just means that x ñ x’ ñ x’’. But in the context of expected utility, if u(x)-u(x’’) = 2(u(x’)-u(x’’)) ñ 0 where u gives an expected utility representation on P, this has cardinal significance. It means that a lottery that gives aither x or x’’, each with probability ½, is indifferent to x’ for sure ".
Loin d’être achevé, ce débat se retrouve,
plus récemment, dans l’analyse économique des choix collectifs,
lorsqu’il s’agit de construire une fonction de bien-être social.
Il est vrai qu’il n’est pas toujours évident de comprendre l’enjeu
d’une dissociation entre utilité cardinale et utilité ordinale.
Après tout, l’explication de E. Malinvaud ne reste-t-elle pas la
plus sage ? Chacun choisit ses outils et la façon dont il souhaite
s’en servir !
Maîtrise 2001-2002
Il y a deux points que
j'aimerai aborder:
1/ Vous vous étes étonné que nous
ne soyons pas choqué par le principe utilitariste qui veut que la
somme des utilités individuelles proccure l'utilité sociale.
Pour moi, je ne vois rien de choquant. Pendant toute ma scolarité,
il n'y a pas une année (au collége puis au lycée)
où l'on ne m'a pas parlé des droits de l'homme et notamment
d'un des articles qui dit a peu près ceci: la liberté de
chacun s'arrête où commence la liberté de l'autre.
Ramené à l'ensemble d'une nation, on peut dire que la liberté
sociale est garantie par l'ensemble des libertés individuelles.
En fait, pour moi, les grands principes de liberté et d'égalité
sont très proche de l'utilitarisme. Une société peut
être dite égalitaire si les droits et les devoirs d'un individu
égal ceux d'un autre qui égal ceux d'un autre. Avec la fin
des monarchies, on est rentré dans une société individualiste
et c'est pour ça que, personnellement je ne vois rien de choquant
dans: l'utilité sociale est obtenue par l'aggrégation des
utilités individuelles.
2/ L'autre point qui m'ennuie un peu, c'est ce retour
permanent à Ricardo et à la menace de convergence des économies
vers un état stationnaire. Ricardo est un très grand théorisien,
mais je pense que sa théorie est fondamentalement liée à
son époque où il n'y avait pas encore ce qu'on appel aujourd'hui
des biens de consommation. Je ne crois pas qu'on puisse un jour avoir une
économie stationnaire. J'explique mon point de vue:
c'est simplement du à une logique d'entrepreneur.
Cette idée m'est venue quand M Sudrie a dit dans son cours que le
but d'un entrepreneur n'est pas de fabriquer des biens. C'est vrai, son
but, c'est de faire du chiffre. A partir de là, on peut prendre
la théorie de Ricardo et l'appliqué jusqu'au point de tangence
avec l'économie stationnaire. On se situe donc à un moment
où les profits sur un marché sont quasiment nul. C'est là
qu'on se rend compte que la théorie de Ricardo est liée à
son temps car il utilise les biens agricoles. Que va faire un entrepreneur
dans une situation pareille? Il va créer de nouveaux besoins! La
théorie économique a tendance à expliquer les augmentations
des ventes ou profit par le progrès technique, or c'est rarement
le cas! Je prendrai comme exemple le téléphone portable qui
au départ est un réel progrès technique, mais si on
l'avait laissé tel qu'il était à ces début,
il aurait connu le cycle de vie habituel de tous les biens: jeunesse, croissance,
maturité. Or les fabriquants ont réduit ce cycle en modifiant
à chaque fois par petites touches: Au début un téléphone
servait à téléphoner, puis il a servi à envoyer
des messages écrit, puis on a pu télécharger
d'internet des sonneries différentes et bientôt on aura accès
à internet.
Et cela marche, les entrepreneurs peuvent créer
des besoins grace à un éléments qui de mon point de
vue est trop souvent mis de côté car difficile à paramêtrer,
c'est les éléments sociologiques. Nous vivons en société
et nous sommes soumis au regard des autres. Il y a une citation de Rousseau
qui illustre bien mon propos:" Chacun commença à regarder
les autres et à vouloir être regardé soi-même;
et l'estime publique eut un pris." (discours sur l'inégalité
des hommes). C'est pour ça qu'on n'aura jamais d'économie
stationnaire. Fondamentalement, un homme n'a besoin pour vivre que de peu
de chose: des vêtements, de la nourriture et un toît. Seulement,
si on regard dans n'importe quelle maison, on y verra bien plus. Pourquoi,
parce qu'il y a une compétition entre les hommes, il faut avoir
plus ou mieux que son voisin. C'est ce qui fait que l'on a parfois des
biens dans nos maisons qui n'ont pas d'utilité en eux-même
mais qui serviront à se différencier.
Je ne sais pas si j'ai été très clair sur Ricardo, mais pour moi, c'est évident, certains marchés convergent effectivement vers une sorte d'état stationnaire, mais ils sont abandonnés au profit d'autres. Je pense qu'on a constament un renouvellement des besoins