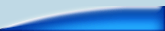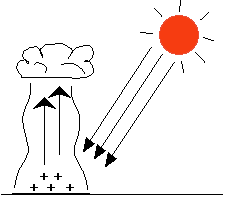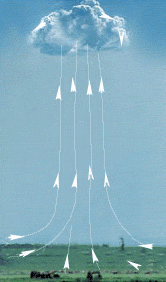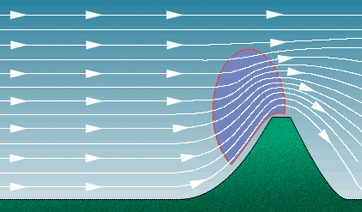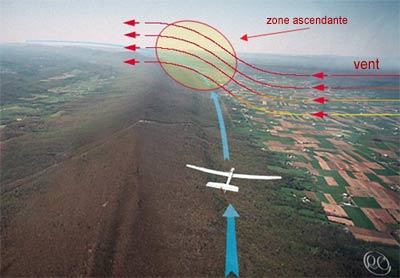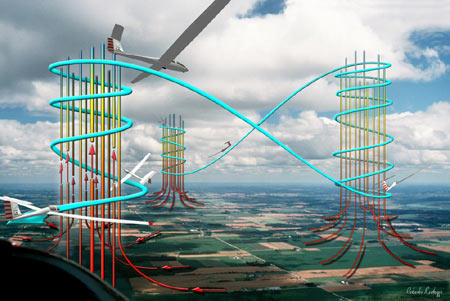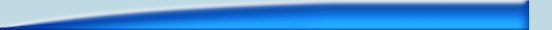IV) Ascendances naturelles :
Pour
répondre à ce problème,
nous analyserons donc les diverses possibilités qu’offre
l’énergie
atmosphérique à un planeur pour lui permettre de prendre
de l’altitude, malgré
son taux de chute.
1) Ascendances
thermiques :
Le sol ne
réagit pas de la même manière face au rayonnement
infrarouge du soleil, suivant
sa nature. En effet lorsqu’il s’agit d’une zone
sombre, par exemple une forêt,
alors le sol absorbe ces rayons. A l’inverse quand la zone est
dite clair,
comme une prairie ou un champ, le sol réfléchit les
rayons. C’est pourquoi
l’air situé au-dessus de ces zones devient plus chaud, ce
qui a pour
conséquence la formation d’une bulle d’air chaud. Or
nous savons que l’élévation
de la température de l’air diminue sa masse volumique,
donc il se forme une
instabilité entre cet air chaud et l’air ambiant, plus
froid.
Dès lors,
à
défaut de pouvoir colorer l’air, il est possible
d’apparenter l'air à de l'eau,
tous deux étant des fluide. C’est ce que nous avons fait
pour prouver
l'élévation dans l'atmosphère de la bulle d'air
formée. En expérience, nous
avons plongé une cartouche percée d’encre chaude
dans de l’eau froide :
l’encre monte. (Vidéo) Puis nous avons
placé une cartouche d’encre froide dans de l’au
chaude : l’encre descend. (Vidéo) En conclusion,
l’ai chaud monte par rapport à l’air froid.
Mais la
colonne d’air chaud n’existe que si plusieurs de ces bulles
d’airs sont
formées. En effet, dans le cas inverse, l’air froid du
terrain voisin prendrait
alors la place de l’air chaud qui est monté et
l’ascendance n’existerait plus,
du moins tant que le niveau d’ensoleillement reste faible.
Si cette bulle
est chargée en humidité, du fait de son
élévation, elle sera mise en contact
avec l’air plus froid, ce qui entraînera la condensation de cette
humidité. Ce
changement d’état crée, au-dessus de
l’ascendance thermique un cumulus, ce qui
permet au pilote du planeur de la repérer plus facilement.
Ascendances
thermiques et
leurs cumulus.
Pour que cette
colonne d’air chaud soit réellement exploitable par le
planeur, elle ne doit
pas être brisée par des vents horizontaux
irréguliers, voire violents. En effet
dans ces conditions, l’ascendance thermique serait alors
«hachée». Au contraire
un vent régulier inclinera la montée d’air chaud
par rapport à la verticale et
le vélivole pourra ainsi l’utiliser facilement.
Ce gain
d’altitude varie entre 1000 et 3000m au-dessus du sol. Mais il
n’est réalisable
que si le planeur est maintenu dans la colonne, Pour cela son pilote
lui fait
prendre une trajectoire en forme d’hélice sous le cumulus
formé. Ainsi, en
allant d’ascendances thermiques en ascendances
thermiques, on peut parcourir
de longues distances et rester en sustentation
plus longtemps. Mais il se peut aussi que, grâce au relief, des
colonnes
apparaissent successivement formant une suite de cumulus. Ce
phénomène est
appelé «rue des nuages» et il suffit au planeur
d’emprunter cette «rue» pour
prendre de l’altitude en moins de temps.
2) Ascendances
orographiques :
Les
ascendances orographiques regroupent deux types de vol :
- le vol de pente :
En région
montagneuse, si la vitesse d’un vent est suffisamment importante
(supérieure à
27km/h) et que sa direction soit contre un relief, alors ce dernier
interagira
avec celui-ci. En effet la trajectoire du vent va se distordre en
passant
au-dessus du sommet du relief, et former ainsi une composante
verticale :
c’est l’ascendance
dynamique. Mais si le
relief n’est pas assez imposant, le vent le contournera et aucun
vol de pente
ne sera possible.
De plus,
lorsqu’un
versant d’une montagne (falaise, …) est exposé au
soleil, il apparaît alors une ascendance thermodynamique,
combinant les deux ascendances
précédemment décrites. En général ce
genre de phénomène est violent et très
turbulent.
Une
ascendance dynamique.
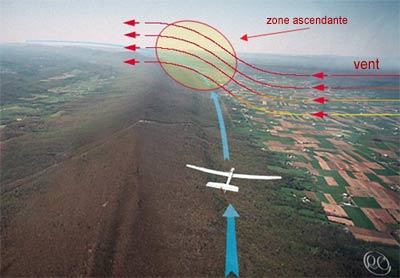
- le vol d’onde :
Toujours en
région montagneuse, nous pouvons également trouver une
autre forme d’ascendance,
dite d’onde. Elle se forme quand une masse d’air
butte sur plusieurs
obstacles terrestres (chaînes de montagnes, …). En effet
l’air légèrement
comprimée à sa redescente du premier relief, rencontre la
base d'un second
relief. L'impulsion ascendante arrive alors juste au même endroit
que la
détente de l'air : on dit que le vent est en phase avec le
relief. L'ascendance
qui en résulte devient alors beaucoup plus importante que ne le
permettrait le
simple effet dynamique du relief et l’effet prend de plus en plus
d’ampleur par
la suite. Cela ne se produit que lorsque la masse d’air est
très instable,
c'est-à-dire lorsque la différence de température
pour une élévation de 1 000 m
est supérieure à 8° C. Alors les différentes
couches ne se mélangent pas et se
repoussent donc les unes les autres (car l'air est mauvais conducteur
de la
chaleur).
|
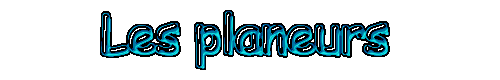
 Accueil
Accueil
 Synthèses
personnelles
Synthèses
personnelles  Multimédia
Multimédia
 Glossaire
Glossaire
 Bibliographie
Bibliographie